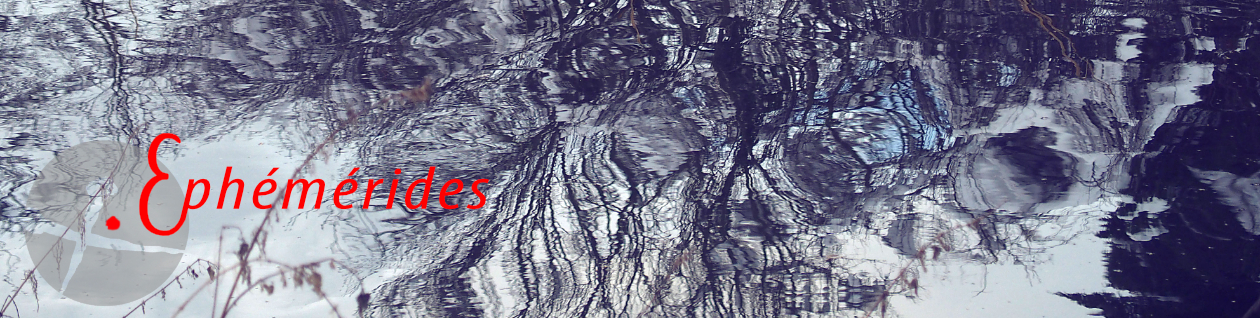un regard et des choix – forcément subjectifs – sur l’offre culturelle 2022
#LIVRES : George Orwell & La vie ordinaire (S. Leménorel)
#CINÉMA : Chanson d’amour (H. Rœsch), Have You Seen This Woman? (D. Zoric & M. Gluscevic), On a eu la journée, bonsoir (N. Mari), J’ai aimé vivre là (R. Sauder), En nous (R. Sauder)
#EXPOSITIONS : Kunstmuseum Basel : La modernité déchirée & Curt Glaser / Fun Feminism / Picasso–El Greco / Louise Bourgeois x Jenny Holzer,
MAMCS & MTU (Strasbourg) : SurréAlice / Marcelle Cahn,
Françoise Saur : La mémoire des murs (Agora, Cernay) / Ce qu’il en reste (MBA, Mulhouse),
Simone Adou (Saint-Louis), Art Brut (Musée Würth Erstein), Fondation Beyeler | 25 ans (Riehen), Alain Clément (galerie RADIAL Strasbourg), Françoise Ferreux (Malraux, Colmar), Nos Îles (Fondation Schneider, Watwiller), Maurice Mata (Mulhouse), Sauveur Pascual (Mulhouse), Anri Sala, Rudolf Stingel (Bourse de Commerce – Pinault Collection, Paris), Smith-Désidération (La Filature, Mulhouse), Fabienne Verdier (Musée Unterlinden, Colmar), Raymond E. Waydelich (Ferrette)
#SPECTACLES VIVANTS : Hôtel Proust (Descanvelle/Moritz), La Mouette (Tchekhov/Teste), Hamlet & Hamlet-Machine (Shakespeare+H. Müller/Delétang), La dernière nuit du monde (Gaudé/Murgia), L’homme qui tua Mouammar Kadhafi (Poulin, Superamas), Bernard Foccroulle (clavecin au musée Unterlinden)
εphεmεrides 2024 • 2023 • 2021 • 2020 • 2019 • 2018
le Luxe en extatique célébration
La Bourse de Commerce – Pinault Collection
Anri Sala, Rudolf Stingel…
#EXPOSITION
Paris, Bourse de Commerce – Pinault Collection
_Une seconde d’Éternité [Rudolf Stingel, Philippe Parreno…] du 22 juin 2022 au 9 janvier 2023
_Anri Sala du 14 octobre 2022 au 16 janvier 2023

La Bourse de Commerce ? Un volume intérieur gigantesque : le cylindre pensé par Tadao Ando. Mais surtout un espace magnifié par la coupole de François-Joseph Bélanger qui couvre en 1811 la cour intérieure du bâtiment annulaire édifié en 1767 : une charpente métallique [1] vitrée en 1838. Car, tel un monumental cadran solaire, la course des rayons à travers la verrière met en vibration le lieu et en scène un tour du monde : la fresque exaltant le commerce entre les cinq continents – vision très colonialiste – caractéristique de l’académisme IIIe République, le capitalisme en majesté [2] qui s’exhibe pour l’exposition universelle de 1889.
Sous ce péplum, le cylindre en béton de l’architecte japonais offre l’écrin immense et épuré de la Rotonde aux œuvres de la Collection Pinault. Au choix des scénographes : une noria de sculptures (tel à Orsay), des cimaises la fractionnant en labyrinthe, des installations qui s’éploieraient du sol au plafond (ou l’inverse)… ou cet écran géant incurvé qui happe le visiteur de novembre 2022.
Anri Sala investit la Rotonde
Avec Time No Longer (13 min, 2021), Anri Sala le phagocyte par un effet blast : le gigantisme amplifiant l’impact du plan séquence tournoyant en apesanteur avec force gros plans sur le bras d’une platine lisant et diffusant un vinyle du Quatuor pour la fin du Temps de Messiaen [3]. Le dispositif enveloppe dans sa modernité revendiquée le chaland qui s’y plie instinctivement, faisant des selfies (nouvel atavisme techno), photographiant compulsivement espace, lumière et œuvres. Ainsi il devient acteur de l’installation immersive de Sala qui s’accomplit grâce à ces fantômes captifs, mais tendances et valorisés en hôtes VIP des lieux autant par l’ostentation du projet muséal que par l’aimable prévenance du personnel.
En déambulation dans cette vertigineuse publicité en abyme, le public s’identifiera facilement avec la femme (Maribel Verdú) de 1395 Days without Red (Anri Sala, 2011, vidéo de 44 min projetée à l’Auditorium du sous-sol – 2) qui marche, court, guette, se hâte dans les ruines de Sarajévo (un des 1 395 jours où ses rues étaient la cible des snippers). Une beauté en apesanteur sur le gris des décombres où le corps customisé par le luxe serait le dernier refuge, le seul endroit sûr dans un monde déréglé et périlleux. D’autant plus que la proximité (déjà) de la guerre en ex-Yougoslavie renvoie au conflit de 2022 en Ukraine tout aussi proche.
Rudolf Stingel, Untitled, 2001
L’installation de Rudolf Stingel offre un contraste encore plus saisissant avec cette sophistication glamour et impose sa présence spectrale au 2e étage (Galerie 7).
La salle est tapissée du sol au plafond d’une mousse isolante couverte d’un pare-vapeur en aluminium (Celotex TUFF-R). Toute la surface est griffée, découpée, taguée, creusée, amendée, placardés… Tickets de métro, photos d’identité, mots collés, messages incrustés, dessins, tags, etc. Les hiéroglyphes de tout ce qui peut faire mémoire dans les espaces interstitiels : métro, couloirs, caves ou parkings, ponts, toilettes… Des endroits où les corps sont en suspension, en attente d’un métro, d’un rendez-vous, d’un amour peut-être… avec l’envie face à ce temps soudain trop pesant de laisser une trace, d’inscrire dans la ville un petit bout de soi – tendre ou violent – et conjurer ainsi la béance de l’anonymat. Des hurlements de révolte graphique et populaire contre la disparition.
Stingel les a collectés ou inventés, multipliés, minutieusement reproduits, grattés, installés… et, dans la logique de sa démarche, il incite le public qui devient ainsi l’exécutant de l’artiste, à intervenir sur la surface. La quantité des motifs comme l’étendue de la proposition sont impressionnantes et renvoient à l’usure de milliers de vies qui s’exposent là timidement par fragments minuscules. Les traces, les griffures sont plus éparses vers le haut des parois moins accessibles, plus denses vers le bas.
Entre ces signes touchants ou pathétiques accumulés sur fond de misère humaine, le regardeur distingue son reflet brouillé et peut s’interroger : ces cicatrices ne s’insurgent-elles pas à leur manière contre la toxicité du monde ? Ne sont-elles pas l’indice d’une suffocation dissoute dans le temps qui se purge soudain dans une saignée, un collage ? Un geste exorcisant la fin du temps comme le Quatuor de Messiaen ?
Occasionnellement les ballons en forme de poissons volants (ou l’inverse…) de Philippe Parreno (My Room is a Fish Bowl, 2014) égarent leur clinquant imago dans la salle de Stingel. Consciencieusement les gardiens viennent les rattraper pour les ramener au bercail.
Untitled, 2001, est une des pièces du parcours « Une seconde d’Éternité ». Le livret de visite précise d’après une idée de Charles Baudelaire, car à la Bourse, tout n’est qu’ordre et beauté, Luxe, calme et volupté (L’invitation au voyage), le luxe étant le vecteur indispensable pour accéder au reste…
La Bourse a certes le mérite de présenter des pièces ouvrant (consciemment ou non) ces abyssales perspectives, il n’en demeure pas moins qu’un tel environnement intègre l’amateur, le temps d’une visite, dans une séduisante cérémonie émotionnelle qui oriente le regard vers un univers de postures esthétiques – réflexives parfois pour être gratifiantes.
Un moment hors du temps, hors du monde.
Si Dostoïevski affirme que l’art sauvera le monde, la Bourse précise que le luxe sauvera sa vision de l’art. Quant au Monde…
Une seconde d’Éternité
commissariat : Emma Lavigne, directrice générale de Pinault Collection
avec Caroline Bourgeois, conservatrice auprès de la collection,
et Matthieu Humery, conservateur auprès de la collection, chargé de la photographie
Pour aller plus loin, notamment sur l’influence des groupes de luxe sur le marché de l’art, il est stimulant de lire : Annie Le Brun, Ce qui n’a pas de prix (Éditions Stock, 2018).
[1] élaborée avec l’ingénieur François Brunet, elle remplace celle en bois rajoutée dès 1783 et dévorée par l’incendie de 1802. Pour être complet, l’architecte Henri Blondel a procédé à d’importants remaniements de 1885 à 1889 quand l’ancienne halle aux blés conçue par Nicolas Le Camus de Mézières a été transformée en bourse de commerce.
[2] Philippe Dagen, Une fresque du commerce international très IIIe République, Le Monde, 22/05/2021
[3] précisément une transcription pour clarinette et saxophone du 3e mouvement l’Abîme des oiseaux. L’œuvre, écrite en détention à Görlitz en 1940, est inspirée par l’Apocalypse de Saint Jean.
la chair du monde
Alain Clément
#EXPOSITION
Strasbourg, galerie RADIAL art contemporain du 19/11 au 31/12/2022
#ESTAMPES
Colmar, Éditions Bucciali du 16 au 18 novembre 2022
L’artiste Alain Clément a séjourné en Alsace pour une exposition à la galerie strasbourgeoise RADIAL art contemporain et pour réaliser de nouvelles gravures dans l’atelier des Éditions Bucciali à Colmar.
Portrait avec ses mots…
je suis né dans la guerre
Je dirai même : je suis né avant les camps. Je suis né avant Drancy. Je suis né en 41 – Drancy, c’est 42. Donc je porte en moi cette plaie, je dirai presque cette responsabilité, même si physiquement je n’y étais pas. Je fais partie de cette société qui a permis ça. J’en suis la prolongation. Donc ça a toujours été quelque chose de dur à analyser, à prendre en charge. J’ai très vite compris que la peinture ne pouvait pas le faire… Aujourd’hui peut-on faire une peinture sereine avec l’Ukraine ?
la Nouvelle Vague, Godard
J’étais fasciné. Fasciné, parce que j’ai senti chez ces gens qu’il y avait une communauté d’esprit avec ce que je tentais de faire. J’étais très loin d’avoir leur maîtrise.
Faire de l’art, c’était une histoire sérieuse parce que ça t’engageait à avoir une attitude critique, mais au bon sens du mot, pas s’opposer.
Faire de l’art, ce n’était pas se laisser aller, c’était prendre conscience, regarder en face ce qui est insupportable et s’y attaquer, prendre en charge notre histoire et tenter d’y participer. Pas fabriquer des fictions, mais les déconstruire !
inspiration
Je dirais plus respiration qu’inspiration. Si je fais ce que je fais, c’est que j’ai besoin de respirer, de prendre un peu d’envie sur les contingences matérielles, politiques, économiques, journalières. Je ne fais pas ça parce que ça m’est tombé du ciel.
Jeune Parisien, j’ai beaucoup fréquenté les musées et ces images énigmatiques entourées de cadres dorés dans lesquelles je plongeais. Je dois avouer que je regardais plus les tableaux de femmes nues que les tableaux de paysages parce que la chair des êtres qui m’était interdite par le puritanisme dans lequel j’étais élevé, la peinture me les offrait. J’ai compris que c’étaient des corps qui étaient œuvrés. Ce n’étaient pas des corps bruts livrés, mais des corps œuvrés par une spiritualité : les Vierges Marie, la vie des martyrs ou bien ces femmes du monde, ces femmes de pouvoir, ces femmes réincarnées par la magie de la peinture qui les désire…
l’arrivée massive des Américains
Mes grandes fascinations, très vite, c’étaient des gens comme Sam Francis, Joan Mitchell, Shirley Jaffes… Tous ces peintres qui arrivaient, qui avaient une vingtaine d’années de plus que moi. J’ai eu la chance de les fréquenter dans la galerie par excellence qui faisait le pont entre l’art vieillissant de l’École de Paris et les Américains, cette génération pétante de santé et d’ambition. Et ma peinture n’en est jamais revenue, toujours éblouie par les couleurs.
Cette galerie, c’était Jean Fournier à Paris où je suis entré en 1982.
poésie et éditions
Dans les années 65-66, je faisais avec des amis une revue de poésie que j’illustrais et je me suis intéressé à la littérature, à l’édition. J’ai co-fondé les éditions Fata Morgana à Montpellier qui publie depuis cinquante ans des livres qui comptent. Nous construisions des ouvrages avec des poètes que j’admirais (Henri Michaux, Victor Ségalen…) et on les faisait illustrer par Masson, Max Ernst, Matta… Par l’édition et ces travaux, j’ai aussi connu des peintres et des auteurs de ma génération et j’ai continué l’aventure.
Aujourd’hui je participe sans cesse à des livres où se mêlent les mots, les formes et les couleurs pour la joie d’œuvrer ensemble. C’est cela les livres : la fraternité.
gravure
En 1963, j’ai connu Stanley William Hayter, un graveur anglais qui avait des techniques complètement novatrices et recevait dans son atelier – l’Atelier 17, rue Daguerre – toute l’avant-garde débarquant à Paris. Picasso y a gravé, Miró, Pollock… et ma génération aussi.
Ce que permet la gravure, c’est l’analyse. Quand vous peignez, le corps entier s’y projette, on ne structure pas les états différents de ce que l’on fait. Ça vient d’un bloc dans une émotivité. Il y a des urgences, des envies de couleurs, des modifications des formes… Le tableau n’est jamais fini. La gravure vous interdit ça. Il faut la penser étape après étape, il faut la construire, tenir une idée avec la nécessité de la découper en différentes plaques de cuivre gravées, une pour chaque couleur. J’aime faire de la gravure pour la méthode que cela induit et qui m’oblige à raisonner et ne pas être simplement le pulsif expressif qui manie la couleur du bout du pinceau.
Dans l’atelier des Bucciali, je grave en interaction constante avec le père, sa fille et l’excellent Mitsuo dans une fraternité qui nous permet toutes les inventions. En trois jours, nous avons réalisé dix gravures et autant de grands monotypes. J’aime ces moments d’intense activité créative.
donc en 68
Il y a rupture et tout vole en éclats. En 68, l’urgence était dans la rue, pas dans les ateliers. Ça a été une grande envolée où la peinture prenait de l’air et volait en éclats. Et là… j’ai pu me libérer et peindre au grand jour ce qui était mon jardin secret : la féminité de la peinture où mon corps est complètement en osmose avec elle, avec la chair du monde. Je ne la figure pas, je ne l’interprète pas. Je fais de la peinture dite abstraite, mais ce n’est pas vrai. Je fais de la peinture pour la saveur du monde. La saveur, ce n’est pas abstrait. Je fais de la peinture gustative, pour donner de l’appétit. Je fais de la peinture comme je vais à l’école buissonnière : cueillir les couleurs et les offrir dans mes tableaux.
portraits de ma génération
Je suis né à la peinture à un moment où aucune structure – ni galerie, ni musée – ne pouvait accueillir les premiers travaux que je faisais. Aucune. Il n’y avait aucun musée qui avait une collection d’art contemporain. Sauf Pierre Gaudibert au Musée d’Art moderne de Paris qui avait eu cette intuition en 1967 d’ouvrir ses portes à la création contemporaine. Donc ma génération s’est démerdée toute seule.
Avec mes complices de l’époque (Alkema, Azémard et Bioulès), on avait organisé à Montpellier en 1970 « 100 artistes dans la ville » qui est devenu le portrait de ma génération. Ça allait de Kiefer à Boltanski en passant par toutes les stars abordables.
l’Allemagne
Elle s’ouvre à moi par l’amour d’une femme de Brême, Elisabeth, qui m’amène sur son territoire. Ça me plaît qu’elle me fasse découvrir la magie allemande avec cette volonté de reconstruire sans rien oublier.
J’ai fraternisé avec des peintres qui essayaient par leur peinture de conjurer le passé comme Kiefer et plus tard Polke. J’ai collaboré avec de nombreuses galeries à Brême (Katrin Rabus), Cologne (Wentzel, Orangerie Reinz et Boisserée) et plus tard à Francfort (die Galerie), Nüremberg (Bode)… Et puis en Allemagne, il existe de vrais collectionneurs. Beaucoup sont devenus des amis et me suivent pour une sorte d’hédonisme français et la joie de la couleur face au tragique allemand.
l’ennemi, quel est-il ?
On vit une époque de la confusion des spécificités. Tout se mélange. Je persiste à croire que c’est une perte de l’intelligence. Bien sûr les sciences humaines nous ont appris quelque chose qui s’appelle la transversalité…
Je ne me réclame pas de l’art quand je fais quelque chose : je fais et je montre. Ce ne sont pas des produits pour gagner de l’argent. Je fais contre ce que les sociétés inventent pour nous empêcher d’être et nous pousser à suivre le troupeau. L’Art pour moi c’est ça, malgré les censeurs, contre la connerie qui me paraît le plus grave des ennemis. Mais le principal ennemi, c’est soi-même, qui vous empêche d’aller jusqu’au bout. Ne regardez pas dans le miroir que vous tendent les autres, Car je est un autre [4]…
l’économique, le pléthorique
Maintenant il y a une telle incertitude dans la définition des choses. Qu’est-ce que le bon, qu’est-ce que le mauvais ? Qu’est-ce que le beau, qu’est-ce que le laid ? Tout cela rejoint la suprématie économique : il faut que ça rapporte du fric et de la gloire narcissique. En l’occurrence l’économique rejoint, est peut-être même nécessairement attelée au populisme. Avec un truc qui est spécifique à la France – et nous n’en tirons que peu de reconnaissance à l’étranger –, c’est qu’on est avec l’ex-Union Soviétique le seul pays au monde qui ait un art officiel contrôlé par le ministère de la culture.
Il faut dire aussi que le nombre d’artistes est effrayant ! Tout le monde fait de l’art et espère ses cinq minutes de célébrité [5] dans la cacophonie assourdissante des médias.
Donc des artistes pléthoriques, des galeries pléthoriques, des institutions pléthoriques. Tout ça fait que tout s’affaisse, se ressemble, est vulgaire et atteint un niveau presque létal maintenant. « L’art, c’est bien fini [6] ».
Mais cela me donne le courage de continuer de plus belle !
[4] « Car je est un autre », affirmation d’Arthur Rimbaud dans une lettre à Paul Demeny datée du 15 mai 1871
[5] selon la formule de Warhol
[6] titre d’un livre d’Yves Michaud paru en septembre 2021, paraphrasant Marcel Duchamp : Marcel, c’est fini, la peinture.
marcher sur l’eau
Chanson d’amour d’Hervé Rœsch
#CINÉMA
documentaire sorti en décembre 2022
diffusion France 3 Grand Est le 15/12/2022, puis en replay (version 52 min),
diffusion en salle sous le titre Fanclub (version 67 min)
Raymonde et Jean-Martin sont de jeunes retraités, rien ne les distingue d’autres couples qu’on pourrait croiser dans la rue, au supermarché ou à une fête de Noël destinée aux anciens.
Sauf que dans cette nouvelle vie, ils se lâchent pour une passion ancienne : la Volksmusik, très précisément le duo tyrolien Mario & Christoph.
Sauf que leur fils est à la fois réalisateur et témoin déconcerté de cet engouement.
En filmant ses parents avec beaucoup de tendresse, Hervé Rœsch a la modestie de montrer ce goût des choses simples porté par des gens simples. Si par ailleurs, la littérature a pu l’anoblir de sens (la madeleine de Proust ou, plus récemment, La Première Gorgée de bière de Philippe Delerm), le réalisateur choisit un autre registre : faire sentir comment cette candeur peut mener à la catharsis. Et celle-ci monte, enfle avec les bons sentiments, les rythmes électrisants et le partage – la catharsis est une expérience collective. Grâce à cette sexagénaire qui rougit et vibre en présence des deux musiciens, son conjoint habituellement réservé qui se déhanche sans réserve lors des galas ou l’enthousiasme débridé des membres du fan-club, le spectateur ressent sa montée en puissance et attend le moment où ils vont marcher sur l’eau !
La réalité est plus cruelle : la pandémie met un coup d’arrêt aux concerts, aux déplacements, aux rencontres. La magie a ses limites…
Au-delà de l’ingénuité des Chansons d’Amour, de la proximité attentive et réciproque des Rœsch avec Mario et Christoph (les deux musiciens viennent volontiers à Mussig participer aux fêtes familiales : retraite de Raymonde, anniversaires…), tous partagent la conviction que les bons sentiments peuvent être réels et actifs. La prudence et la distance lors des retrouvailles après covid en attestent et sont aussi l’indice de la fragilité des choses. Cette fragilité est perceptible dans les échanges et Hervé l’inscrit dans son film avec les images d’archives : les rushs des souvenirs de famille captés par son père, les saynètes tournées par le cinéaste en herbe… Même le final se revendique cousin de l’esprit des vidéos Hi-8 de son enfance. Et de l’univers de la Volksmusik !
Quel destin pour ce film atypique qui tient à la fois du documentaire et du biopic ?
Il y aura certes le regard critique des intellectuels – ce mépris de classe pour des gens modestes, sans prétention autre que la joie de vivre, et leurs goûts culturels.
Nonobstant le film sait restituer la sincérité, la profondeur et l’intense vibration du fan [1] (ça pourrait être pour Johnny, un club de foot…).
Il suggère aussi que le populaire (qui n’est pas populisme) n’est ni unanime, ni global. Il a un périmètre : sa Heimat (la Volksmusik, c’est du Danemark à l’Italie du Nord, de l’Alsace à la Slovénie). Il a un ancrage social : ici une classe laborieuse plutôt rurale qui revendique son jardin secret et, à sa manière joyeuse et bon enfant, résiste ainsi à la mondialisation et à son uniformisation.
documentaire d’Hervé Rœsch produit par Milana Christitch
image : Hervé Rœsch ; montage : Ludivine Saes
musique : Mario & Christoph, musique originale : Tristan Lepagney
son : Jérémie Vernerey, Martin Sadoux, Vivien Roche
coproduction Ana films et France 3 Grand Est
[1] La version longue s’appelle d’ailleurs Fanclub.
un univers inspirant et inspiré
SurréAlice au MTU & au MAMCS
#EXPOSITION
Strasbourg, Musée d’Art moderne et contemporain & Musée Tomi-Ungerer – Centre international de l’illustration
du 19 novembre 2022 au 26 février 2023
commissariat : Barbara Forest (MAMCS), Thérèse Willer (MTU) et Fabrice Flahutez
Double catalogue sous coffret cartonné (45 €), bel objet et ouvrages bien documentés
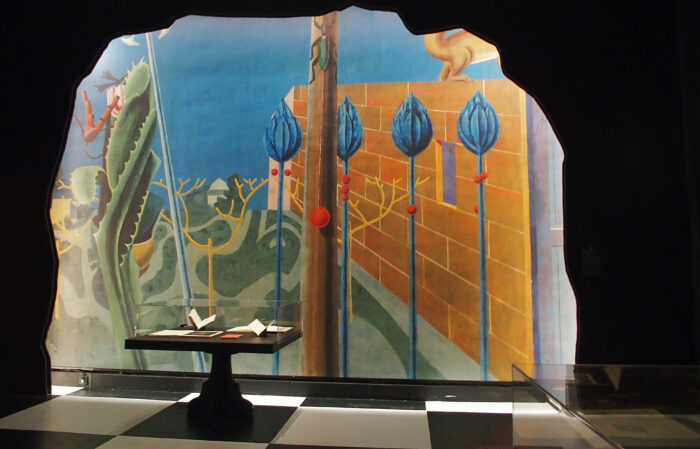
Sous ce vocable SurréAlice emprunté à Michel Remy, les musées de Strasbourg proposent deux expositions : Lewis Carroll et les surréalistes au musée d’art moderne et Illustr’Alice, un panorama de l’univers de l’auteur britannique à travers son illustration de 1865 jusqu’à nos jours au musée Tomi-Ungerer. Une programmation en lien avec Strasbourg, Capitale mondiale du livre.
Alice est une folie douce, allègre à première vue, mais de fait… un conte de fées pour adultes. Il explore ce royaume qui se situe au-delà du miroir et qui fut, il y a un siècle, révélé par Lewis Carroll pour stimuler notre imagination (8-8. A Chess Sonata in 8 Movements, film de Hans Richter, Jean Cocteau et Marcel Duchamp, 1957).
Alors qu’il publie en 1929 une traduction de The Hunting of the Snark, Louis Aragon s’enthousiasmait pour le caractère iconoclaste et subversif du personnage. C’est d’ailleurs cet usage d’Alice par les surréalistes (comme Nicolas Bouvier parle d’Usage du monde) qui popularise en France à partir des années trente Alice et l’univers déjanté de Lewis Carroll.
L’exposition assume le ludique comme le non-sens à travers un espace immersif (spectaculaire scénographie de Martin Michel). Pour y pénétrer, l’artiste britannique Monster Chetwynd a conçu une monumentale tête de chat dont la gueule avale les visiteurs. Les deux premières salles, les plus sombres, sont aussi les plus prenantes. La première rappelle une grotte avec son sol en échiquier et un décor d’opéra baroque menant au fond de scène de Max Ernst (reproduction d’Histoire naturelle, 1923), la suivante évoque autant un grand manège qu’un arbre dont le tronc héberge les œuvres inspirées de La chasse au Snark. Des spécimens prêtés par le musée zoologique jalonnent le parcours et rendent palpables le bestiaire que croise Alice dans ses pérégrinations.
Les quelque 300 œuvres présentées sont de très belle qualité : René Magritte – qui interrogeait comme Carroll l’arbitraire du langage –, Max Ernst, Victor Brauner, Marcel Duchamp sont très présents, mais aussi Salvador Dali, Meret Oppenheim, Hans Bellmer, Enrico Baj, Man Ray… Une attention particulière a été portée aux femmes surréalistes moins connues bien que très actives notamment ici Toyen et Dorothea Tanning. Des appropriations plus contemporaines s’invitent ensuite avec notamment la grande peinture murale de Topor (Alice à la neige, 1970).
À la villa Greiner, le visiteur glisse d’un univers à l’autre : le fantastique d’Europe Centrale (Dušan Kallay, Markéta Prachatiká, Jiři Trnka), l’ancrage dans la société industrielle des Anglo-Saxons (Peter Blake, Alice B. Woodward), la variation poétique (Folon, Nicolas Guilbert), la netteté de la gravure (Mervyn Peake, Ralph Steadman tiraillé entre un Ukiyo-e teinté de décadence et Dürer), voire le détournement érotique du cabinet noir (le Strasbourgeois Antoine Bernart), sans oublier le cinéma avec l’iconoclaste Betty Boop (Betty in Blunderland, 1934) qui fait pendant à son assagissement en princesse blonde de Disney (1951).
Les historiques John Tenniel et Arthur Rackham ne sont pas oubliés et les gravures sur bois (1982) si affûtées de Barry Moser acquises en 2021 sont présentées pour la première fois au public.
Cependant le mérite essentiel revient à Lewis Carroll qui a inventé – il y a cent cinquante ans ! – ce mythe moderne et permet la richesse, l’inventivité restituées par ces deux expositions. En miroir son univers onirique renvoie le visiteur à l’ubiquité du monde contemporain, questionne la cohérence de notre rationalité qui s’effiloche en mondes virtuels, parallèles suggérant que, peut-être, comme l’affirme le chat Cheschire à Alice : Nous sommes tous fous ici, je suis fou et vous êtes folle.
Entrevues | 37e édition du 20 au 27 novembre 2022
Retour à une vraie édition après la covid…
Lire la suite sur la page dédiée au festival.
Le palmarès de la 37e édition.
chimères du monde d’avant
Hôtel Proust d’Antoine Descanvelle
#THÉÂTRE
représentation du jeudi 10 novembre à la Comédie de Colmar
Une proposition de la 10e édition de Scènes d’Automne – cinq spectacles, cinq lieux – destinées à accompagner et donner une visibilité au travail des troupes de la région.
Si Antoine Descanvelle est crédité du texte, le projet est le fruit d’une écriture de plateau sur une matière et une envie du metteur en scène Mathias Moritz. Une « comédie pessimiste » dans cet espace interstitiel qu’est le hall d’un grand hôtel où gravitent les membres d’une microsociété imbus de leur pouvoir pour beaucoup : ces élites qui ont produit notre XXIe siècle ?
De la variété et une nymphette (Débora Cherrière) en minijupe au ras du cul pour l’ambiance cool, un manager cravaté pour l’outrancière prospérité plongent le spectateur dans cette année 1995.
Très vite, le sexe déborde (doit déborder) et chauffe même les conseils d’administration. Dans l’ombre portée de cet argent-roi, de ce pouvoir (de nuisance ?) pulsent quelques fêlures avec une SDF (Claire Rappin) et la petite main du factotum (Lucas Partensky) prévenant, discret avant de dresser un portrait particulièrement nauséabond des arrières cuisines de cette oligarchie. La violence la plus abjecte se raconte (Srebrenica, ex-Yougoslavie, c’est juillet 1995), mais Bernard (Romaric Séguin) explique avec enthousiasme comment transformer une tragédie en lucratif investissement. Avec son tailleur, Corinne (Claire Rappin) tente d’acquérir l’envergure des costards cravatés et obtient l’accessit de Jupette (femme ministre du gouvernement Juppé, terme inimaginable aujourd’hui). Et comme chaque cours a besoin de bouffons, l’ombre d’un roi Lear déclassé (Vincent Portal) et un chanteur de boys band (Frédéric Baron) empêtré dans l’opportunisme de la réussite à tout prix hantent cet Hôtel Lobby où Le mensonge est la plus puissante des drogues et il y a ici de nombreux toxicos.
Une matière riche et violente qui s’expose surtout en monologues : ces gens traînent là, se confient, vantent leur vie au premier venu (de fait le public), au personnel qu’ils imaginent muet comme une tombe (il est à leur service), un anonymat qui permet de déraper. Car il y a des cris, des pétages de plombs.
Une forme propice aux bons mots, aux phrases assassines. Et puis le monologue n’est-il pas une déclinaison de l’ego que ces personnages cultivent avec frénésie ?
Pendant ce temps, les autres se figent en postures quelquefois grotesques. Car il y a les corps où subsistent quelques lambeaux d’humanité. Certains s’exposent presque nus (un slip, les chaussures), surtout les hommes : leur cuir est plus épais, il faut leur arracher la carapace du costume pour creuser plus profond et découvrir une petite lueur. Les femmes en contrepoint se risquent à être plus lucides, plus humaines. Plus humiliées du coup.
Pour faire lien, les corps sont chorégraphiés : la légèreté d’une barcarolle d’Offenbach dont les opérettes sont si impitoyables envers les nantis du Second Empire. L’ancien monde est décidément une idée ancienne…
Un spectacle féroce et exigeant avec une violence qui suinte de cette succession d’images en suspension, un peu comme ce « Soir Bleu » d’Edward Hopper (1914), et suscite la sidération : Le trash ? C’est la langue des puissants, la violence de l’élite passe par le langage.
Un geste théâtral stimulant !
Efficace ?
Nous sommes nés pour accomplir un crime, affirme le factotum… et Jakuta Alikavazovic demande : Que pouvons-nous contre l’obscénité du monde ? Le seul fait de se dresser contre elle condamne-t-il à cette solitude épaisse, et qui avance ?
scénographie Arnaud Verley, création lumière Fanny Perreau,
costumes Élise Kobisch-Miana,
création sonore & régie générale Nicolas Lutz,
production Groupe Tongue
allégorie temporelle
Fondation Beyeler | 25 ans
Exposition Anniversaire – Special Guest Duane Hanson
#EXPOSITION
Riehen (Bâle), Fondation Beyeler du 30 octobre 2022 au 8 janvier 2023
commissariat : Raphaël Bouvier

Transformer un jubilé (d’argent) en moment exceptionnel est un exercice difficile, encore plus pour une Fondation comme Beyeler qui a acquis une réputation internationale. L’habitué aura une impression de déjà-vu puisqu’il retrouvera, certes de très belles pièces (une centaine), mais déjà présentées lors des expositions temporaires souvent passionnantes.
L’équipe en avait sans doute conscience et a invité son commissaire Raphaël Bouvier à mettre en dialogue les chefs-d’œuvre issus du fond avec les sculptures hyperréalistes de Duane Hanson (1925-1996). L’idée est provocante et amusante. Dès l’accueil, un ouvrier repeint le mur (House Painter, 1984) à côté d’un Picasso à moitié déballé. Plus loin, un jardinier passe la tondeuse (Man on a Mower, 1995) entre Le bassin aux nymphéas de Monet et celui de la Fondation, des ouvriers casse-croûtent sur leur échafaudage (Lunchbreak, 1989) devant les vastes toiles chantier d’Anselm Kieffer, un couple se gave de friandises (Self-portrait with Model, 1979) sous Roy Liechtenstein et Andy Warhol, etc.
Le plus épatant est de découvrir la pertinente vitalité de l’engagement de Duane Hanson (cf. Policier & émeutier, 1967) interpellant notre monde si paresseux (beaucoup de ses personnages sont au repos). Extraits de l’envahissant brouhaha de leur « environnement naturel », de l’obsession du placement de produits par la pub pour certains, ils deviennent ici spectateur/intercesseur d’œuvres du patrimoine mondial. Cette suspension que l’hyperréalisme rend encore plus troublante, clame une brusque exigence de sens et les œuvres denses de la Fondation suggèrent un début de réponse.
Déambuler entre ces Américains moyens si lebendig et les fleurons de la collection est aussi délectable que stimulant. Mais un anniversaire, n’est-ce pas surtout cela : passer du temps avec des gens et dans des lieux qu’on aime ?
Le proprement festif du 25e sera ailleurs : un grand bal costumé jusqu’au bout de la nuit (29/10) et les nocturnes du vendredi jusqu’à 22 h avec des propositions artistiques et ludiques au foyer du musée.
épineuse résilience
Zerrissene Moderne & Le collectionneur Curt Glaser au Kunstmuseum Basel
#EXPOSITIONS
Kunstmuseum Basel – Neubau
_La modernité déchirée. Les acquisitions bâloises d’art « dégénéré » du 10 octobre 2022 au 19 février 2023
commissaires : Eva Reifert, Tessa Rosebrock, catalogue en allemand ou en anglais, 344 p., 54 CHF
_Le collectionneur Curt Glaser du 10 octobre 2022 au 12 février 2023
commissaires : Anita Haldemann, Judith Rauser, catalogue en allemand (incluant un cahier avec la trad. en anglais), 240 p., 38 CHF

Déchirure : un mot douloureux et glaçant dont les répliques s’échelonnent sur 90 ans et deux expositions qui dialoguent au Kunstmuseum Basel : La modernité déchirée. Les acquisitions bâloises d’art « dégénéré » & Le collectionneur Curt Glaser.
Des expositions pour l’histoire… et la justice, car toutes deux tentent de réparer la spoliation. Aussi elles méritent un autre regard que seulement celui de l’esthète ou de l’amateur, surtout à l’heure du soft power…
la chronologie
Chapitre I.
En raison de ses origines juives, Curt Glaser est évincé de son poste de directeur à la Kunstbibliothek de Berlin en 1933. Avant d’émigrer en Suisse, puis aux États-Unis en 1941, il vend aux enchères (à prix bradés vu le contexte) une grande partie de sa collection (dont un important fond Munch, Matisse, Beckmann). Le Kunstmuseum Basel acquiert ainsi 200 dessins et gravures pour son Kupferstichkabinett.
En 2020, le musée conclut un accord juste et équitable avec les héritiers de Glaser en faveur du maintien des œuvres incluant une compensation financière et cette exposition hommage.
Chapitre II.
En 1937, dans le cadre de leur politique « culturelle », les nazis retirent d’office des musées allemands ce qu’ils qualifient d’«entartete Kunst» (art dégénéré) soit environ 20 000 pièces. Beaucoup de ces œuvres sont directement détruites. Les autres considérées comme « exploitables à l’international » sont mises sur le marché entre autres pour se fournir en précieuses devises étrangères.
Le nouveau Kunstmuseum – l’actuel bâtiment principal – a été inauguré en 1936 avec un espace pour l’art contemporain, sauf que très peu d’œuvres figurent dans les collections… Le directeur en poste, Otto Fischer, se renseigne auprès des autorités du Reich. Finalement son successeur, Georg Schmidt, acquiert en 1939 21 œuvres grâce à un crédit spécial dont le montant est âprement discuté.
Chapitre III.
En juillet 1937, les nazis inaugurent à Munich l’exposition «entartete Kunst», un vocable sanction, péjoratif pour discréditer les artistes qui déplaisaient au régime. Gratuite et itinérante, elle circule durant quatre années dans les grandes villes du Reich suscitant la curiosité de presque trois millions de visiteurs tant pour les artistes estampillés handicapés que ceux réprouvés par la propagande.
Dans son exposition actuelle Art brut, le musée Würth Erstein (F) rend hommage (jusqu’au 21 mai 2023) sur une de ses cimaises à Paul Goesch, patient assassiné à l’hôpital psychiatrique de Teupitz (Aktion T4), le confrontant à Emil Nolde en référence aux accrochages de Munich…
Chapitre IV.
Durant toute cette période, les dignitaires nazis (Gœring en premier) se servaient en zone d’occupation aussi bien dans les collections des musées que dans celle des particuliers notamment juifs. Ces vols concernent surtout les grandes œuvres du passé ou celles d’agrément (nues, paysages…). À l’issue du conflit, quelques milliers d’œuvres spoliées n’ont pu être restituées faute de traçabilité. En France, la Réunion des Musées Nationaux en possède deux milles réparties dans ses différentes institutions : les MNR (Musées Nationaux Récupération).
Périodiquement elles sont exposées et la galerie Heitz (Palais des Rohan) présente jusqu’au 23 mai 2023 les 27 pièces du fond strasbourgeois (un Sisley, un Lucas de Leyde entre autres).
Il est aussi utile de rappeler que dès le 10 mai 1933, les nazis ont procédé à des autodafés de livres devant l’opéra de Berlin, mais pas seulement, témoignant de leur violence tant à l’égard des œuvres que des artistes.
Si le Kunstmuseum documente son histoire et ses choix de l’époque avec une grande honnêteté, il est difficile de s’abstraire du contexte en visitant ces expositions, de ne pas être troublé aussi par la simultanéité des propositions, presque un siècle après, et par ces comptes qui peinent à se solder. Émerge aussi cette assertion de Walter Benjamin : il n’est pas de témoignage de culture qui ne soit en même temps un témoignage de barbarie.
les œuvres exposées
Elles offrent un panorama représentatif de la censure de l’époque.
Il y a bien sûr les artistes juifs (Chagall…) et des tableaux qui dépeignent cette communauté.
Le contingent le plus important est constitué des différents courants expressionnistes qui restituent la réalité sociale dans toute sa crudité : les tripots, la (médiocre) condition ouvrière pointant par ricochet que le Reich n’est pas cet éden un brin viril vanté par la propagande. Le visiteur admirera de nombreux Ensor ou Munch (un ami personnel de Curt Glaser), mais aussi Corinth, Dix, Kokoschka, Kirchner, Kollwitz… un remarquable cabinet de gravures derrière le portrait du collectionneur (salle 2).
Il y a les artistes qui s’éloignent trop d’une « figuration réaliste » : Derain, Gauguin, Matisse, beaucoup de Nolde ou ces magnifiques chevaux bleu de Franz Marc (The Large Blue Horses, 1911)…
Enfin ceux qui creusent d’autres sillons : Picasso, Max Ernst, Kandinsky, Klee…
Certains choix surprennent comme Les Amants de Dresde (1928) de Conrad Felixmüller (1897 – 1977), mais à y regarder de près, il était communiste…
Deux expositions stimulantes avec des pièces rares et formidables.
Mais entre l’émotion que peut provoquer un chef-d’œuvre et son parcours chaotique dans l’enfer des hommes, le temps est un chemin dur à remonter comme le suggérait Jorge Luis Borges (Histoire universelle de l’infamie, 1935).
Expositions mentionnées :
Art Brut. Un dialogue singulier avec la Collection Würth
commissariat : Claire Hirner, Jean-Pierre Ritsch-Fisch, catalogue bilingue franco-anglais (48 €)
Musée Würth (F. Erstein) jusqu’au 21/05/2023
Les MNR des musées de Strasbourg
commissaires : Thibault de Ravel d’Esclapon, maître de conférences à l’Université de Strasbourg , Dominique Jacquot, conservateur en chef du Musée des Beaux-Arts
Galerie Heitz / Palais Rohan jusqu’au 15/05/2023
clairvoyance de la folie
Art Brut
Un dialogue singulier avec la Collection Würth (Erstein)
#EXPOSITION [parution papier NOVO n° 67]
Erstein, Musée Würth du 9 octobre 2022 au 21 mai 2023
commissariat : Claire Hirner, Jean-Pierre Ritsch-Fisch
catalogue bilingue franco-anglais (48 €)

L’article est paru en décembre dans Novo n°67 (p. 94 & 95) : Les Portes du Possible.
chorégraphie cosmique
Fabienne Verdier : Le chant des étoiles
#EXPOSITION
Colmar, Musée Unterlinden du 1 octobre 2022 au 15 mai 2023
commissariat : Frédérique Goerig-Hergott, conservatrice en chef, assistée de Léa Rosenfeld
catalogue en français / anglais, 192 p., 30 €

#Une version condensée de l’article est paru en décembre dans Novo n°67 (p. 96 & 97).
Pour cette exposition monographique, la commissaire Frédérique Goerig-Hergott a imaginé un parcours initiatique à travers le musée menant vers la nef de l’Ackerhof repensée en chapelle ardente, un écho cosmique à celle abritant le Retable d’Issenheim. Selon son habitude, c’est l’aboutissement de quatre années d’échanges avec l’artiste et l’ambition de mettre intimement en résonance son travail avec les collections. C’est aussi un beau cadeau d’adieu aux Unterlinden qu’elle a quitté voilà quelques mois pour prendre la direction des musées de Dijon.
Même si ce n’est pas une rétrospective (Aix-en-Provence en avait programmé une en 2019), les principales stations du chemin de Fabienne Verdier sont présentes. L’influence de la Chine où elle a passé dix ans (1984-1993), les maîtres anciens (notamment Flamands), la musique, sa fascination pour l’énergie universelle avec les Rainbows réalisés en lien avec ce sidéral embrasement qui transfigure le Christ du Retable. Un choix ambitieux qui permet à l’artiste de développer la représentation de la lumière tout en se préservant du dolorisme de la crucifixion que la pandémie a rendu asphyxiant.
geste essentiel
Saisir l’instant en un trait, voilà ce qui me fascinait.
Passagère du silence (2003, p. 18)
Ce trait essentiel aspirant à la transcendance – l’Unique Trait de Pinceau du traité de Shitao qui l’accompagne depuis ses études – pourrait caractériser la quête de l’artiste. Pour peu qu’il restitue l’énergie vitale : un des supplices de l’étudiante en art était de dessiner le buste de Beethoven, un bloc de plâtre sans vie ! Elle préférait le parc et les collections naturalisées du musée d’Histoire naturelle de Toulouse. Mais tenter d’accéder à l’essence par un geste unique est un acte élaboré : Il ne faut pas croire que la spontanéité est quelque chose de facile. En amont, elle lit beaucoup et écoute – écrivains, poètes, linguistes, scientifiques, musiciens, etc. – avec sans doute ce désir d’avoir l’Univers pour maître (devise d’un sceau personnel de lettrée qu’elle s’est gravée à Chongqing) et quand elle parle d’une de ses toiles, elle mentionne abondamment ce qui l’a nourrie : lectures, références, citations. Cette recherche participe de l’élaboration du geste qui est le moyen de parvenir à transcrire l’essentialité avec cette économie et cette concentration.
La dynamique du « triangle » ouvert rouge de Sedes Sapientae II (2011, cloître =>2) tente de nouer l’essence de La Vierge au chanoine Van der Paele de Van Eyck (1434-36) : un opulent drapé incarnat qui à la fois magnifie la mère et l’enfant et les détache des mortels.
L’ample mouvement du pinceau de La Dormition (2012, collection XIXe =>7) pose la vibration nacrée de la défunte sur un fond noir : la Vierge de Hugo Van der Goes à l’origine, associée ici à La femme du Lévite d’Épraïm de Henner (suggérant un axe d’universalité traversant cinq siècles).
Le geste peut être multiple : sur les six pièces Énergies blanches (2018) accrochées dans la Maison =>6 ou Vide Vibration (2018) en regard des Dubuffet =>10.
Cependant pas de geste sans support : le glacis du fond, dense (dix à vingt couches), subtil, vibrant, mais fin et brillant, capte et renvoie la lumière alors que le noir ou le blanc (le rouge pour les Sedes) du « motif » épais, coagulé retient les ombres.
Si l’artiste utilise l’acrylique, elle s’est longuement penchée sur cette subtile alchimie des glacis de la peinture flamande (inspirée selon les Chinois des procédés qu’ils ont élaborés pour les laques et importée en Europe au XIVe siècle par des explorateurs flamands et vénitiens). Depuis vingt ans, je cherche, j’invente des fonds de tableaux susceptibles d’accueillir avec grâce la pensée poétique des coups de pinceau. Elle les applique à partir de 2010 selon sa technique du walking painting avec de gros pinceaux (jusqu’à trente queues de chevaux mongols) suspendus et manœuvrés par un guidon ou avec une poche à douille déposant par gravitation une matière généreuse sur la toile posée au sol. Ainsi l’énergie chorégraphique du corps outil agrandit le geste unique du calligraphe à la dimension de ses grands formats.
Cette diffraction entre le rayonnement du glacis et l’ample matière déployée par le trait qui, quelquefois, se permet une « entrée ou sortie de champ » (Énergies blanches, 2018, ou Cetus, série Ainsi la nuit, 2018, salle d’orientation =>1) est pour beaucoup dans la magnétique vitalité des peintures de Fabienne Verdier.
cercles et confins
Pour les Tibétains comme pour les tribus africaines, les vieux philosophes du Moyen Âge ou les grands maîtres calligraphes zen, le cercle est le point central : vide nourricier, plénitude première, lieu de naissance de tout ce qui est. Cette sorte de « cosmogramme » représentait l’expérience du sacré, la diversité du monde dans l’unité.
Passagère du silence (2003, p. 183)
Avec Rainbows =>12 & 3, le fond de chacune des 78 pièces de la série décline une interprétation du halo d’or en fusion (Huysmans, Trois Églises, 1908) de la Résurrection de Grünewald. Si une dizaine seulement est dorée, tous reprennent la figure du cercle aux frontières impalpables vibrant des couleurs de l’arc-en-ciel. De ces bleus nuit « nourrice des étoiles d’or » (Euripide, Électre), de cette matière noire, de ces aurores incandescentes jaillit le geste de l’artiste : tourbillons tourmentés, pouponnières d’étoiles, sonorités picturales, lave en fusion, éclaboussures éthérées…
Chaque arc-en-ciel se veut à la fois le portrait d’une étoile et, à travers un prénom soigneusement choisi, une nouvelle naissance pour une victime de la pandémie car les étoiles meurent pour renaître : une transsubstantiation de l’énergie vitale, une transfiguration comme sur le panneau de Grünewald. Nous sommes tous des enfants de la lumière comme le suggère l’astrophysicien Trinh Xuan Thuan.
Les deux registres des Rainbows convergent vers le Grand Vortex d’Unterlinden (2022, =>13) : un portrait de cette maison-mère qu’est le néant ?
Avec cet enveloppant mandala de la nef, Fabienne Verdier se mue en passeuse d’éternité et, comme les jardins classiques de Suzhou, nous invite à retrouver l’unité primordiale qui nous mène à l’éveil.
#Grâce à un don de l’artiste, au soutien de la Galerie Lelong & Co. (Paris) et au mécénat exceptionnel du Crédit Mutuel, le Musée Unterlinden a fait l’acquisition de trois « Rainbows » de l’artiste Fabienne Verdier : Khandro, Thera et Vaiiu.
Ces pièces formeront un triptyque et seront exposées du 05.07.2023 au 04.09.2023 au niveau 2 de l’Ackerhof, aux côtés du Grand Vortex de Fabienne Verdier (prêté au musée jusqu’au 04.09) et d’autres grands formats des collections d’art moderne du musée.
concert de Bernard Foccroulle, clavecin
un dialogue entre peinture et musique
Harmonies sonores en écho aux harmonies célestes de Fabienne Verdier avec le concert de clavecin de Bernard Foccroulle sur sa copie du Ruckers des Unterlinden construit par Jean-Luc Wolfs-Dachy avec les quatre couvercles peints par l’artiste.
Quatre panneaux comme les quatre saisons…
Une onde pulsatile enveloppant l’esquisse d’une portée sur le fond safran, l’ivresse de tourbillons liquides sur le cobalt, un geste éthéré et recueilli sur l’ivoire et une énergique saignée d’encre cinglant le cinabre : une blessure couture sur ce lumineux incarnat (le glacis de ses fonds) avec, en traînes subtiles, des larmes comme les harmoniques de la cicatrice et ces éclaboussures la ponctuant de virevoltants pizzicati (le clavecin est un instrument à cordes pincées !).
Ce rouge d’un automne embrasé clôturait le concert et ramenait au Silence (nom de la pièce Ivoire).
Un concert en quatre mouvements, un pour chaque couvercle.
En invités : le temps, la présence, la mélancolie et le silence.
Le silence, mis en espace, mis en temps et en tension, est la marque des pièces écrites par Bernard Foccroulle pour ce clavecin et ces peintures : pas de musique sans silence, nous confiait le musicien qui introduisait chaque partie et, allusion à l’omniprésent tumulte de notre modernité, il ajoutait malicieux : on s’achemine peut-être vers une disparition de la musique…
Outre ses compositions, un choix de pièces issues de son répertoire : des fragrances méditerranéennes de Correa de Arauxo à l’énergique Toccata de Weckmann, des Tombeaux (Froberger, Couperin…) à la Passacaglia ungherese de Ligeti évoquant la danse d’une poupée cassée avec, en refrain conclusif de chaque partie, un Contrapunctus de l’Art de la Fugue (Bach).
À l’issue du concert, Fabienne Verdier et Aline Zylberajch ont annoncé le nom de la lauréate du concours Clavecin en France : Mathilde Jallot dont la proposition sera réalisée sur un couvercle appartenant à l’association. Les maquettes des six finalistes seront exposées au musée jusqu’au 12 décembre.
=> concert du samedi 15 octobre 2022 au musée Unterlinden, La Piscine
Des archives filmées (52 min) du travail de Fabienne Verdier de 2019 à 2022 autour du panneau de la Résurrection du Retable d’Issenheim de Grünewald sont diffusées à La Piscine et accessibles en ligne.
Pour préparer ou prolonger la visite…
– catalogue bilingue franco-anglais sous la dir. de Frédérique Goerig-Hergott, conservatrice en chef (30 €),
– portfolio de 12 tableaux choisis dans la série Rainbows (180 €)
– son récit des années passées en Chine : Passagère du silence, 2003 (rééd. Le Livre de Poche, 7,90 €)
jeux de miroirs brisés
La Mouette
Anton Tchekhov & Cyril Teste
#THÉÂTRE
représentation du mercredi 28 septembre 2022 à La Filature, Mulhouse
Enthousiasmés par la nouvelle traduction d’Olivier Cadiot, Cyril Teste et son équipe adaptent en performance filmique la pièce de Tchekhov [sans Chamraïev & Paulina, parents de Macha]. La scénographie (Valérie Grall) dresse au milieu du plateau un long mur qui, à la fois, voile une arrière-salle où les caméscopes traquent les visages, les corps en jeu et dévoile, côté public, l’action in devant et sur un fond de projections polyptyques : de grandes toiles blanches sur châssis qui se tournent comme les pages d’un livre qu’on feuillette, en avant, en arrière…
Avec des écrans sur pieds à cour et jardin en sus, le dispositif permet une démultiplication des regards et des personnages comme les fragments d’un miroir brisé. Ceux-ci se nourrissent de l’attention aiguisée de Kostia (Mathias Labelle) notamment qui shoote Nina (souvent, comme chacun peut le faire aujourd’hui avec son smartphone) et du hors-vue filmé qui crée des en-champ focalisés avec beaucoup de gros plans (deux cameramen présents sur le plateau – discrètement).
Les larmes et les yeux, les lèvres, les cigarettes, le verre de whisky prennent une importance inimaginable dans une représentation classique et, par ailleurs, s’installe une ubiquité qui, au cinéma, relèverait de l’expérimental. Les acteurs passent du plan large du plateau au gros plan de la projection (ou inversement). La perception devient duelle avec un couple à vue et son profil inversé en plan serré sur des écrans séparés amplifiant leur distance. Si le dispositif devient panoptique par moments, il permet quelques belles scènes : par écrans interposés les mains de Macha et Kostia semblent se toucher, mais lui finalement attrapera les feuillets de sa pièce écrite pour Nina… Des corps inaccessibles rendus douloureusement proches par la trahison des images !
Cyril Teste impose aussi un glissement dans le temps. L’ambiance évoque Antonioni avec les cigarettes omniprésentes ces années-là. Katia Ferreira (Macha) fait penser à Silvana Mangano et Olivia Corsini (Irina) revient à sa langue maternelle parlant régulièrement italien. Il cultive aussi le désœuvrement crépusculaire de la Beat Generation et suscite une Nina (Liza Lapert) tête brûlée limite cassos (qui fonctionne plutôt bien).
Une élaboration très dense qui s’allège vers la fin où la pièce se résout presque comme un film projeté sur l’écran unique du mur – à la fois Cassavetes et sitcom. Mais peut-il en être autrement ?
Comme dans La Ronde de Schnitzler (où la succession des aventures est assumée), La Mouette opère un glissement des amours : au début, supports et vecteurs des idéaux, des rêves, les sentiments produisent du malentendu – et ce cinéma direct les expose tel un miroir grossissant (comme un sous-texte visuel). La réalité, les enjeux (devenir actrices, écrivains célèbres…) les ravalent vers cette débâcle (ces glaciers beaux et immaculés charriés plus tard en chaos souillé par les fleuves) et mènent Kostia jusqu’au suicide.
Les affinités, les en-vies originelles se sont épuisées, ne reste que la régie des corps. En cours de route, l’idéal s’est accompli en vertige consumériste : on consomme/consume des êtres pour assouvir ses pulsions, ses ambitions, on prend ce droit sur les autres. Au détriment de la Vie…
lumières : Julien Boizard, création vidéo : Mehdi Toutain-Lopez,
musique : Nihil Bordures, production : Collectif MxM
irrévérence acidulée
Fun Feminism au Kunstmuseum Basel | Gegenwart
#EXPOSITION
Kunstmuseum Basel | Gegenwart du 24 septembre 2022 au 19 mars 2023
commissariat : Maja Wismer et Alice Wilke avec Senam Okudzeto et Claudia Müller

L’exposition propose une immersion dans l’univers féminin avec une quarantaine d’œuvres et autant d’artistes. Une bonne partie est issue des collections du musée – celles datant de la fin des années 1960 aux années 1990 – que complète une sélection de travaux plus récents. Comme l’intitulé le suggère, le regard et la scénographie se revendiquent ludiques et légers avec une constante : l’irrévérence. Pour la visite, il convient de prendre le temps : 80 % des pièces intègrent des vidéos.
La plus spectaculaire Ciao Bella (2001) de Tracey Rose qui occupe un côté du rez-de-chaussée (3 écrans), est une « sainte cène » avec la Cicciolina se trémoussant sur la table des agapes, mais les convives sont plutôt les accessoires mis en chorégraphie par des corps féminins délurés et incarnant ces rôles assignés de godiche, de pin-up, etc.
Beaucoup d’œuvres s’emparent des stéréotypes pour les dénoncer par l’exagération, la parodie : ménage, cuisine – frites géantes (Puck Verkade – Plague, 2019), batteurs de cuisine (Jana Heuler) – et bien sûr la mode et la sexualisation. Pour les travaux en volume, il y a une prépondérance du plastique aux tons vifs qui accentue la futilité des objets mis en scène, pas forcément utiles, forcément éphémères, dont la femme elle-même, objet du coup, qui se trouve réduite à un dérisoire – mais excitant – accessoire du patriarcat. Sont déclinés les images de pub, de télévision (celle de Berlusconi), les mannequins des vitrines, l’envahissement du quotidien par des ustensiles aux couleurs criardes avec un parfum de pop art prescrivant la tyrannie du festif.
Certaines pièces utilisent des techniques et des matériaux connotés féminins – confection (Katharina Kemmerling, Sylvie Fleury…), tapis (Polly Apfelbaum), céramique (Aline Stalder, Betty Woodman…) – et si les chaînes apparaissent gigantesques, fabriquées en carton elles semblent plutôt légères (Katrin Niedermeier).
Derrière cette exploitation de la femme, s’exposent la préemption consumériste généralisée sur les ressources et l’inanité de notre mode de vie. Des actrices et autres célébrités le relayent, le popularisent en posant pour les magazines mettant en scène le corps pipole aux côtés de leur mâle. Les hommes perpétuent le modèle par habitude, instinct de meute et l’affichent instrumentalisés par la presse : des corps avachis potentiellement alcoolisés sur des transats (Marianne Wex, Let’s Take Back Our Space. ‘Female’ and ‘Male’ Body Language as a Result of Patriarchal Structures).
Le militantisme est présent avec le collectif Guerrilla Girls ou Lily van der Stokker sans oublier la mise en écho de cette colonisation mentale avec le colonialisme (Fatimah Tuggar, Ellen Gallagher, Kawita Vatanajyankur…).
Mais après tout, pour la machinerie patriarcale, le militantisme, les expositions… ne sont-ils pas des artefacts parmi d’autres de la société du spectacle ? En dépit des injustices et des crises… The show must go on !
Vivian Sutter
À l’étage, Vivian Sutter s’approprie une salle et joue avec ses toiles suspendues inondées de lumière (très beau soleil le matin de la visite de presse) et habitées de gestes larges, colorés, enthousiastes. Avec cet accrochage affirmant la volonté de ne pas individualiser les pièces, elle propose une installation ductile qui insuffle à l’espace respiration et inspiration.
=> jusqu’au 1 octobre 2023.
généalogie sidérale
Simone Adou : Âme animale à Saint-Louis
#EXPOSITION
Hôtel de ville de Saint-Louis (68) du 23.09 au 6.11.2022

Simone Adou avait déjà exposé à l’hôtel de ville de Saint-Louis en 2002. Après le confinement – très studieux –, une visite de son atelier à l’initiative de l’attaché culturel Stéphane Valdenaire a convaincu l’équipe municipale enthousiasmée par son travail de l’inviter à nouveau.
L’accès est gratuit aux heures d’ouverture de la mairie jusqu’au 6 novembre.
L’espace s’offre au visiteur avec les enveloppantes ellipses d’une chapelle baroque autour de la travée centrale où sept kakémonos – série Animale (2019-2020) – mènent vers l’Ancêtre fleuri (2015) qui, avec ses incrustations de feuilles d’or, se dresse dans le chœur tel un Pantocrator chamanique. L’artiste aime les séries, Âme animale en affiche trois : La famille des Ancêtres (œuvres d’inspiration chamanique de 2016), Les Diptyques (œuvres de confinement) et Les petits formats (œuvres de confinement et re-confinement). Les Bivouacs et surtout Passage, six pièces du printemps dernier, insufflent la chaleureuse respiration de leurs fonds cobalt et orangé à un ensemble assez souvent sombre (il y a l’anthracite du fusain, celui des pelages) qu’avivent cependant quelques discrètes ponctuations colorées.
L’artiste travaille presque exclusivement sur papier recyclé à bords frangés. Passage est emblématique de sa pratique : sur un fond d’encre et d’acrylique appliqué au rouleau ou avec un gros pinceau favorisant des surfaces lacunaires aux limites indécises et aléatoires, elle dessine ses créatures au pastel, au fusain, à la craie. Des outils dont la pulvérulence installe l’éphémère, le fragile mais lui permettent aussi cette précision immatérielle qui devient troublante quand elle joue de la paréidolie : le mufle des bœufs musqués devenant un visage. Naissent au fil de la réalisation ces créatures polymorphes, multiples, timidement hybridées ou ostensiblement recomposées (Cerfglier ou Tyrannosauradou). Elles sont souvent tapies, comme au bord du monde, apeurées derrière ces délicates efflorescences et déjà contaminées par cette végétation gracile qui, chassée des territoires bétonnés et goudronnés, s’approprie les marges, les interstices épargnés (provisoirement) par l’anthropocène. Ces racines astrales sont omniprésentes dans les figures des ancêtres et en accentuent l’envoûtante majesté.
Dans les kakémonos, elle joue sur l’équilibre précaire de bêtes massives aux pauses improbables – bœufs musqués, rhinocÉros… La matière picturale du fond – traînées, coulures… – remplace souvent les pattes imposant cette dansante suspension vers une possible assomption, à moins qu’un Yack équilibriste (2020) ne prenne une pose circassienne sur une chaise rouge (cf. affiche). Si les cadrages en raccourcis – très cinéma, récurrents dans son œuvre – sont moins marqués, le traitement des corps préserve l’influence expressionniste tempérée par une touche féminine avec ces visages animaux pétris d’humanité.
La commotion du confinement l’emporte vers Füssli [1] – le mouvement des corps – et confronte le visiteur à des vanités gagnées par l’urgence affolée de notre temps avec la projection de ces groins en forme de crâne. La sidération des Nightmare du peintre britannique d’origine suisse demeure, mais l’artiste sait être plus suggestive avec « ses grands yeux ouverts sur le lointain, sur d’imminentes et inéluctables catastrophes. […] les yeux je les fais comme ça, en creusant le bois, en créant une cavité, seul le vide peut supporter la vue du vide [2] » : des ovales de peinture blanche sur la cendre fuligineuse du fusain, comme piégés par l’infrarouge d’un photographe et saisis de sidération par la brutalité du confinement – stridentes et omniprésentes sirènes déchirant les rues désertes, vrombissements des hélicoptères vers le Mœnch [3]. Des yeux siphonnés par les écrans aussi ? Toujours la tension reste palpable avec la volonté de préserver l’âme – l’anima – face à la déraison avec l’abyssale crainte de la perdre. Des regards abasourdis que partagent même une paire de Roméo & Juliette (2020). Tel un effet Koulechov, la singularité du monde de Simone Adou habite les yeux vides transperçant ses créatures.
Ainsi sous ses doigts, s’incarnent des âmes errantes tétanisées ou dansantes : une avant-garde des derniers survivants réfugiés sur les hauteurs vosgiennes et croisés lors de ses nuits sous la pleine lune ?
Dans son catalogue de 2016 „Simone Adou en a-pesanteur”, elle écrivait :
Celui qui a trouvé va mourir,
celui qui cherche va naître
Avec ses craies, ses pinceaux, Simone Adou continue de chercher.
[1] Johann Heinrich Füssli ou Henry Fuseli, (7/02/1741, Zurich – 16/04/1825, Putney Hill), peintre et écrivain d’art suisse ayant vécu et travaillé en Angleterre.
[2] Claudio Magris, À l’aveugle (2009, p. 228)
[3] le Mœnchsberg, principal hôpital de Mulhouse
Prophète ou Cassandre ?
George Orwell & La vie ordinaire de Stéphane Leménorel
#LIVRES [hebdoscope, édition numérique semaine 36]
chez le passager clandestin, collection « Précurseur·ses de la décroissance », 2022 (124 p., 10 €)
Dès les Trente Glorieuses, d’éminents lanceurs d’alertes avaient prédit la plupart des désastres qui compromettent « la possibilité d’avoir encore un monde » (p. 62). La biologiste Rachel Carson et son Silent Spring (1962) ou l’agronome René Dumont, le philosophe Günter Anders, des écrivains aussi : Romain Gary avec Les racines du ciel (Goncourt 1956)… Mais avant eux, dès les années trente, Georges Orwell (1903–1950) dénonçait le mythe du progrès et prônait la décroissance.
Dans la collection dirigée par Serge Latouche « Précurseur·ses de la décroissance » chez le passager clandestin, Stéphane Leménorel nous présente (souvent avec de jolies formules) les analyses et les idées que développait l’auteur britannique incluant des extraits d’œuvres moins connues que 1984.
« George Orwell a construit sa pensée au contact des réalités concrètes, n’ayant pas hésité à s’immerger dans la misère la plus sordide pour comprendre ce monde de l’intérieur. » (p. 12)
Et cela par-delà le genre. Le roman Une histoire birmane (1935) s’inspire des cinq années passées dans la police impériale britannique (je servais dans la police, c’est-à-dire que j’étais au cœur de la machinerie du despotisme [1]). Avec des récits inspirés de son expérience personnelle, Dans la dèche à Paris et à Londres (1933) évoque sa vie parmi les pauvres des deux capitales. Avec des chroniques de témoin privilégié, Hommage à la Catalogne (1938) relate sa participation à la guerre d’Espagne auprès des Républicains et le traumatisme de l’impitoyable liquidation des autres mouvances communistes par les staliniens. Et aussi des reportages commandités : les conditions de vie des mineurs avec Le Quai de Wigan (1937) ou comme correspondant de guerre en Europe (1945).
« Si c’est en Espagne qu’il a fait la rencontre, décisive, du mensonge politique organisé, il le retrouve également en Angleterre. » (p. 20)
Ses critiques du stalinisme se heurtent à la russophilie aveugle des intellectuels de gauche. Ces controverses avivent sa farouche méfiance envers la sphère politique dont il déconstruit les discours en pointant l’usage pervers des mots : La politique et la langue anglaise (1946). Comment ne pas penser à LTI, la langue du IIIe Reich de Victor Klemperer (1947) ? Et effectivement dans sa dystopie 1984 (son dernier livre), Orwell érigera la novlangue en vecteur essentiel de la tyrannie.
« La machine est le modèle le plus abouti de la rationalité économique. Elle correspond au projet d’une modernité viciée » (p. 41)
Avec à terme, la transformation de l’homme en automate comme le regrette Orwell ou en machine comme le développe Günter Anders dans L’obsolescence de l’homme (1956). En prolongement Stéphane Leménorel suggère le travestissement de ce futur « camp de concentration technologique universel » par les accessoires de La société du spectacle (Guy Debord, 1967).
« L’empire de la nature, pour impitoyable qu’il soit, est bien moins violent que l’empire des hommes, et bien moins encore que celui des machines. » (p. 57)
Dans sa réflexion, Orwell souhaite avant tout ouvrir des horizons à défaut d’apporter des réponses définitives et toutes faites – il les détestait ! – avec l’envie de réenchanter le monde. La décroissance n’est pas un retour à l’âge de pierre et il s’y adonne dans l’île de Jura en Écosse où il s’est retiré loin de la modernité et des métropoles.
Orwell : une pensée claire, exigeante et visionnaire. Malheureusement… car dans son œuvre, « il est rare d’y trouver une inquiétude dont l’avenir n’ait pas montré la justesse » (p. 111).
[1] Le Quai de Wigan (1937)
Hamlet Diptych
Bussang 2022 : Hamlet & Hamlet-Machine
Shakespeare / Heiner Müller
#THÉÂTRE [hebdoscope, édition numérique semaine 35]
représentations du jeudi 18 août 2022 au Théâtre du Peuple, Bussang
Chahuté par les restrictions, l’été 2020 avait dû se limiter au beau (et court) moment du texte de Stig Dagerman, aussi l’association gestionnaire du théâtre avait décidé de reporter à 2022 le projet de Simon Deletang d’« offrir un chemin jusqu’à Hamlet-Machine » avec la pièce de Shakespeare programmé l’après-midi.
Dans sa proposition, les deux pièces sont liées – même décor, même distribution, même énergie – et mises en dialogue par petites touches. Elles sont très rarement jouées dans la continuité et en France c’est une première.
passacaille
Quatre cubes blancs à cour, autant à jardin dressent vers le fond et sa porte coulissante une perspective épurée. Le rideau à l’avant-scène la découvre, la voile au besoin pour un jeu ou un changement de scène : l’un ou l’autre cube glisse et quelquefois un ou plusieurs crânes s’imposent en volumineux obstacles aux trajectoires des personnages (en avertissement aussi). Cette économie visuelle focalise la tragédie sur les corps. Vêtus de robes de clergyman noires, ils surgissent des travées du décor en un énergique ballet de va-et-vient, tendus et affairés tels des businessmen surbookés. Ils se croisent beaucoup, s’accrochent quelquefois impulsant un pas de deux, de trois… La découverte vers la forêt amplifie la chorégraphie en appogiatures baroques ritualisées et mortifères : les enterrements, les duels. L’espace devient le lieu d’une mécanique de la mort qui s’éploie en majesté selon l’ensorcelante partition visuelle et sonore (musiques finement choisies !) élaborée par le metteur en scène.
De ces marionnettes jouets de leurs ambitions et/ou de leurs désirs, se détache l’Hamlet envoûté de Loïc Corbery (le seul à être en pantalon). Un être en suspension dans cet univers en apparence si net et qui semble savoir où il va (ce que proclament les corps et les discours). Lui doute, est désuni entre la vengeance réclamée par l’ombre de son père, son amour ambigu pour Ophélie, les complots de cour… Tour à tour distant, complice, emporté ou se confiant au public, il promène son intériorité tourmentée dans ce monde d’intrigants et déploie avec une palette fine, délicate et virtuose une incarnation fascinante et d’une rare subtilité.
Avec sa robe carmin, Ophélie hante Elseneur comme une blessure. Elle aussi vacille mais pas du même côté qu’Hamlet et, incapables de se trouver, ils seront dévorés par la machine de mort.
En contrepoint d’Hamlet, Jean-Claude Luçon en figure harassée d’imprécateur d’outre-tombe ne cesse de réactiver la malédiction… jusqu’à en contaminer son propre fils.
L’arrière-fond de guerre se limite aux drapeaux noirs et rouges brandis comme lors des préludes de bataille chez Kurosawa (Kagemusha, Ran), ils resurgiront dans Hamlet-Machine notamment durant les manifestations. Quatre rôles masculins sont distribués à des femmes et l’ensemble de la troupe – professionnels, amateurs confondus – affiche une belle unité et un ardent engagement jusqu’aux saluts.
scherzo
Et justement les saluts d’Hamlet ouvrent la pièce de 1977 installant Shakespeare en vaste prologue de celle d’Heiner Müller.
À l’avant-scène, Simon Deletang se fait conteur, dit son admiration, invoque la filiation d’Artaud – son Théâtre et la peste –, commente l’enregistrement historique du texte allemand avec la voix de l’auteur (entre autres) qui sera diffusé.
Derrière lui, les machinistes complètent à vue le décor. Un panneau doré sur deux des cubes, des chaises pour tout le monde : la petite bourgeoisie a pris le pouvoir et ne transige pas avec son confort. Régulièrement les cubes obstruent la perspective, cassent l’espace auparavant si ordonnancé et, en quatre siècles, les crânes ont perdu leurs dents…
Entrent les personnages, ils se sont individualisés – jeans, chemises ou sweats, tenues de sport… Mais leur diversité est laminée : chez Heiner Müller, le collectif remplace les individualités et la parole circule librement entre des actants interchangeables. Hamlet y proclame même son indifférence au rôle (en écho à ses choix d’interprétation dans le Shakespeare). Dans la mise en scène de Bussang, il libère même Ophélie de ses bandages vers la fin. D’ailleurs le dramaturge ne s’embarrasse guère des conflits de la tragédie, il règle plutôt ses comptes avec l’Europe, la modernité, l’oppression, l’injustice, le pouvoir…
La mort n’est plus nette et tranchante comme un uppercut, elle est plus sournoise, plus diluée (cancer du sein, Ophélie finit en fauteuil roulant…). Refoulée ?
Mais conjurer la barbarie reste toujours extraordinairement difficile. On s’y essaye par la révolution ou par l’étourdissement : le glamour avec ce slow final sous une boule disco… en forme de crâne. Car la barbarie perdure sous une autre forme : Fernsehn Der tägliche Ekel Ekel (Télévision L’abomination quotidienne Abomination) ou Heil Coca-Cola (Tableau 4), etc. Règne désormais « ce pouvoir surexposé du vide et de l’indifférence transformés en marchandise » comme le suggère Didi-Huberman [1].
En regard… l’abyssal désarroi face au néant, celui d’Hamlet, celui de Shakespeare. Le nôtre ?
[1] Survivance des lucioles (2008)
archéo-fiction du bonheur
« Lydia Jacob Story » de Raymond E. Waydelich
#EXPOSITION [hebdoscope, édition numérique semaine 29]
Espace Muséal Re-Naissance (Hôtel de ville de Ferrette) du 14 juillet au 30 octobre 2022
[des vidéos avec Raymond E. Waydelich sont aussi en libre accès sur place]
=> ses dernières œuvres monotypes „Pompéi”
L’Espace muséal Re-Naissance situé au rez-de-chaussée de l’hôtel de ville de Ferrette, un bâtiment de la Renaissance rhénane daté de 1572, a été inauguré après travaux en octobre dernier par le comte en titre : S.A.S. le Prince Albert II de Monaco. Ce dialogue entre grande et petite histoire se poursuit sous l’égide de l’association Trésors de Ferrette avec le concours de la galerie Courant d’Art (Mulhouse) pour cette Lydia Jacob Story visible jusqu’au 30 octobre. L’exposition est une immersion dans ce futur passé (ou l’inverse…) reconstitué par l’artiste alsacien grâce à une cinquantaine de pièces dont les plus récentes ont été réalisées lors des dernières époques confinées. Une collision temporelle comme les apprécie Raymond E. Waydelich !
Depuis la découverte en 1973 sur un marché aux puces de Strasbourg du carnet de notes (daté de 1890) de Lydia Jacob, cette cousette de Neudorf accompagne Raymond E. Waydelich. Il fabrique les traces, les documents, les hommages, les reliquaires d’une biographie téléportée vers le futur pour mieux évoquer notre présent. Dès 1978 à la Biennale de Venise où il représente la France, il expose « L’homme de Frédehof, 2720 après J.-C. », un environnement qu’il dédie à Lydia Jacob. En 1981, avec des pages annotées, des dessins, peintures, objets, installations, la vie rêvée de Lydia Jacob prend corps au Musée Zoologique de la Ville de Strasbourg.
Le potentiel de ce passé enfoui qui soudain resurgit, il le découvre enfant dans un article du journal de Spirou sur Schliemann (inventeur de Troie). Naîtra une fascination qui ne le lâchera plus et qu’il nourrira : sur les sites archéologiques romains en Algérie durant son service militaire au service photographique des armées (1961), au début des années soixante-dix à Tabarka (Tunisie), à Éphèse, Aphrodisias, Milet, Hiérapolis (Turquie) et surtout en Crète en 1984 avec le choc des figures noires sur les vases minoens.
Dans son travail, il creuse ce sillon du glissement temporel, de cette archéo-fiction qui confronte un futur rétrospectif et un passé prospectif. Une veine qu’il décline en 1983 à Fribourg-en-Brisgau avec le site de Grubierf en 3500 après J.‑C., en 1994 à Villefranche-sur-Saône avec L’Île d’Orsi, 3720 après J.‑C., en 1995 à Strasbourg avec Mutarotnegra*, 3790 après J.‑C. et ce Caveau du futur enfoui sous la place du Château, en 2010-2011 avec les Fouilles récentes de Mutarotnegra* à Réthymon (Crète), puis au musée archéologique de Strasbourg.
*anagramme d’Argentoratum, nom romain de Strasbourg
Pour autant Raymond E. Waydelich n’est pas un artiste du passé, il réussit à faire le grand écart entre l’art pariétal (la récurrence de ces silhouettes aux bras levés) et cet esprit de happening un brin provoquant à la Joseph Beuys n’oubliant jamais son humour pince-sans-rire. D’ailleurs plutôt qu’artiste peintre, il se revendique « marchand de bonheur ! »
Au-delà des figures, des dispositifs, ce qui l’intéresse ce sont ces traces estompées par le passage du temps qui muent quelquefois, mais demeurent malgré tout, têtues, obstinées et nous aiguillonnent, nous rappellent qu’il n’y a pas de génération spontanée, que tout est ancré : les craquelures évoquant les huiles anciennes des Memories painting, le délavé des monotypes „Pompéi”, les feuillets des comptes rendus du comité Coop du siècle dernier support de ses encres de Chine de 2020. Entre hommage et rappel que le passé ne s’efface pas d’un trait de plume, ces télescopages suggestifs imposent l’immuable dans une époque mouvante, évanescente, fragile.
En suivant le fil chronologique de ses œuvres, la figure humaine s’estompe. Restent les mots proférés en phylactères par son bestiaire anthropomorphisé comme dans les cartoons dont il raffole : I love you, Hoplà, I have a dream, Good morning, Live is a hot dream… et des destinations Kreta, Namibia, Alsatia avec les flèches nécessaires pour s’y retrouver dans notre monde déboussolé.
Toutes ces pièces – dessins, peintures, gravures, sculptures, céramiques, collages en 2D et 3D… – imposent un univers singulier aisément reconnaissable illustrant des situations inattendues quelquefois croquignolesques avec des créatures au sourire carnassier. Seuls les volatiles – cigognes, oies, coq… – n’ont pas (encore…) de dents. Des prédateurs aux quenottes acérées qui tendent leur gueule béante vers des saucissons et autres charcuteries : et si la Schmierwurscht* n’était pas seulement cet aliment convoité et « fabuleux », mais comme il le proclame cet « oxygène » si nécessaire dans une société devenue étouffante ? Évoquant les rhinos, les éléphants croqués en Namibie, il lâche : « Et on les tue aussi, on les liquide, on liquide la terre entière, c’est dingue ! » (entretien de mai 2021).
Raymond E. Waydelich ?
Marchand de bonheur certainement, mais la générosité n’empêche pas la lucidité.
* saucisse à tartiner à base de petit cochon rose d’Alsace
Les couleurs du temps
La mémoire des murs de Françoise Saur
#EXPOSITION [hebdoscope, édition numérique semaine 27]
Centre socioculturel Agora (Cernay) du 2.07 au 22.07.2022
Médiathèque de Cernay du 16.09 au 4. 11. 2023

Ce travail de mémoire avec les habitants du quartier Bel-Air à Cernay initié par l’Agora, centre socioculturel, est la troisième collaboration avec la photographe Françoise Saur. Il se décline en photos, entretiens réalisés par des étudiants en histoire à l’UHA, un livre (en préparation) et une exposition.
Et l’engagement de Céline, Nora, Françoise et tant d’autres…
Edward Hopper peignait des êtres en suspension dans des espaces de solitude désenchantée. Dans le quartier Bel-Air de Cernay, Françoise Saur a photographié les espaces vidés de ses habitants avant démolition (en 2022). Plus de locataires, plus de meubles… mais les traces de vie demeurent ! Têtues, touchantes, saugrenues quelquefois.
L’attention portée au traitement de la couleur intensifie la singularité du témoignage de ces fragments. Sur les plans plus larges, la photographe trouve même le rose partagé par Gauguin et Picasso et le bleu limpide du peintre américain magnifiant un espace désinstallé en attente de sa fin. Ses images saisissent la quintessence du souvenir en l’absence de ceux qu’il hante et nous l’offre en réflexion.
Des objets abandonnés – si importants à un moment sans doute – intensifient le sentiment de déshérence, préservent l’empreinte des vies évacuées, des gestes qui se prolongent désormais ailleurs. Surgissent des stigmates aussi déroutants et touchants que ces motifs créés par des papiers peints arrachés évoquant les découpages de Matisse. Une mémoire saisie dans une matérielle et sensible densité sur ces murs maintenant disparus. Ne restent que les images de ce désarroi, de ce bord du temps qui change, bouleverse souvent et emporte les choses et les êtres.
Ce sont les clichés accrochés sur les cimaises, en statique.
En boucle, sur écran, défilent les portraits d’habitants qui ont accepté de poser. Des gens plutôt âgés, venus d’ailleurs – de très loin quelquefois – ou des vallées voisines pour se rapprocher du travail et tous ont fait leur vie dans ce quartier. Ils posent dans leur ancien logement désert, corps en pause dans l’espace vide de leur vie d’avant, mais aussi dans leur environnement d’après, regard enjoué vers l’objectif, nantis d’un pot de fleurs ou d’un autre accessoire. En off la voix de leurs souvenirs raconte…
Des passeurs de mémoires qui tels Les anges protègent les châteaux de sable, pas les châteaux de pierre (Christian Bobin, Un bruit de balançoire, 2017).
la modernité avant la modernité
#EXPOSITION [hebdoscope, édition numérique semaine 25]
Picasso – El Greco à Bâle, Kunstmuseum Basel | Neubau du 11 juin au 25 septembre 2022

Mélancolie métallisée
SMITH DÉSIDÉRATION (Summa)
#EXPOSITION [hebdoscope, édition numérique semaine 26]
galerie de La Filature, Scène nationale de Mulhouse du 31.05 au 25.08.2022
commissariat : Emmanuelle Walter

Vernissage ce samedi 11 juin de l’exposition de Smith. Le photographe avait déjà présenté son travail au printemps dans le cadre des Vagamondes sur une proposition de Christian Caujolle.
SMITH DÉSIDÉRATION est monté en association avec Corps Célestes, 5e édition de la Biennale de la photographie de Mulhouse. Une exposition touffue qui s’inscrit bien dans la thématique de la manifestation, en accès libre dans la galerie jusqu’à la fin de l’été.
Devenu artiste complice de la maison, Smith reviendra mi-mars 2023 installer Transgalactique en tant que commissaire (Superpartners avec Nadège Piton) à l’occasion de la prochaine édition des Vagamondes. Nous l’attendons avec impatience dans ce nouveau rôle – de l’autre côté du miroir – tant son travail d’artiste est dense, polymorphe et gourmand de transdisciplinarité : Explorant la porosité des pratiques artistiques, scientifiques, de la philosophie et des narrations spéculatives, Désidération propose une autre mythologie du spatial. (Lucien Raphmaj).
Dans ses prises de paroles, Smith explique sa démarche avec une généreuse assurance maniant l’incohérence poétique, les oxymores… privilégiant l’élaboration de ses propositions plutôt que le détail des œuvres.
Dans celles-ci, il joue beaucoup sur la profondeur de champ. Son choix de mise au point favorise le plus souvent le paysage et le traitement technique l’impose en espace cosmique, surnaturel, changeant selon les déplacements du visiteur et le glissement de l’éclairage. Un personnage au premier plan souvent flou renforce cette irréalité de la lumière – nuit américaine, celle de vieux films de science-fiction (quand les effets spéciaux se cherchaient) voire l’ambiance suspendue de certains films d’Antonioni – ouvrant vers l’ailleurs, l’imaginaire.
Dans la galerie, Smith a installé un noyau architectural qui à la fois augmente la capacité d’accrochage et favorise une proximité immersive du regard avec l’œuvre modifiant la perception de la feuille d’aluminium du Dibond® – fréquemment à nu quand les surfaces sont unies et claires, suggérant quelquefois le voile d’essuyage d’une plaque avant gravure. Une virtuosité technique qui anoblit certains clichés qui pourraient apparaître banals : un coucher de soleil noir, d’autres jouant avec les codes du selfie…
De ces nombreuses photographies surgit l’impression que le monde (et ce cosmos imaginé) a renoncé aux couleurs sauf pour quelques détails à la marge. Et si elles s’invitent malgré tout, la monochromie en désactive l’éclat tapageur.
Un palimpseste de l’exil
Sauveur Pascual
#EXPOSITION [hebdoscope, édition numérique semaine 21]
Galerie Valérie Cardi (Mulhouse) du 30.04 au 4.06.2022

Le projet s’était noué lors de la dernière édition de St’art (novembre 2021) : une immersion dans l‘œuvre de l’artiste bas-rhinois Sauveur Pascual à la galerie Valérie Cardi (Mulhouse). Ses pièces couvrent une trentaine d’années avec une préférence pour l’acrylique, l’encre et les craies sur papier. De ses toiles souvent carrées, de ses polyptyques avec une attention particulière au cadre et de ses grands formats avec des collages, des phrases écrites (quelquefois à l’envers) émergent l’omniprésence des enfants et une troublante « solarité » : ici cette dense et éblouissante présence du soleil issue de Van Gogh, avec aussi la figure d’Icare (série de 1993) qui s’y brûle les ailes…
À quinze ans, tandis que ses camarades se retrouvent pour jouer de la guitare, de la batterie et montent des groupes de rock, Sauveur Pascual crée un groupe d’art : sa stratégie pour prolonger l’enfance dans l’âge adulte ?
Car de son Autoportrait (1987) en jeune adolescent à ces Paysages d’enfances (2022) en passant par les Enfants d’Izieu (série de 2002), leurs regards hantent ses travaux et nous interpellent. Ils proclament l’évidence d’un monde (en)volé : par la barbarie nazie à Izieu ou ce paquebot qui l’a arraché à l’Algérie en 1962. Même l’oisiveté de ses estivants semble contrainte par ces cadres qui les cernent et, non loin, ce transatlantique esquisse le risque de l’exil. Leurs visages perplexes surgissent de scènes quotidiennes avec un vélo, un cheval sur roulette, sous un parasol ou entourés de signes plus ésotériques, étiquetés de mots découpés dans les pages jaunies de livres pour enfants… L’artiste ranime leur mémoire, anoblit le destin de ces jeunes êtres éliminés physiquement comme ceux d’Izieu (le mémorial lui avait ouvert ses archives photos d’avant la rafle) ou évacués par leur mue en adultes responsables (?). Ces apparitions spectrales ou ostensibles suggèrent le potentiel gâché : seule l’enfance, avec son innocence et son enthousiasme, est capable de régénérer le monde. C’est cette lumineuse horizontalité de l’enfance qu’il faudrait préserver au lieu de s’en remettre à la verticalité du pouvoir.
Son optimisme gourmand d’avenir s’affiche dans la série Bonheurs (2016). Se référant ouvertement à Van Gogh, ses jaunes, ses rouges enfièvrent la si intense lumière d’un été qui ne devrait jamais finir (comme l’enfance…). Ce bonheur est capté dans l’instant, mais l’illusion se dissipe rapidement. La ponctuation des titres en tempère la plénitude. Éden se prolonge d’un « ? » Comme dans la série éponyme, les Cyprès sont couchés…
Dans sa dernière série, Exodes, les activités balnéaires sont récurrentes, mais restent sous la menace du transatlantique (premier vecteur de la globalisation…). Ces polyptyques sont articulés par le blanc systématique des châssis qui à la fois prolonge et cloisonne celui de l’œuvre : solarisation, bois flotté blanchi par le sel… L’éclat de la corrosion : la beauté du Mal dresse ses cases, compartimente le monde (gestes barrières…). Et rend fou : un ciel griffé de noir comme parcouru en tous sens par un supersonique pris au piège. L’incandescente lumière demeure, renouvelée par ce presque noir et blanc scandé d’aplats céruléens. Avec les paquebots, un parfum de nostalgie traverse ses toiles d’une époque à l’autre plutôt que d’un port à un autre. L’enfermement se prête mieux au voyage dans le temps.
Si le peintre évoque Memling, Goya, Picasso, on songe aussi à la narration poétique d’Hugo Pratt et à Corto Maltese comme si l’artiste questionnait l’époque où s’est élaboré le désastre qui s’annonce.
Au fil de la visite, la peinture de Sauveur Pascual apparaît comme un palimpseste de l’exil et c’est avec une vigoureuse lucidité – la blessure la plus rapprochée du soleil selon la formule de René Char –, qu’il répond sans hésiter à la question de Picasso* : qui est l’ennemi ?
– L’ignorance !
*L’art n’est pas fait pour décorer nos appartements. C’est une arme contre l’ennemi.
La question c’est : qui est l’ennemi ?
Pablo Picasso
Chimères d’un monde flou
Nos Îles à la Fondation François Schneider
#EXPOSITION [hebdoscope, édition numérique semaine 19]
Fondation François Schneider (Wattwiller, 68) du 29 avril au 18 septembre 2022
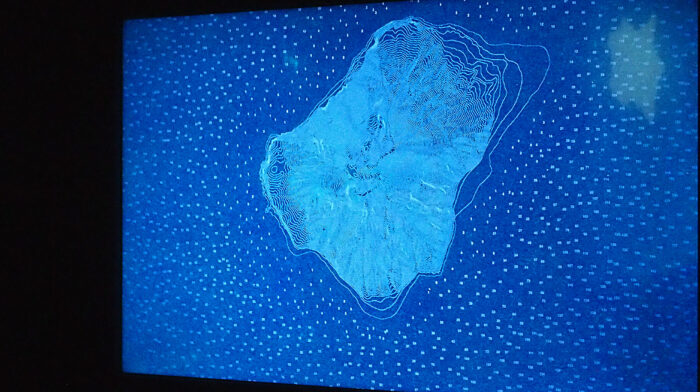
Deux approches du confinement de 2020 étaient possibles. Endurer le joug des restrictions – du hurlement des sirènes à l’obscénité des quotidiennes statistiques – ou cultiver l’imaginaire et – tant qu’à faire – s’inventer libre ! Sur une île qui conjugue liberté et isolement ? Ce fut le choix de Marie Terrieux, directrice de la Fondation et commissaire de l’exposition qui a élaboré cet archipel de 21 propositions (20 artistes). Sa narration rythmée d’extraits littéraires évoque l’insularité en jetant l’ancre sur des territoires troublants ou saisissants.
Le son d’entrée.
Celui de la tempête et du naufrage, échapper/survivre à un monde hostile avant d’accéder à l’ailleurs comme Orphée traversant le miroir : C’est du vent, le noir avec juste une ampoule de cambuse (installation sonore de Philippe Lepeut, 2015). Puis une chicane. Grondement de cataracte dans Le Refuge de Stéphane Thidet (2007) : sa cabane inondée d’une pluie perpétuelle et drue occupe l’espace central de la Fondation imposant sa présence sonore jusqu’à la mezzanine. L’illusion de notre monde – avec ces livres noyés – qui ne nous protège pas ?
Puis Robinson.
En métaphore inévitable du naufragé cherchant à entrer en re-possession de soi et qui se décline en perplexité contrariée (Rodney Graham), en stratégie de survie en milieu hostile (Abraham Poincheval ou Gilles Desplanques), en convoquant des images d’archives pour une autofiction filmée sur l’île aux naufrages (Eleonore Saintagnan, Une fille de Ouessant, 28 min, 2018), en réinventant un hédonisme familial enjoué d’un paganisme facétieux (photos de Yohanne Lamoulère).
Avec Vendredi.
Et s’ouvrir – prudent – à cette nouvelle altérité avec l’inquiétant tribalisme de masques vaudous (Pierre Fraenkel), le kitch des vahinés filmées – à Toulon ! – (Charles Fréger), l’échouage de nos totems quotidiens (Axel Gouala) ou l’ombre portée de notre dite civilisation externalisée sur l’île prison de Manus Island avec le diptyque vidéo d’Hoda Afshar (Remain, 2018).
Et la nature.
Déroutante forcément. En Palmier synthétique et carbonisé (Sébastien Gouju), âprement minérale (photos de Cécile Beau) ou fragile et sédimenté avec une grâce corallienne : les faïences et porcelaines émaillées de François Génot (2022).
Mais l’artificialisation des esprits produit aussi ce rêve climatisé pour touristes en goguette balnéaire entre eaux turquoise et superstructures d’extraction minière sur Yali en mer Égée (installation vidéo d’Olivier Crouzel, 2021).
Arpentage enfin. Et nommer ! Pas de survie sans contrôle…
Exploration et identification de ces terres par la cartographie comme outil de survie (Benoit Billotte) ou d’appropriation du monde – en 80 jours et 331 pages (Aurélien Mauplot).
Pulsations cyanotiques des hauts fonds comme sur ces écrans de guerre ou de catastrophe : la sophistication des onze Haïkus cartographiques de Pauline Delwaulle (2019) détourne celle des moyens d‘inventaire et de toponymie.
Au revers, un planisphère activant les liens entre nos îles continentales, fresque rouge sang sur les eaux globales dégorgeant sur le sol ses écheveaux cramoisis (Brankica Zilovic, Embrace again, 2018).
Le son vibrionne aussi dans ce sous-sol, plus délicatement. Respiration champêtre de la chimère sonore (P. Lepeut) ou le subtil tintinnabulement des coquillages cueillis sur l’estran de Gdansk et agités par une brise (Stéphane Clor).
Nos îles explorent une insularité flottante, vibrante de questions et d’ambiguïté, d’inventivité et de virtuosité technique aussi qui, agrégées en archipel, interrogent la sauvagerie. Ailleurs ? Ou ici ? La nôtre ?
Judith Schalansky (Atlas des îles abandonnées, 2010) suggère :
Le paradis est peut-être une île. L’enfer en est une autre.
Addendum du 20 mai 2022.
Marie-Anita Gaube, M’hammed Kilito, Eva Medin et Sarah Ritter sont les 4 lauréats du concours Talents Contemporains 2022. Leurs œuvres rejoindront la collection de la Fondation.
Le jury était placé sous la présidence de Jean-Noël Jeanneney. 432 artistes originaires de 36 pays avaient candidaté.
Apesanteur géométrique
Marcelle Cahn, En quête d’espace
#EXPOSITION [hebdoscope, édition numérique semaine 18]
Musée d’Art moderne et contemporain de Strasbourg du 29 avril au 27 août 2022, catalogue 44 €
Musée d’art moderne et contemporain Saint-Étienne Métropole (MAMC+) du 15 octobre 2022 au 5 mars 2023
Musée des Beaux-Arts de Rennes du 1er avril au 30 juin 2023

Même si elle était d’un naturel discret et modeste, Marcelle Cahn s’est beaucoup impliquée dans l’effervescence artistique d’avant et d’après-guerre. Sa réserve, son engagement pour le travail de ses collègues et des moments d’éclipse ne lui ont pas permis d’acquérir la notoriété qu’elle méritait. Trois musées qui ont beaucoup enrichi leurs collections grâce à elle lui rendent aujourd’hui hommage à travers cette exposition monographique. Le MAMCS en tout premier qui a bénéficié en 1980 d’une importante donation de l’artiste, avant Saint-Étienne et Rennes. L’itinéraire qu’a élaboré la commissaire Cécile Godefroy est fort logiquement chronologique avec plus de 400 pièces.
Née en 1895 à Strasbourg où elle prend ses premiers cours de dessin, Marcelle Cahn déménage à Berlin avec sa famille en 1915 en raison du premier conflit mondial. Elle y côtoie aussi bien des représentants de la Sécession (elle sera l’élève de Lovis Corinth) que les expressionnistes à la galerie Sturm. Quelques pièces attestent ces influences notamment une huile traitée en pleine pâte : Nu berlinois (1916). Des Cygnes, l’élan des Trois biches, figures très graciles, préfigurent la future légèreté de sa ligne et de sa touche (Cat. 37 & 38, 1914).
De 1920 à 1930, elle s’installe à Paris avec de fréquents séjours à Strasbourg. Elle y suivra les cours de Fernand Léger et d’Amédée Ozenfant dont elle gardera les couleurs plus sourdes et un goût pour l’épure. Si son geste reste figuratif, il articule désormais les volumes suivant les leçons du cubisme. La figure humaine entre en concurrence avec le décor : vases, raquettes, rames, rues… Elle participe à des expositions collectives et gagne l’estime de ses pairs : Guitare et éventail (1926) ou Femme à la raquette (1927). Avec les mêmes profonds aplats, elle peint ses premières Compositions abstraites (1925). Parallèlement les corps s’étirent (La Nageuse, 1930), deviennent fluides (Personnages (Profil bleu), vers 1948) cherchant sa voie dans cette tempête que nous appelons le progrès selon le mot de Walter Benjamin (1940).
Le mystère demeure sur son retour à Strasbourg en 1930 où elle cessera quasiment de peindre, se consacrant au dessin sur le motif… Cet ascétisme et cette discrétion se prolongeront à Toulouse où sa famille se réfugie en raison de la guerre et du risque de déportation.
Dès 1946, elle retourne à Paris et s’installe en 1952 dans un logement-atelier rue Daguerre. Une année charnière avec sa première exposition personnelle et un changement de style. Avec des compositions d’une rigueur limpide affinée jusqu’à la transparence sur l’écrin de l’absolu blanc, elle tente de reconstruire un monde fragile, mais joyeux et coloré. Une période très prolixe où dominent les verticales et les horizontales qui s’élargissent en fins rectangles rompues quelquefois de cercles par l’ajout de pastilles, de sphères en surépaisseur. Des propositions composées à la fois d’une fugue graphique avec la subtile mise en résonance de couleurs délicatement choisies et de sa partition. Certaines évoquent des plans d’urbanisme, puis, vers 1960, quelques-unes semblent chercher la perspective avec des diagonales, des lignes de fuites quêtant la troisième dimension. Elle se concrétise dans sa série Spatials (1966-1976) avec leurs plans pliés ou rabattus et avec deux sculptures inaugurées en 1976.
Résidente à partir de 1969 à la Fondation Galignani à Neuilly (jusqu’à son décès en 1981), elle réalise de nombreux collages utilisant des objets quotidiens, des gommettes, des cartes postales… Une féerie plastique et ludique – faisant surgir un personnage d’une enveloppe (Cat. 227, 1977) – fruit d’un enthousiasme de gamine guillerette qui devise, assise sur son lit et entourée de ses découpages, avec Pierre Gisling en 1976 (film de Louis Barby pour la collection Clés du regard, 40 min, visible en fin de parcours) :
Je ne réfléchis jamais. Je fais quelque chose et puis je m’envole.
Commissariat : Cécile Godefroy
avec Barbara Forest (MAMCS) et Alexandre Quoi (MAMC+)
Chemins de désirs
J’ai aimé vivre là de Régis Sauder (2020)
avec la participation et les textes de Annie Ernaux
#CINÉMA [hebdoscope, édition numérique semaine 16]
documentaire sorti en salle en juillet 2020 (89 min)
Régis Sauder a rencontré Annie Ernaux en marge d’une projection de son Retour à Forbach : un documentaire où la maison de son enfance est vidée, métaphore d’une ville qui se vide… de son activité et sans doute un peu de son âme. De cette plume, de cette caméra qui racontent, traquent la vitalité des « quartiers » devaient forcément naître un projet partagé. C’est J’ai aimé vivre là. Là, c’est Cergy-Pontoise (210 000 habitants), ville nouvelle surgie de nulle part dans les années soixante-dix et où Annie Ernaux vit depuis vingt ans. Sorti en 2020 dans les turbulences des restrictions sanitaires, le film prolonge sa carrière en parallèle du dernier opus du réalisateur : En nous.
Les chemins de désirs sont ces itinéraires qui naissent, se gravent sous les pas des usagers, des riverains et que les urbanistes, les architectes n’avaient pas prévus. Une appropriation têtue et dynamique qui redessine les aménagements en cité rêvée. Des lignes microscopiques quelquefois – pour gagner cinq secondes –, mais surtout la vie qui s’empare des lieux : y échanger, y partager, y apprendre, y chanter et danser… Un vaste mouvement qu’insufflent les habitants à leur espace et qui innerve le film.
Au début, le RER nous mène à Cergy avec les visages de passagers que le spectateur apprendra à connaître. Vers la fin, l’usage du roller amplifiera la respiration de ces espaces urbains. Des trajectoires régulièrement ponctuées par la silhouette d’un couple qui s’embrasse comme un leitmotiv de sens et de promesses. En cinquante ans, la végétation aussi a conquis le minéral magnifiant les images de Tom Harari. Même les départs – souvent pour poursuivre des études – sont des aboutissements teintés de regrets par la crainte du déracinement.
La poésie des textes d’Annie Ernaux, lancinants, obsédants, tresse une tonalité mineure, mais résonne toujours du regard empathique pour tous ces êtres qu’elle côtoie. Des corps trop souvent saisis par le maussade rituel des courses au supermarché et le métro-boulot-dodo – scandé comme un rappel à l’ordre par cette énorme horloge de la gare qui toise la foule industrieuse.
Un film choral dont l’écrivaine serait l’aède et les habitants les choristes qui, tour à tour, lisent ses textes et se racontent avec leurs mots. Des visages, des sourires, beaucoup de complicités que fait revivre le réalisateur. Une jeunesse d’âme et un enthousiasme partagés tant par les adolescents nés là que les anciens qui ont fait souche voilà des décennies. Un terreau humain qui perpétue aussi la solidarité et l’accueil bienveillant des premières années quand la France manquait de bras – la patinoire est devenue centre d’accueil pour migrants. Tous partagent leurs lignes de vie : des coins de parc, des bords d’Oise, des bouts de jardin avec d’amicales tablées qui tissent les liens à l’écart du spectaculaire urbanistique – l’Axe majeur tourné vers celui de la Défense, la pyramide inversée de la préfecture, la place des colonnes-Hubert Renaud, la gare…
L’utopie est dans les gens qui font la ville, lui donne cette incroyable énergie comme le suggère le réalisateur qui compose ici une cartographie subjective et humaine en contrepoint des mots d’Annie Ernaux. Au fil de ses voyages, Nicolas Bouvier avait dressé ce bel Usage du monde, Régis Sauder, de film en film, dresse ce bel Usage de la Ville.
documentaire de Régis Sauder
image : Tom Harari, Régis Sauder ; montage : Agnès Bruckert ; son : Pierre-Alain Mathieu
production : Thomas Ordonneau (SHELLAC)
The Safe Place
En nous de Régis Sauder (2021)
#CINÉMA [hebdoscope, édition numérique semaine 14]
documentaire sorti en salle en septembre 2021 (89 min)
En 2009, Régis Sauder avait filmé une quinzaine de jeunes des quartiers nord de Marseille (une ZEP) qui s’emparaient d’un texte du XVIIe siècle et, grâce au filtre des mots de madame de Lafayette, évoquaient leur vie, leurs difficultés, leurs rêves… C’était le très beau : Nous, Princesses de Clèves. Ils et – surtout – elles étaient en première ou en terminale et passaient le bac. La plupart l’ont eu, d’autres pas. Dix ans plus tard, le réalisateur les interroge à nouveau : Quand je les ai retrouvés pour entamer l’écriture de ce film, j’ai été frappé par leur force, leur aptitude à déjouer les schémas d’un verdict social qui les voudrait courbés, soumis, radicalisés…
S’il filmait beaucoup les visages, le réalisateur capte ici la gracieuse chorégraphie des corps qui marchent, conduisent, s’approprient l’espace urbain, le paysage – les parcs remplacent les cours et le béton. Il tisse aussi le temps entre le passé – quelques archives des Princesses – et le présent forcément plus terne. Les images sont tournées pour l’essentiel au début du 2e confinement (novembre 2020). Un contraste qui accentue la couleur de leur vie présente devenue sérieuse. Des lunettes mangent quelques visages. Au gré des échanges sont évoqués des enfants nés depuis, des séparations aussi, une responsabilité et des chemins de vie pas toujours faciles. Cependant par deux ou trois, le lien perdure et les rires, les partages renaissent avec le verdict du réalisme qui sanctionne désormais les départs de rêve. En dix ans, ils ont déjà beaucoup vécu mais l’engagement prend le pas sur la révolte.
Le Nous des titres est essentiel pour Régis, ses témoins, ces jeunes devenus adultes. Et si lucides sur leur condition. Être ou ne pas être, pour eux, la question ne se pose pas. Ils sont, envers et contre tout. Avec un peu d’amertume, car l’égalité des chances n’est pas vraiment au rendez-vous et la société leur renvoie obstinément leur condition d’origine, leur couleur de peau… un parfum discrètement patriarcal voire colonial malgré des avancées.
Si l’ascenseur social est en panne, Armelle défend le service public pour qu’il ne le soit pas définitivement. Laura, docteur en pharmacie, évoque l’insertion professionnelle bien plus facile pour les camarades issus de milieux favorisés.
Au fil des conversations surgit ce maillon essentiel de leur réussite : l’école de la République et l’entrée au lycée pour décrocher le bac qui semble conjurer la prédestination à l’échec. En creux se dessine le schéma qui marche : l’appui du ou des parents avec l’indispensable soutien humain et matériel des services publics, l’école en tout premier.
Et c’est là où le bât blesse.
En fil rouge du documentaire, la voix off dite et écrite par Emmanuelle, professeure de français depuis 15 ans au lycée Denis-Diderot, traduit le sentiment partagé par ses collègues et le réalisateur. Le désengagement de l’État enfonce le clou de la marginalité au nom d’une fictive rentabilité (ZEP, etc. : tous ces changements de noms avec toujours moins de moyens) favorisant le focus sur les voitures brûlées, les trafics et les règlements de compte. Le jeune Abou établit un constat similaire à l’hôpital : épuisé par sa tâche d’infirmier en France et le sentiment de ne plus être au service des patients (60 à gérer), il a trouvé un poste à Lausanne où il s’épanouit (avec seulement 15 patients).
Alors ?
Croire en Nous. Préserver et solidifier entre nous ce commun nécessaire : la bienveillance au bon sens du terme et au bon endroit, à l’opposé du laxisme brandit par certains. C’est ce qu’ont réussi ces jeunes : investir the safe place, pas seulement matérielle, mais en termes d’éthique, d’intelligence, de conduite de vie.
La galère – quelquefois noire – serait-elle le préalable pour ouvrir notre conscience vers une lumineuse épiphanie ?
Avec l’obligation de provoquer le miracle qui peut nous sauver…
documentaire de Régis Sauder
image : Aurélien Py, Régis Sauder ; montage : Agnès Bruckert ; son : Pierre-Alain Mathieu
production : Thomas Ordonneau (SHELLAC)
Esthétique des ruines
La dernière nuit du monde
Laurent Gaudé
#THÉÂTRE [hebdoscope, édition numérique semaine 12]
Les Vagamondes 2022, représentation du vendredi 18 mars 2022 à La Filature, Mulhouse
En lisant le postulat du spectacle – supprimer le sommeil –, instinctivement c’est le fameux travailler plus pour que le capital gagne plus qui vient à l’esprit. Et comme c’est l’ingestion d’une pilule révolutionnaire qui active la capacité de veille, s’invite la stratégie vaccinale toute récente avec son ambition d’unanimité totalitaire – et les auteurs revendiquent l’influence de cette période pandémique dans leur inspiration. Très vite cependant, avec ce bouleversement des cycles naturels et l’instauration d’une nuit active, d’autres questions surgissent. Que devient tout cet espace de liberté brusquement anéanti : le lien et le festif, l’amour, le rêve, etc. ?
Dès l’entrée du public, un gigantesque écran carré au centre du plateau pulse de visages et de voix. Un premier cadre. Deux rectangles lumineux au sol s’y ajouteront : les espaces dédiés au personnage principal, un des promoteurs du projet (joué par le metteur en scène Fabrice Murgia lui-même), et à sa femme Lou (Nancy Nkusi) qui imposent d’emblée la distance entre les êtres. Autour l’environnement reste plus indistinct, se nappe de fumerolles et sera la neige de la fin. Les lumières d’Emily Brassier sculptent de belles images focalisées par ce qu’affiche l’écran : des flashs angoissés (tels des images subliminales), des témoignages venant de l’autre bout du monde (le projet est planétaire), beaucoup de gros plans en direct de la comédienne notamment lorsqu’elle chante. Des visages qui disent, se disent avec régulièrement des répliques qui font mouche. Les trois cadres structurent le jeu. Si l’écran offre une dimension cinématographique à Lou qui épure, le dispositif enracine les comédiens et mène par moments l’acteur vers une surexpressivité corporelle. Des ego en naufrage sur leur radeau de lumière ? Un corps qui se rebelle ou pris de convulsions par manque de sommeil ? À la fin, le couple se retrouvera en dehors de ses cadres. Dans l’au-delà, au-delà de ce monde qu’il a contribué à fabriquer… ou à détruire.
Car évidemment tout déraille : les corps, les mécanismes physio-biologiques avec des conséquences sur l’écosystème et les autres créatures qui nous tournent le dos : tout est tordu. Une caricature d’anthropocène.
Sans nuit, les yeux saignent et, avec la nouvelle frénésie, plus personne ne prend le temps de protéger le peu qui reste. Le système lui trouve du temps supplémentaire pour travailler à sa propre perte, produire de nouvelles ruines. Décidément la technologie ne nous sauvera pas, bien au contraire, elle nous décimera comme l’ont été les populations amérindiennes par l’irruption des maladies importées par les conquistadors.
D’ailleurs la technologie sera-t-elle capable de perdurer sans nous ? Sans le dévouement de ses officiants humains ?
scénographie Vincent Lemaire, création vidéo Giacinto Caponio, création son Brecht Beuselinck
• Spectacle donné dans le cadre du festival les Vagamondes 2022 (15-27/03) qui expose aussi The Nemesis Machine, la vibrionnante métropole high-tech de Stanza jusqu’au 27 mars (sur la mezzanine) et l’apesanteur plastique des photographies de SMITH jusqu’au 7 mai (dans la galerie).
Désactiver l’Incontrôlable !
L’homme qui tua Mouammar Kadhafi
Superamas
#THÉÂTRE [hebdoscope, édition numérique semaine 12]
Les Vagamondes 2022, représentation du mercredi 16 mars 2022 à La Filature, Mulhouse
Dans le cadre du festival les Vagamondes, la Filature a accueilli une proposition de théâtre documentaire et interactif sur le renversement de Kadhafi imaginée par le journaliste politique Alexis Poulin et le collectif Superamas. Ils ont convaincu un véritable maître espion en poste à Tripoli de 2007 à 2011 de témoigner à visage découvert afin de préciser les dessous de l’implication du Libyen dans la présidentielle française de 2007 et de son retour en grâce internationale jusqu’à sa chute planifiée le 20 octobre 2011.
Avec la tension du direct, Alexis Poulin est dans son rôle de journaliste d’investigation (à un moment, il était question de publier son enquête en livre). Il détaille l’enchaînement des faits, le rôle des différents protagonistes matérialisés sur scène par des portraits manipulés comme des pions sur l’échiquier international. En maître des horloges, il accueille cet ancien agent de la DGSE, l’interroge, invite les spectateurs à poser leurs propres questions (et ils ne s’en privent pas).
Les tenants et les aboutissants, les manipulations aussi (les fake news avancées par Al-Jazeera) s’exposent sous nos yeux et révèlent le narratif pour « vendre » à l’opinion le renversement de l’incontrôlable dictateur Libyen par le CNT. L’ex-espion (son nom n’est pas mentionné) raconte sobrement la fin du fantasque dirigeant tempérant le sensationnalisme de ce moment sordide dont des images avaient circulé sur les écrans. Il s’interroge aussi sur ce geste de mort : Qu’est-ce qui compte véritablement dans cette histoire ? Est-ce que c’est le nom de l’homme qui a appuyé sur la gâchette ou c’est le nom de celui qui lui en a donné l’ordre ?
C’est d’ailleurs ce sentiment d’être trahi et de ne plus agir pour l’intérêt général qui lui a fait renoncer à cette carrière.
Le journaliste le rappelle au début : cette forme théâtrale veut prendre le temps de l’intelligence, ce que ne permet pas le plateau de télévision (ou les joutes des réseaux sociaux) qui attise l’urgence et l’affrontement des postures idéologiques plutôt que de poser les enjeux y compris sous-jacents, ceux de la géopolitique (et de l’économie !). Contrairement à un livre, elle permet l’échange avec le public (très impliqué ce soir-là) et donne une densité concrète à ces événements, ces personnalités.
À démonter le complot (le plot des scénarios hollywoodiens), la pièce interpelle aussi sur la transparence et la vocation de la guerre lancée au bénéfice d’intérêts privés ou du pouvoir de quelques-uns sous prétexte de libérer un peuple avec le story telling émotionnel qui assure l’après-vente. La manipulation des masses n’est pas une exclusivité des régimes totalitaires et nos démocraties ne s’en distinguent que par quelques nuances de brutalité.
Malheureusement l’actualité nous confronte à une tragédie de plus où quelques ego se purgent à nouveau dans le sang des Autres. Des Autres toujours trop nombreux à pleurer, saigner, mourir.
Urgence avant dispersion
Françoise Saur
Ce qu’il en reste
#EXPOSITION [hebdoscope, édition numérique semaine 10]
Musée des Beaux-Arts (Mulhouse) du 5.03 au 15.05.2022
#LIVRE Prises de vie / photographies de Françoise Saur, suivi de Dernier feu, nouvelle de Nicolas Bézard (Médiapop Éditions, 160 p., 16 €)

Pour honorer l’invitation du Musée des Beaux-Arts de Mulhouse (lancée en 2017, mais mise en œuvre avec la conservatrice Chloé Tubœuf seulement en 2021 en raison de la pandémie), Françoise Saur propose une plongée dans la mémoire intime et la décline en cinq Chambres. Deux pistes s’y croisent. Des « photos d’inventaire » réalisées lors du rangement des biens de ses parents décédés – c’est sa toute dernière série – et un film projeté dans la « Chambre 3 » réalisé à partir du journal qu’elle tient depuis les années soixante-dix : Prises de vie.
Un envoûtant travail de mise en beauté du temps.
L’exposition associe des objets réels (photos d’archive, lingerie, collections, etc.) qui deviennent vestiges de civilisation dans l’espace muséal avec, aux murs, une mise en scène de ces fragments de vies photographiées par l’artiste. Son travail sur les rendus en grands formats leur donne une spectaculaire matérialité – dans un premier mouvement, le visiteur croit voir l’objet réel dans ses trois dimensions – et les magnifie jusqu’à la transcendance de certaines natures mortes ou vanités qui jalonnent l’histoire de la peinture. Au-delà de la profondeur, c’est le temps et la densité de la mémoire qu’installe son travail. C’est particulièrement sensible dans la Chambre 1 : Les Malles (anciennes, tapissées de tissu à l’intérieur) composent d’exubérantes partitions avec leur contenu en déballage. Françoise a ce don d’élargir le champ des deux dimensions du cadre vers l’universalité, comme si elle rendait palpable à travers une banale liste de courses le festin qui suivra.
Si la présentation peut évoquer un cabinet de curiosités (l’inévitable vintage de certaines pièces l’aiguise), plutôt qu’exotiques, les objets sont ceux du quotidien d’hier, d’avant-hier anoblis par la distance temporelle et le regard de l’artiste. Ces reliques – lettres d’amour (une pile équivalente à une ramette), télégrammes, diplômes, cartes postales, clefs, médailles, vaisselle, etc. – s’affichent aussi précieuses que celles de personnalités consacrées par l’histoire et suggèrent la substance de la Vie plutôt que le récit biographique.
Prises de vie, le film co-réalisé avec Joris Rühl, plonge dans son cercle familial et amical, capte les moments joyeux et festifs offrant un contrepoint gorgé de sève aux objets forcément statiques exposés par ailleurs.
La complicité de Philippe Schweyer (Médiapop) lui a permis d’éditer en livre les photos utilisées prolongeant Les années Combi de 2017.
L’exposition est aussi emblématique du parcours de la photographe. Connue pour ses clichés noir et blanc en argentique, elle a toujours tiré elle-même les épreuves dans sa chambre noire délaissant la couleur beaucoup trop contraignante. Les logiciels de retouches d’image lui ont permis de trouver une maîtrise comparable de la gamme chromatique et de migrer vers le numérique. Compositions sur le marbre (2019, deux clichés de la série sont visibles au rez-de-chaussée), exposées au MAMCS durant l’été 2021, avaient déjà permis d’admirer cette évolution. Fascinant passage d’un monde où le noir et blanc captaient l’intensité de la Vie vers la couleur qui en sédimente les traces luxuriantes comme la poussière sur cette pile de livre (Chambre 2 : Les Accumulations) – le savoir, l’intelligence délaissés par la culture 2.0 ?
Ce qu’il en reste ?
La délicatesse du temps qui passe, l’air de rien, et la puissance thaumaturge des images de Françoise Saur !
Intime violence
Louise Bourgeois x Jenny Holzer
The Violence of Handwriting Across a Page
#EXPOSITION [hebdoscope, édition numérique semaine 8]
Kunstmuseum Basel – Neubau du 19 février au 15 mai 2022
#LIVRE The Violence of Handwriting Across a Page / livre d’artiste, CHF 75
commissariat : Jenny Holzer avec Anita Haldemann

ARTIST ROOMS: Tate and National Galleries of Scotland. Lent by Artist Rooms Foundation 2011
Le Kunstmuseum Basel a donné carte blanche à Jenny Holzer pour une exposition hommage à Louise Bourgeois (1911-2010). Sa proposition, à la fois intelligente et admirative, est très respectueuse du travail de son aînée. Elle lui laisse l’essentiel des cimaises du Neubau puisque ses propres œuvres, élaborées avec des sentences de Louise Bourgeois, sont réservées aux projections dans l’espace public (sa marque de fabrique). L’originalité de son engagement se retrouve dans la mise en scène exigeante des œuvres avec en fil rouge les mots. Et Louise Bourgeois écrivait. Beaucoup !
Lavis rouge, hachures rouges, écriture au stylo rouge – rouge sang !
La violence de l’écriture saignant la page… comme l’indique le sous-titre de l’exposition. L’écriture ensanglante le papier, le biffe, le gondole, ajoute l’incendie de sa violence à l’obstination répétitive du trait, du geste. La commissaire accentue la dimension sérielle dans sa mise en espace qui décline la détermination compulsive de la plasticienne à chercher le signe juste, la représentation pertinente d’un feuillet à l’autre et tente de comprendre cette brutalité, cette barbarie dont le sens échappe, reste hors champ.
Les gros plans pleine page du livre d’artiste édité pour l’occasion – conçu également par Jenny Holzer – prolongent ce parti pris radical avec en regard les tourments et les horreurs de quelques anciens appartenant au musée : les pendus de Callot, Baldung Grien (Le suicide de Lucrèce, c. 1520), Holbein, Schongauer, Munch…
Les motifs répétitifs, superposés, alignés suggèrent la même vertigineuse aspiration que le tunnel de la Montée des bienheureux vers l’empyrée de Bosch, mais comme immobilisée, avec la profondeur qui résiste, s’aplatit devant l’évidence de la finitude, celle des organes, de la déchirure de l’enfantement, de l’affrontement des sexes qui ouvrent vers un piège au lieu du paradis promis, suscitant par moments un sentiment d’étouffement.
En 1990, Louise Bourgeois suggérait : « être artiste implique une forme de souffrance. Voilà pourquoi les artistes se répètent – parce qu’ils n’ont pas accès à un remède » (Freud’s Toy). Si elle avait assisté aux côtés de Rembrandt à La Leçon d’anatomie du docteur Tulp (1632), sans doute qu’elle n’aurait retenu que le sanglant contenu des haricots et l’écarlate éviscération de la dépouille ! Mais au XVIIe siècle, la civilisation cherchait encore à (se) comprendre, aujourd’hui il n’y a plus rien à comprendre : le monde est une stupeur comme l’écrivait le philosophe Jean-Luc Nancy.
Et que faire contre cette cruauté clandestine ? Il y a la révolte et pour la partager, les images de ces organes crus, des corps qui n’en sont plus. Et les mots !
Jenny Holzer s’empare de ceux de son aînée et les met en scène, en dialogue. La rencontre a lieu dans cet espace des mots : leur récurrence obsessionnelle, leur questionnement, leur figuration, leur capacité à détourner – plaques funéraires, bannières, cahiers… Plutôt qu’un remède, ils trouvent le dérisoire : le poids du quotidien (The Hour of the Day, 2006), le passé (ces paysages de la Bièvre où elle a passé son enfance : La Rivière gentille, 2007) ou la provocation de The Destruction of the Father (1974-2017), de ces mannequins pendus enchevêtrés… Quitte à en conjurer la brutalité par une page entière couverte de Je t’aime (1977). Et puis, la couture (ses parents avaient un atelier de restauration de tapisseries) qui raccommode un cœur entouré d’aiguilles et de bobines de fils (Heart, 2004) : pour le réparer ou l’écorcher ? Ambiguïté d’une mécanique qui couture les sentiments pour mieux se les approprier dans le moule du patriarcat.
Le sens, l’âme ? La réponse de Louise Bourgeois, c’est le sang ! Cette figure du désespoir scellant notre impuissance…
Retisser l’espace en bataille
Maurice Mata
Entre les lignes !
#EXPOSITION [hebdoscope, édition numérique semaine 11]
Galerie Valérie Cardi (Mulhouse) du 12.03 au 16.04.2022

Pour cinq semaines, la galerie Valérie Cardi accueille le travail de Maurice Mata que le musée des Beaux-Arts de Mulhouse avait exposé en 2014. L’artiste a eu plusieurs vies : éditeur, courtier en art… et bien sûr peintre. S’il a vite déserté les écoles d’art et ne revendique aucun maître, il reconnaît volontiers des influences : Soulages et sa série Outrenoir ou la récurrence du bleu Klein (dont il a élaboré son propre mélange plus stable que l’original selon ses dires :-)
Fervent adepte de l’abstraction, Maurice Mata avance d’emblée son refus de donner à ses œuvres un titre qui briderait l’imagination du visiteur. Il en est presque à regretter la trop grande figuration de sa série inspirée par les masques africains. Une envie de délivrer un secret tout en l’enfouissant profondément sous la géométrie ?
Si, notamment pour ses travaux récents, Soulages se caractérise par un geste ample imposant de (très) grands formats, une quasi-exclusivité de la matière noire et une direction identique des traces, Maurice Mata articule chaque toile – souvent carrée – en une entité géométrique diffractée : l’ostinato d’un thème principal affronte en contrepoint suspendu un motif voisin ou tranché selon la pièce. Un ordre en apparence nettement établi bousculé par un intrus ou une trahison, une tentative de perfection contrariée ou rompue par une saignée incendiaire. Quelquefois de ses jeux de diagonales, de rectangles, de lignes scrupuleusement alignées surgit la profondeur de la troisième dimension. Le damier devient labyrinthe, mais discret comme si, trop enraciné dans la toile, il hésitait/renonçait à prendre son envol.
Si le peintre superpose les couches, celles-ci s’échappent de l’oppression de la supérieure imposante, mais parcellaire. Naissent de subtiles nuances favorisant la vibration de tons proches : si l’incidence de la lumière fait vivre ses noirs, leurs marges sont contaminées par l’outremer sous-jacent. La défaite assumée de l’opacité plutôt que la victoire de la transparence crée ces débordements, ces frontières fragiles, mais impertinentes.
Cette netteté laisse peu de place aux courbes. Pourtant l’esquisse d’un paysage se devine parfois, mais une dominante rouge semble vouloir en désamorcer la tension figurative.
Des rêves géométriques que l’artiste transcrit directement sur la toile retissant le support en champ de bataille aussi tourmenté que feutré.
Sobriété bienheureuse
Françoise Ferreux
De la présence de la nature
#EXPOSITION [hebdoscope, édition numérique semaine 4]
Espace d’Art Contemporain André Malraux (Colmar) du 15 janvier au 13 mars 2022

Au rez-de-chaussée de l’Espace Malraux à Colmar, une Collection (l’artiste revendique le mot) de sculptures en brins de lin cousus avec du fil de coton. Aux murs de la mezzanine, des dessins au feutre noir sur papier. Et deux choix exigeants : la sobriété et la monochromie – grège en bas, noir en haut.
Avec ces quinze tables carrées spécialement conçues pour offrir aux pièces une présentation horizontale, le White Cube prend des allures de musée zoologique avec l’éventaire raisonné d’une naturaliste qui aurait collecté des tests d’oursins, des coquilles de nautiles ou de crustacés voire des bois flottés rejetés par le ressac et qu’elle aurait patiemment répertoriés avant de les exposer. Le matériau est pour beaucoup dans cette première impression : calcaire et sable avec la brûlure du temps qu’évoque la teinte écrue du lin. Mais d’autres similitudes surgissent et la fantaisie s’enflamme vers des spécimens inédits minutieusement (re)constituées. Des sculptures molles que le visiteur a envie de toucher (malheureusement c’est interdit, les pièces étant fragiles).
Françoise Ferreux fabrique et invente (plutôt dans cet ordre) des créatures, des organismes, des objets tout en fils de lin cousus ensemble (celui en coton est invisible sauf certains nœuds). Pas de tressage, ni de tissage. Et une évidente affinité avec ce textile (depuis 2008) et son ancrage : les bandelettes des momies égyptiennes étaient en lin et son usage était majoritaire jusqu’à sa marginalisation au XIXe siècle par le coton plus propice à la mécanisation.
D’en haut, le regard appréhende l’ensemble de la Collection. Sur un des murs – les autres sont nus –, une citation de Marcel Conche extraite du livre (2001) qui donne son titre à l’exposition.
L’artiste invoque volontiers ce philosophe (centenaire en mars) : L’évidence de la Nature et l’évidence de la mort ne sont qu’une seule et même évidence. Droit de vie, droit de mort… et Françoise Ferreux assume ce provisoire. Ses sculptures peuvent se découdre, se défaire. Néanmoins elle donne figure à l’infigurable et mesure à l’incommensurable. Un geste d’incarnation.
Ses dessins au feutre s’inscrivent dans la même démarche. Celui du geste : une forme minuscule – boucle, hachure, maille, lignes parallèles… – dont la répétition engendre les représentations – microcosme ou macrocosme – avec plis et replis, textures végétales ou minérales, cartographie ou drapés… Le faire précède le concept et une énergique vie du trait sous-tend la maîtrise technique alors que ses œuvres dégagent beaucoup de douceur.
Linné considérait que la connaissance scientifique nécessite de nommer les choses. Aujourd’hui celles-ci disparaissent, alors Françoise Ferreux dessine, coud, fantasme de nouveaux spécimens pour compenser cet appauvrissement taxinomique. Avec une exigeante modestie.