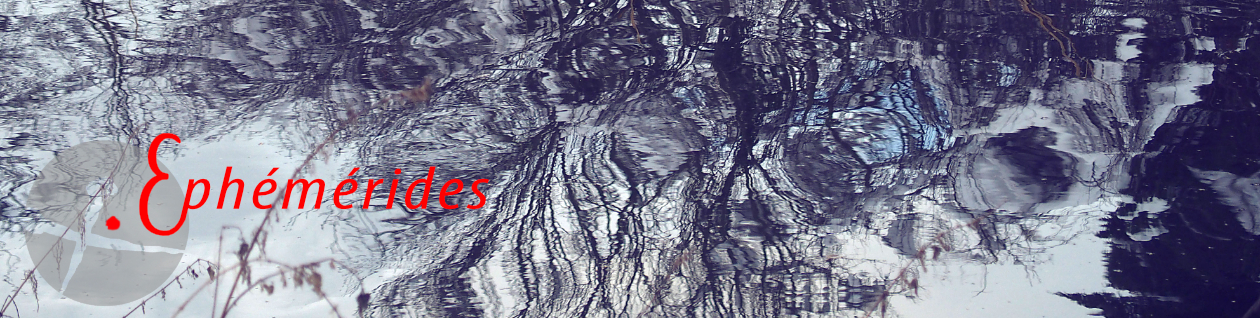un regard et des choix – forcément subjectifs – sur l’offre culturelle 2023…
#LIVRES : Antigraffitisme (Jean-Baptiste Barra & Timothée Engasser), La guerre des mots (S. Derkaoui & N. Framont)
#CINÉMA : Maman déchire (Émilie Brisavoine), An Evening Song (Graham Swon), Maîtres (Swen de Pauw), Ceux de la nuit (Sarah Leonor)
#EXPOSITIONS :
Kunstmuseum Basel : Andrea Büttner / Shirley Jaffe / Jasper Johns Un artiste collectionneur / Matisse, Derain et leurs amis / Carrie Mae Weems ;
Fondation Beyeler (Riehen) : Niko Pirosmani / Doris Salcedo / Wayne Thiebaud ;
La Filature (Mulhouse) : Anna Malagrida / Le temps s’enfuit sans disparaître / Trans(e)galactique ;
Musée Unterlinden (Colmar) : 170 ans – Ça se fête avec vous ! / @Camille Broucke, nouvelle directrice du musée Unterlinden / @Silvère Jarrosson / Célèbre la terre pour l’ange ;
Abdelkader Benchamma (Fondation Schneider, Wattwiller), Joseph Bey (Courant d’art, Mulhouse), Élisabeth Bourdon (Temple Saint-Étienne, Mulhouse), Alma Bucciali à St-Art (Strasbourg), Les 40 ans des Éditions Bucciali (Colmar), Michel Cornu (galerie Murmure, Colmar), Giacometti–Dali (Kuntzhaus Zürich), Anna Haifisch (Musée Tomi Ungerer, Strasbourg), Pierre Muckensturm (Galerie La Ligne, Zurich), RADICAL. L’abstraction géométrique & Lore Bert (Musée Würth, Erstein), Françoise Saur (médiathèque de Cernay), Aux temps du sida (MAMCS, Strasbourg)
#SPECTACLES VIVANTS : Le Journal d’Hélène Berr (B. Foccroulle, M. Cruciani), Hamlet (Shakespeare/C. Umbdenstock), Qui a tué mon père (É. Louis/I. van Hove), Vollmond (Pina Bausch), L’horizon des événements (F. Sonntag), Le Tartuffe (Molière/I. van Hove), L’ivresse des profondeurs (S. Sirvani, M. Ahadinia, L. Hekmatnia), Cyrano de Bergerac (Rostand/K. Hunsinger & R. Dana), Turandot (Puccini/Hindoyan & Bastet), Dans la mesure de l’impossible (T. Rodrigues), répétition Music for 18 musicians (vidéo, Filature, Mulhouse), L’Incoronazione di Poppea (Monteverdi/Pichon & Titov), Hen (J. Bert), The Bacchae (Euripide/Papakonstantinou), Le Dragon (Schwartz/Joly), Des femmes qui nagent (Peyrade/Capliez), Vessel (Jallet, Nawa), Das Weisse vom Ei (Labiche/Marthaler)
@avant-papier sur présentation de presse et documents remis
Sur la page d’accueil, des informations actualisées sur les évènements encore accessibles.
εphεmεrides 2024 • 2022 • 2021 • 2020 • 2019 • 2018
printemps foudroyé
Le Journal d’Hélène Berr
de Bernard Foccroulle
#OPÉRA
représentation du 6 décembre 2023 à la Comédie de Colmar

Hélène Berr a rédigé son journal en deux parties, la seconde devenant une adresse à l’homme qu’elle aime Jean Morawiecki parti rejoindre les Forces Françaises Libres. Écrit d’avril 1942 à février 1944, il n’a été édité qu’en 2008. Bernard Foccroulle l’a découvert dix ans plus tard alors qu’il quittait la direction du festival d’Aix-en-Provence pour se consacrer à la composition et à l’interprétation. Il a réduit le texte à ce monodrame mis en musique en 2019-2020.
Créé en version de concert à Cherbourg au printemps dernier, Matthieu Cruciani a dirigé la création scénique mondiale pour l’Opéra national du Rhin.
En début de spectacle, huit grands tulles translucides gisent telles des feuilles mortes, puis s’envolent vers les cintres. Par la suite ils ne dresseront que des frontières sur l’espace du plateau. En fond de scène, deux régisseurs en manipulent les filins avec à jardin la pianiste Jeanne Bleuse et à cour le Quatuor Béla.
Le texte est un long monologue découpé en seize scènes. La mezzo Adèle Charvet le dit – les dates entre autres comme un leitmotiv du destin qui avance jour après jour vers l’horreur – et le chante glissant occasionnellement vers le Sprechgesang balayant avec aisance et ardeur tous les registres de l’expression vocale avec son timbre chaleureux.
La prosodie est d’inspiration post-debussyste, on pense à La voix humaine de Poulenc (autre monodrame) avec une dynamique un peu semblable d’élans enflammés et de moments plus réflexifs saignés de dissonances et de grincements qui rappellent le Schönberg de Pierrot Lunaire, mais aussi, dans les moments instrumentaux, sa Verklärte Nacht. Une écriture musicale exigeante, nerveuse (recours fréquents aux pizzicati), érudite et au service du texte d’Hélène Berr introduisant volontiers certaines œuvres qu’il mentionne : le molto adagio du 15e quatuor de Beethoven (inspirant le bel interlude entre les deux parties) ou les vers de Heine (Ich hab’ im Traum geweinet) mis en Lied par Schumann (et l’allemand va bien à Adèle Charvet).
Musicalement s’instaure un dialogue à trois voix entre le chant, le piano, les cordes : en contrepoint, en complément, en échange, en tension selon les scènes, les évocations, les souvenirs ou les nouvelles (mauvaises en général) restituées par les mots.
La chorégraphie des tulles s’érigeant en obstacles ou esquissant les lieux de son paysage intérieur donne parfois une respiration de Waldweben (cf. Siegfried) aux déplacements de la jeune femme si sensible à la beauté de la nature. Au besoin un(e) instrumentiste entre en jeu avec la chanteuse comme ami(e) ou témoins (épilogue).
La seconde partie se fait plus tendue avec des lumières plus froides, rasantes, et un pantalon remplace la robe : plus pratique pour l’ultime voyage ?
Un éveil du printemps guetté par le génocide programmé.
Le tragique destin d’Hélène Berr renvoie évidemment à celui d’Anne Frank (de 8 ans plus jeune). Toutes deux sont mortes à Bergen-Belsen à quelques jours d’intervalle au printemps 1945, toutes deux étaient issues de familles juives ouvertes et cultivées et leur journal couvre une période et des faits similaires.
Le journal d’Anne Frank (publié en 1947) est un best-seller mondial, la parution de celui d’Hélène Berr (soixante ans après) fut plus discrète et malgré la réitération du « plus jamais ça », Tout le monde parle de paix mais personne n’éduque à la paix. On éduque pour la compétition, et la compétition marque le début de toutes les guerres (Maria Montessori *).
* à Amsterdam, Anne Frank fréquentait une école montessorienne.
Création mondiale scénique pour l’Opéra national du Rhin (3.12.2023)
scénographie Marc Lainé, costumes Thibaut Welchlin, lumières Kélig Le Bars
Adèle Charvet mezzo-soprano
Jeanne Bleuse piano & Quatuor Béla (Julien Dieudegard & Frédéric Aurier violons, Paul-Julian Quillier alto, Alexa Ciciretti violoncelle)
du 3 au 8.12.2023 à la Comédie de Colmar
du 13 au 21/12/2023 à Strasbourg, Théâtre de Hautepierre
& le 12/01/2024 à Mulhouse, Théâtre de La Sinne
La Belle Strasbourgeoise
ST-ART 27e édition | 2023
#SALON
St-Art du 24 au 26/11/2023
Strasbourg, nouveau Parc des Expositions de Strasbourg Events (Halls 2 & 3)

Du 24 au 26 novembre, la 27e édition de St-Art, Foire d’Art Contemporain et de Design, s’invite pour la deuxième fois sous l’égide de Strasbourg Events dans le nouveau Parc des expositions et accueillera 56 galeries représentant dix pays (dont la Corée du Sud). Avec douze galeries de plus qu’en 2022, les organisateurs espèrent faire grandir l’évènement et dépasser les 13 300 visiteurs de l’an passé.
Conforté par cette évolution encourageante, Christophe Caillaud-Joos, Directeur général de Strasbourg Events, souhaite renouer avec le lustre des débuts qui avaient bénéficié, en 1994, du dynamisme de galeries plus nombreuses, d’une position plus ferme de Strasbourg capitale européenne et, en 1998, de l’ouverture du musée d’Art moderne et de la création d’Apollonia : des marqueurs importants pour réaffirmer l’ambition d’ancrage dans le territoire et de tremplin pour la jeune création.
Des partenariats enlumineront et animeront ces trois jours – St-Art est aussi un espace de débats et de conférences. S’exposeront ainsi l’installation de Luke Jerram Museum of the Moon grâce à l’Industrie Magnifique qui lancera sa 3e édition lors de la foire, Moss de Marco Barotti réalisée dans le cadre de Vital, programme d’Apollonia associant art et environnement, et le projet Guernica Ukraine de Jean Pierre Raynaud.
L’émergence sera mise en lumière par la Société des Amis des Arts et des Musées de Strasbourg (SAAMS). Pour ses 190 ans, elle a invité les précédents lauréats de son prix Théophile Schuler (palmarès proclamé lors de St-Art) à créer une œuvre : une vingtaine d’entre eux a répondu à l’appel et leurs pièces seront exposées sur 140 m2.
Soutien à la jeune création aussi pour l’artiste invitée cette année : Alma Bucciali, jeune plasticienne strasbourgeoise à laquelle St-Art a commandé deux estampes dont une épreuve sera jointe au catalogue du salon.
Un thème a été suggéré à l’inspiration des lauréats du prix Schuler comme à l’invitée d’honneur : La Belle Strasbourgeoise. La toile de Nicolas de Largillierre (1703) sera l’emblème de cette édition pour marquer la singularité de St-Art par rapport aux manifestations similaires organisées dans d’autres régions et rappeler que la SAAMS s’était activement engagée en 1963 pour qu’elle entre dans les collections des Musées de Strasbourg.
Alma Bucciali, artiste invitée, ses mots pour se dire
les deux estampes du catalogue
ce sont des aquatintes – un petit format carré (19×19 cm) – avec beaucoup de morsures différentes, donc ça fait une gradation, et en travaillant l’encre noire avec un peu de Terre d’ombre, de Terre de Sienne brûlée on arrive à avoir des nuances plus chaudes avec un seul passage
le bestiaire
J’aime beaucoup le rapport ente la banalité du quotidien et le merveilleux. Cette hybridation est au cœur de mon travail.
Je suis une môme des années quatre-vingt-dix, j’ai grandi avec la fantaisie, le merveilleux, Tolkien, l’Égypte ancienne, l’art médiéval, la Renaissance rhénane… Tout ça a un côté bestiaire et la figure humaine et l’animale font partie des choses que j’aime vraiment représenter, cette hybridation du corps humain et du corps animal… C’est un peu ce que faisait La Fontaine avec les Fables, prendre des animaux pour représenter des humains. Représenter l’humain n’est pas facile, c’est chargé un visage, donc je vais crypter les choses, mettre des têtes d’animaux, des hybridations…
Dans la série des licornes il y a beaucoup d’objets qui existent dans la vraie vie, il y a un mélange de lieux dans lesquels j’ai vécu. Mais c’est quelque chose de très vulnérable de parler de soi, ce truc de métaphore visuelle, d’astuce de représentation permet de poser une distance. Et on se concentre plus sur le sens, c’est en partant de choses très personnelles qu’on arrive à des choses qui touchent.
l’art de la citation
Dans beaucoup de mes travaux, il y a la citation comme la Dame à la Licorne des tapisseries du musée de Cluny. J’aime beaucoup ce principe de la référence, puiser dans un grand système d’images et de grands thèmes, la mythologie, les vanités… j’aime bien faire référence à ces choses-là parce que ça fait un appui.
le tarot
on est clairement là-dedans, dans cette citation.
Le but, c’était de prendre quelque chose qui a été beaucoup représenté, beaucoup décliné et d’en faire ma version.
Le tarot c’est presque le sujet idéal, tout le monde peut y trouver une piste de réflexion, un axe, quelque chose qui fait écho à sa vie, on a des choses très terre à terre et en même temps il y a les astres, les grandes figures tutélaires, la justice, la tempérance, puis les empereurs, les impératrices, des choses du réel, des figures un peu permanentes… et de grandes choses immanentes.
La série a été finie au printemps, c’est la suite majeure de 22 cartes, 22 estampes, à St-Art c’est la première fois qu’on la présentera en entier, sur le stand des Éditions Bucciali, on pourra acheter estampe par estampe ou le jeu complet…
mes médiums
le choix de la gravure, le choix de la broderie… c’est à la fois quelque chose qui prend du temps et des petites formes un peu intimes, un peu resserrées qui me canalisent, dans la gravure il y a des temps de morsure, la broderie c’est de toute façon très très long.
C’est aussi je pense une réaction par rapport à la monumentalité que peuvent prendre les choses aujourd’hui, l’extrême diffusion des images, la vitesse d’exécution, je trouve qu’on a le droit de prendre son temps pour faire des choses et de faire peu, mais d’essayer de faire bien et de faire des formes un peu humbles et modestes, j’aime bien ces choses-là…
la ligne, la narration
Il y a les gens qui pensent en masse et ceux qui pensent en ligne, et moi depuis toute petite je suis quelqu’un de la ligne, enfant j’avais un stylo bic, je ne voulais pas les feutres les couleurs, je dessinais d’un trait sans lever le stylo, la gravure retrouve ce rapport à la ligne.
À la base je voulais faire de la bande dessinée, j’avais commencé à étudier l’illustration à LISAA à Strasbourg, après Épinal ça me tentait bien parce qu’il y avait toute cette histoire de l’impression, de haut lieu de l’imagerie populaire, finalement je me suis rendu compte que l’illustration et la BD ce n’était pas pour moi, mais je pense que j’ai vraiment un rapport à la narration qui est là depuis tout le temps, celle d’une image qui génère du récit.
démuséifier
Il faut démuséifier le rapport à l’art dans le sens où beaucoup de gens aujourd’hui ont l’impression qu’ils ne sont pas à leur place dans une galerie, ils n’osent pas s’imaginer qu’eux aussi pourraient être propriétaire d’une œuvre d’art alors que, notamment en gravure, il y a des choses qui sont beaucoup moins chères que certains habits.
C’est important que les gens puissent avoir leurs images… moi je suis contente que les gens puissent avoir de l’art chez eux, chez elles !
en raccourci
Hamlet de Shakespeare
version Catherine Umbdenstock
#THÉÂTRE
représentation du 8 novembre 2023 à la Comédie de Colmar

Nouvelle traduction modernisée (Dorothée Zumstein) et version resserrée par l’équipe (2h30) pour cet Hamlet programmé dans le cadre des Scènes d’Automne en Alsace, un dispositif qui soutient les compagnies et la création théâtrale du Grand-Est offrant à la fois des lieux de résidences/répétitions et l’opportunité d’être diffusé en Haute Alsace (Comédie de Colmar, La Filature Mulhouse, le Créa Kingersheim, l’Espace 110 Illzach, La Coupole Saint-Louis).
La production est également reprise au TAPS – Scala de Strasbourg du 5 au 9 décembre 2023.
Pourquoi Hamlet n’est pas une chanson douce ? semble se demander Catherine Umbdenstock. Aussi elle tente une approche légère en interpellation du public dans la logique du théâtre épique (sa Cie ne s’appelle pas Epik Hotel pour rien). Dès la première scène (1re apparition du spectre), les comédiens sont alignés face au public : une bande de moujiks terrorisés qui convoque l’Opéra de Quatre Sous surtout quand Horatio (Samuel Favart-Mikcha), micro de crooner en main, slame le texte de Shakespeare. Une étrangeté importée dans les brumes d’Elseneur, si le texte est scandé comme il se doit, il ne provoque ni n’interpelle comme le devrait le slam, même avec la nouvelle traduction : Shakespeare ouvre ses abîmes sur le long cours…
La metteuse en scène creuse cette option avec Polonius (Frank Williams) qui écoute sa fille talentueuse harpiste (Nabila Chajaï) jouant La Moldau (Smetana), ou le même Frank Williams, en comédien cette fois, qui entonne Que je t’aime de Johnny Hallyday…
Saynètes poétiques, pittoresques, mais les Songs et Ballade chez Brecht mettent l’action sur pause et en réflexion collective, faut-il forcer la pièce de Shakespeare à entrer dans ce schéma extrospectif ?
Ce choix instaure les comédiens en collectif qui, harassé par le froid et cette nuit soudain redoutable, se serre les coudes, une bande de potes… interchangeables, Hamlet (Lucas Partensky), Horatio, courtisans, valetaille… en cuir, en treillis. C’est la longueur et la fréquence des répliques qui établit la différence. Seuls à s’en détacher, Christophe Brault ostracisé par le groupe (en Claudius, il rappelle à tout bout de champ qu’il est le chef et, en spectre, il les gave avec sa vengeance) et Frank Williams qui dessine des personnages atypiques avec un zeste de caricature (il sera aussi Laërte).
Quelquefois s’esquissent des bons mots… qui provoquent quelques rires isolés, mais qui n’amorcent guère la salle.
Il y a de belles images (la neige qui tombe avec un comédien qui active le dispositif à vue) et quelques trouvailles (la cotte de mailles du spectre raclant le bois du plateau) qui font qu’on ne s’ennuie pas.
La scénographie de Claire Schirck fonctionne bien, donne une unité au spectacle et les éclairages de Florent Jacobbien l’ancrent dans de glaciales tourmentes.
Dans sa note d’intention, Catherine Umbdenstock suggère : « Si tu montes Hamlet un jour, fais-le pas trop tard. Quand on est vieux, on veut rajouter des couches, et Hamlet n’en a pas besoin ».
Au final, il y a comme un doute : trop ou pas assez ?
Sa production d’Hamlet apparaît comme une version light avec un parfum de cabaret.
Et la pénombre, l’humidité, la froidure d’Elseneur, The rest is silence.
le corps du forçat
Qui a tué mon père d’après Édouard Louis
#THÉÂTRE
représentation du 3 novembre 2023 à La Filature, Mulhouse

Deuxième volet de l’hommage de la Filature à Ivo van Hove après Le Tartuffe et avant Après la répétition + Persona (22 & 23/03). Une salle presque comble pour un spectacle en néerlandais (surtitré bien entendu). Stanislas Nordey avait commandé ce monodrame à Édouard Louis et l’avait joué au Théâtre de la Colline, puis au TNS en 2019. Une version fine, élaborée en manifeste politique que prolongeaient les interventions dans les médias de l’écrivain et de l’acteur/metteur en scène.
Subjugué par la lecture de ce texte, Ivo van Hove a immédiatement voulu le monter.
Des murs noirs bourrés de coups ferment l’espace. Un lieu pauvre, industriel, une paillasse à cour avec des draps jetés comme la loque d’un corps ratatiné, une vieille télévision. À l’entrée du public, une musique de supermarché, celle censée donner l’entrain pour remplir le caddie. Un vide bruissant qui ferme l’horizon, bouche les trous autour des corps en transit. Et balise leur parcours.
Noir silence, le fils surgit comme un diable ou un archange de la saignée incandescente de la porte, une épiphanie qui brisera le silence.
Seul le fils parle *.
Ses mots, ses gestes rendront la misère palpable. Son corps empruntera celui du père : il se voûtera en silhouette poussive et phtisique d’après l’usine avec de petits pas pluvieux, les mains nouées sous le pull bleu (comme le bleu de travail…) qui fera ventre, le débit haché, le souffle coupé par la cigarette.
Car il y a le corps de Hans Kesting. Il incarne les corps de tous ces pauvres, celui juvénile de l’auteur adolescent jouant à la fille, le frère drogué et brutal, le père si usé… Il passe d’un corps à l’autre, les met en dialogue – difficilement, car les phrases ne sont pas leur fort. Mais il rend perceptible l’espace d’un corps à l’autre, un espace de tension, de méfiance, d’incompréhensions, de conflits aiguisés par la douleur – celle de la carcasse ouvrière éreintée – et par la pauvreté – cet argent qui manque en permanence. Le corps de l’autre devient l’exutoire – en tendresse ou en défouloir – de cette autre violence qu’on endure ailleurs (et se cache sous d’autres mots : travail vs fainéantise, virilité, police, réussite, etc.).
De rares fois, des éclats de lumière déchirent l’obscurité : la porte s’ouvre et le corps illuminé s’échappe pour téter sa cigarette ou la télévision projette les images de Titanic sur la romance My Heart Will Go On, fragiles et fugaces échappées vers ailleurs, étourdissement du tabac, rêve d’amour… Un autre demain ! Peut-être… sans doute pas.
Le fils en messie pose les mots, identifie cette douleur polymorphe assignée par la brutalité des règles, démonte le piège de la fatalité, en dénonce les coupables, livre leurs noms. S’il dénoue (un peu) la violence domestique et légitime la révolte (le dernier mot du texte est révolution), le malaise grandit au fil de sa diatribe. Enveloppé de fumée, dispersant des perles de sueur quand il s’emporte, Hans Kesting donne massivement corps à la souffrance de cet homme et de ses semblables, la transfère au public et transforme en tragédie antique ce banal quotidien.
Si chez Nordey, les ouvriers étaient pauvres, ils le sont bien plus chez van Hove : des working poor dans une misère noire. Sa proposition inscrit le réquisitoire d’Édouard Louis en blessure dans la chair de l’acteur qui sait l’infuser au public. Ainsi van Hove rend peut-être encore plus justice à l’ambition de l’auteur : dire cette souffrance, documenter à charge la culpabilité des dirigeants notamment politiques qu’énonce la pièce et qui révoltait déjà Henrik Ibsen (1828–1906) : L’État est la malédiction de l’individu. Il faut que l’État disparaisse. Voilà la révolution que je veux faire.
* extrait du court texte de présentation – seule didascalie – de la pièce parue chez Seuil (2018)
a story within a story
Carrie Mae Weems
The Evidence of Things Not Seen
#EXPOSITION
Kunstmuseum Basel | Gegenwart du 26.10.2023 au 7.04.2024
commissariat : Maja Wismer avec Alice Wilke
catalogue en anglais, 176 p., 28 CHF | Carrie Mae Weems. Reflections for Now (sélection de textes, d’entretiens et de photographies de l’artiste)

Après Kara Walker – charnelle et véhémente – au Neubau en 2021, le Kunstmuseum Basel accueille Carrie Mae Weems au Gegenwart : un autre éclairage sur le Black and Female in USA. Sa production, principalement photographique, souvent élaborée en installations, est teintée d’autodérision et de mise à distance : une légèreté pour imposer la gravité. Et la réflexion.
En 1973, « mon boyfriend m’a offert cet appareil photo, j’ai shooté une bobine. Une bobine ! et j’ai su que c’était la chose qui allait me porter le restant de ma vie et c’est ce qui est arrivé […] je serais une photographe documentaire. » (24.10.2023 au KMB)
Carrie Mae Weems avait vingt ans, cependant les images volées aux sujets qu’elle cadrait, cette intrusion dans l’intimité la gênaient et elle cherche une autre voie. Sa patte personnelle, elle la trouve en 1990 avec sa série la plus célèbre The Kitchen Table Series, une démarche fondatrice pour son rapport à la photographie.
Un décor et un cadre identiques d’une photo à l’autre – une table de cuisine éclairée par un plafonnier – où elle se met en scène, seule ou avec des familiers : l’autofiction devient acte documentaire. L’univers est clairement identifié : le cercle familial dans l’intimité de sa cuisine et des situations quotidiennes a priori banales. Cependant chaque cliché saisit un moment emblématique qui révèle les rapports de pouvoirs, le poids de la tradition, les habitudes de consommation, etc. Ces Things Not Seen (choses non vues) révélatrices d’enjeux que quelquefois les protagonistes eux-mêmes ignorent, comme le sous-texte au théâtre, sauf qu’il est élaboré non par les acteurs, mais, le plus souvent, par le collectif et son ordre prescriptif « nous ne croyons que ce qu’on nous autorise à croire – ou plutôt ce que nous devons croire, ou plutôt ce qu’il faut impérativement que nous croyions » (Günther Anders, 1971, préface de la 5e édition de L’Obsolescence de l’homme, 1956).
Un storytelling dont les prédicats hiérarchisent et trient en permanence avec tout en haut le mâle blanc et tout en bas la femelle noire. Une violence symbolique (quelquefois physique) envers la communauté afro-américaine qui impose et perpétue une culture dominante (et séculaire).
Dans son travail, Carrie Mae Weems s’ingénie à la démonter, la détournant, fabriquant du contre storytelling grâce à ses photos et d’autres dispositifs développés avec des images fixes ou animées.
L’artiste ramène ainsi dans le cadre l’évidence de ce pouvoir qui s’efforce de rester hors-champ. L’hyperréalisme de l’image photographique rend le constat plus percutant et le traitement, la mise en scène la mettent en perspective dénonçant un réel douloureux sans être doloriste.
Dès 1989, elle ajoutait de courtes légendes à ses clichés aux tons sépia de And 22 Million Very Tired and Very Angry People : A Hot Spot in A Corrupt World sous un globe terrestre, An Informational System sous une machine à écrire…
En 2000, avec sa vaste installation The Hampton Project, elle élargissait aux populations autochtones cette évidence de la désintégration nécessaire à l’intégration grâce aux photos de Frances Benjamin Johnston présentée à l’Exposition universelle de 1900 à Paris.
Avec Slow Fade to Black (2010), elle détourne le glamour des black beauties Katherine Dunham, Lena Horne et Joséphine Baker avec le flou du fondu au noir qui précède la disparition…
Trois propositions parmi les dix-neuf exposées sur les trois niveaux que lui consacre le musée.
Cette approche aussi fine que saisissante lui a permis d’être la première femme afro-américaine à bénéficier d’une exposition monographique au Guggenheim (2014). Une reconnaissance qui est aussi le fruit de son engagement au long cours : « Permettez-moi de dire que ma principale préoccupation en art, comme en politique, est le statut et la place des Afro-Américains dans notre pays. » (6.10.2007). Car la plupart des commissaires, des artistes, la majorité du public et des acheteurs sont des white males……
En 2007 dans Storytelling, la machine à fabriquer des histoires et à formater les esprits, Christian Salmon écrivait : « Les histoires sont primordiales pour donner du sens aux chiffres. » Obstinément Carrie Mae Weems revient aux chiffres : The numbers tell the story! (People of a Darker Hue, 2016)
ordre animal, désordre humain
Anna Haifisch Souris au bec
#EXPOSITION
Strasbourg, Musée Tomi Ungerer | Centre International de l’Illustration (Villa Greiner)
du 20 octobre 2023 au 7 avril 2024
commissariat : Anna Sailer, conservatrice du MTU
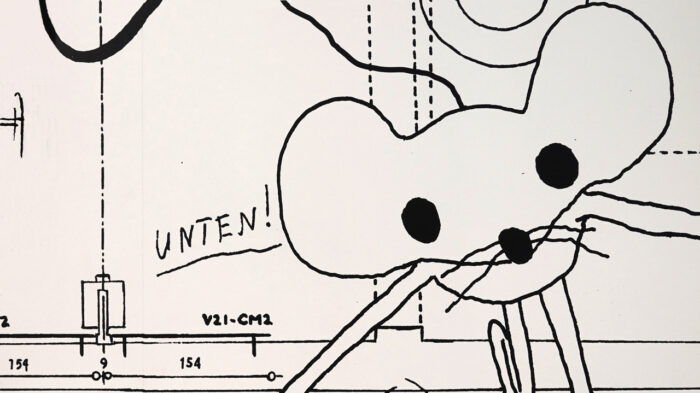
À peine six mois après sa prise de fonction, Anna Sailer, conservatrice du Musée Tomi Ungerer – Centre international de l’Illustration, inaugure sa première exposition consacrée à l’illustratrice allemande Anna Haifisch dont elle a découvert le travail dans une librairie de Francfort. Elle a également repensé la (nécessaire) rotation du fond Tomi Ungerer. Désormais les œuvres affichées seront choisies pour être en lien avec la thématique de la proposition temporaire.
Souris au bec
Une illustratrice qui expose et s’expose. La démarche interpelle manifestement Anna Haifisch qui joue du plan d’architecte de l’étage dans un grand format créé pour l’occasion (Stillleben, 2023) et immerge le visiteur dans son univers fait de souris souriantes… ou piégées, une mise en enjeu amusée, préambule à un ordre animal si humain.
La souris, mais aussi le chat (autoportrait au travail avec son chat sur les genoux) et ses références au détour d’une planche : Tintin, Bugs Bunny, Snoopy, Coyote, Mickey… hommage, mais surtout irruption d’un autre univers plus proliférant, évoquant la consommation de masse, la célébrité aussi (ce Bugs Bunny dont le sourire et la carotte narguent la petite souris qui, la larme à l’œil, a jeté son carnet de croquis devant les studios de la Warner : Kalifornien 2, 2014).
Son trait noir est minimaliste – comme les haïkus qu’elle affectionne –, la tête de sa souris est si simple qu’on n’y penserait même pas avec un museau qui s’allonge en trompe quand pointe la déprime. Mais souvent en contraste, le décor enfle, s’impose en prolifération. Une surabondance de détails comme si le matérialisme devait recourir à la profusion pour s’imposer.
Ce que dessine Anna Haifisch, c’est un désert plein, outrageusement plein d’objets, de messages, d’injonctions, d’absurdités, de violences parfois. Ses personnages perplexes, quelquefois médusés ou dépressifs (tels Walt Disney, Saul Steinberg et Tomi Ungerer dans Clinique von Spatz, 2015) errent dans ce mirage que Henry Miller qualifiait de cauchemar climatisé et s’ils croisent un congénère, c’est qu’il faut lui porter secours…
Le dernier volet (Ready America, 2023) est le fruit d’une résidence toute récente à la Villa Aurora aux États-Unis qui l’a confrontée à l’intense submersion sous les injonctions contradictoires dont elle fait son miel : une pub pour un lotisseur affronte un des Earthquakes & survival supplies (kit en cas de tremblement de terre) ou une offre de Happy Hours une pub d’aspirine, etc.
Son propre nécessaire de survie face à l’ordre désordre prescriptif ?
Juste à temps
Tomi Ungerer, ce serait l’étape d’après, quand tout ou presque a disparu, même le masque glamour de la consommation :
« Les oiseaux, les papillons et les rats étaient partis. L’herbe et les feuilles s’étaient flétries. Les fleurs n’étaient plus que des souvenirs. Les rues et les immeubles étaient abandonnés, Tout le monde était parti sur la lune. »
Une démission (ou une liquidation) générale que l’artiste, écologiste dès 1951, transcrit dans son tout dernier livre d’images, Juste à temps (2019).
L’accrochage met l’accent sur le règne animal très abîmé – telle cette nichée de squelettes qui reçoit la becquée de la maman squelette (Alle Vögel sind schon da, 1971) –, mais aussi avec des dessins d’observation virtuoses et remarquablement vivants, aussi précis que pour une encyclopédie.
Dans la première salle, une vitrine présente le dernier projet : Der Schatten Freunde (L’ami de l’ombre) sorte d’ange gardien dont l’humanité que dessine Tomi Ungerer (ou Anna Haifisch) aurait bien besoin !
liquide exubérance
Vollmond de Pina Bausch
#DANSE
représentation du dimanche 8 octobre à La Filature, Mulhouse

Après Tartuffe, la Filature offre à son public un autre cadeau pour son trentième anniversaire : une chorégraphie de Pina Bausch (1940–2009) par sa compagnie le Tanztheater Wuppertal Pina Bausch qui préserve son héritage. Daphnis Kokkinos, Robert Sturm qui ont dirigé les répétitions et certains danseurs ont participé à la création de la pièce en 2006 : une garantie de fidélité à l’esprit de la grande chorégraphe allemande.
L’espace offert aux douze danseurs par Peter Pabst, scénographe attitré de Pina Bausch à partir de 1980, est à la fois d’une grande beauté et d’une extrême simplicité : un imposant rocher enjambe un bras d’eau traversant le plateau de cour à jardin. Le frémissement apaisant d’une plage à perte de vue et l’indice d’un immémorial chaos. La soyeuse lumière de la pleine lune caresse ces tonalités sombres qui permettent au feu de certains costumes d’éclater.
Le spectacle naît du silence. Les corps activent le délicat bruissement des accessoires. Et de l’eau.
Des bouteilles plastiques chuintent au geste ample du bras des danseurs, le bâton d’un autre fouette l’air et les provoque. Une évidence de petites choses anodines qui s’agrandissent à la dimension du rituel avec une exubérance qui les transfigure en magie. La musique s’invite. Des mots aussi, un mot répété comme une obsession ou une phrase comme une caresse ou une mise à distance amusée.
Des personnages arrivent, seuls, par deux, par grappes, des amoureux, des égarées cherchant un havre pour la nuit. Ils s’adonnent à des jeux de désœuvrement avec un galet, une chaise… et l’humour (des femmes s’emparant du rôle de mâle dominant), la légèreté distante et malicieuse des films muets, leur tendresse aussi. Si le cinéma a les gros plans, Pina a l’ampleur du plateau avec des traversées qui lui permettent des pulsions de déchaînement. Elle les ponctue de détails toujours ancrés dans le corps fruits d’une acuité d’observation et d’une vive inventivité qui leur donne vérité, évidence et humanité. Avec l’eau, certains nagent, surfent, s’aspergent… dansent même quelquefois. Tout un paysage humain en estive qui s’évaporera avant le point du jour quand les pêcheurs harassés échoueront leur monstre marin sur la plage comme dans le final de La Dolce Vita (Fellini).
Avec la pleine lune, tous sont peut-être un peu fous cette nuit-là et la danse de Pina nous entraîne dans cette douce folie.
En seconde partie, Boris Charmatz propose une pièce de son projet Terrain dans le même décor. Sa chorégraphie est plus étale, privilégie les morceaux dansés, lancinants, répétitifs. S’il sait trouver la poésie dans les moments les plus apaisés et compose de belles images comme ces gerbes d’eau qui, lancées contre le rocher, jaillissent en kaléidoscopes saisis par la lumière, il se prive de la pétulante exubérance de son aînée. La dimension rituelle demeure, mais là où Pina Bausch exorcise le quotidien, Boris Charmatz préfère l’aspect incantatoire et cérémoniel.
questions d’avenir
170 ans – Ça se fête avec vous !
#EXPOSITION
Colmar, Musée Unterlinden du 14 octobre 2023 au 4 mars 2024
commissariat : Chloé Héninger, Attachée de conservation, Responsable des collections archéologiques
* Carole Martinez / Onze voix sous les tilleuls (Éditions Médiapop, octobre 2023 / 9 €)

170… un anniversaire qui peut surprendre.
Pourtant en vingt ans, les Unterlinden ont beaucoup changé : Il y a eu l’importante extension de 2015, la restauration du Retable d’Issenheim (2018-2022), une réflexion entamée avec les sociétaires sur le musée de demain (saison 2019-2020) et la période post-covid a interpellé les équipes (mais pas qu’à Colmar), notamment sur le lien avec les publics.
Hasard (?) du calendrier, une nouvelle directrice vient de prendre ses fonctions.
Une exposition qui ouvre une nouvelle ère ?
Il fallait ouvrir un musée pour exposer ce qui avait été préservé de la bêtise humaine.
Des mots que Carole Martinez met dans la bouche de Louis Hugot, le créateur du musée en 1853*.
À une époque où certains évoquent la dé-civilisation, les musées qui abritent des fragments de civilisation se cherchent. Et chacun tente d’apporter des réponses, positives et enthousiasmantes.
Aux Unterlinden, les choix de la commissaire Chloé Héninger jettent un pont entre le passé et l’avenir.
Sa proposition est narrative : comment se constitue un musée et surtout ses collections avec comme fil rouge onze personnalités marquantes de son histoire. Onze parcours de vie et d’engagements en dépit des soubresauts de l’Histoire (quatre changements de nationalité et trois guerres) : de la générosité en contrefeu des destructions et des convoitises.
Certains sont connus, Auguste Bartholdi ou Hansi (Jean-Jacques Waltz), d’autres moins ou seulement par un nom de rue : celle qui abrite le conservatoire (Ignace Chauffour) ou la cité administrative (Edmond Fleischhauer). Les uns avaient un engagement proche (les archéologues Madeleine Jehl & Charles Bonnet, le sculpteur Théophile Klem), d’autres plus lointain et (re)trouvaient un ancrage local en soutenant le musée (le collectionneur Jean-Paul Person, les galeristes parisiens Florine Langweil, Jean-François Jaeger).
Carole Martinez – autrice de Le cœur cousu (2007) et fascinée par le Retable – s’est plongée dans les archives et a imaginé les mots de ces Onze voix sous les tilleuls*. Une version courte figure sur les cartels des onze stations qui jalonnent le parcours et mettent en valeur des pièces emblématiques des collections. Des œuvres à découvrir ou à redécouvrir.
Chloé Héninger avait déjà piloté la mise en espace (très réussie) du département d’archéologie (janvier 2020) et c’est avec beaucoup d’attention qu’elle a élaboré l’intégration des nouveaux outils de médiation (3D, VR, interactivité, etc.). S’il y a une volonté de former et séduire un public plus jeune (mais pas que), les œuvres restent au cœur de la scénographie qui ne cède pas à la tyrannie du multimédia (les vidéos sauf une ne dépassent pas 4 min) et amène une réelle plus-value comme la restitution de la fontaine Schongauer à côté de sa statue.
Certains dispositifs intégreront d’ailleurs les collections après l’exposition (celui montrant l’évolution architecturale du musée).
croisade festive
Aux temps du sida. Œuvres, récits et entrelacs
#EXPOSITION
Musée d’Art moderne et contemporain de Strasbourg (MAMCS)
du 5 octobre 2023 au 4 février 2024
commissariat : Estelle Pietrzyk, conservatrice en chef, responsable du MAMCS
catalogue sur papier glacé (264 p., 40 €)

Après la Marseillaise (2021-2022), le Musée d’Art moderne et contemporain de Strasbourg propose une nouvelle exposition témoignage développant une position de lieu de mémoire sociétale et d’animation du territoire. Depuis l’identification des premiers cas de ce « cancer rare » (juillet 1981) jusqu’à aujourd’hui, la scénographie présente quarante années d’arts et de luttes. Le dispositif inclut, à l’extrémité sud de l’espace sous verrière, une permanence d’acteurs associatifs liés à la thématique du projet (santé, accompagnement, discriminations).
Il était un temps, au début des années quatre-vingt, où les policiers encadrant les manifestations n’étaient pas surarmés et portaient un simple calot, une ambiance bon enfant visible dans l’une des vidéos d’actualité (INA) qui jalonnent l’itinéraire. Pourtant l’État était plutôt absent aux premiers temps de l’épidémie et en minimise longtemps la gravité. C’est l’activisme des associations épaulées par des personnalités en vue qui ont fait avancer la prise en compte, puis la prise en charge et la recherche sur la maladie.
Dans le récit – qui s’écrit à toutes les personnes du singulier comme du pluriel – que déploie la commissaire Estelle Pietrzyk, un axe, une ambition s’imposent aux victimes et à leurs proches : sortir de la clandestinité, devenir visible, permettre à chacun d’être reconnu dans son identité. Un chemin laborieux : « pas de prosélytisme pour l’homosexualité » lâchait un ministre en off (1993). Aussi les militants, mais aussi les artistes mobilisent le réel. Et la photo, la vidéo en sont les moyens d’affirmation les plus cinglants. Le réel dans sa crudité : l’effondrement du corps – confronté au souvenir de sa splendeur quelquefois –, sa maigreur, ses stigmates (sarcome de Kaposi), mais aussi, surtout sa poésie, son émotion avec le sang magnifié, les médicaments mis en scène, surdimensionnés et la grâce malgré la maladie.
Le combat n’est pas né là, il se prolonge, prend de l’ampleur et le sida fédère en communauté, en solidarité. Les Sœurs de la Perpétuelle indulgence sont nées en 1979, Michel Journiac est actif et engagé dès 1969, le prémonitoire dessin de Copi où l’allégorie de la mort s’écrie « La star, c’est moi » date de 1973.
Les images documentent (cette séquence d’Apostrophe où Hervé Guibert émacié est le seul à être filmé en gros plan), mais surtout exaltent le corps, ce corps si sévèrement atteint. Les déguisements, les maquillages et le mouvement, la danse invitent à une surenchère festive, avec l’éloge de la nuit. Un Memento mori baroque, une danse macabre revisitée où les feux de la vie qu’on découvre soudainement précaire et fragile s’étourdissent, s’exposent, célèbrent l’étrangeté, la beauté au-delà de la maladie.
Avec des chorégraphes (Béjart, Alain Buffard…), mais aussi des cinéastes (Almodovar, Carax, Collard…), des écrivains (Lagarce, Guibert…), des musiciens (Klaus Nomi…) et de nombreux artistes visuels, l’exposition se revendique pluridisciplinaire. Les travaux de 78 personnalités se déclinent avec en dominante le noir et le rouge au fil de dix sections qui privilégient la part d’extravagance de la culture gay et queer.
Dès l’antichambre unifiées par le papier peint et π, ce veilleur scrutant l’avenir, créés pour l’occasion par Mehryl Ferri Levisse, mots, slogans, revendications, couvertures de magazines, pochettes de disques, DVD, tracs, affiches plongent le visiteur dans une conjuration jubilatoire de la mort. Car En parlant de la mort, on a sauvé quelque chose de soi-même (E.M. Cioran Sur les cimes du désespoir, 1933).
Si le parcours est à peu près chronologique, le catalogue (264 p., 40 €) est conçu comme un abécédaire avec entrées thématiques et biographiques.
cul de sac ?
L’horizon des événements de Frédéric Sonntag
#THÉÂTRE
représentation du jeudi 5 octobre à la Comédie de Colmar

La pièce s’inspire du Rapport Meadows (1972) qui pointe les externalités péjoratives de la croissance économique et démographique, la première étant la limite des ressources. Ses avertissements n’ont guère été pris en compte alors que ses hypothèses ont été confortées depuis (GIEC, etc.). Le «business as usual» (BAU) l’a emporté sur le changement de paradigme qui aurait été nécessaire pour préserver l’avenir.
Avec un demi-siècle de recul, Frédéric Sonntag imagine le contexte, les circonstances possibles de cette désactivation. Il tente de trouver son chemin entre les enjeux planétaires et l’intime. Un premier jet de son texte a été finalisé par une écriture de plateau avec la compagnie ASA NISI MASA.
En 2005, Nathan Jeffrey apprend qu’il va devenir père et se plonge dans l’épopée, trente ans plus tôt, de ses parents (alter ego français du couple Meadows). Il essaye de comprendre pourquoi ils ont abandonné leur vaste étude économique qui devait identifier les options pour l’avenir de l’humanité (et peser sur les choix politiques). S’il est sensible aux tourments de sa mère privilégiant sa carrière au détriment de ses enfants, Nathan découvre surtout les trois pistes d’avenir élaborées par leur laboratoire et les controverses, les attaques dont ils ont fait l’objet. Pour y répondre, son père juge nécessaire de communiquer sur leurs travaux. Du matériel vidéo est ainsi produit en direct sur le plateau et fournit des éléments de pédagogie sur leurs recherches. Il accentue aussi le parfum seventies et sa mode surannée avec ces caméras sur trépied roulants, envahissants mastodontes dont les images sont projetées sur écran géant.
Glissement vers les États-Unis où un autre (futur) couple travaille sur les trous noirs et la théorie de la relativité (L’horizon des événements en est une notion). L’épisode offre les plus séduisantes images du spectacle avec ce mouvement stellaire projeté sur la résille d’avant-scène. Si la perspective d’être avalé par un trou noir prolonge les sombres prophéties des Jeffrey, les astrophysiciens suggèrent un jeu sur le temps – une confusion entre passé, présent, futur – et imaginent la possibilité d’une autre issue pour l’humanité et plus poétique que la colonisation spatiale façon Musk.
Tous les comédiens prennent plaisir à changer de peau et à voyager dans l’espace-temps mis en scène par le spectacle. Des images d’archives raniment Pompidou ou le running gag : La France n’a pas de pétrole, mais a des idées. Cependant une préoccupation didactique très présente – alors que le public de théâtre est sans doute sensibilisé aux questions abordées – peine à ancrer dans la chair les enjeux d’avenir et le projet théâtral souffre d’être tiraillé dans toutes ces multiples directions.
La tyrannie des dividendes (le BAU) plane sur le projet scientifique des Jeffrey et obère toute autre issue. Cette force de frappe (adossée à une technologie réputée omnipotente) que Frédéric Sonntag a parfaitement intégrée dans sa proposition théâtrale, le condamne à ne formuler qu’un timide (et hypothétique ?) espoir.
Le dernier mot de la pièce est « bifurcation »…
danse de mort
Le Tartuffe ou l’Hypocrite de Molière
#THÉÂTRE
représentation du 1r octobre 2023 à La Filature, Mulhouse

Le spectacle est le premier volet de l’hommage de La Filature à Ivo van Hove (avant Qui a tué mon père en novembre et Après la répétition + Persona en mars). Il permet aussi d’accueillir dans ses murs la troupe de la Comédie-Française pour fêter les 30 ans de la maison.
Pour cette création (janvier 2022), le metteur en scène flamand a choisi la version de 1664 (reconstituée par Georges Forestier) interdite par Louis XIV car trop critique envers l’épiscopat. La pièce passera le barrage de la censure et à la postérité dans sa 3e version (1669) avec des personnages (Marianne, Valère) et deux actes supplémentaires dont le deus ex machina final fruit de la « clairvoyance du prince ».
Extérieur nuit. Dans la pénombre du plateau se devine un tas de couvertures. Orgon s’approche, les soulève prudemment, découvre un corps. Il rameute sa maisonnée, fait baigner, réchauffer, habiller de frais ce SDF. Le ver – ou plutôt le catalyseur de la folie – est dans le fruit. Pendant la toilette, l’apparat se met en place (lumières, fleurs, praticables en fond de scène). Une toile blanche est dépliée vers l’avant : un rectangle comme un tatami où se jouera le match avec salut de rigueur avant de pénétrer dans l’arène (l’étripage se drape de civilités). Le lieu des règlements de comptes. De la séduction aussi !
Le remplacement des luminaires identifie les actes et une ligne de néons tombant des cintres avec un fracas au son les changements de scènes. L’agitation de tous à ces moments et le ballet des lustres évoquent le vertigineux délire des fêtes felliniennes (Casanova), mais préserve une mécanique militaire, impitoyable : une machine à broyer.
Tartuffe est un corps brut, exposé au début, nu. Et Christophe Montenez est jeune, séduisant.
La pénombre, le noir des costumes (contemporains) ne s’éclairent que de la peau pâle qui se découvre et catalyse les tourments enfouis, activent un désir omniprésent où les corps sont livrés ou offerts, saisies ou caressés, baisés quelquefois, et, perpétuellement, se cherchent. Ou s’esquivent…
Et Orgon, et sa femme Elmire se disputent le corps de Tartuffe.
Par facilité – et nécessité –, il devient l’agent du pouvoir d’Orgon. Un rôle qu’il endosse assez vite à contrecœur. Quand il confesse ses avances à Elmire (espérant mettre fin au simulacre…) et qu’Orgon le renvoie à la fiction, il est pris de sidération comme Damis qui l’a surpris et dénoncé. Le piège est solidement cadenassé par les mots de la vertu.
Orgon ne drague pas Tartuffe, mais sa fascination est aussi impérieuse que refoulée, décuplée par la puissance du déni. Un abyssal éclatement qui mène Orgon vers la folie et produit une féroce toxicité. Denis Podalydès joue en virtuose sur ce fil qui tient en laisse (ou pas) ses pulsions. Délicat et attentionné envers le jeune homme, il est patelin avec les autres, doucereux, humble, au besoin fuyant, d’un autoritarisme souterrain avec des crises d’emportement quand ça résiste et qu’il perd le contrôle.
Elmire (Marina Hands) est sous l’emprise de son mari, mais découvre cette béance. Tartuffe en est le révélateur et apparaît comme une issue prometteuse (accessoirement, elle suit l’argent : Orgon lègue tous ses biens à Tartuffe). Jusqu’au complot du IIIe acte, elle opère un subtil glissement et dans le feu de l’action, au lieu de simplement piéger Tartuffe, elle s’offre à lui avec jubilation sous les yeux de son mari.
Tous les comédiens adhèrent à cette vision crépusculaire, se fondent dans cette volonté d’Ivo van Hove de faire théâtre et transcendent la « représentation » en libérant avec une incroyable densité la profondeur humaine.
Cléante (Guillaume Gallienne) croit encore à une forme de raison (il est bien seul) et tente vainement d’argumenter, de raisonner son beau-frère. Dorine (Dominique Blanc) en est revenue depuis longtemps et joue la distance et la dérision. Damis (Julien Frison) voit sa blessure intime enfler et termine sonné par son tyran de père. Même la matriarche (Claude Mathieu) finit sacrifiée comme les grands principes qu’elle ressasse en vain.
Autour d’eux bruissent les six servants (membres de l’Académie de la Comédie-Française) attentifs et serviables donnant une matérialité à l’entreprise Orgon, sa maison, ses biens, son empire (?).
Cette noirceur n’empêche pas les moments d’humour (souvent noir) qu’amplifie la musique d’Alexandre Desplat évoquant par moments Nino Rota.
Le bref tableau conclusif aussi virevoltant qu’un final de Rossini suggère que tout peut finir en beauté, mais dans la liberté des corps. Et en tenant à distance les mots, car La moitié des mots dont nous nous servons n’ont aucun sens, et de l’autre moitié chaque homme comprend chaque mot à la façon de sa folie et de sa vanité (Joseph Conrad, 1898).
les coulisses des chef-d’œuvre
Jasper Johns – Un artiste collectionneur
#EXPOSITION
Kunstmuseum Basel | Neubau du 30.9.2023 au 4.02.2024
commissariat : Anita Haldemann, Responsable du Kupferstichkabinett
catalogue (incluant des photos des œuvres in situ chez Jasper Johns) en allemand ou en anglais, 151 p., 58 CHF

Avec cette proposition atypique, le Kunstmuseum Basel révèle un aspect moins connu de l’artiste américain : le collectionneur. Pour l’occasion, Jasper Johns prête au musée 103 œuvres sur papier de 47 artistes. Une partie provient d’échanges avec les confrères qu’il fréquentait, certains étant des cadeaux dédicacés. Paul Cézanne, Pablo Picasso et Willem de Kooning sont particulièrement bien représentés.
Pour compléter ce parcours, une salle dédiée au 1er étage du Neubau regroupe les pièces de Jasper Johns les plus significatives qui figurent dans les collections du musée (7 peintures, 1 dessin et 223 estampes).
Ce fond a pu se constituer grâce à la longue et amicale collaboration, entamée dès 1968, entre l’artiste américain et les conservateurs et/ou directeurs successifs du Kunstmuseum Basel dont l’actuel Josef Helfenstein. Ce lien privilégié a permis d’imaginer cette exposition rare.
Jasper Johns est un collectionneur exigeant qui a toujours suivi son goût personnel – loin de toute logique spéculative – avec une attention marquée pour le dessin.
« Comparés aux peintures, les meilleurs dessins paraissent plus concis, plus sobres, plus schématiques, plus dépouillés, plus proches de la pensée, plus proches de la force motrice dont ils sont issus. » (2006)
Et qui dit dessin, dit souvent études, esquisses, dessins préparatoires qui préfigurent ou élaborent des œuvres plus importantes : des gestes de recherche, des tentatives de synthèse, d’économie, d’expressivité au-delà d’une représentation réaliste (à laquelle Picasso s’astreint quelquefois avec virtuosité : sa Course de taureaux, 1923).
Cet aspect est particulièrement sensible avec la déclinaison des mains : Passarotti (1555-60), Kollwitz ou celles torturées de Picasso (qui semblent s’interroger : que faire de ces mains ?).
Et plus encore avec celle des corps, dramatisés par Füssli, diaphanes jusqu’à l’éthérée chez Seurat, d’une active évidence pour Fischl… voire tentés par l’hybridation tels Redon, Picasso, Kim Jones…
Chaque dessin est un lieu de métamorphose, mais l’exposition est aussi un théâtre de la confrontation : l’articulation des traits, du geste suggère le cousinage de Matisse et Picasso. Les nombreux Cézanne sont proches d’attentives académies permettant de parvenir aux Grandes Baigneuses (1894-1906) qui inspireront l’artiste américain (Tracing after Cézanne, 1994).
Mais sa collection va bien au-delà des esquisses et couvre un large panorama. Des portraits – le pénétrant John Cage de Carl Fredrik Reuterswärd (1993) réduit à quelques lignes et cette intensité du regard – ou l’épure de Bruce Nauman (Six Inches of My Knee (right) Extended to Six Feet, 1967), une économie de la fragilité où la bande d’assemblage contribue autant à l’acuité de l’œuvre que la trace du crayon.
Plus atypique, des partitions de John Cage sont élevées (très légitimement) au rang d’œuvres graphiques, plus inattendus, des dessins que lui a dédiés le chorégraphe Merce Cunningham. La scène artistique new-yorkaise à partir des années cinquante est largement représentée : Jack Tworkov, Willem de Kooning, Barnett Newman, Franz Kline, Robert Rauschenberg, Cy Twombly, Frank Stella, Brice Marden…
Et Jasper Johns achetait aussi bien d’illustres anciens (Füssli, Degas, Redon, Gauguin, Seurat) que des collègues plus jeunes pour soutenir leur travail (Kim Jones, Terry Winters…).
Toutes ses acquisitions le touchent, lui parlent et il les accroche, les pose, les affiche, s’y frotte quotidiennement. Elles le nourrissent aussi. Une proximité visible sur les photographies de sa maison, de son espace de vie qui rythment le parcours et figurent dans le catalogue ajoutant une émouvante touche personnelle à l’exposition.
dénouer les cicatrices
L’ivresse des profondeurs
Sayeh Sirvani, Mahmoud Ahadinia, Leila Hekmatnia
#THÉÂTRE
représentation du 29 septembre 2023 à l’Espace 110, Illzach

Ouverture de saison à l’Espace 110 (Illzach) avec le spectacle de Sayeh Sirvani, artiste associée pour trois ans avec un projet de territoire et une envie de l’équipe d’accompagner ses créations.
Plutôt qu’un théâtre d’objets, elle développe un théâtre de tissus frémissant, inventif et généreux.
En Iran, les contes commencent par « Il y avait quelqu’un » ou par « Il n’y avait personne ». Dans L’ivresse des profondeurs, il y a Sayeh Sirvani ! Seule en scène, caressée, agrandie ou dévorée par la lumière (Antoine Lenoir), quelquefois par sa propre lumière : celle qui émane de ses mains. Toute la liquidité des profondeurs marines vit dans son corps ductile, émane de sa grâce : les algues frémissant au ras du sol comme l’essor de la sirène qui aspire à l’air pur. Elle devient l’espace vivant de ces abysses.
Actrice, elle se noue et se dénoue, elle déballe quantité de tissus, de peluches personnages qu’elle porte quelquefois comme une maternité, ou d’autres plus vastes avec quelques figures (la nageoire caudale de la sirène) s’agrandissant à presque toute la hauteur du plateau. Une tribu des profondeurs qui surgit de l’obscurité de cette solitude désolée et qu’elle berce d’une mélopée iranienne qui ancre le passé de ces femmes qui s’incarnent, se racontent, se confessent, livrent leurs rêves, leurs espoirs, tentent de dénouer les cicatrices par les mots.
Le texte joue du langage et des subtilités de culture car, dans cette plaine liquide, les courants brassent les rencontres, celle de sa Perse natale avec celle du pays qui l’accueille et du public.
S’il y a occasionnellement des éclats (l’orage au début), elle incarne tout en délicatesse ces destins de femmes magnifiées par la volupté de ces métamorphoses virtuoses et inventives de tissus qui s’accouplent et accouchent des poupées de chiffons se donnant la main. Une solidarité, une attention et une ambition tellement nécessaires quand les eaux se font cimetière.
Avec ses mots, son corps, sa chorégraphie textile, Sayeh Sirvani défait les nœuds et ouvre les portes à l’humanité, à la singularité de chaque être, car Chaque fois qu’on défait un nœud, on sort un dieu (Amadou Hampâté Bâ).
nocturne éternité
Niko Pirosmani
#EXPOSITION
Riehen (Bâle), Fondation Beyeler du 17 septembre 2023 au 28 janvier 2024
commissariat : Sam Keller, directeur de la Fondation Beyeler, et Daniel Baumann
beau catalogue en anglais ou en allemand, 208 p., 58 €

Avec quelques 50 œuvres, la Fondation Beyeler propose une des expositions les plus importantes en dehors de son pays natal consacrée au peintre géorgien Niko Pirosmani (1862–1918). Ne possédant aucune toile de l’artiste, elle a fait appel aux collections du Musée national géorgien de Tbilissi et du Louisiana Museum of Modern Art de Humlebæk.
Peu documentée, sa vie fut modeste. Il a bénéficié d’une reconnaissance tardive à Tbilissi (à partir de 1912), jusqu’à devenir le peintre national après la rétrospective de 1929. Sa notoriété passe les frontières à partir des années soixante et son œuvre s’impose en 1995 grâce à la Kunsthaus de Zurich.
Des œuvres denses et économes en tension entre le réel et l’irréel.
L’œil de la pleine lune veille nombre de sujets du peintre : animaux, personnages, paysages… Mais même sans ce soleil nocturne, des gestes de blancs lèchent les silhouettes, domptent les moutonnements, déposent des halos et plongent dans un effet de nuit le Pêcheur à la chemise rouge, la Paysanne avec enfants cherchant de l’eau, l’Ours sous la lune, le Chamelier Tatar, l’Ourse polaire avec ses oursons…
Son monde surgit du noir comme d’une lanterne magique, des apparitions saisies au vol par des couleurs souvent crues. Celles-ci s’affrontent à la texture de la toile cirée noire du support qui transpire sous la peinture ou échappe au pinceau. La végétation apparaît par fragment, quelques traces esquissent un sol, les formes restent simples, sans ombres mais avec l’éclat de ces échines cérusées donnant un sentiment d’évidence et d’essentialité.
La poésie s’invite et joue avec la transparence : ce délicat geste d’aile sur la peau de L’actrice Margarita, la larme de la Girafe, cette jambe transparente du Chevreuil et paysage, le velouté du pelage, les boutons de fleurs, les oiseaux traces dans ses ciels… ou cette intrigante omniprésence de troncs coupés.
Au-delà des apparences, les créatures de Pirosmani sont en action. Mais leur mouvement est suspendu comme surpris par le peintre et mis en pause pour la pose entre un avant et un après imminent, suscitant cette tension dans la posture souvent axée vers le spectateur – ces regards effarés des animaux traqués. La tension est discrète, mais palpable : le pêcheur s’apprêtait à rentrer chez lui avec sa prise, la Femme avec une chope de bière allait la poser sur la table, œil et oreille aux aguets, le Chevreuil au bord d’un ruisseau s’est arrêté de boire, prêt à fuir…
La présence de l’eau accentue le sentiment de bascule, de frontière.
Des cours d’eau partagent ses paysages – de vastes mises en scène collectives rappelant les cycles picturaux du XVe. Quand le cadre est resserré autour de l’animal, il boit avec deux pattes dans l’eau et deux en dehors, comme le pêcheur encore debout dans la rivière qu’il va quitter.
Et le Bac à Didube sonne comme le passage du Styx…
Une suspension entre deux mondes.
Fils de paysan, très vite orphelin, autodidacte, Pirosmani gagne sa vie par d’autres moyens et s’il peint régulièrement, notamment des enseignes, il ne se consacrera pleinement à la peinture qu’à partir de 1901. Découvert en 1912, présenté la même année à Moscou dans l’influente exposition « Michen » (La Cible) aux côtés de Marc Chagall, Natalia Gontcharova et Kasimir Malevitch, il ne donne guère suite à une possible carrière. En 1916, il est invité à adhérer à la Société des artistes géorgiens, mais les relations sont heurtées et distantes.
Aux honneurs, il préfère sa vie humble et nomade auprès de connaissances, souvent des restaurateurs qui lui offrent le gîte et le couvert en échanges de toiles ou d’enseignes. Cette proximité et cette humanité se retrouve dans ses portraits des petites gens, imprègne aussi ses animaux : l’Âne que monte le docteur, le Cerf, l’instinct maternel de l’Ourse si proche de celui de la Paysanne.
Une éternité concrète avec ses métiers, ses fêtes, ses traditions où la modernité technique est quasi absente : à peine une ligne de funiculaire ou ce train – très jouet d’enfant – dont la lumière artificielle des compartiments – le jaune flavescent des fenêtres – s’oppose au glaçage blanc des rayons lunaires.
Sur ces toiles noires, Pirosmani saisie des moments de rencontre avec ces immémoriales figures d’éternité, les fait surgir de la nuit, de notre nuit.
concerto en soleil majeur
Matisse, Derain et leurs amis
L’avant-garde parisienne des années 1904–1908
#EXPOSITION
Kunstmuseum Basel | Neubau du 2.9.2023 au 21.1.2024,
commissariat : Arthur Fink, Claudine Grammont, Josef Helfenstein
catalogue toilé en allemand ou en anglais, 266 p., 58 CHF

De septembre à janvier, le Kunstmuseum Basel consacre une exposition aux Fauvistes, mot dérivé du péjoratif « fauves » lancé par le critique d’art Louis Vauxcelles lors du Salon d’Automne de 1905. Le mouvement a été surtout actif à partir de 1904 et la chronologie affichée documente les années 1892 à 1908.
Pas moins de 160 œuvres s’affichent sur les cimaises du Neubau (2e étage). Certaines sont rarement montrées, quelques-unes même pour la première fois en Suisse.
La première salle présente des vues d’ateliers (Manguin, Marquet…) où la peau des modèles vivants irradie la lumière dans un environnement dense, graphique, enlevé, fait de taches, de traces : une respiration liquide, généreuse et colorée qui restitue les chevalets, les toiles dressées, les peintres à l’ouvrage… Les corps nus prennent des poses plutôt pudiques, mais arborent les coiffures sophistiquées de l’époque : la mode s’invite discrètement, avec aussi les melons et les canotiers.
Le groupe prend la pose le temps d’une photo. Il est informel et s’est constitué dans la classe de Gustave Moreau à l’École des Beaux-Arts de Paris. Après son décès en 1898, Henri Matisse prend l’ascendant. Sa touche est plus sombre que celle de ses camarades (ses collages La Tristesse du roi ou Jazz seront pour bien plus tard, après 1943), son Serf (bronze, 1900 – 1903) évoque Rodin. S’il se défend d’être un théoricien, il se livre volontiers, affirme que le tableau est plus important que le sujet. L’art doit savoir se déancrer du réel et il souhaite s’affranchir des usages trop installés.
On ne peut pas vivre dans un ménage trop bien fait, un ménage de tantes de province. Ainsi on part dans la brousse pour se faire des moyens plus simples qui n’étouffent pas l’esprit. Il y a aussi à ce moment, l’influence de Gauguin et Van Gogh. Voici les idées d’alors : construction par surfaces colorées, recherche d’intensité dans la couleur. La lumière n’est pas supprimée, mais elle se trouve exprimée par un accord des surfaces colorées intensément. / Henri Matisse (L’Intransigeant, 14 janvier 1929)
L’époque leur est favorable : avec les trains, les loisirs, le tourisme, émerge un monde nouveau qui favorise ce jaillissement.
Sur le conseil de Signac, Matisse passe l’été 1905 à Collioure avec Derain où ils développent leur langage pictural. Chez ce dernier les couleurs explosent. Les branches, les troncs articulent des tensions qui semblent repousser le cadre comme si le sujet était trop à l’étroit dans l’espace du tableau. Ils s’éloignent des impressionnistes et s’inspirent des gestes des pointillistes, mais sans la précision analytique, les touches sont larges, généreuses. Ils imposent un univers vivifiant aux tonalités audacieuses qui agrandit le monde, amplifie celui hédoniste des affiches et des cartes postales qui promeuvent ces destinations en bords de Méditerranée ou en Normandie. Celle-ci s’invite quand des artistes du Havre (Georges Braque, Raoul Dufy, Othon Friesz) rejoignent le groupe après le scandale de 1905.
Les drapeaux (Raoul Dufy, Le 14 juillet au Havre, 1906) ou les premières publicités (Albert Marquet, Affiches à Trouville, 1906 : la 1re œuvre pop art selon Joseph Helfenstein) envahissent leurs toiles. Ou ce soleil explosif dominant un contrejour électrique (Albert Marquet, La Passerelle à Saint-Adresse, 1905). Alors que Marie Laurencin s’inspire du douanier Rousseau. Si c’est La Plage rouge qui a suscité l’ire du critique, Matisse privilégie la figure humaine (Portrait de Mme Matisse, 1905 ; Margot, 1906 ; Portrait de Pierre Matisse, 1909) et comme ses collègues, il délaisse la préparation du fond. La texture du lin vibre sous les aplats crus (souvent tels sortis du tube) avivés par le gris clair des surfaces non-couvertes. Le traitement est franc, large, proche de Gauguin, s’inspirant quelquefois de son exotisme comme les apsaras de la monumentale Danse de Derain (1906, pièce rarement exposée, collection privée). Réunies en face (autre rareté), six de ses Peintures de Londres (1906-07) qu’Ambroise Vollard lui a commandé pour sa galerie.
Tous déchaînent l’exubérance solaire et bondissante de l’Alborada del gracioso de Ravel avec ses traits de trompette irradiant un parfum de jazz, tout en préservant l’ensorcelante délicatesse de son Ondine. Le reflet d’un monde qui se croit encore tout permis et auquel appartient l’avenir.
Une des originalités de l’exposition est de mettre en écho de nombreuses photos d’époque (fond Herzog & de Meuron) documentant aussi bien le balnéaire que les travailleurs des Halles ou les clochards parisiens. Car le monde interlope de la nuit parisienne, entre festif clinquant et misère, s’invite : Nu couché (Maurice de Vlaminck, 1905), Nu aux bottes noires (Charles Camoin, 1907), Modjesko, sopraniste (Kees Van Dongen, 1908)…
Une génération pétante de santé dont l’audace, l’articulation des compositions se prolongeront dans le cubisme. Ou l’expressionnisme : Van Dongen rejoint Die Brücke.
De la peinture sauvage avec tout le confort moderne pour paraphraser Claude Debussy (évoquant Le Sacre du Printemps).
éruptive profondeur
Le monde du silence
Michel Cornu à la galerie Murmure, Colmar
#EXPOSITION
Colmar, galerie Murmure du 8 septembre au 4 novembre 2023
contact@galerie-murmure.fr / +33 3 89 41 49 25
À l’automne 2020, Michel Cornu avait exposé avec Rose-Marie Crespin à la galerie Murmure située au cœur du vieux Colmar. Audrey Clerc ouvre à nouveau ses cimaises à l’artiste : une exposition monographique cette fois que la dimension de ses derniers travaux (2021-2023) mérite amplement.
énergie
Qui a-t-il de plus fascinant chez cet artiste ?
Plonger dans les noirs profonds, les tourbillons de ses grands formats comme si on était emporté dans la dispersion astrale du big bang ?
Ou le voir à l’œuvre avec cet impressionnant déploiement d’énergie, notamment quand il grave ?
Car Michel Cornu est une énergie. Opiniâtre, dense, presque cosmique comme certaines de ses œuvres. Il grave tel un boxeur, qui avance vers l’adversaire et ne le lâche jamais, malgré les coups, et cogne, cogne, cogne encore jusqu’à l’acculer dans les cordes. Des milliers de traits, de saignées, ces blessures infligées au métal qui, sous ses assauts, gondole, se tord (et le cuivre résiste, il a ses nœuds comme le bois) au point que le premier passage en presse aplatit la plaque autant qu’il imprime l’épreuve.
L’effort n’est pas seulement concentré sur le contrôle de la pointe sèche ou de la gouge, mais engage le corps entier surtout quand il entaille le centre de la plaque (il travaille sur établi des supports ayant souvent un mètre de large). Plus tard viendra l’encrage de ces presque deux mètres carrés et à nouveau l’exigeante contrainte sur le dos et la colonne afin de traiter toute la surface avec le même soin. D’ailleurs son premier geste de la journée à l’atelier est de boucler sa ceinture lombaire.
une logique de manière noire
Dans ses dessins très souvent, il couvre progressivement le support : encre de Chine, pastel, craie grasse… Des couleurs issues de la matière tellurique qui évoquent la terre, le feu ou la glace. Ensuite il gratte, érode, ponce, souvent à la machine, tourmentant la pulvérulence opaque (tellement plus exigeante à faire vivre que la peinture à l’huile qui se complaît dans les déclinaisons diaprées au fil du jour). Pourtant il ouvre une éclaircie, ajoute le trait rouge ou bleu, discret mais suffisamment cinglant pour qu’il surgisse de la matité qui s’illumine avec une force silencieuse au lieu d’abroger la lumière. Une provocation, entre enthousiasme et doute, qui génère une émotion vibratoire emportant le visiteur dans l’au-delà de l’œuvre.
Le chaos mis en beauté ? La beauté en suggestion d’ordre ?
Mais Michel Cornu sait aussi être légèreté, mettre à distance, réduire son geste à l’essentiel : spontané, net et juste.
Dans l’atelier des Éditions Bucciali où il pratique l’aquatinte, son pinceau virevolte sur le cuivre pour déposer le sucre [8]. Sa main danse avec des scansions, des contretemps, des caresses, des arrêts et des retours avec une grâce jazzistique générant d’explosives galaxies.
Occasionnellement il revient aux propositions qu’il développait il y a une dizaine d’années : un trait rare et clair cadrant quelques (petites) plages de couleur. Des pièces qui prêtent une respiration et une autre inspiration à son travail, rééquilibrent son parcours vers une altière méditation en contrepoint des denses profondeurs aussi ardentes que ténébreuses.
Un retour à l’effleurement… Blanc contre noir… Vide face au plein…
encres ludiques
Cette grâce labile se retrouve dans ses encres.
Des gestes amples avec des moments pulsatiles, des coups de brosse pointillistes et la manipulation, l’inclinaison qui arbitrent le sec et l’humide et se jouent du papier Japon (autour de 20 grammes/m2). L’évanescence s’emplit de vigueur. Le presque rien du support habité par le geste essentiel de Shitao devient une quête d’épure afin d’accéder à un ineffable qui génère une puissance visuelle emportant le corps, le sien d’abord, celui du regardeur par la suite.
Une urgence ludique qu’il a beaucoup pratiquée pendant les confinements : une conjuration enjouée de ce temps étal et verrouillé avec cette mélodie d’une œuvre par jour.
Et cette légèreté migre vers le cuivre !
Dans le travail préparatoire, il étale l’encre sur le métal : un gisement liquide qui cherche sa voie entre déclivité, obstacles et provocation, qui avance et rayonne. L’encre sèche, s’écaille, une corrosion discrète crée des motifs, des jeux de masses, de traces, entre dispersion et modulation. À creuser, à approfondir. Ou pas.
Si quelquefois d’anciens motifs surgissent tels des spectres – des arbres aux généreuses frondaisons ou les mendiants souvent affrontés –, ils sont toujours le fruit de cette vitalité originelle qui fabrique un chemin de silence vers d’autres mondes. L’hallucinante beauté des confins cosmiques qui explose dans l’espace du papier ou l’opiniâtre et dense avancée de la lave en fusion d’où émane une stridente incandescence.
Car Les yeux seuls sont encore capables de pousser un cri. (René Char, Feuillets d’Hypnos, 1946)
[8] La peinture « dite au sucre » permet à l’artiste de dessiner/peindre directement sur le cuivre son motif qui sera imprimé quasi à l’identique mais en miroir.
icônes de lumière
Quand dix mille vues entrelacées apprivoisent la lumière.
Élisabeth Bourdon au Temple Saint-Étienne
#EXPOSITION
Mulhouse, Temple Saint-Étienne du 9 septembre au 21 octobre 2023

L’artiste Élisabeth Bourdon investie l’espace d’exposition du Temple Saint-Étienne avec ses œuvres récentes : des pièces singulières à la technique innovante évoquant l’art du vitrail particulièrement en harmonie avec le site qui abrite des vitraux du XIVe.
Sont aussi exposées une demi-douzaine de toiles peintes à l’acrylique entre 2012 et 2018.
Dans un monde fragile et fragmenté, il est tentant de chercher, d’explorer afin de (re)trouver un ordre, tout au moins quelque chose qui permet de donner un fil de cohérence au désordre. Il y a sans doute une part instinctive dans cette pulsion, une part de conjuration aussi.
Le carré, unité primaire, apparaît comme un premier geste d’évidence. Mais le réel ne se laisse pas circonscrire aussi facilement et, très vite, il convient de le démultiplier. Le carré devient motif sériel, s’invite en profusion, en superposition, en lien. Bientôt les formes oblitèrent le fond – le geste premier de la peinture est de préparer le fond et Élisabeth y est très attentive. Si celui-ci disparaît peu à peu sous les motifs, il demeure en résonance avec les couleurs postérieures comme les harmoniques en musique enluminent la voix du chanteur ou de l’instrument. À la fin, il se livre en pulsations ourdies dont l’artiste joue car il y a du ludique dans la chorégraphie polychrome de ses compositions.
À ce trouble jeu, surgit quelquefois un visage, un animal, une architecture : magie de la paréidolie.
Si avec la peinture, elle module l’opacité avec de souterraines rémanences, depuis 2018, elle a inversé son approche et travaille sur la transparence. D’une technique à l’autre, la logique d’élaboration change peu.
Le fond, c’est désormais un luminaire led (60 x 60 cm), une surface écran et surtout une source de lumière pour irriguer l’exubérance colorée de ses arrangements obtenus par le filtre d’anciennes diapositives superposées, retravaillées.
La première série respecte strictement la règle du jeu avec l’occlusion du cadre : la juxtaposition scrupuleuse des diapositives (121 par couche). La créativité naît de l’apposition et de la superposition. Les sujets photographiés se dissolvent par la magie des recouvrements et de la diffraction. Le matériau impose ses contraintes, mais génère de l’inattendu, acquiert une vie propre loin des clichés.
Peu à peu l’artiste se libère de l’exigence du carré en décollant la pellicule du cache. Les œuvres gagnent en transparence, en vibration, abolissent les frontières tranchées, s’autorisent des superpositions plus nombreuses, plus audacieuses. Elle joue avec les rangées de perforations, manipule, abrase l’émulsion du support… Comme les sujets préexistent, elle les regroupe par séries thématiques suscitant à chaque fois une dynamique particulière à leur texture : élan des colonnes d’églises vers les chapiteaux, arabesques des tympans, moutonnement des paysages, etc. Même ses propres photos, souvenirs de familles, deviennent matière à filtrer la lumière.
Le film inversible a capté le réel – et de façon hyperréaliste : visages, paysages, détails d’architecture, tableaux… mais ces rendus objectifs n’existent plus que pour être transgressés. Le figuratif devient ferment d’abstraction ou chaque pièce décline sa dominante colorée.
Coquetterie d’artiste, avec des diapositives de leurs œuvres, elle rend hommage à Bacon, Rembrandt, etc., ajoutant quelques traits de pinceaux pour attiser l’émergence du portrait. Mais toujours discrètement, sans ostentation : laisser à l’amateur le plaisir de la découverte.
Avec ces pièces de lumière, Élisabeth Bourdon réinvente un art du vitrail non pour représenter ou raconter, mais provoquer la vibration graphique, colorée des photogrammes et, comme à l’ouverture d’un coffret à bijoux, offrir au visiteur le miroitement des trésors qu’il abrite.
Dans sa quête d’un ordre du monde, ses œuvres suggèrent qu’au-delà du carré l’unité primaire est la lumière et, comme le souffle Christian Bobin dans La grande vie (2014), L’âme naît au point de rencontre de notre néant avec la lumière qui nous en sauve.
artifice de l’imposture
Cyrano de Bergerac à Bussang
#THÉÂTRE
représentation du samedi 19 août 2023 au Théâtre du Peuple, Bussang
Saison de transition au Théâtre du Peuple de Bussang : Simon Deletang (qui l’a programmée) est parti en janvier et Julie Delille, sa remplaçante à la direction artistique, ne prendra ses fonctions qu’en octobre.
Aussi, Je voudrais parler de Duras, donné en soirée, est un spectacle invité tandis que Cyrano de Bergerac, monté pour la première fois à Bussang et programmée l’après-midi, a été confiée à la Yanua Compagnie.
Cyrano est la pièce la plus jouée du répertoire français. Si elle a quelques inconvénients pour le producteur : une distribution pléthorique, pas d’unité de lieu (cinq décors difficilement réductibles à un seul), elle a de sérieux atouts : conçue comme un opéra avec ses airs – les tirades – et un primo uomo omniprésent (il déclame 1 600 des 2 600 vers) permettant d’engager une tête d’affiche susceptible de remplir la salle. Cet amateur de bonne chère, bravache et revanchard, victime de sa personnalité entière auquel il est facile de s’identifier, contribue à rendre populaire le personnage comme l’ouvrage. C’est un théâtre d’action verbal mis en scène par l’alexandrin dont le rythme et les rimes amplifient les bons mots de l’auteur. Les quatre premiers actes sont plutôt narratifs et le cinquième concentre le réflexif sur le temps (qui passe), l’amour, etc. et s’achève par la mort de Cyrano : l’artifice du panache jusqu’au bout.
La proposition de Katja Hunsinger et Rodolphe Dana s’inscrit dans cet esprit et joue sans complexe le spectaculaire. L’entame est animée avec de nombreuses entrées et sorties par les portes latérales, quelques-unes vers la tribune. Le jeu est enlevé, légèrement appuyé, avec des enchaînements rapides voire des superpositions de répliques. Ça s’agite, ça crie, ça s’interpelle d’une loge d’avant-scène à l’autre jusqu’à l’entrée de Cyrano où le texte prend la main et conditionne la mise en scène. Elle reste allante, porte les bons mots de Rostand et le public rit souvent.
Rodolphe Dana incarne le personnage avec autorité, humanité et charisme (il est juste un peu moins vif que son jeune adversaire – un véritable acrobate – lors du duel au I). Et la troupe le suit (ou l’affronte) avec engagement et enthousiasme tel le flux et le reflux de la marée.
Olivier Dote Doevi joue un Christian constamment bousculé par les évènements, alternativement enflammé, timide, toujours en proie au doute. Mais distribuer un acteur noir dans ce rôle (un gage à la diversité sans doute) donne bizarrement aux mots de Rostand une coloration coloniale (le personnage est décrit comme sot, sans lettre, maladroit)…
Il est sûr qu’en face, De Guiche est un parfait salaud et Antoine Kahan prend plaisir à le jouer ainsi, cassant et venimeux. Lors de la bataille d’Arras dans l’ouverture vers la forêt, on le voit menacer de son mousquet les Cadets de Gascogne qui se replient ou reprennent leur souffle ; même si au V, il s’adoucit un peu affichant quelques remords.
La Roxane de Laurie Barthélémy est une cocotte posant ses exigences (aux trois hommes !) augurant la future dame patronnesse (elle amènera les victuailles lors du siège d’Arras). Un aveuglement narcissique dont elle prend conscience dans le dernier acte.
Quelquefois les mots des uns ou des autres se perdent (mais peut-être qu’avec la canicule, le son monte facilement vers les cintres).
Le décor naturel avec sa vaste découverte vers les Vosges est intelligemment utilisé.
Une saignée verticale dans le fond laisse deviner le carnage de la bataille (A IV).
Pour le dernier acte, les portes s’ouvrent entièrement. Des voiles aériens font basculer le marron du bois vers le blanc comme le capitonnage d’un cercueil s’ouvrant vers les spectaculaires frondaisons : un au-delà édénique et éthéré. Mais le saint sulpicien est mangé par la luxuriante végétation : en ce début d’automne et avec cette belle lumière du jour finissant, le sauvage par cet arbre noueux et magnifique imprime son évidence et son éternité sur l’artifice de l’imposture…
Les feuilles ! […] Comme elles tombent bien ! (A V, s 5)
suturer la fragilité du monde
Doris Salcedo
#EXPOSITION
Riehen (Bâle), Fondation Beyeler du 21 mai 2023 au 17 septembre 2023
commissariat : Sam Keller, directeur de la Fondation Beyeler, et Fiona Hesse
beau catalogue – exhaustif sur Salcedo – en anglais, 256 p., 58 €
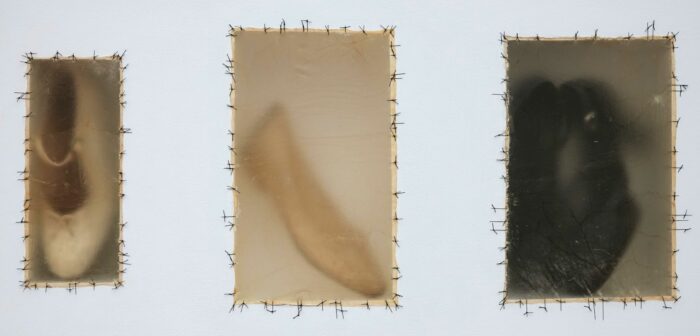
La Colombie est un pays violent par la politique, par la criminalité : FARC, cartels de la drogue, groupes paramilitaires, forces gouvernementales… avec la nécessité pour la population de survivre à leurs affrontements, exactions et collusions. Dès 1948, l’assassinat de Jorge Eliécer Gaitán, dirigeant du parti libéral, ouvrait la période dite « La Violencia » (1948-60) et le désarmement des FARC fin 2016 n’a qu’imparfaitement pacifié le pays. Doris Salcedo est née dans cet « épicentre de catastrophes », Bogotá, et toute son œuvre est traversée par cette brutalité aussi sauvage qu’impitoyable.
La Fondation Beyeler a réuni une centaine de ses pièces pour huit installations.
Pour l’artiste, chaque œuvre, chaque installation est l’écho d’un drame, d’un crime… et aussi d’une plongée en enfer, car elle enquête et se confronte aux survivants, aux proches des victimes, aux témoins. Dans son travail d’élaboration (qui est aussi d’inventivité et d’imagination : rien n’est jamais au premier degré comme chez un photographe de presse qui shoote le sang et les ruines), elle s’immerge dans la matérialité de la violence et de ses effets induits, y déniche souvent les matériaux concrets de ses installations pour en exprimer la quintessence et partager la stupeur absolue devant la possibilité de cette barbarie, souvent institutionnalisée.
Je ne travaille pas le bronze ou le marbre, mais des matériaux plus ordinaires. Ils vous montrent à quel point l’être humain peut être fragile. Je parle de la fragilité d’une caresse passagère. Si nous étions capables de comprendre cette fragilité inhérente à la vie, nous serions peut-être de meilleurs êtres humains.
création collective
Le long temps préparatoire, la mise en œuvre collective (souvent), l’investissement d’un lieu emblématique (quelquefois) rappellent le process de fabrication de Christo & Jeanne-Claude, sauf que Salcedo déballe, met le doigt là où ça fait mal. Et cela fait d’autant plus mal qu’entre la métaphore, l’allusion et surtout cette toute féminine délicatesse – sans avoir l’air d’y toucher –, l’émotion infuse le visiteur doucement par la beauté des œuvres : ce jeté de fleurs de A Flor de Piel (2011–14) – à fleur de peau –, cette impalpable résille de Disremembered (2014–15 & 2020–21)… L’objet, leur accumulation imposent un silence recueilli qui ressuscite la mémoire, puis entrent en résonance jusqu’à l’insupportable, comme le crissement de la craie sur un tableau noir, noir comme cette partie de notre (in)humanité capable des actes dont témoignent ses installations.
Son geste artistique est toujours d’une rare et pertinente intelligence : ces noms liquides qui s’écrivent, s’assèchent, puis coulent à nouveau comme des larmes qu’il est impossible d’étancher (Palimpsest, 2013–17), ce martèlement à la masse (par les victimes elles-mêmes) des armes des FARC (acte cathartique quelque part, Fragmentos*, 2018), cette opposition de la fragilité indicible de la soie phagocytant de fines aiguilles (Disremembered), cette récurrence du fil chirurgical et des sutures qui sont réparation et liens, mais affirment en creux les aiguilles, le percement de la chair. Un jeu de contrastes saisissant qui rameute la douleur, lui donne sens et suggère qu’elle peut aussi guérir. La souffrance n’est pas toujours vaine…
guérir l’humanité ?
Doris Salcedo n’est pas dupe : Nous ne savons pas et ne voulons même pas pleurer les vies sans valeur pour nous (2018).
Cependant elle persiste à donner une présence à cette infrahumanité (migrants, disparus, victimes…) maintenue dans les marges et, comme un testament de leurs blessures, brandit l’arme du beau : cette dichotomie entre l’inimaginable violence et cet indicible que font vivre ses pièces. Pourtant elles savent être fermes – béton de Untitled, 1989 – voire monumentales – les 400 m2 de Palimpsest – ou incontournables – les 800 m2 en plein centre de Bogotá de Fragmentos*. Avec la logique de séries, elles proclament le nombre – celui des victimes (presque toujours plusieurs dizaines de milliers) –, mais multiplient aussi les indices d’espoir.
Si ses œuvres s’écrivent en volume, leur surface aussi parle : la peau de A Flor de Piel, de discrètes broderies ou couleurs affleurant de la laitance sédimentée du béton (Untitled, 1989), ces brins d’herbe si graciles émergeant des interstices de tables ayant la dimension de cercueils (Plegaria Muda, 2008–10), ces peaux floutant les chaussures de disparus devenus fantômes (Atrabiliarios, 1992–2004), cette matière comme amidonnée de chemises figées sur leur pal (Untitled, 1989–93).
anonymat
Si Doris Salcedo n’a pas de grand discours philosophique (mais elle en lit et s’en inspire), elle ajoute avec son travail cette pierre angulaire à la banalité du mal : l’anonymat, un moyen institutionnel d’évacuer ceux qui dérangent, une forme de nihilisme du système qui prospère quand la violence est endémique. Avec ce silence radical synonyme d’absolue indifférence, cet exercice du pouvoir ouvre des cicatrices bien palpables.
L’artiste colombienne s’en fait l’archéologue et y oppose la pénétrante acuité de ses œuvres nourries d’une active Humanité. Celle d’un « être Humain » !
* pièces non exposées, mais documentées dans le catalogue
nouvelle ère aux Unterlinden
Camille Broucke, nommée Directrice du Musée Unterlinden avec la responsabilité scientifique des collections médiévales
#MUSÉE
Colmar, Musée Unterlinden (cp du 6 juillet)

Face à un monde qui bouge et de plus en plus vite, il est important d’être en capacité d’évoluer, de s’adapter aussi, et Camille Broucke qui a beaucoup bougé – par goût comme par nécessité – aura la charge de piloter le Musée Unterlinden vers cet avenir mouvant et incertain à partir du 18 septembre 2023.
Conservatrice territoriale du patrimoine depuis 2011, elle succède à Pantxika De Paepe partie à la retraite après dix-huit années à la tête de la prestigieuse institution colmarienne.
Éric Straumann, Maire de Colmar, revendique un choix consensuel du jury paritaire – Mairie et Société Schœngauer – pour désigner la nouvelle directrice.
Thierry Cahn, président de la Société, précise que cette nomination permettra à la jeune femme de participer au recrutement de la conservatrice en charge de l’art contemporain, poste vacant depuis janvier 2022 suite au départ pour Dijon de Frédérique Goerig-Hergott.
Camille Broucke a fait une brillante carrière universitaire avec des choix pragmatiques (elle a fait Sciences Po) tout en préservant un parcours dans le patrimoine médiéval aux perspectives de carrière plus fragiles, mais qui lui permettait de cultiver son goût pour le concret : le contact direct avec les œuvres.
En 2012, elle a rejoint sa première affection à Moulins au Centre national du costume et de la scène (CNCS).
Elle retrouve sa spécialité en 2014 à Nantes au musée Dobrée où elle est chargée des collections médiévales.
Lors de son cursus universitaire, elle a eu une première expérience américaine au Metropolitan Museum de New York (stage à l’international) et surtout en 2023, elle fut l’une des lauréates du programme Museums Next Generation de la Villa Albertine. Initiée en 2021, cette institution (telle la Villa Médicis) immerge des professionnels de la culture au cœur d’une Amérique vue « comme le chaudron utopique et dystopique du monde qui vient » avec un rôle déterminant dans la nouvelle géographie mondiale des arts et des idées.
C’est d’ailleurs à Los Angeles qu’elle a appris sa nomination.
En flamboyant héritage, elle bénéficie d’un Retable d’Issenheim « presque neuf » du haut de ses cinq cents ans et, si elle n’a découvert les Unterlinden qu’en 2015 après l’extension, elle se dit très fière de diriger un musée de notoriété nationale et même internationale pour les médiévistes rappelant qu’au-delà du Retable, la collection compte nombre de chefs-d’œuvre de cette période aux spécificités tout à fait remarquables.
Après l’exposition-anniversaire des 170 ans du musée (14.10.2023 – 04.03.2024), elle assurera le commissariat de celle consacrée aux primitifs rhénans (1400-1550) prévue ensuite. Ce début de mandat aussi exigeant qu’exaltant lui permettra de donner toute la mesure de son talent.
une logique d’enfermement
Turandot à l’OnR
#OPÉRA
représentation du mardi 4 juillet à La Filature, Mulhouse (OnR)
Puccini est décédé avant d’achever Turandot. La première prévue en novembre 1925 a été repoussée au printemps 1926, le temps qu’Alfano termine l’opéra et c’est cette version créée le 25 avril par Toscanini à la Scala de Milan qui circule depuis, sauf quand une équipe (comme à Zurich cette saison) décide de ne présenter que ce qui est de la main de Puccini, soit jusqu’à la mort de Liu incluse.
La réalité est un peu plus complexe*. Toscanini, qui connaissait les fragments, a réclamé de sérieuses coupes dans la version d’Alfano (les passages sans esquisses de Puccini). C’est la fin complète telle que composée par Alfano, plus cohérente, qu’Alain Perroux a choisi d’utiliser pour cette production.
* dans le programme, un article d’Alain Perroux détaille les circonstances dans lesquelles s’est déroulé le travail d’Alfano.
Il existe un enregistrement de cette version dirigée par Antonio Pappano
avec Jonas Kaufmann, Sondra Radvanovsky & Ermonela Jaho (mars 2022).
Une foule bigarrée, smartphones collés à l’oreille, s’adonne avec frénésie au shopping. Elle est canalisée par les néons d’enseignes multicolores en mandarin. Cette agitation désordonnée installe l’opéra dans une Chine contemporaine livrée aux injonctions consuméristes. Cependant de sombres nervis rôdent, sanctionnant le moindre écart, et bientôt des projecteurs-caméras gèleront la foule et la contraindront à un ordre plus militarisé rappelant que la liberté n’est qu’un simulacre.
Éparpillée en tous sens, la masse chorale (les chœurs de l’OnR renforcés par ceux de l’Opéra de Dijon) a d’emblée beaucoup de mérite en préservant un bel ensemble avec une dynamique puissante si importante dans cet ouvrage.
Au-delà du côté techno, la metteuse en scène, Emmanuelle Bastet sait créer de belles images : cette lune projetée au sol où « s’abreuve » la foule rassemblée en cercle (Perché tarda la luna?).
Très vite, Timur, Liu, Calaf qui diffractent – des étrangers, des migrants… –, s’isolent. D’ailleurs les couleurs disparaissent, les néons s’éteignent, les enseignes se rabattent et la boîte se referme.
Cette intimité profite à Mischa Schelomianski qui aurait gagné à être plus mordant, Timur est comme un roc qui surgit du fleuve sans parvenir à arrêter le courant de la folie (de son fils, de la meute).
Adriana Gonzalez cisèle une Liu remarquablement émouvante avec sa voix onctueuse à la projection impeccable, s’autorisant des piani filés dignes des plus grandes. Le chef Domingo Hindoyan accompagne cette infinie délicatesse avec des sonorités diaprées, puis s’engouffre dans les tutti leur trouvant des rugosités moussorgskiennes magnifiant cette figure de femme broyée tant par la compassion assez extérieure de Calaf que par les pulsions sauvages du collectif qui ne jure que par la brutalité du sang et du faste.
Avec un timbre agréable aux couleurs plutôt sombres, Arturo Chacón-Cruz incarne un Calaf musicalement vaillant avec une tendance instinctive à venir vers l’avant-scène. S’il est moins subtil qu’Adriana Gonzalez, son énergie vocale compense une certaine raideur et il ne pâtit pas trop de la comparaison quand il enchaîne ses airs avec ceux de Liu.
C’est en trottinettes électriques et casques avec GoPro que Ping (Alessio Arduini, baryton aussi pertinent qu’incisif), Pang (Gregory Bonfatti) et Pong (Éric Huchet) envahissent la boîte avant de s’affaler dans des fauteuils de bureau : des managers harassés par la régie des supplices. Ils énoncent certaines consignes au téléphone, et cela fonctionne plutôt bien, tout comme leur rêve de retraite champêtre. Malgré son apparente légèreté, la scène prend ainsi un tout autre poids.
Les gamins alignés (Les Petits Chanteurs de Strasbourg – Maîtrise de l’OnR) agitant des drapeaux rouges et la démultiplication de l’image de l’empereur suggèrent un caricatural culte de la personnalité. En vieux général médaillé, Raul Gimenez (fort de sa belle carrière de belcantiste) donne une vaillance bienvenue à Altoum, un empereur encore vif et très digne.
Turandot est un rôle difficile qui écrase tout de sa puissance (pas seulement vocale). Le souvenir de son aïeule assassinée par un prince étranger est trop superficiel pour creuser des zones d’ombre, la puissance ne remplace pas l’épaisseur humaine. Elisabeth Teige est très impressionnante, nette et droite, avec ses modulations hypnotiques, elle domine tant l’orchestre que les chœurs. Elle trouve plutôt ses espaces de jeu dans le silence et impose la femme avec ce corps qui se révolte contre des tourments irrationnels (la pulsion suicidaire, le Nessun dorma devenant un étrange hommage à cette femme endormie).
Le duo avec Calaf est rivalité, combat de titan où chacun avance sa volonté, il est sonore, sans excès ici, mais ces deux-là peinent à se fabriquer un destin commun. Le rêve d’égaler Tristan est loin, il n’y a pas l’accomplissement émotionnel nécessaire et la version longue y change peu de choses (à peine un espace-temps supplémentaire pour effectuer sa mue sensible). Certes les réminiscences du Nessun dorma l’irriguent d’un soleil nocturne, mais l’effronterie dans la révélation du nom – Amore – relève plus du truc de librettiste. On reste dans l’émotion pipole et le choix d’Emmanuelle Bastet l’entérine : le jeune premier craque pour la star hollywoodienne – et dans son lamé, la soprano évoque Anita Eckberg dans Fellini Roma qui en est une spectaculaire métaphore. Le chef souligne volontiers les dissonances, les élans non résolus tirant la partition vers une séduisante modernité (Schönberg admirait beaucoup Puccini), mais la modernité, semble-t-il, n’est pas propice à l’amour…
Si Butterfly est une charge cinglante (et déchirante) contre le colonialisme le plus abject, Liu est peut-être la plus accomplie de ces femmes victimes avec la bouleversante « marche funèbre » enchâssée dans une barbarie collective qui soudain s’amende. Une empathie, une attention au collectif, un humanisme plus proche de Puccini (on pourrait aussi évoquer Il Tabarro) que l’hédonisme somptueux, mais narcissique de Wagner dans le duo de Tristan.
Puccini s’est arrêté à cette bouleversante mort de Liu. L’émotion aussi.
scénographie : Tim Northam ; costumes : Véronique Seymat
lumières : François Thouret ; vidéo : Éric Duranteau
chefs de chœur : Hendrik Haas, Anass Ismat & Luciano Bibiloni
Pierre à La Ligne
Living Systems
Carola Bürgi & Pierre Muckensturm
#EXPOSITION
Galerie La Ligne, GmbH, Heinrichstrasse 237, 8005 Zürich (CH) du 17 juin au 29 juillet
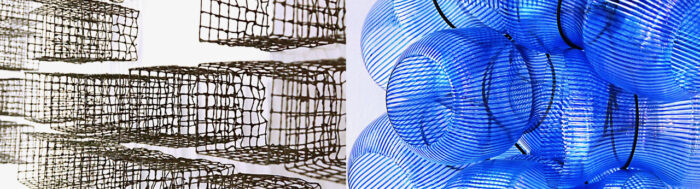
Pierre Muckensturm qui vit et travaille dans la vallée de Munster avait exposé à l’Espace Malraux (Colmar) en 2021. Peu après, il est entré dans « l’écurie » de la galerie La Ligne à Zurich au côté de figures marquantes de l’art concret : Vera Molnar ou Aurelie Nemours. Du 17 juin au 29 juillet, La Ligne met son travail en avant et en dialogue avec celui de la plasticienne zurichoise Carola Bürgi.
Le vernissage a été l’occasion d’échanger avec l’artiste et d’évoquer l’évolution de sa démarche, la liberté ludique qu’il développe dans le cadre de la géométrie concrète et ses perspectives (lire l’article).
Un artiste à suivre.
« Tenter de maîtriser un système conduit essentiellement à le perturber…
Carola Bürgi et Pierre Muckensturm manient avec une légèreté ludique la déclinaison sérielle de modules déconstruisant un système, sans avoir l’air d’y toucher. Par accumulations et strates, ils dévoilent des moments de basculement qui brisent les frontières du sens.
Pour Pierre Muckensturm, l’usage répétitif et systématique d’éléments structurants – Entasis, frette crénelée – génère une chorégraphie déraisonnable qui rend lisible l’illisibilité.
Carola Bürgi recycle des déchets – barquettes en plastique, PET-Flaschen – et cherche à travers une transparence plastique une potentielle métamorphose ayant une foisonnante signification métaphorique. »
Sabine Arlitt, historienne de l’art
(traduit de l’allemand)
spatialité vibratoire
RADICAL. L’abstraction géométrique dans la Collection Würth
LORE BERT. Collection Würth et prêts
#EXPOSITION [parution papier NOVO n° 69, p. 82-83]
Erstein, Musée Würth du 13 juin 2023 au 7 janvier 2024

Le Musée Würth, Erstein, met deux femmes à l’honneur : la galeriste parisienne Denise René et l’artiste allemande Lore Bert, deux protagonistes de l’abstraction géométrique.
L’article est paru en juin dans Novo n°69 (p. 82 & 83)
sous le grill
Dans la mesure de l’impossible
de Tiago Rodrigues
#THÉÂTRE
représentation du 15/06/2023 à La Filature (Mulhouse)
La pièce de Tiago Rodrigues se revendique du théâtre documenté avec une part d’écriture de plateau. Son projet (aller voir les humanitaires sur place, dans l’action) a basculé avec la pandémie vers des entretiens ici, loin des lieux de l’impossible. Ils ont produit des récits distanciés qui prennent aussi le temps d’interroger, sans l’épique, sans le sang. Ne restent que de gros caillots coagulés et c’est d’autant plus glaçant.
Avec les percussions de l’impressionnant Gabriel Ferrandini, compositeur et interprète, qui accompagnent, contrepointent, hurlent à l’occasion.
Des battements comme le tocsin dès l’entrée du public.
Ostinato.
Sur scène, une grande toile suspendue – tente ou montagne enneigée – sous un gril avec sa machinerie de théâtre : poulies, filins, projecteurs…
Entrent deux femmes, deux hommes, vêtements ordinaires, comme vous et moi, la lumière baisse à peine.
Ils elles nous parlent, livrent des bouts de témoignages, esquissent le récit des humanitaires aux comédiens [vers nous, public] qui veulent transcrire, puis jouer ces rôles.
Avec le silence des questions.
Émergent les doutes, les hésitations, les personnalités, leur idée de l’humanitaire, leurs motivations, ambiguës quelquefois – notre générosité est égoïste.
Mise à distance car l’urgence est loin, dans ces pays de l’impossible.
Un premier quart d’heure presque statique,
un flottement figé dans le doute,
dans le trauma des souvenirs aussi.
Ensuite à tour de rôle, ils racontent des histoires vraies, vécues, dans leurs détails insoutenables ou lumineux, leur engagement voire l’acharnement à poser des sparadraps sur les plaies ouvertes. Mais les drames sont fabriqués plus vite qu’ils ne posent ces rustines : l’impossible change constamment de place !
La musique gronde sourdement ou gifle ou scande les mots staccato ou leur fait écho, sait se taire aussi ou raconter avec une brutalité amplifiée : ce passage qui évoque les hélicoptères d’Apocalypse Now (sans hélicos ni Walkyries), quand la guerre reprend ces droits et, juste après le sauvetage d’une victime, produit de nouvelles victimes avec les comédiens figés dans cet assourdissant silence. Le monde est une stupeur écrivait Jean-Luc Nancy et Tiago Rodrigues la met en image et en son.
À vue, au fil du spectacle, les comédiens/humanitaires tirent les haubans, lèvent la toile de tente, lèvent ce voile comme pour dévoiler le pot aux roses :
La source de cette souffrance qui nous indigne, quand on enquête vraiment, se trouve chez nous, dans notre système capitaliste qui a envahi toute la planète et adultéré les valeurs fondamentales.
Long solo final de Gabriel Ferrandini, les humanitaires sont partis : les mots n’ont plus leur place ou alors loin, dans ces lieux de l’impossible pour tenter de changer une vie, gagner du temps, car on ne peut pas changer le monde. Et pour nous curieux, public assis dans le possible, il déploie cette vibrante densité physique pour purger l’horreur.
chaos joyeux
répétition Music for 18 musicians (S. Reich/S. Groud)
#MUSIQUE & DANSE
La Filature (Mulhouse), Theater Basel & Theater Freiburg
3 représentations les 3, 8 & 10 juin 2023
OsM+Ensemble Links dirigé par Rémi Durupt, mise en mouvement de Sylvain Groud
Quelques images de la répétition une semaine avant la 1re représentation du spectacle.
Une atmosphère de chaos joyeux (et hypnotique) pour tous les participants.
Une implication très sérieuse – quand même – de la quarantaine de volontaires qui seront sur scène avec les danseurs du Ballet du Nord (Lauriane Madelaine, Julien-Henri Vu Van Dung, Julien Raso, Martin Grandperret, Perrine Gontié) pour ce spectacle participatif donné le 3 juin à La Filature, Mulhouse. Ils seront rejoints par leurs homologues Fribourgeois et Bâlois préparés de la même façon.
Générale la veille dans le lieu, avec deux autres représentations : le 8 juin à Bâle & le 10 juin à Fribourg.
Le projet porté par trois villes et trois théâtres ambitionne de sensibiliser de nouveaux publics à la musique contemporaine grâce à sa dimension participative. Au programme Music for 18 musicians de Steve Reich chorégraphiée pour une centaine de danseurs. Une pièce culte de la musique répétitive créée en 1976, une œuvre hypnotique jusqu’à la transe qui figure au répertoire de l’ensemble Links depuis quelques années et nécessite un dispositif impressionnant – notamment quatre pianos – auquel s’associeront pour l’occasion onze instrumentistes de l’Orchestre symphonique de Mulhouse.
Minibus, tsunami, marche impériale et bien sûr samba : des images évocatrices pour partager les gestes, les déplacements de la mise en mouvement imaginée par Sylvain Groud sur la musique de Steve Reich.
La semaine avant, Julien Raso et Martin Grandperret avaient déjà transmis l’ensemble de la chorégraphie. Samedi, ils se concentraient sur le rythme, les échanges (de regards !), la netteté des mouvements et la prise en compte du… chaos !
répétition du samedi 27 mai (13h30–19h, 2 groupes) à la Filature, Scène nationale de Mulhouse
preuves à (dé)charge
Le temps s’enfuit sans disparaître
#EXPOSITION
galerie de La Filature, Scène nationale de Mulhouse du 26.05 au 9.07.2023
commissariat : Emmanuelle Walter

L’exposition quoique collective restitue le travail de Cassandre Fournet et Gaëtane Verbruggen, lauréates du Prix Filature 2019 et de Rémy Hans, lauréat 2021. Elle se déroule en lien avec Mulhouse 023, biennale de la jeune création contemporaine (du 10 au 13 juin à Motoco).
Pour une fois, le dessin prend le pas sur la photographie. C’est le point commun de ces huit artistes de la jeune génération, mais qui travaillent, le plus souvent, d’après photo : un moyen qui permettait de rapporter un sujet dans le lieu de confinement, mais aussi ceux qu’il est impossible de documenter autrement.
Une exposition qui interpelle aussi la figuration.
Elle s’ouvre avec un binôme revendiqué (même atelier, même site Internet) : Capucine Merkenbrack restitue le corps par fragments – un jeu de couleurs et d’os –, sa camarade Chloé Tercé croque des personnages en jouant sur le décalage, l’antinomie et les reproduit en risographie (un dispositif d’impression respectueux de l’environnement inventé en 1946 et commercialisé à partir de 1958).
En face, les enfants que dessine Jo Kolb sont très vite dérangeants par l’assimilation du sujet et de ses gadgets – qui phagocyte qui ? Mais l’artiste l’assure : tous ces portraits sont faits d’après photo. Sa façon de valider l’artificialisation en cours de l’humanité ?
La contamination du quotidien par le consumérisme touche aussi Chloé Charrois qui a manifestement une fascination pour les gadgets. Souvent liés à des souvenirs d’enfance, elle les resitue de façon ludique s’autorisant des collages sur certains.
Adepte de la miniature, Gaëtane Verbruggen affiche des vues de hangars industriels ou d’intérieurs marouflées sur bois. Des dessins discrètement colorés, à peine plus grand qu’une carte postale, avec des éclairages rappelant le clair-obscur hollandais. La série évoque des hublots vers des lieux vastes et troublants : ceux d’un crime ? Des espaces liés à l’inquiétante étrangeté assurément…
Rémy Hans semble discret – la matière diaphane de ses voiles transparents bleu, ses sujets perdus sur de vastes supports –, pourtant il s’empare de l’espace de la toile comme de sa part de galerie : une dissonance affirmant la force et la fragilité des souvenirs ?
Profusion et diversité avec la précision botanique des herbes folles de Cassandre Fournet, qui colonisent la netteté industrielle des (micro) espaces urbains s’amusant avec la couleur quand l’appropriation est humaine (fresque).
Les nombreux météores et quelques satellites d’Iva Šintić sont réalisés d’après photos – forcément. Sa patte hédoniste fait chatoyer cette obscure immensité, mais s’attarde aussi sur le trouble du ciel avec un chaos façon Elon Musk. Pour suggérer que le chaos est surtout d’origine humaine ?
L’ampleur et la précision des encres d’Emmanuel Henninger achèvent l’exposition en grand. Notamment deux panoramas des mines de Hambach et Garzweiller (Rhénanie-du-Nord-Westphalie) avec un choix fort : laisser en blanc l’empreinte humaine. Son travail est très documenté (repérages, photos, croquis…) avec la volonté de multiplier les points de vue sur le sujet. Le prochain sera de dessiner le lieu où tout se joue : le Bundestag, un hémicycle avec ses gradins comme ces mines à ciel ouvert…
Au-delà de la photo (qui peut aussi être retouchée…) se pose la question de la restitution du réel. Souvent les choix de l’artiste quand il fabrique ses images font émerger une réalité plus réelle et palpable qu’une documentation « authentifiée » qui met à distance la vitalité du sujet.
L’acte de dessiner de Jo Kolb produit un regard affûté par l’artiste et donc une interrogation plus dense sur cet univers que ne le feraient les photos originales.
La blessure dans le paysage apparaît d’autant plus démesurée sur les encres d’Emmanuel Henninger que les zones blanches évacuent autant les énormes excavatrices (Bagger 288) que la fascination technologique.
D’ailleurs par crainte du fichage, les Zadistes ont refusé d’être dessinés. Dans la société de surveillance, même les dessins peuvent devenir des preuves…
dopo l’apocalisse
Abdelkader Benchamma, Géologie des déluges
Fondation François Schneider, Wattwiller
#EXPOSITION
Wattwiller, Fondation François Schneider du 13 mai au 24 septembre
commissariat : Marie Terrieux

Abdelkader Benchamma s’intéresse depuis fort longtemps à l’infiniment grand et s’efforce de le faire entrer dans l’exiguïté de la toile, du papier ou de l’espace qui accueille ses expositions et sur lequel il lui arrive d’intervenir directement. Ainsi Écho de la naissance des mondes à l’automne 2018 au Collège des Bernardins où Marie Terrieux, directrice de la Fondation François Schneider et commissaire de l’exposition, a découvert son travail. Peu après elle lui a proposé d’investir les 1 200 m2 de la Fondation aboutissant à cette Géologie des déluges conçue spécialement pour le lieu.
Des épisodes diluviens hantent la plupart des mythologies, de l’Asie à l’Amérique latine, des textes mésopotamiens à la Bible en passant par le Mahabharata indien, le Shanhaijing chinois ou le Coran sans oublier les traditions animistes. Comme si un cataclysme aquatique avait bouleversé la planète semant le chaos, se gravant dans les mémoires collectives, le bouche-à-oreille transformant progressivement une traumatique épopée climatique en mythes. Si le déluge biblique est punitif, sous d’autres cieux il peut être (re)fondateur.
Entre documentation scientifique et livres sacrés, Abdelkader Benchamma explore cette cosmogonie et la transcrit en récits picturaux, en paysages mentaux. Il utilise beaucoup l’encre de chine quelquefois rehaussée par l’acrylique surtout dans ses interventions in situ au rez-de-chaussée. Pour y inscrire ses Lignes de rivage, il a occulté certaines fenêtres vers les Vosges et a installé en regard des modules autoportants de placoplâtre : des fonds pour ses motifs à la fois tourmentés et hédonistes couvrant les surfaces visibles du visiteur qui pénètre dans la salle, se limitant à de petits paysages sur certains flancs face au jardin. Son dispositif évoque les îles karstiques et les pitons rocheux de la baie d’Ha Long et, s’il se referme sur lui-même côté ouest, il se prolonge harmonieusement au dehors côté jardin par Le Mont d’ici (Sylvie de Meurville, 2011–2013).
Ces tertres se veulent aussi l’émergence des « dessous » engloutis par les eaux. Si les dominantes bleues rehaussent l’habituel noir et blanc de l’encre, elles peinent à donner cette vitalité liquide d’une eau physiquement présente – comme le délicat bassin aux céramiques de Céleste Boursier-Mougenot (clinamen v.6, 2012–2019) ou l’omniprésence sonore du Refuge de Stéphane Thidet (Nos îles en 2022).
Le long palier en contrebas affiche des petits formats inspirés du Kometenbuch (Livre des comètes, 1587) rappelant que les comètes seraient à l’origine de l’eau sur terre. Des enluminures fines et délicates que prolongent de plus grands formats au niveau moins un : Géologie des déluges & Retraite des eaux avec une version chinoise de la catastrophe.
Au sous-sol (–2), la Grotte Céleste ouvre vers un autre univers, sombre et mouvant : tréfonds, cavernes, mais aussi planètes en révolution. Ce qui, possiblement, a été englouti… ou épargné. Les sources et les fascinations d’Abdelkader Benchamma s’affichent ici et tissent le lien avec d’autres arts visuels : la bande dessinée et le cinéma. Il cite 2001, l’Odyssée de l’espace, mais il y a aussi cette couveuse qu’explore l’équipe d’Alien… Dans les vidéos, se devinent des traces d’humanité : discrètes fourmis, de petits personnages s’y affairent. Plus loin il présente les planches de son livre d’artiste Random (2014) proche du 8e art tout en s’abstrayant de ses règles trop strictes (cases, scénario…). Le goût du chaos est palpable avec l’ambition de l’élever au rang de mythe et comme préalable à un autre monde auquel l’artiste a envie de croire. Cependant comme le suggère Nietzsche : La civilisation n’est qu’une mince pellicule au-dessus d’un chaos brûlant.
Addendum du 20 juin 2023.
Ulysse Bordarias, Bilal Hamdad, Manon Lanjouère, Aurélien Mauplot, Ugo Schiavi et Noémi Sjöberg sont les 6 lauréats de la 12e édition du concours Talents Contemporains. Leurs œuvres rejoindront la collection de la Fondation.
Le jury était placé sous la présidence de Jean-Noël Jeanneney. 433 artistes avaient candidaté.
archéologie des cicatrices
Andrea Büttner, Der Kern der Verhältnisse
Kunstmuseum Basel – Gegenwart, Hauptbau, Neubau
#EXPOSITION
Kunstmuseum Basel – Gegenwart, Hauptbau, Neubau du 22 avril au 1er octobre
Andrea Büttner, Au cœur des relations | commissariat Maja Wismer
catalogue très documenté sur l’artiste (Deutsch, Englisch, 384 p., 58 CHF)

Au Gegenwart, le Kunstmuseum Basel propose jusqu’au 1er octobre la plus importante rétrospective jamais consacrée à l’artiste berlinoise Andrea Büttner avec plus de 90 œuvres regroupées en six fils narratifs. Son geste artistique prolonge son exigeante attention aux faits sociétaux notamment aux rapports de pouvoir ou aux ambivalences qui se cachent dans les (demi-)vérités établies. Chaque fois, elle utilise le média le plus pertinent pour les rendre puissamment visibles, de la gravure à la vidéo en passant par la sculpture, la photo ou l’installation.
Le point d’entrée de son travail pourrait être ses grandes gravures sur bois qui jalonnent sa carrière et les cimaises du musée. Sous une apparente simplicité, le format ample s’oppose au trait économe, net et nerveux s’autorisant quelquefois un ornement – au sens musical : une vibration suscitée par le matériau qui élargit la trace de l’outil (cf. série Beggars, 2015 | 9). S’en dégage une impression de puissance et l’énergique morsure de la gouge renvoie au geste lourd du travailleur récoltant les asperges (Erntende, 2021 | 7). Chez elle, les mains incarnent intensément le rapport au monde même quand il est virtuel avec ces traces bien concrètes laissées sur les écrans (Phone etching, 2015 | 2). La logique de série avec la multiplication des pièces – et donc des efforts – amplifie la rugosité du labeur de l’ouvrier représenté comme celui de la graveuse qui se l’approprie et renvoie à Kunstgeschichte des Bückens (Histoire du corps courbé dans l’art, 2021, diaporama | 1).
Le bois est un choix revendiqué, c’est le matériau de beaucoup de ses sculptures (Spargel, 2021 | 7), un élément structurant de ses installations (Benches, 2012-18 | 4, ou de la présentation des Vases, 2021 | 6), celui de la croix aussi. De telles constantes, entre métaphore et présence palpable, balisent son œuvre : ainsi le marron du rez-de-chaussée ou derrière les Vases : allusion à la terre, au chocolat ou aux excréments, à la bure de Saint-François comme aux chemises brunes… ou les Bread Painting, (fixés sous verre, 2015 | 10) qui dialoguent avec les miches de la Cène, de la multiplication des pains ou de banquets. Une volonté de s’ancrer dans la profondeur d’un quotidien atavique, de tisser aussi le lien entre art et artisanat (cf. aussi Vase ou ces parterres photographiées ou plantés Moss Garden, 2014 | 8).
Les croix noires rythmant l’accrochage du 2e étage, au-delà de leur symbolique, renvoient aux vidéos qui interrogent la religion, plus précisément le lien entre l’ambition spirituelle affichée et l’environnement profane : Little Sisters : Lunapark Ostia, 2012 (HD video, 42 min | 4) ou What is so terrible about craft ? 2019 (double-channel video 32 min | 8). Dans cette dernière, elle joue sur une logique de confrontation par le multi-écrans. Mais là où Abel Gance avec son Napoléon fabriquait de l’épique, du traitement narratif de Büttner transpirent les étincelles du mensonge… l’immuable structure de la communication qui, fallacieusement, peint toujours le produit en beau.
Une logique déjà utilisée pour Shepherds and Kings, 2017 | 9. Quelquefois elle n’a même pas besoin d’insister sur la dichotomie, il lui suffit de nommer : Auschwitz et ses parcelles biodynamiques cultivées par les nazis ou le Carmel de Dachau | 6.
De sa formation de philosophe, elle garde le goût de propositions plus ouvertement didactiques : une édition illustrée de la Kritik der Urteilskraft de Kant (Critique de la faculté de juger, 2014 | 3) ou la collision de photographies noir et blanc (portraits, paysages) avec des citations de Simone Weil (Die gefährlichste Krankheit | 5).
Sa création la plus récente Schamstrafe, 2022-23 | 3, repensée pour l’exposition décline des représentations anciennes et actuelles de châtiments publics. Des impressions sur le mur ayant la discrétion de traces laissées sur le sable : leur évanescente fluorescence démultiplie la honte du corps châtié ou de l’impudique exposition infligée par les réseaux sociaux.
Rien ne distingue les souvenirs des autres moments. Ce n’est que plus tard qu’ils se font reconnaître. À leurs cicatrices. écrivait Chris Marker pour La jetée (1962).
Avec une vigilance exacerbée, Andrea Büttner dresse un inventaire de nos cicatrices collectives, celles des plaies d’hier ou de demain gravées dans nos corps, comme dans l’espace de nos vies.
Les | n° renvoient au Plan de salles (pdf en anglais) :
=> Gegenwart rez-de-chaussée salles 1 & 3, passages sur la rivière salles 2, 2e étage salles 4 à 8 ;
=> passage du Hauptbau vers le Neubau salle 9 ;
=> Hauptbau 1er étage, collection XVe – XIXe siècles, salles 10.
partition à quatre mains
Giacometti/Dali – Jardins de rêves
Kunsthaus Zürich
#EXPOSITION
Kunsthaus Zurich du 14 avril au 2 juillet 2023
commissariat : Émilie Bouvard & Philippe Büttner
catalogue en allemand/anglais ou français/anglais, 192 p., 39 CHF

En octobre 1929, Giacometti est sollicité par Charles et Marie-Laure de Noailles pour une sculpture destinée à leur villa à Hyères qui évolue vers un « Projet pour une place » plus ambitieux et complexe. Ayant intégré peu après le groupe surréaliste, Dali s’en mêle et naissent un fourmillement d’idées et un dialogue à quatre mains par esquisses interposées pour une création… qui ne verra pas le jour.
D’abord présenté à l’Institut Giacometti à Paris (13.12.2022 – 9.04.2023), l’exposition arrive au Kunsthaus de Zurich et sera visible jusqu’au 2.07.
La photo de couverture du catalogue est déjà tout un programme. Dali, cheveux gominés découvrant le front, regard écarquillé et moustache filiforme pose dans son univers narcissique et revendique sa sophistication de dandy. Giacometti, tignasse drue, mâchoire volontaire, fermement appuyé sur des mains de maçon surgit de l’ombre et évoque plutôt un ragazzo réchappé d’un film de Pasolini. Le contraste est d’emblée saisissant.
D’autres clichés jalonnent l’exposition qui documente, à travers les choix contrastés de ces deux artistes, ce moment de l’histoire de l’art où les tensions internes au groupe surréaliste amorcent une progressive perte de contrôle sur le mouvement que scellera le conflit mondial.
L’entente et la collaboration entre les deux personnalités sont pourtant fructueuses. Des notes et des mentions dans les lettres attestent d’un dialogue riche et singulier. De nombreuses esquisses et maquettes éclairent la qualité des échanges témoignant autant de l’admiration réciproque que de l’avancement du projet. Tous deux s’accordent sur l’esprit du programme qui sous-tend l’œuvre – le jardin d’Éden, l’Ève tentatrice – et l’ambition de donner une dimension architecturale à l’installation : un espace pénétrable et actif où l’usager peut circuler, être en interaction directe avec l’œuvre (ainsi le serpent fauteuil).
Dali affiche son assurance et son univers visuel fantasmagorique avec des détails obsessionnels nourris de psychanalyse. Giacometti visiblement se cherche et dans une direction inverse : l’épure, l’économie, la synthèse avec des propositions évoquant parfois le travail de Joan Miró. C’est la partie la plus passionnante de l’exposition, la plupart des pièces étant encore éloignées des figures filiformes de chair liquide pour lesquelles il est connu. Il lisse, géométrise, recherche la forme la plus nette (avec un peu de transpiration ?) et, étrangement, semble aboutir à un contrepoint condensé des « objets à fonctionnement symbolique » du catalan. Ce dernier diffracte les volumes dans une sophistication élaborée qui les vaporise dans l’éther du rêve (et la peinture s’y prête plus volontiers). Les qualités et l’intérêt des œuvres respectives, assez différentes au demeurant, ne sont bien sûr pas en cause.
Ce Projet pour une place devait être sculpté dans la pierre. Il est abandonné fin mars 1932, mais une reconstitution grandeur nature en plâtre occupe le centre de la présentation. Un seul élément, Figure, sera réalisé par Alberto avec son frère Diego entre août 1931 et août 1933.
Marqué par la mort de leur père cette année-là, Giacometti se détourne du surréalisme et modèle à partir de là d’après nature. Sa façon à lui, finalement, de transcender le désordre ? Comme le suggère Edgar Morin (Introduction à la pensée complexe, 1990) : Le désordre constitue la réponse inévitable, nécessaire, et même souvent féconde, au caractère sclérosé, schématique, abstrait et simplificateur de l’ordre.
Âge de raison ou de folie (douce) ?
Le 40e anniversaire des Éditions Bucciali
#EXPOSITION
Éditions Bucciali – 31 rue des jardins, Colmar (rv au 06 14 23 59 45)
exposition anniversaire du 28 avril jusqu’à fin juin
Quarante ans : quarante artistes, quarante œuvres !
Ce printemps 2023, les Éditions Bucciali fêtent leurs quatre décennies à Colmar avec comme point d’orgue une rétrospective exceptionnelle le vendredi 28 avril 2023 à partir de 18 h : 40 gravures de 40 artistes ayant marqué l’histoire de l’atelier, des grands maîtres aux jeunes premiers…
suivie à 20 h d’un concert du duo JUST FOR JAZZ (Jean-Marc Clergue, guitare & Jacky Boesch, basse).
Rémy Bucciali, taille-doucier et fondateur des Éditions Bucciali, a fait ses classes en région Parisienne à l’atelier Rigal où il se forme notamment auprès de Gaston Gerbeau et où il a imprimé les gravures de grands maîtres comme Salvador Dali.
À la toute fin des années soixante-dix, il ouvre un premier atelier rue Rambuteau, puis déménage ses presses dans un moulin à papier du XIVe siècle près d’Angoulême.
En 1983, il s’installe à Colmar où il fonde les Éditions Bucciali avec une démarche unique en son genre : conception des gravures – le plus souvent lors de résidences d’artistes –, impression des estampes, édition et diffusion des œuvres par la galerie régulièrement présente dans les foires internationales.
Les Éditions Bucciali, c’est aussi une équipe avec, outre Rémy, Mitsuo Shiraishi, son collaborateur depuis presque trente ans, lui-même peintre et graveur (exposition personnelle à Saint-Dié du 15/04 au 14/08), et, depuis une demi-douzaine d’années, sa fille Alma Bucciali, également illustratrice et graveuse (une édition de son tarot vient de sortir de presse : présentation et vernissage le 5 mai à l’Estampe, Strasbourg).
L’Atelier utilise des techniques historiques datant de plusieurs siècles – eau-forte, aquatinte, pointe sèche, monotypes –, mais n’hésite pas à développer voire inventer des solutions originales en émulation avec la créativité de ses hôtes [voir par exemple Vinça Monadé en mai 2022] affirmant une ligne résolument contemporaine.
En 2016, les Éditions Bucciali ont reçu le label d’État « Entreprise du Patrimoine vivant ».
Graver n’est pas un acte isolé et expéditif, c’est un geste collectif, réfléchi, impulsé par l’artiste. Premier partenaire, le taille-doucier est aussi le premier regard sur l’œuvre, regard exigeant et souvent admiratif. Pour chaque résidence l’Atelier se transforme en ruche bruissante et joyeuse où plus de 80 artistes sont venus échanger, travailler, expérimenter et créer. Des peintres, des graveurs et des sculpteurs, des maîtres à la renommée internationale comme de jeunes talents, originaires de toute l’Europe, des États-Unis, du Japon, et bien sûr d’Alsace se sont succédé derrière les presses de la rue des jardins.
Pour ne citer que quelques noms dont les estampes seront présentées : Tomi Ungerer, Alma Bucciali, Michel Cornu, Mùargreth Hirschmiller-Reinhart, Daphné Gamble, Robert Schad, Mitsuo Shiraishi, Anke Vrijs… et certains reviennent depuis plus de vingt ans comme Raymond Émile Waydelich, Germain Roesz, Didier Guth ou Alain Clément.
Comme le suggère Rémy : C’est la route et l’aventure est loin d’être terminée puisque sa fille Alma maintient la tradition avec la même exigence et invite des créateurs de sa génération.
arpenter le territoire
des présences, des délices, un voyage
Joseph Bey à Courant d’art, Mulhouse
#EXPOSITION
Galerie Courant d’art, 10 rue des Tanneurs à Mulhouse du 21 avril au 6 mai
tél 03.89.66.33.77
avec l’aimable participation de la ferme MOYSES et sa variété de pains anciens et bios

La sensation physique du territoire saisit d’emblée l’œil, le corps devant un paysage de Joseph Bey. Le peintre n’arbitre pas entre abstraction et figuration, entre mystique et tectonique. Son geste dresse l’espace, scandent les plans comme érodés par le temps, les éléments. Quelquefois l’humain s’invite, discrètement. Une intrigante silhouette avec des gestes d’incantation suggère ce murmure des ombres qui hantent ses itinéraires que ce soit un des chemins de Saint-Jacques ou le pèlerinage de Shikoku au Japon…
Grand marcheur devant l’éternité, l’artiste a une intimité viscérale avec la terre. La terre qu’il foule lors de ses randonnées, les champs et les forêts qu’il traverse et où il goûte la vitalité génésique qu’exprime la nature au fil des saisons : ses beautés chatoyantes, ses tourmentes quelquefois, ses senteurs qui explosent par bouffées bourgeonnantes ou distillent de subtiles fragrances sous la caresse du vent ou l’ardeur du soleil. Un souffle et une présence têtue que mesure l’effort pas après pas.
Son appétence d’authenticité et l’exigence de la marche au long cours ne pouvaient que se retrouver dans la gamme des pains et la démarche pour les produire de Lili et Christophe Moyses.
Située à Feldkirch dans le cône alluvial de la vallée de Guebwiller, la Ferme Moyses s’étend sur des terres traditionnellement consacrées à la culture des céréales. Son équipe cultive en non-labour (nutriments naturels, économie de carburant…) exclusivement des variétés anciennes (antérieures à 1900), possède sa propre meunerie pour ré-apprendre et mettre en œuvre les méthodes de travail et de panification d’antan. Les pains sont cuits uniquement au four à bois et se déclinent selon les variétés de céréales : blé tendre, épeautre, orge, seigle, sarrasin… avec des miches qui émoustillent autant le regard que les papilles.
Des peintures de Joseph Bey aux miches mordorées des Moyses naît l’envie de parcourir cette terre nourricière où l’arôme et le goût du pain prolongent le regard.
voir aussi : Les piliers du monde d’AJAA installés dans le Parc à Sculptures du Nouveau Bassin, Mulhouse (permanent depuis février 2019)
l’ivresse de la barbarie
L’Incoronazione di Poppea à l’ONR
#OPÉRA
représentation du mardi 18/04 au Théâtre de la Sinne, Mulhouse (ONR)

Grand retour du Couronnement de Poppée à l’Opéra National du Rhin où il n’avait plus été joué depuis 2005. Dans la fosse, Pygmalion dirigé par Raphaël Pichon, son fondateur (en 2006). C’est la première fois que le chef et son ensemble se produisent en Alsace et aussi la première fois qu’ils jouent cette œuvre. La mise en scène sera assurée par Evgeny Titov qui a surtout travaillé pour le théâtre, il fait ses débuts en France à cette occasion.
Nerone et Ottone seront tenus par des contre-ténors (Kangmin Justin Kim, Carlo Vistoli). La soprano Giulia Semenzato fera ses débuts dans le rôle de Poppea. Tous les interprètes sont des habitués de ce répertoire et collaborent avec des chefs et des ensembles baroques prestigieux. Katarina Bradić (Ottavia) fréquente aussi très régulièrement un répertoire plus tardif et plus lourd (choix courant pour ce rôle).
l’œuvre
Monteverdi a soixante-quinze ans, il délaisse la mythologie (Orphée, Ulysse) pour l’histoire (la politique…) et son impitoyable cruauté : une barbarie proche des tragédies de Shakespeare avec le cynisme en majesté ! Une atmosphère tendue par la concentration dramaturgique et musicale, sans doute le premier opéra au sens où l’entendait Mozart ou Verdi. Le drame transcende le distractif (l’entertainment) – une suite de scènes et de numéros (ce qu’était encore Orfeo) – et impose une féroce et intense unité.
Des bourreaux – Nerone (surtout) & Poppea – et des victimes – Ottavia, Ottone & Seneca.
Une intrigue avec des enjeux de pouvoir – le contrôle de la Rome antique – où le désir est la couverture de la manipulation. Même les moments de respiration (ce que les scénaristes américains appelleront Mountain and Valley) avec Arnalta (la vieille nourrice), Valletto, Damigella… en inscrivant le contrepoint du quotidien avec leur légèreté, leur trivialité quelquefois et leurs jeux donnent une dimension abyssale et soudain puissamment palpable à la tragédie.
Même si le tyran est hors-sol, sa barbarie est très concrète et active.
Et c’est tellement plus beau quand c’est triste…
La (sublime) mort de Seneca avec en écho la polyphonie incantatoire de ses disciples (Non morir, Seneca, no). L’Addio Roma d’Ottavia ou comment faire son deuil en direct (et en un air). Ou l’incandescent duo conclusif précédé par un sombre chœur masculin (A te sovrana augusta) avec la rugosité des basses et une polyphonie qui semble jeter l’opprobre sur le tyran et sa « prostituée » (selon le mot d’Evgeny Titov). Une apothéose fragile : les cuivres triomphants et l’entrain des cordes sont minés par le spectre de traits mineurs qui crucifient le sublime comme la musique sait si bien le faire.
la production : R. Pichon & E. Titov
Le dispositif scénique : un plateau tournant avec un cylindre d’aspect industriel (bunker, réservoir aménagé…) auquel s’accroche un long escalier métallique qui monte à la galerie, car côté ouvert, l’intérieur tient à la fois du théâtre (la salle tapissée de velours rouge sang avec le balcon, les sièges…) et du lupanar. Au pied de l’escalier, une enseigne verticale en néon sur toute la hauteur « Poppea » précède une porte (discrète) avec digicode. Un lieu interlope où vient s’encanailler la jet set quand elle se pique de venir se frotter au peuple pour la débauche. Sous les marches zonent ceux qui sont à la ramasse avec sacs-poubelles, matelas éventré, bidon métallique pour se chauffer (ou cuire les merguez) : les ratés qui ne gagnent pas une thune (l’intello Seneca, le looser Ottone) et les piques assiettes, les petites frappes attirés par le bling-bling (et le pognon), mais qui s’y brûlent les ailes comme des papillons de nuit.
Un parti audacieux d’Evgeny Titov et de son dramaturge Ulrich Lenz, qui fonctionne atrocement bien renforçant la barbarie et l’abyssale dimension shakespearienne de l’opéra de Monteverdi. Ce tourniquet de la vie crée aussi une dynamique glaçante : chaque scène déborde sur la suivante et provoque des tensions, des frictions supplémentaires amplifiant le poids de la tragédie. Ainsi l’avant-dernier duo Nerone Poppea se termine en gâterie sexuelle suscitant les soupirs de la jeune femme qui se mélangent à ceux plaintifs de l’Addio Roma d’Ottavia, l’épouse répudiée. Une mise en scène qui prend à la gorge, exacerbe l’indifférente cruauté du tyran, la vénalité des courtisans et la pathétique impuissance de ceux qui tentent d’enrayer la monstrueuse broyeuse de ce pouvoir aveuglé par sa toute-puissance : la raison est un frein vigoureux pour qui obéit, non pour qui commande (Seneca).
Seules réserves : Ottavia qui attaque la porte à la disqueuse (c’est un peu ridicule) et surtout lors du duo final tous, sauf Nerone et Poppea (couverte de sang), agonisent (avec le plateau tournant le spectateur les découvre au fur et à mesure) et leurs spasmes occupent tout le morceau, un choix juste et cohérent avec ce qui précède, mais qui distrait de la musique. Certes on comprend ainsi que les courtisans étaient trop mal en point pour le chœur final (A te sovrana augusta), mais la proposition de Busenello et Monteverdi était plus pertinente (cf. ci-dessus l’œuvre) que ce too much un brin grand guignolesque. Un tableau inerte (noir et blanchi par la cendre du futur incendie de Rome ?) aurait été bien plus féroce tout en préservant l’idée de Titov : le meurtre comme rituel d’initiation au pouvoir.
L’interprétation musicale de Raphaël Pichon et des seize musiciens de Pygmalion est à l’avenant de cette réussite. Une restitution de la partition riche, précise avec beaucoup de finesse dans les ornements et d’exceptionnelles couleurs : les bois et cornets, les cordes notamment pincées, l’orgue régal et une culture des silences suspendus qui amplifient les choix dramaturgiques et crée le « suspens ».
Avec ses cheveux oxygénés, Kangmin Justin Kim dessine un Nerone en clubber juvénile et insupportable que seule la sexualité tient en laisse. Poppea (Giulia Semenzato) s’y emploie avec une sensualité tant vocale que physique laissant émerger (très fugitivement) quelques doutes rapidement ravalés par l’ivresse de la réussite. Ottavia (Katarina Bradić) déploie l’énergie d’une lionne y compris vocale pour conjurer son destin et trouve des nuances émergeant subtilement du silence dans son Addio. L’Ottone de Carlo Vistoli est un être accablé et larmoyant qui se réveille à la fin de l’ouvrage aiguillonné par Ottavia et Drusilla (Lauranne Oliva qui assure généreusement malgré sa grippe).
Seneca (Nahuel Di Pierro) est impressionnant, caverneux à souhait, et sa mort est un des grands moments de la soirée entouré par les hommes de main de Nerone (Antonin Rondepierre, Renaud Brès, Rupert Charlesworth) plus venimeux les uns que les autres et emmenés par le ténor Patrick Kilbride.
Emiliano Gonzalez Toro nous offre ce pur moment de grâce : la berceuse d’Arnalta. Il prend aussi beaucoup de plaisir dans la satire jouant de son embonpoint avec sa robe panthère sur bas résilles et une incendiaire perruque rousse.
Il convient de citer la vivacité du Valetto de Kacper Szelążek, les figures allégoriques (Julie Roset, Rachel Redmond) qui – très cocottes – interviennent dans l’action et la majestueuse maîtrise de la Virtu (Marielou Jacquard) quand elle clame sa résignation.
éruptive liberté
Shirley Jaffe, Form als Experiment
Charmion van Wiegand, Expanding Modernism
au Kunstmuseum Basel – Neubau
#EXPOSITIONS
Kunstmuseum Basel – Neubau / Musée Matisse (Nice, 18/10/2023 – 8/01/2024)
_Shirley Jaffe, Form als Experiment du 25 mars au 30 juillet 2023
commissariat : Olga Osadtschy (Kunstmuseum Basel), Frédéric Paul (Musée national d’art moderne Centre Pompidou), catalogue en allemand et en anglais, 296 p., 48 CHF
_Charmion van Wiegand, Expanding Modernism du 25 mars au 13 août 2023
commissariat : Maja Wismer avec Martin Brauen, catalogue en allemand ou en anglais, 160 p., 44 CHF

L’exposition Shirley Jaffe, Une Américaine à Paris présentée au Centre Pompidou en 2022 a été élaborée avec le Kunstmuseum Basel et le Musée Matisse (Nice, 18/10/2023 – 8/01/2024). Le Neubau l’accueille du 25.03 au 30.07.2023. Une exposition impressionnante et exhaustive sur la carrière presque exclusivement parisienne de l’artiste.
Celle consacrée à Charmion van Wiegand Expanding Modernism occupe les trois salles du sous-sol jusqu’au 13.08.
Avec ces deux propositions, le musée souhaite faire découvrir des artistes peu connues, mais marquantes. Si Shirley Jaffe l’est pour sa peinture, van Wiegand l’est surtout pour sa proximité avec Mondrian.
Shirley Jaffe (1923 – 2016) est arrivée à Paris en 1949 avec son mari journaliste qui bénéficiait du G.I. Bill (aide financière aux soldats démobilisés). Quand le couple se sépare peu après, elle s’installe dans la capitale et y restera jusqu’à son décès. Elle y fréquente d’autres expatriés (Al Held, Norman Bluhm, Kimber Smith, Sam Francis, Joan Mitchell et le Canadien Jean-Paul Riopelle) : une génération pétante de santé et d’ambition (Alain Clément) qui influencera les artistes de la jeune génération d’alors.
Dès la première salle, le visiteur est happé par l’énergie que déploie l’artiste. Elle couvre la toile, la sature. On pense au dripping, mais sans la distance du geste, visiblement elle est au contact du support et la brosse s’active intense et énergique, cinglante quelquefois. Si un certain hédonisme est perceptible dans les premières œuvres avec des jaunes solaires (1956), très vite des émeraudes, des outremers, des flux anthracite mangent les teintes plus lumineuses imposant d’abrupts contrastes. La matérialité de la peinture (coulures…) s’affirme et impose un univers plus sombre. Souvent des titres suggèrent qu’elle restitue par ce gisement le ressenti que provoque le motif (Medrano, 1958, récemment acquise par le KMB).
Un expressionnisme abstrait qu’elle commence à articuler vers 1965 après un long séjour à Berlin (1963-64) encore fortement marqué par la guerre. Une tension centrifuge, des axes ouvrent des saignées plus nettes canalisant la peinture telle des résurgences magmatiques. Au-delà de l’abstraction qu’elle n’abandonne pas, les toiles suggèrent des plongées aériennes entre des gratte-ciel, l’émergence de paysages issus d’un dense fourmillement urbain, mais toujours comme nourries de l’intérieur et projetées vers le spectateur.
Dans les années soixante-dix, le bouleversement est encore plus radical. Des formes géométriques en aplats limpides et lumineux occupent toute la surface de la toile : faire cohérence sans faire figuration. Un apurement, mais sans négliger la liberté avec des formats triangulaires, circulaires, très étroits… Cette recherche impose une rigueur presque toujours bousculée par une envahissante intruse plus organique.
Vers 1985, elle vide la toile : un fond, blanc le plus souvent, où les formes rares, prudentes sont apposées, espacés avec peu de mélanges, de superposition : un ballet aérien et éthéré.
Peu à peu elle reprend en compte le cadre, la surface : les éléments s’articulent plus nettement, esquissent quelquefois un paysage épuré, synthétique et elle superpose, mêle à nouveau. Certains aplats retrouvent aussi de la substance.
Mais la volonté d’organisation demeure, pose des cohérences et quand elles sont trop fermes, trop nettes, elle les biffe comme cette puissante et noire croix de Saint-André (cf. affiche : X, encore, 2007). J’ai toujours essayé de faire en sorte que quelque chose d’étrange, d’insatisfaisant, mais qui fonctionne tout de même, se produise (1982).
Un itinéraire sous le sceau de la liberté – notamment celle de tout changer – avec cependant un besoin de domestication : une méfiance envers la fougue de ses débuts ?
Expanding Modernism
dans le sillage de Mondrian
Jaffe partage avec son aînée son engagement dans l’abstraction et l’influence de Matisse. Si Jaffe y vient tardivement, Charmion van Wiegand (1896-1983) s’en inspire dès la fin de la guerre et la disparition de Mondrian.
En 1941, elle prend la défense du peintre néerlandais sur la scène artistique américaine et se rapproche de lui devenant même son assistante jusqu’à son décès en 1944.
Leur proximité est flagrante sur la moitié des toiles accrochées (une cinquantaine). Elle ajoute une touche féminine dans le choix des couleurs notamment, s’affranchissant de la réduction chromatique au rouge, jaune, bleu, et l’articulation générale de la composition avec des motifs plus nombreux. Ses œuvres dégagent une grande douceur, une sérénité aussi : à partir des années-cinquante, elle se convertit au bouddhisme tibétain et la géométrie de Mondrian lui permet de glisser sans accroc à la structure et à l’esprit des mandalas ou de temples stylisés (la dernière partie de l’exposition).
Le projet prévu pour 2021 a été reporté à 2023 en raison des restrictions liées à la pandémie.
Sur la mezzanine, une vitrine présente des esquisses et carnets de croquis…
jubilation transgressive
Hen de Johanny Bert
#THÉÂTRE / MUSIQUE
représentation du mardi 28 mars 2023 à l’Espace 110, Illzach – Les Vagamondes 2023
adaptée en LSF par Vincent Bexiga (réalisation Accès Culture)
Quatre lignes lumineuses balisent un cadre, un bord de scène et installent le music-hall : ce sera un tour de chant avec de la nostalgie, de la provocation – des moments de stand-up –, de la poésie, de l’enthousiasme et un brin de folie. Hen animé – en théâtre noir – par deux marionnettistes (Johanny Bert, également voix de HEN, & Lucile Beaune) tiendra la scène pendant presque une heure et demie accompagné(e) par le violoncelle de Guillaume Bongiraud et Cyrille Froger aux percussions.
L’entame est envoûtante, musicalement et visuellement. Un moment éthéré : Hen, pâle sirène dans son aquarium, évolue nu(e) derrière une membrane de plastique translucide qui s’effondre pour l’entrée de l’artiste. Un cocon placentaire avant d’affronter le monde et d’en prendre plein la gueule ?
Une queue-de-cheval d’ébène plantée sur le sommet de son crâne rasé, Hen est femme, homme, corps éclaté, démembré, explosé. Car Hen navigue d’une identité à l’autre, est un peu victime de tous ses combats et le raconte avec humour et provocation, autodérision aussi, jouant des mots et de ses corps. Il/elle digresse sur ces vies chahutées, persécutées, humiliées par la bêtise, les préjugés voire les autorités qui ne protègent pas ou si peu ceux qui sont autres.
Hen chante (beaucoup), danse, provoque, striptease, se trans-formise – il lui pousse des seins ou des érections, quelquefois ses fragments s’éparpillent –, se donne l’absolution par l’abandon au plaisir et ne revendique qu’une chose : la liberté d’être.
Sa bouche, la délicatesse expressive de son visage, son regard ardent lui donnent une présence intensément humaine. Les marionnettistes – ses gardes du corps ! – s’invitent par moments, jouant le visible et l’invisible, la mise en abîme du dispositif théâtral. Le spectacle avance poétique et rythmé, toujours avec finesse et intelligence avec des textes affûtés et/ou émouvants.
La salle est conquise, applaudit chaque numéro, chaque chanson, l’agrémentant même de youyous enthousiastes.
À suivre la vie et les combats de Hen se dessine pourtant une chose toute simple : et si au fond tout cela ne tenait qu’à un énorme déficit de bienveillance qui condamne chacun à choisir la peau (et sa peau avec l’égoïsme induit…) contre la folie du monde ?
Hen : un hymne, un appel à la générosité ? À l’Ouvert ?
Un jour quelqu’un me serrera tellement fort dans ses bras qu’il me recollera tous les morceaux.
fabrication des marionnettes : Eduardo Felix, costumes : Pétronille Salomé
auteurs compositeurs pour la création : Marie Nimier, Prunella Rivière, Gwendoline Soublin,
Laurent Madiot, Alexis Morel, Pierre Notte, Yumma Ornelle et une reprise de Brigitte Fontaine
création lumière : Johanny Bert, Gilles Richard
création son : Frédéric Dutertre, Simon Muller
production : Théâtre de Romette
chaos festif
Trans(e)galactique (exposition)
The Bacchae
Elli Papakonstantinou d’après Euripide
#FESTIVAL
=> exposition du 17.03 au 14.05
=> représentation du vendredi 17 mars 2023 à La Filature, Mulhouse – Les Vagamondes 2023
Vendredi 17 mars, la Filature a lancé les Vagamondes, 11e édition, avec l’exposition Trans(e)galactique à la galerie (visible jusqu’au 14 mai) sur une proposition de Superpartners (SMITH et Nadège Piton) et la création de The Bacchae de l’artiste grecque Elli Papakonstantinou d’après Les Bacchantes d’Euripide.
Le festival traite de la notion de FRONTIÈRES au sens large et met cette année – notamment pendant ce week-end d’ouverture – l’accent sur celle des genres.
Trans(e)galactique
L’exposition offre un autre paysage humain que la partition binaire hommes vs femmes instituée par nos sociétés :
Nous construisons ce que nous sommes à l’intérieur d’un système fait de frontières, de séparations, de distinctions, d’exclusions, de scléroses, de dominations. Dans ce monde capitaliste, sous surveillance généralisée, où l’opacité, le mystère, le secret ont disparu – quels chemins de traverse se frayer pour devenir ce que nous sommes : pirates, tricksters, divergent·e·s en tous genres ?
Des niches qui s’affirment et s’affichent à travers ces photos par la mise en scène des corps, le journal intime, de nouvelles pratiques artistiques (donc d’autres images comme la caméra thermique de SMITH ou l’Amazogramme de Roberto Huarcaya) ou en s’appropriant le militantisme notamment écologiste.
L’accrochage est dense – outre les cimaises, de nombreux panneaux suspendus rythment l’espace –, plonge dans le temps – les clichés les plus anciens remontent aux années quarante – et revendique aussi une volonté documentaire notamment les photos « privées » de Sébastien Lifshitz dénichées dans les marchés aux puces.
35 artistes internationaux pour presque une centaine de pièces.
The Bacchae
À l’inverse, The Bacchae revendique une forme d’outrance. La pièce s’ouvre sur une bonbonnière où une drag-queen et un drag-king dressent un banquet. De même, Penthée arbore un maquillage chargé, de longs cheveux gris, un costume vaporeux et, dans la seconde partie, Dionysos se déchaînera en string.
Au son, une musique rock/contemporaine comme une sourde et lancinante rumeur que fendent des envols opératiques au chant s’appropriant le côté too much du genre.
Le blanc domine et pulse au rythme d’un séduisant mapping (monochrome) : des paysages numériques se propageant telle une lave en fusion.
Dionysos débarque en étranger : personnage sombre, encapuchonné et inquiétant, semblant sortir du côté obscur de Star Wars. Au début, il est mutique, anonyme (de dos) et les Bacchantes (qu’on ne voit pas) sont d’autres migrants venus dans le même esquif : la submersion à venir de l’insouciante abondance par ces naufragées (politiques, économiques, climatiques…), les prémices d’une fin du monde cataclysmique. La métaphore est reprise par un sismographe qui transcrit les vibrations du plateau sur un paperboard déversant ses larges bandes de papier (offrant vers la fin une très belle image quand les acteurs s’emballent et circulent sur le plateau en tirant ce papier devenu chenille ou dragon et vibrant du mapping stroboscopé).
Dionysos pousse ce petit monde vers une surenchère qui les met à nu au propre (tous finissent en slip) et au figuré, mais cela ne suffit guère à endiguer le chaos qui monte progressivement dans la seconde partie et, en s’emparant du papier, tous semblent plutôt le propager. Comme s’il était toujours trop tard…
Le spectacle – en anglais, espagnol, grec – est très touffu, cultive le cérémoniel et le sacrificiel. Le tournage de scènes dans les coulisses projetées en direct sur le décor (procédé désormais courant cf. La Mouette en début de saison) éclaire incidemment (et plutôt sordidement) la trame.
Pour Elli Papakonstantinou, la pièce d’Euripide fournit le squelette d’une mise en proposition de cette apocalypse joyeuse. Car ça pulse et ça part dans tous les sens avec un esprit festif qui rejoint l’envie des Superpartners dans leur programme d’ouverture : celle d’un étourdissement prêt à céder à la folie, non pas au sens pathologique ou psychiatrique, mais à celle théâtrale et baroque de l’Orlando furioso où la passion explose par la peau, les corps, les pores, les émotions, en disruption, certes, avec la culture dominante, patriarcale, mais qui restent malgré tout dans le spectacle (au sens de Guy Debord), car la Culture, ce n’est pas ce qui combat le capitalisme, c’est sa courroie de transmission (Franck Lepage)…
avec Vasilis Boutsikos, Georgios Iatrou, Hara Kotsali,
Ariah Lester, Lito Messini, Aris Papadopoulos
conception, direction artistique : Elli Papakonstantinou
texte : Elli Papakonstantinou, Chloe Tzia Kolyri, Kakia Goudeli
scénographie : Maria Panourgia, lumières : Marietta Pavlaki
chorégraphie : SINE QUA NON ART
musiques : Ariah Lester, production : OCD Ensemble
Addenda : à l’issue de la représentation, les comédiens ont pris la parole pour rappeler le grave accident ferroviaire du 28 février en Grèce : un symptôme dramatique de l’effondrement de tous les services publics dans leur pays. Ils ont évoqué la dégradation induite sur la qualité de vie de leurs compatriotes et leur plus vive inquiétude pour la démocratie.
Himmel über…
Célèbre la terre pour l’ange
Clément Hervieu-Léger, Bruno Bouché
#LECTURE & DANSE
répétition & représentation du 10 mars 2023
Colmar, Musée Unterlinden avec le CCN • Ballet de l’Opéra National du Rhin
sous la direction de Bruno Bouché, directeur artistique et chorégraphe
Répétition, sous la direction de Bruno Bouché, dans la (réverbérante) Piscine du Musée Unterlinden de « Célèbre la terre pour l’ange » : lecture et danse, avec le piano délicat et attentif de Maxime Georges, Clément Hervieu-Léger, sociétaire de La Comédie Française, et les danseurs Jesse Lyon et Cauê Frias.
Bach, Rilke, Delacroix.
Une des propositions de « L’Œuvre qui va suivre » avec les peintures monumentales de Silvère Jarrosson pour élargir l’espace vers le vertige.
La chorégraphie – Bless – ainsi soit-Il – est inspirée de la Lutte de Jacob avec l’Ange peinte dans la chapelle des Saints-Anges (Saint-Sulpice, Paris) :
C’est l’œuvre de Delacroix peinte sur les murailles de l’église Saint-Sulpice qui me regarde plus que je ne la regarde ; ça me regarde au creux même de ma nuit. (Bruno Bouché)
La Chaconne de Bach (de la Partita n° 2 en ré mineur, BWV 1004) transcrite par Ferruccio Busoni – admirablement servie par Maxime Georges – martèle l’inexorabilité du destin de manière peut-être plus impérieuse que ne le fera Beethoven et le piano (instrument à percussion) plus énergiquement que le violon original. Les moments d’éclats de l’œuvre s’ombrent de l’intimité délicate et suspendue d’un ostinato irrésolu à jamais.
Et puis les Anges de Rainer Maria Rilke !
Quand Rilke écarte l’idée de dieu, ce sont eux qui ouvrent un espace vers la transcendance.
Si l’on chante un dieu,
ce dieu vous rend son silence.
Nul de nous ne s’avance
que vers un dieu silencieux.
Cet imperceptible échange
qui nous fait frémir,
devient l’héritage d’un ange
sans nous appartenir. [2]
Omniprésentes dans l’œuvre de Rilke et dans les textes choisis pour cette soirée, ces figures d’anges éveillent des images d’une grande poésie.
Quelque part l’Ange de l’Oubli,
radieux, tend sa figure au vent
qui tourne nos pages. [3]
Et si l’écriture du poète est d’une articulation élaborée (c‘est le prix de ses doutes), plutôt difficile à dire, Clément Hervieu-Léger les emplit d’une limpide évidence.
Grâce à lui, les mots déploient leurs ailes bienveillantes, mais aussi les interrogations du poète…
Vues des anges, les cimes des arbres peut-être
sont des racines, buvant les cieux [4]
Mais voilà un siècle déjà que
même les Anges ont cessé de voler. [5]
Depuis le ciel a perdu beaucoup de racines,
les sereines frondaisons ne veillent plus
sur ces novices devenus des fantômes. [6]
Nous nous dissipons en expiration
de brasier en brasier [7]
soumettant même cet alpage des anges
à la tyrannie des machines !
Car… à quoi bon voler
dans des cieux désormais saturés d’aéronefs ?
De drones, de satellites, de missiles…
Y a-t-il encore un espace pour l’indicible ?
Pour l’invisible ?
Plus que jamais, les anges cherchent une piste d’envol…
[2] Vergers (1926)
[3] Le grand pardon (1926)
[4] Poèmes français : Portrait intérieur, XXXVIII (1926)
[5] Le Livre d’heures (1899–1903)
[6] cf. Günther Anders, L’Obsolescence de l’homme (1956) : Notre normalité est une histoire de fantômes…
[7] Deuxième Élégie de Duino (1912)
abysses & vanité(s)
Wayne Thiebaud à la Fondation Beyeler
#EXPOSITION
Riehen (Bâle), Fondation Beyeler du 29 janvier au 21 mai 2023
commissariat : Ulf Küster
catalogue en allemand ou en anglais (cahier avec trad. en français), 160 p., 58 €

Mort centenaire en 2021, le peintre américain est un quasi inconnu en Europe où l‘exposition monographique de la Fondation Beyeler est seulement la quatrième à lui être consacrée. Sa notoriété s’amorce pourtant dès 1962 aux États-Unis où ses œuvres figurent dans les collections des plus grands musées à l’égal de Hopper ou Warhol.
Le commissaire Ulf Küster a choisi de présenter la soixantaine d’œuvres par thématiques : les natures mortes, les portraits (le plus souvent en pied), les paysages (surtout à partir de 1995) : les vues de San Francisco, le delta du fleuve Sacramento, enfin ses vertigineux paysages de montagnes.
Wayne Thiebaud (1920-2021) est souvent présenté comme précurseur du pop’art : il en reprend les motifs – des produits de consommation – et la logique sérielle. Mais il s’insurgeait légitimement contre cette classification. Si son travail de la couleur est séduisant – il revendique la palette fauviste –, les dominantes sont acidulées servies par une touche fine, riche et élaborée, loin de l’hédonisme et de la jubilatoire profusion de la consommation de masse. S’y ajoute une distance critique assez systématique.
Dans ses natures mortes, le contexte se limite à un éventuel présentoir, le prix est presque toujours ostensible (quelquefois provoquant : Cent Masterworks, 1970−72), chaque produit se fabrique avec son ombre une matérialité dense et autarcique, mais suscite en contrechamp un grand vide que le peintre traite volontairement avec économie (brossage soigneux des contours renforçant l’isolement du sujet). Ses sucreries – et ses gâteaux à la crème sont si périssables – se transforment ainsi en vanités d’autant plus tourmentées qu’elles sont pimpantes… mais abandonnées dans cette incantation aussi désertique que solaire.
Plus tardifs (2005), les bandits manchots (Jackpot ; Two Jackpots) gravitent dans le même no man’s land et évoquent ces fameux maneki-neko (chat porte-bonheur japonais) dressant leur patte/manette en signe d’appel à consommer/jouer… Perdant ?
À ses personnages, il réserve un traitement similaire : un réalisme glaçant proche de la taxidermie. Des poses gelées dans le temps marchand, exclusivement vouées à la consommation (leur burger : Eating Figures (Quick Snack), 1963 ; la glace : Girl with Ice Cream Cone, 1963).
Jusqu’à s’afficher eux-mêmes en produits ? Offerte ou en vente la jeune femme léchant sa glace les jambes écartées ? Comme ces Deux figures à genoux accablées de lassitude : Two Kneeling Figures (1966) ? Ou ces baigneurs déposés là comme trois cadavres : Three Prone Figures (1961) ?
Des pistes discrètes émergent : au-dessus de la Student (1968) trône une horloge : le temps, c’est de l’argent. Chez Wayne, les accessoires, s’il en met, ne sont jamais anodins et la posture de la jeune femme est résignée, son regard hésite à dévisager le peintre/spectateur. Gênée, honteuse de sa réticence face au destin qu’on lui assigne ?
Le fascinant Woman in Tub (1965) est l’exemple le plus emblématique de sa manière. Trois lignes horizontales vibrantes (moins d’un centimètre, mais reprenant les couleurs de l’arc-en-ciel) et une flaque azur indiquent à peine la baignoire. Une épure où la tête de la femme soigneusement détaillée est offerte comme une de ses pâtisseries dans un espace décharné, le peintre laissant au spectateur le soin de construire, d’imaginer le tableau. N’affirmait-il pas : Depuis toujours je suis fondamentalement convaincu que mon travail est abstrait.
Moins connus, moins visibles, les paysages prolongent cette dissonance et ses perspectives. Dès 1993, il peint San Francisco avec ces pentes qu’il dresse exagérément : les montagnes russes d’une fête foraine avec des envolées dignes de la science-fiction. Mais au-delà du ludique, les véhicules tels des modèles réduits peinent à avancer sur ces pentes abruptes et les arbres minuscules s’y accrochent tant bien que mal. L’artiste suggère la fragilité de l’ambitieux geste des aménageurs qui s’efforcent de domestiquer le paysage. Laborieusement : ces routes qui s’épuisent à relier tous ces immeubles en sont le symptôme.
Centrée verticalement, la rue d’Untitled (City View, 1993) monte vers le ciel, tremplin cinglant, mais aussi Tour de Babel… Une composition remarquablement articulée au service d’un thème très classique : une vue de la fenêtre de l’atelier.
Peu après (1997-2008), il peint les paysages du delta du fleuve Sacramento, souvent des vues aériennes. Si la topographie est moins chahutée, cette tension entre l’artificialisation, la gestion logistique des ressources (routes, canaux, lacs artificiels…) et l’environnement naturel reste tangible. Ses toiles saisissent la lumière qui adoucit cette friction du formel et de l’informel, le manège des lignes concurrentes qui colonisent le territoire.
Dans la salle 6, la plus impressionnante, les vertigineux paysages font remonter les chaos et les solitudes de Caspar David Friedrich. Mais ce n’est pas l’impressionnant spectacle de la nature en travail comme chez le peintre allemand, c’est une lutte avec l’ange, l’Homme mécanisé contre la planète… Des hommes absents, mais, écrasées sous un ciel réduit à rien, ses routes, ses maisons lilliputiennes accrochées à une fine pellicule flottant au bord du gouffre : des parois aux dimensions abyssales que le pinceau de l’artiste gorge d’une vie colorée et touffue.
Ces paysages sont peints vers 2008-2012. Thiebaud avait 9 ans en 1929 : suffisamment pour mesurer l’impact de la crise et de la Grande Dépression qui a ruiné sa famille. Et ce monsieur de 90 ans voit plus de dix millions d’Américains expulsés de leur logement suite à la crise des subprimes… folie et rapacité des fonds de pensions, des traders (accessoirement la crise climatique progresse). Lui n’a que son pinceau, alors il érige ces falaises bouillonnantes de couleurs sourdes, cette puissance de la Terre qu’exploite une humanité qui a comme principal horizon sa vanité, mère de toutes les illusions nobles ou viles (Joseph Conrad).
Hopper, avec ses personnages en suspension souvent absorbés vers le lointain, interrogeait le sens de l’American Way of Life. Thiebaud, avec ses icônes pâtissières, reflets de la culture de la pulsion, et ces frêles esquifs humains qui surnagent sur de sombres et vertigineuses cataractes de couleurs, suggère une issue.
Pas forcément la plus joyeuse !
légèreté minérale
L’Œuvre qui va suivre
Silvère Jarrosson au musée Unterlinden
avec Bruno Bouché & le Ballet de l’Opéra National du Rhin
#EXPOSITION [parution papier NOVO n° 68]
Colmar, Musée Unterlinden du 4 au 24 mars 2023
#DANSE +
programme coproduit avec le CCN • Ballet de l’Opéra National du Rhin
sous la direction de Bruno Bouché, directeur artistique et chorégraphe
Petit avant-goût de la manifestation grâce à quelques images tournées durant la présentation de presse :-)
Lors du vernissage (samedi 4.03), la compagnie a également dansé deux pièces témoignant de l’engagement de Bruno Bouché et du Ballet de l’Opéra National du Rhin dans cette programmation.

Programme chorégraphique et culturel en lien avec les œuvres monumentales de Silvère Jarrosson (exposées à « la Piscine ») et les collections du musée.
Une dizaine d’évènements (dont deux performances) avec des invités prestigieux (Clément Hervieu Léger de La Comédie Française, Théotime Langlois de Swarte, Cynthia Fleury, philosophe et psychanalyste…).
Calendrier détaillé et réservations sur les sites des Unterlinden et de l’Opéra National du Rhin.
L’article est paru en mars dans Novo n°68 (p. 26) : fo – cus (vers le milieu).
Repris sur le Facebook du Musée.
Papiers ! Papiers !
Maîtres de Swen de Pauw
#CINÉMA
documentaire sorti en salle en février 2023 (France 2021, 97 min)
La nouvelle monture du Festival du film de Colmar revendique un éclectisme dans sa programmation et a fait une jolie place au documentaire en lui consacrant une journée entière qui s’est achevée par la projection de Maîtres.
Durant quelques semaines, Swen de Pauw a posé ses caméras dans le cabinet d’avocat de Christine Mengus et Nohra Boukara spécialisées dans le droit des étrangers. Si Le Divan du monde (2016) était très statique (dans mon souvenir), ici le réalisateur s’autorise des changements d’échelle de plans, cherche des visages, des détails. Pas de colloque singulier comme chez Georges Federmann, mais deux personnalités très différentes auxquelles s’ajoutent leur collègue, Audrey Scarinoff, les secrétaires, les stagiaires : une ruche bruissant de paperasses…
Car la paperasse est l’ardente obligation de tous, avocats comme clients : un culte, une religion comme si la production de ces fils tracassiers était indispensable pour lier le corps social et en maintenir la cohésion… Si les deux avocates y voient à peu près clair, ce n’est pas forcément le cas des stagiaires et certainement pas des clients souvent présents en France depuis des années avec un emploi stable et qui sont démunis devant la harassante complexité de ces arcanes procéduriers. Pour le cabinet, c’est une bataille de longue haleine avec souvent l’obligation d’affronter et corriger, quand c’est possible, des procédures mal emmanchées, des dossiers mal ficelés ou hors délai. Des parcours éreintants qui installent lassitude, légèreté et négligence voire indifférence chez les demandeurs… provoquant de nouveaux loupés.
Ainsi, consciencieusement, les petites (comme les grandes) mains du cabinet produisent des papiers supplémentaires. Les arpèges feutrés du pianotage en égrènent la saisie avec ces plans sur les doigts tapotant les claviers.
Malgré ces efforts, surgit régulièrement l’accablement des rendez-vous non honorés avec le cabinet, mais aussi avec les administrations quelquefois même pour valider l’attribution de la carte de séjour tant convoitée. Mais le système englue tout le monde dans un temps si interminable, des obligations si tatillonnes et incompréhensibles que certains n’arrivent plus à distinguer l’essentiel du vétilleux.
Des échanges filmés, émerge aussi l’autre tâche que les avocates prennent en charge : l’élaboration de la stratégie et du discours à tenir pour convaincre le juge – une forme de coaching – d’autant que les demandes de régularisation relèvent d’une logique de délit. Il importe d’identifier les choses à dire, celles qu’il ne faut surtout pas mentionner, car le moindre mot, chaque papier produit restent une pièce opposable, à charge au besoin, qui peut compromettre l’attribution du titre de séjour. Or il est tentant, surtout en début de parcours, de produire des faux négociés contre quelques billets pour remplacer des documents égarés lors d’un voyage chaotique ou compliqués à obtenir dans des pays où règnent corruption, laxisme, désorganisation.
Au fil des entretiens, il est patent que ni Christine Mengus, ni Nohra Boukara ne sont dupes. Les constructions procédurales visent à décourager les (futurs) demandeurs d’asile et ces tombereaux de paperasse dessinent de nouvelles frontières, permettent de statuer sur dossier en avançant la froide raison des règles administratives afin de réduire a minima la confrontation avec l’humain : la peau avec ses cicatrices, les yeux avec leurs larmes, les voix avec leurs suppliques, la douleur, le désespoir et la perspective d’un destin sans bienveillance. Ce traitement transforme la problématique des migrants en simple gestion de flux conditionnée par les choix diplomatiques (politiques, économiques…).
Le film, au contraire, rend vibrant la matière humaine, charnelle et montre l’envers de cette logique de tri où les individus sont un peu comme du bétail qu’on sélectionne et qu’on marque au fer : tu fais partie du troupeau (national) ou non. Dans ce cas, le débouté rebascule dans son enfer, celui du clandestin ici ou celui qu’il a fui si une OQTF est mise en œuvre.
À chercher quotidiennement le trou de souris dans cette forteresse administrative, Christine comme Nohra poussent de longs soupirs accablés chaque fois qu’un client invoque la France comme le pays des droits de l’homme…
Nohra précise même : on a réinventé le droit colonial, ici les étrangers sont des citoyens de seconde zone.
directeur de la photographie : Hervé Roesch
production : Seppia avec Film Projectile, Nour Films, TV5Monde
distribution : Nour Films
servitude volontaire
Le Dragon d’Evgueni Schwartz
#THÉÂTRE
représentation du 8/02/2023 à La Filature, Mulhouse
La pièce est un conte (pour enfants ?) avec sa liberté de traitement, mais, écrite par Evgueni Schwartz à Moscou en 1943, comment ne pouvait-elle pas être marquée par l’époque et le climat d’oppression à peu près général en Europe ?
Pour sa production, Thomas Joly s’inspire surtout de la façon dont spectacles, peinture, cinéma se sont emparés de cette sombre période : une manière noire évoquant les carceri de Piranèse saignés d’éclairs Led.
Des projecteurs fixés au balcon comme ceux des miradors balayent la salle pendant l’entrée du public. Un cadre d’avant-scène ayant la forme d’un œil (ou d’une ouverture de caverne) oriente le regard du spectateur vers cette société qui se débat (ou plutôt pas) contre son/ses monstre(s). L’échappée du fond entourée de redents apparaît comme une gueule d’enfer, car un dragon tricéphale (trois comédiens l’incarnent) règne sur cette bourgade. Personne ne songe à se rebeller et tous s’accommodent du sacrifice annuel d’une jeune femme.
Lancelot (Damien Avice), héros professionnel, vient perturber ce statu quo. Avec ses questions gênantes, il découvre une galerie de personnages dont le bourgmestre (belle prestation de Bruno Bayeux), entremetteur omniprésent – sorte d’Eichmann bourré de tics et de névroses –, mais aussi un chat qui parle. Sous la résignation de tous, perce le confort de la situation : la peur du dragon garantit une rassurante autarcie.
Tombé amoureux d’Elsa (Hiba El Aflahi), la prochaine victime, il passe outre aux réticences – les humains sont tellement superficiels – et liquide le dragon. Mais le nouveau monde libéré n’advient pas. Le bourgmestre, gagnant en assurance, prend le pouvoir et se mue en impitoyable tyran (un parfum de Chaplin dans Le Dictateur par moments).
Les images que fabrique Thomas Joly évoquent l’expressionnisme : les films muets (M. le Maudit ou Mabuse avec le fond de ville, Murnau…), le côté vétuste des archives avec ses rouleaux alignés, les costumes et les maquillages excessifs comme sur certaines toiles de Dix, mais aussi sa réappropriation plus tardive par Broadway avec Cabaret (John Kander, 1966) notamment pour les tableaux chantés. La noirceur n’empêche ni le spectaculaire, ni l’humour en dépit de la désolante prédisposition à la servitude volontaire…
À la fin, Lancelot suggère bien une greffe de cerveau, mais la liberté est un fardeau, l’absence de liberté un soulagement comme le relève Charlotte Beradt (Rêver sous le IIIe Reich, 1966).
avec Damien Avice, Bruno Bayeux, Moustafa Benaïbout, Clémence Boissé, Gilles Chabrier, Pierre Delmotte, Hiba El Aflahi, Damien Gabriac, Katja Krüger, Pier Lamandé, Damien Marquet, Théo Salemkour, Clémence Solignac, Ophélie Trichard
mise en scène Thomas Jolly (texte français Benno Besson), scénographie Bruno De Lavenère, lumières Antoine Travert, costumes Sylvette Dequest, musique originale, & son Clément Mirguet
production LE QUAI CDN Angers Pays de la Loire
clair-obscur épique
Des femmes qui nagent de Pauline Peyrade
#THÉÂTRE
représentation du 2 février à la Comédie de Colmar
à La Filature (Mulhouse) les 18 & 19.04.2024
Actrice… une vie, un destin. Avec les images qui vont avec. Cinématographiques surtout. Et des incarnations tirées (vers le haut, le bas ?) par beaucoup de clichés. Émilie Capliez le constate lors des auditions de jeunes comédiennes qui se moulent dans une forme revisitée d’emplois. Un questionnement qu’elle a partagé avec Pauline Peyrade et qui a abouti à la commande de cette pièce évoquant ces femmes si publiques, mais pas que : L’actrice, c’est la part faillible, laborieuse. La star, elle, ne déçoit jamais. Une écriture en amont, mais aussi en échange avec le plateau.
Quatre femmes de quatre générations – une douzaine d’années les sépare. La parole circule de l’une à l’autre, des monologues surtout, mais le plus souvent adressés : tu fais ci ou ça… qui pointent le conditionnement, interrogent le libre arbitre dans un univers plombé par la fabrique des assignations voulues par le patriarcat. Ou qui prônent la rébellion.
Les mots restituent les trajectoires de personnalités iconiques (le spectateur en reconnaîtra quelques-unes). Passent aussi quelques voix enregistrées (Delphine Seyrig…). Quelquefois elles sont embringuées dans des histoires tellement tordues que personne n’y comprend plus rien, y compris elles-mêmes (Mulholland Drive).
Vers la fin, Sigourney Weaver (dans la franchise Alien) est embarquée dans le rapport au temps, à l’âge (ses démêlés avec la production aussi) : une lutte – souvent drôle – avec les monstres et les machines ! Et si les effets spéciaux n’étaient qu’une énorme érection technologique ?
Car un parfum de sexualisation flotte en permanence, et aux États Unis, les auteurs sont tenus de dénoncer l’Eve tentatrice : le Hays Office veille au grain. Sauf qu’il s’est piégé lui-même : Depuis que les femmes sont entrées dans la chambre à coucher, elles y sont enfermées. Or les enfants, à un moment, il faut bien les faire et pour ça les mecs doivent bander…
Le son, la musique installent ce lieu : le CINÉMA, ils donnent la densité mythique et le parfum entêtant de souvenirs vécus ou fantasmés comme le décor qui semble sorti d’une toile de Hopper (cinéphile assidu !) avec ses néons assommés par les couleurs sourdes et les plafonds bas, un espace intermédiaire où transitent ces êtres en suspension, qui nagent entre leur vie et leur chimère sur l’écran… qui doit censément être la vie.
À la fin, s’active une petite main, âgée, usée comme l’est ou le sera la majorité de celles qui passent là avant d’aller admirer ces femmes météores que sont les actrices. Quelquefois elle croit en reconnaître une… dans le doute, elle continue à servir le pop-corn, à passer l’aspirateur. Puis éteint la lumière…
avec Odja Llorca, Catherine Morlot, Alma Palacios, Léa Sery
mise en scène Émilie Capliez
scénographie Alban Ho Van, lumière Kelig Le Bars,
costumes Caroline Tavernier, musique Sylvain Jacques
Le texte de la pièce :
Pauline Peyrade, Des femmes qui nagent (Les Solitaires Intempestifs, 02/03/2023, 14 €)
reprises durant la saison 2023–24 :
Théâtre du Passage, Neuchâtel (Suisse) 10.03.24 ;
Les Quinconces et L’Espal, SN du Mans (72) 21.03.24 ;
Scènes du Golfe, Théâtres Arradon-Vannes (56) 26.03.24 ;
La Comédie de Saint-Étienne, CDN (42) 03–05.04.24 ;
La Filature, SN de Mulhouse (68) 18–19.04.24
portrait après blessures
L’ATTENTE
Anna Malagrida à La Filature, galerie
#EXPOSITION
galerie de La Filature, Scène nationale de Mulhouse du 17.01 au 5.03.2023
commissariat : Emmanuelle Walter

Paris. Paris soldé, Paris désiré, Paris barricadé, Paris confiné…
De 2008 à 2020, Anna Malagrida a photographié et filmé une capitale en déshérence, en suspension : les stigmates pérennes ou fugaces de crises récurrentes que son regard transforme en artefacts archéologiques. Quatre séries et une boucle vidéo avec toujours la volonté d’inscrire son travail au-delà de l’anecdote du moment, dans le temps long celui de l’Histoire, mais aussi de l’histoire de l’art.
Pour sa série la plus ancienne (2008-09), LES VITRINES, celles de commerces en faillite suite à la crise des subprimes, la Fondation Mapfre (Madrid) a produit des tirages en grands formats pour donner aux clichés le caractère épique de la peinture. Le blanc de Meudon appliqué d’un geste vif et large sur les devantures offre un fond organique qui s’enrichit d’inscriptions, de grattages, de collages et aussi des reflets sur le verre à la fois frontière et miroir : éléments de façade, réverbères, silhouettes… La photographe cueille ces témoignages urbains denses, concrets et les mue en œuvres abstraites évoquant Tàpies.
Avec les magasins de luxe barricadés pendant la crise des Gilets jaunes (PARIS BARRICADÉ, 2018-19), elle prolonge ce subtil jeu pictural où le rose pâle du contreplaqué alterne avec le jaune mouillé de l’aggloméré. Des protections provisoires et dérisoires posées le vendredi, déposées le lundi… Des marques de paupérisation ajustées dans la modénature néoclassique des quartiers chics, déserts le dimanche quand elle les photographie. La série est en dialogue avec un assemblage de panneaux récupérés et tagués de cet intrigant « LES MONSTRES SONT A »…
Si nécessaire, elle invente un dispositif : un affût près des Invalides transformant son cadre en théâtre d’ombres et de lumière hanté de rares passants masqués (ou pas) pendant le confinement (LES PASSANTS, 2020-21) ou cet entre corps dans un bar PMU à côté de Beaubourg pour honorer la Carte Blanche PMU dont elle est lauréate (CRISTAL HOUSE, 2016). Elle y filme les parieurs – majoritairement des migrants – qui, les yeux captés par l’écran, rêvent d’une nouvelle vie grâce à quelques euros et beaucoup d’espoir. Entre leurs corps résolument anonymes, des brèches de lumière vers la rue et son flux incessant de passants : des captures d’écran juxtaposées avec la fragilité hachée des films muets suggèrent des trajectoires qui se croisent sans se rencontrer… Et toujours cette affiliation à la peinture avec le ballet des mains des joueurs comme chez de La Tour ou Caravage, des gestes gracieux et expressifs, mais sans les tickets, jetés à terre, déchus, perdants.
En 2010 depuis une galerie d’art (dispositif qui évoque Clouzot filmant Picasso), elle filme LE LAVEUR DE CARREAUX qui voile la vue vers la rue, puis la rouvre pour le spectateur. Son geste pictural et chorégraphique matérialise l’épaisseur d’une frontière dont Anna, ici comme ailleurs, saisit la densité immatérielle.
Les blessures produisent aussi de la lumière (Fabrice Melquiot) et Anna Malagrida sait la capter : la lumière d’un monde en attente.
En attente de guérison ?
expression répression
ANTIGRAFFITISME
de Jean-Baptiste Barra & Timothée Engasser
#LIVRE (essai)
chez le passager clandestin, janvier 2023 (160 p., 20 €)
Les auteurs, eux-mêmes grapheurs, présentent dans une grande partie du livre la diversité des techniques utilisées par les autorités pour lutter contre cette « pathologie susceptible de contaminer les espaces urbains » (p. 10). Effacement bien sûr et depuis longtemps, mais désormais prévention (coûteuse) avec des moyens de plus en plus sophistiqués pour éviter ces « souillures ».
Le premier grand moment du graffiti date de la répression de la Commune de Paris. Dès mars 1871, les murs remplacent progressivement la rue tant pour les revendications que les hommages aux victimes : des mots contre le sang. D’emblée les autorités affichent une ardente volonté d’effacement. Écrire, c’est l’apanage du pouvoir : c’est lui qui hiérarchise, catégorise, criminalise et sacralise les écritures. Effacer devient alors un moyen de purifier les espaces, de les ordonner pour ensuite mieux les sécuriser (p. 10). D’autant plus que depuis une vingtaine d’années, notamment sous l’égide du préfet Haussmann à Paris, se sont imposés des tracés et une gestion hygiénistes de la ville au nom de la fiction du « vivre-ensemble » (p. 43) et, plus confidentiellement, en cas d’émeutes, propices au déploiement des canons et des charges de cavalerie.
Cette logique d’invisibilisation des messages subversifs se traduit par une concurrence acharnée (et dispendieuse) entre les grapheurs et les autorités qui se prolonge au tribunal avec un progressif renforcement des peines légitimé par la « théorie de la vitre cassée [1] ». Le nettoyage des graffitis devient une sorte d’allégorie de la lutte contre la criminalité (p. 55).
Cette concurrence se double d’une course-poursuite industrielle entre la pérennité des peintures et l’efficacité des solvants, de nouveaux revêtements. S’ouvre ainsi un véritable marché du graffiti. Il s’invite dans les opérations de réfections voire dans l’élaboration des projets (cf. la bibliothèque de Los Angeles dessinée par Franck Gehry) avec désormais en ligne de mire la smart city.
Plus récemment le discours sur l’art s’est invité dans le débat et a ouvert une voie alternative : la récupération de l’art urbain par la commande publique. Le street art institutionnel, comme la statue, agit en tant que symbole et récit fictif d’une histoire commune (p. 124) avec un rôle gentrificateur – comme un temps la piétonnisation – et une mise en patrimoine (promotion des friches rénovées avec ses start-up, ses fresques…).
Un jeu du chat et à la souris détaillé avec une certaine gourmandise par les auteurs : les grapheurs semblent faire peser sur la paix sociale une menace aussi effrayante que le font Fantômas ou Joker. Cette présence têtue et ostensible du transgressif rappelle aux pouvoirs publics que le consensus est un mythe politique. Ainsi, sous les enjeux de propreté, se joue l’appropriation par la force de l’espace urbain par les autorités au détriment des habitants, des usagers : l’antigraffitisme est une forme particulière d’iconoclasme (p. 141) qui aboutit finalement à rendre la ville silencieuse.
Pour l’offrir à la communication publicitaire ?
[1] ne pas réparer un carreau brisé sur un édifice entrainera potentiellement la destruction de toutes ses fenêtres et le développement de la criminalité aux alentours (p. 46), analogie développée par James Wilson et Georges Kelling en 1982
chair/glaise en liquide incandescente
Vessel de Damien Jallet & Kohei Nawa
#DANSE
représentation du 15/01/2023 à La Filature, Mulhouse, Quinzaine de la danse

Forme animale et machine organique : deux caractéristiques des œuvres du sculpteur Kohei Nawa qui ont fasciné Damien Jallet et éveillé son envie de collaboration. Elle s’est concrétisée par cette pièce lors d’une résidence de quatre mois à la Villa Kujoyama à Kyoto (équivalent de la Villa Médicis au Japon) avec une création en 2015 (pour trois danseurs initialement).
Présenté à l’occasion de la Quinzaine de la danse, Vessel est le deuxième volet du portrait consacré au chorégraphe par La Filature.
Nuit noire. Émerge un frémissement, au son, à l’image. Se devine un cratère calcaire, un nid cérusé, un vaisseau posé sur un film d’eau. Autour enfle un grouillement animal : des créatures des grands fonds, d’outre-monde ?
Des corps noués par paire dont les membres mandibules brassent au rythme des courants. Des corps presque nus, blanchis par la lumière, en gémellité avec leur reflet sur le miroir liquide. La lenteur (le plus souvent), l’épure et la poésie des images convoquent inévitablement le butō. Manquent les visages (sauf un des danseurs à la toute fin).
Quand les corps se détachent, ils sont presque constamment cassés en deux, les bras rabattus vers la nuque masquant tête et visage, affichant la membrane du dos des danseurs : des faces gigantesques d’une fascinante expressivité avec les clins d’œil des omoplates, les sourires des biceps, avec des mouvements pulsatiles, des déplacements saccadés, en crabe. Des anatomies matière : supports plastiques et acteurs d’une monumentale sculpture en respiration qui d’Urwelt s’élabore en Welt. Des organismes bruissant en quête d’incarnation comme si, tombés à terre, des rescapés de La Porte de l’Enfer de Rodin se ranimaient, empruntaient ce passage entre vie et mort que suggère le titre.
Souvent Damien Jallet joue la symétrie, mais celle organique de la cartographie musculaire, des déplacements, des gerbes d’eau et des reflets. La fascination est d’autant plus hypnotique que les postures sont contorsionnées, les bras en articulation. Pourtant ces gestes d’une vie silencieuse, ces mouvements sont d’une aisance limpide, d’une orchestration morphologique qui semble s’abstraire de l’effort.
La musique liquide, murmure des grands fonds, s’autorise des grincements, lâche quelques tutti et de sauvages éclats de percussions.
La lumière fait émerger d’une obscurité qui favorise l’effet miroir la carnation laiteuse des corps, éclabousse les plis et replis de l’anatomie des sept danseurs burinant les creux d’ombres.
Les deux artistes nous livrent un spectacle d’un incandescent noir et blanc – les deux couleurs de la mort – où la chair/glaise en travail accouche d’un palpitant éveil à la vie ! Dense et fugace…
Comme le suggère René Char : Les yeux seuls sont encore capables de pousser un cri.
avec Aimilios Arapoglou, Nobuyoshi Asai, Ruri Mito, Jun Morii, Mirai Moriyama, Astrid Sweeney, Naoko Tozawa
chorégraphie Damien Jalet, scénographie Kohei Nawa
musique Marihiko Hara & Ryūichi Sakamoto
lumière Yukiko Yoshimoto
tissu cicatriciel
Ceux de la nuit de Sarah Leonor (2022)
#CINÉMA
documentaire sorti en salle en janvier 2023 (France, 70 min) // séances sur Première
Ceux de la nuit, ce sont ces invisibles (et qui veulent le rester) que Sarah Leonor ne filme pas et que personne ne voit sauf la police et les maraudeurs.
Pourtant ils sont omniprésents.
À l’image, par ces lambeaux d’écorché – un bout de vêtement, un sac accrochés à une branche comme les stigmates de notre barbarie ordinaire –, les tags des activistes ou ce travelling hésitant cherchant la tombe de Blessing Matthew : à l’écart, au fond du cimetière, exilée jusque dans la mort. Et puis vibrante de vie – la chouette, les avant-plans de nature, les paysages… –, cette puissance lyrique mais impitoyable de la montagne (surtout avec l’hiver dans la deuxième moitié du film) qui les guette, les surplombe, les menace.
Au son, avec la respiration de la nature – le vent, le chahut des eaux, la Durance – et les récits : celui de ce territoire entre le col de Montgenèvre et Briançon ancré dans l’histoire avec déjà la traversée par les Piémontais au XIXe, par les Siciliens au XXe, les souvenirs de Sarah qui venait y skier et les témoignages des maraudeurs, des réfugiés recomposés (à partir d’entretiens audios) en quelques personnages et dits par six comédiens. Une élaboration inspirée de la fiction, mais qui restitue le vécu avec une crudité plus dense qu’un direct.
La réalité palpable des migrants surgit de cette confrontation des images et du son, se nourrit aussi d’archives et d’extraits du Chemin de l’espérance de Pietro Germi. Comment ne pas penser à Chris Marker, à son Sans soleil notamment ?
Et il y a cette autre réalité ludique des sports d’hiver et des activités de montagne affichés au grand jour et qui s’invite de la même manière : à l’image avec des infrastructures qui modèlent le paysage et par la voix des maraudeurs (dont c’est le gagne-pain) qui racontent comment ils ont pris conscience qu’après la fermeture des équipements de loisirs, des ombres se lèvent et tentent de traverser la frontière.
En creux il y a aussi le travail de ces géographes qui permettent de décrypter notre monde à partir de son espace et d’identifier les enjeux de pouvoir : Martin, une des voix off, Élisée Reclus que cite la réalisatrice (et, par ailleurs, Christophe Guilly et sa France périphérique ou Guillaume Faburel et ses Métropoles Barbares).
À la fin, comme après un mauvais rêve, la réalisatrice rembobine le film – l’avalanche remonte la montagne – comme si Blessing n’était pas tombée dans la Durance et s’incarnait en Eunice bien vivante avec la promesse de son fils Wisdom.
Le grand mérite de Ceux de la nuit est de restituer la présence de ces migrants dans leur densité palpable d’êtres humains alors que la majorité de la population ne les voit guère même s’ils sont omniprésents (une récurrence dans les discours médiatiques). Sarah Leonor la pose aussi en termes de tragédie. Avec sa caméra, elle arpente la cicatrice où ce qui se revendique civilisation déraille : Leur mondialisation n’a pas prévu le surgissement de l’humain. Elle n’a prévu que des consommateurs (Patrick Chamoiseau, Frères Migrants, 2017).
avec les voix de Françoise Lebrun, Solène Rigot, Adrien Michaux, Damien Bonnard, Olivier Rabourdin, Hovnatan Avédikian
Labiche en apnée
Das Weisse vom Ei (Une île flottante)
Christoph Marthaler d’après Eugène Labiche
#THÉÂTRE
représentation du 10/01/2023 à La Filature, Mulhouse
La pièce de Labiche est un jeu de dupes qui doit sceller un marché de dupes : le mariage de Frédéric Ratinois avec Emmeline Malingear. Deux familles banalement petites bourgeoises qui se poussent du coude et se saignent pour se donner un vernis de grande bourgeoisie. Marthaler y ajoute un ingrédient de cacophonie et d’incompréhension supplémentaire : les Ratinois sont Allemands. Les costumes d’inspiration XIXe se prolongent par un décor surchargé d’un kitch suranné.
En ouverture, les huit protagonistes entrent à petits pas pluvieux et tentent, a capella face au public et en franco-allemand, d’exposer leur situation – pour plutôt l’embrouiller – trahissant surtout qu’ils ne sont que les copies conformes les uns des autres.
Quand le rideau se lève, le spectateur a l’impression de pénétrer dans un monde vieillot et poussiéreux, hanté par des vieux – y compris les futurs mariés. Une usure du temps dont Marthaler fait son miel en dilatant les silences entre des répliques banales (surtout au premier acte). Les personnages assument cette inertie au son poussif du tuba et des cloches qui sonnent presque en permanence comme un glas. Un choix à contre-courant de la tradition des portes qui claquent et du tempo endiablé habituel dans ce répertoire. À l’occasion, l’un entonne une chanson dont l’énergie relance le rythme de la représentation dans un esprit proche des Monty Python.
La mise en scène joue sur le comique de situations où les corps s’empêtrent avec des accessoires, des manies obsessionnelles et leurs propres limites (celles des mensonges…). Un burlesque évoquant Jacques Tati est poussé vers l’absurdité en l’étirant jusqu’à l’étouffement. Les rires du public sont fréquents, mais dispersés, éclatés, conditionnés par ce temps qui enfle et, parfois quand même, épuise l’effet comique.
À la fin on range, on évacue tout. Pour laisser la place à un nouveau monde ? Affaire classée tout simplement…
Avec ce dispositif radical, la pièce reste drôle et critique à la fois de cette petite bourgeoisie arriviste et vaniteuse qui apparaît peut-être plus pathétique…
Chacun passe sa vie à jeter des petites pincées de poudre dans l’œil de son voisin… Pourquoi fait-on de la toilette ? Pourquoi a-t-on des diamants, des voitures, des livrées ? Pour les yeux des autres ! (Eugène Labiche, La poudre aux yeux, AI, s6)
Et, à propos, pourquoi fait-on du théâtre ?
avec Marc Bodnar, Carina Braunschmidt, Charlotte Clamens, Raphael Clamer,
Catriona Guggenbühl, Ueli Jäggi, Graham F. Valentine, Nikola Weisse
scénographie & costumes Anna Viebrock, dramaturgie Malte Ubenauf