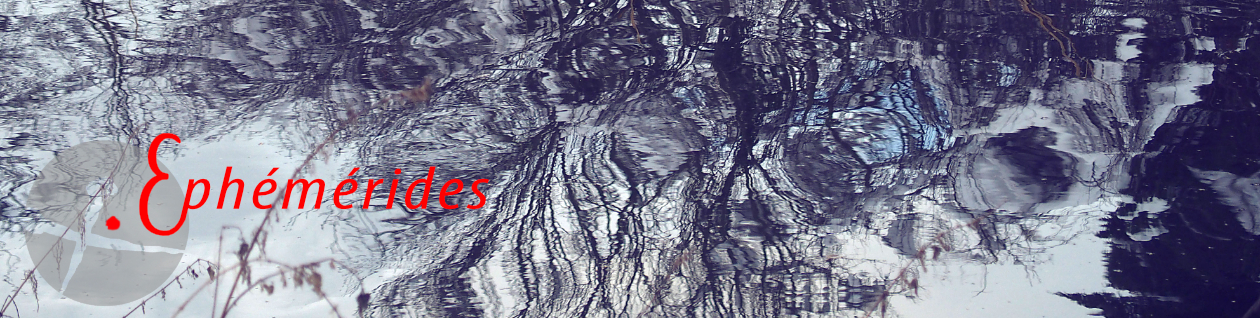un regard et des choix – forcément subjectifs – sur l’offre culturelle 2024…
#EXPOSITIONS : Made in Japan, Estampes d’Hiroshige, Kunisada & Hokusai (Kunstmuseum Basel | Neubau), Dan Flavin Dédicaces en lumière (Kunstmuseum Basel | Neubau), Femmes de génie (Kunstmuseum Basel | Hauptbau), Strasbourg 1560-1600. Le renouveau des arts (Musée de l’Œuvre Notre-Dame, Strasbourg), Jeff Wall (Beyeler), Frisbee ! (Musée Würth Erstein), Frédéric Croizer, galeriste (art KARLSRUHE 2024)
#THÉÂTRE & MUSIQUE : les 400 ans du clavecin Ruckers (musée Unterlinden, Colmar), Après la répétition + Persona (Bergman/I. van Hove), On achève bien les chevaux (B. Bouché, C. Hervieu-Léger, D. San Pedro), Chœur des amants (T. Rodrigues), Polifemo (Porpora/Haim, Ravella), Phèdre (Racine/Cruciani), L’araignée (Lagrange)
@Saisons 2023-24 : Comédie de Colmar, La Filature (Mulhouse), Espace 110 (Illzach), Opéra national du Rhin
@avant-papier sur présentation de presse et documents remis
Sur la page d’accueil, des informations actualisées sur les évènements encore accessibles.
εphεmεrides 2023 • 2022 • 2021 • 2020 • 2019 • 2018
l’ange à la harpe
les 400 ans du clavecin Ruckers
#EXPOSITION & MUSIQUE
Musée Unterlinden (Colmar) d’avril 2024 à janvier 2025
concerts les 12.05 (18 h), 4.10 (19 h) & 6.10 (15 h & 17 h 30)
présentation des deux Ruckers dans la nef de l’Ackerhof du 9 octobre à janvier 2025

Le clavecin Ruckers du musée Unterlinden a été achevé en 1624 à Anvers par Ioannes (1578–1642), aîné de la deuxième génération de la dynastie. Cet anniversaire est l’occasion d’une programmation autour de l’instrument dont quatre concerts.
En automne dans la nef de l’Ackerhof, les visiteurs pourront admirer l’instrument ainsi qu’un de ses cousins (daté de 1612) prêté par le musée d’Amiens/Cité de la Musique. Avec un peu de chance, ils les entendront sonner à l’occasion d’une des masters classes prévues in situ.
Les curieux, les audacieux peut-être, qui s’aventurent au premier étage du cloître des Unterlinden d’ordinaire boudé par les visiteurs pressés, peuvent y découvrir un des joyaux du musée qui est à la fois une œuvre d’art et un instrument d’une exceptionnelle qualité ! Installé la plupart du temps dans le coin nord-ouest du déambulatoire, le clavecin Ruckers, couvercle rabattu, apparaît comme un grand coffre laqué de noir avec une décoration géométrique dorée, le piétement est plus chamarré avec ses colonnettes d’inspiration ionique abondamment couvertes de feuilles d’or.
Si la chance leur sourit, un ou une claveciniste joue l’instrument et le son délicat et fruité envahit les travées avec la netteté piquante des aigus, la chaleur enveloppante des graves surtout si le registre du luth est activé.
S’ils s’approchent, la table d’harmonie est visible avec les oiseaux du décor original et la rosace portant la signature de Ioannes : ses initiales encadrant un ange jouant de la harpe. La bordure interne des éclisses et des échines préserve également une frise caractéristique des Flandres.
Le nom de Ruckers est au clavecin ce que Stradivarius est au violon.
Le fondateur Hans Ruckers (1555–1598) assied la réputation du nom à partir de 1575 et forme ses deux fils qui reprendront l’atelier avant que le cadet Andreas I (1579–1652) ne fonde le sien dont héritera son fils Andreas II (1607–1655). L’aîné Ioannes (1578–1642), sans successeur direct, formera son neveu Ioannes Couchet (1615-1655), fils de leur sœur Catherina.
Grâce à la qualité et l’ampleur de leur son, les instruments de ces trois générations se sont vendus à travers toute l’Europe et il en subsiste aujourd’hui une centaine dont cinq seulement sont en état de jeu.
Cependant le goût et l’écriture musicale évoluaient et variaient d’un pays, d’une tradition à l’autre. Ainsi l’instrument est mis au goût du jour à Paris en 1680 : un « petit ravalement » où les deux claviers sont alignés et un second jeu de huit pieds rajouté sans modifier ni la caisse d’origine, ni la structure interne. Le couvercle est peint à cette occasion avec la joute musicale d’Apollon et de Pan sous l’écoute du roi Midas inspirée des Métamorphoses d’Ovide, le piétement est sans doute aussi réalisé à ce moment-là.
Vers 1720, un éminent facteur parisien, Antoine Vater (1689-après 1759) augmente l’étendue des claviers toujours sans élargissement de la caisse, pour l’adapter aux exigences de la littérature pour clavecin de François Couperin et Jean-Sébastien Bach.
En 1778, le clavecin est mentionné dans l’inventaire du château de Condé-en-Brie (Aisne) où il demeure jusqu’à son classement en 1966. Avant de le mettre en vente en 1980, le dernier propriétaire Xavier de Sade le fait restaurer par le facteur Christopher Clarke qui veille encore aujourd’hui sur l’instrument. La Société Schöngauer s’en porte acquéreur pour enrichir sa collection d’instruments anciens. Il est inauguré par Gustav Leonardt lors d’un concert l’année suivante. Depuis de prestigieux interprètes (Blandine Verlet, Bob van Asperen, Lisa Crawford, Christophe Rousset, Christine Schornsheim notamment) l’ont choisi pour leurs enregistrements, une trentaine à ce jour.
@concerts, conférences, visites, animations
Le dimanche 12 mai (18 h), Jean Rondeau, jeune et brillant claveciniste formé au CNSM de Paris, lancera cette saison anniversaire avec les Suites en Ré, en La, en Fa de Louis Couperin. Dans les jours précédents, il les aura enregistrées pour son intégrale de l’œuvre pour clavecin du compositeur chez ∑rato.
Le vendredi 4 octobre (19 h), Christine Schornsheim sera accompagnée de Mayumi Hirasaki & Jonas Zschenderlein (violons), Christian Goosses (alto), Werner Matzke (violoncelle) pour les concertos de clavecin de J.-S. Bach, une occasion rare d’écouter le Ruckers en dialogue avec un ensemble.
Le dimanche 6 octobre, deux concerts permettront de se mettre dans l’oreille la sonorité des deux instruments : le Ruckers de 1612 avec Jean-Luc Ho interprétant L’héritage de Lully (Lully, Muffat, d’Anglebert, Buxtehude, Bach) à 15 h, puis celui du musée avec Christophe Rousset dans Froberger, Louis & François Couperin à 17 h 30.
En complément de ces concerts, des conférences (les facteurs de clavecin Christopher Clarke & Émile Jobin, Jean-Luc Ho, l’historienne Florence Gétreau…), des visites guidées, des animations à destination des plus jeunes (Atelier famille|Happy family) et des « publics empêchés » (le 9.11 à 14 h).
Le détail est régulièrement mis à jour sur l’agenda du musée.
l’envers du monde
Made in Japan.
Estampes d’Hiroshige, Kunisada et Hokusai
#EXPOSITION
Kunstmuseum Basel | Neubau du 16.03 au 21.07.2024
Commissaires : Judith Rauser, Hans Bjarne Thomsen
catalogue en allemand, 240 p., 48 CHF
du mardi au dimanche de 10h à 18h (20h le mercredi)
entrée libre dans les collections en semaine à partir de 17h (sauf jours fériés)

Le Kunstmuseum Basel possède un fond de 350 estampes japonaises qui proviennent majoritairement d’un legs du chimiste et collectionneur d’art bâlois Carl Mettler (1877–1942) au Kupferstichkabinett. Anita Haldemann, directrice a.i. et du cabinet des estampes, souhaitait les montrer au public et aussi poursuivre ce travail sur la mémoire du musée (comme fin 2022 avec Le collectionneur Curt Glaser). 110 pièces (rares pour certaines) de cet âge d’or des XVIIIe et XIXe siècles ont été sélectionnées pour cette exposition et restaurées par Annegret Seger sous l’expertise des commissaires Judith Rauser et Hans Bjarne Thomsen.
Les estampes japonaises s’inscrivent à la confluence d’une tradition picturale célébrant les quatre saisons (shiki-e) ou les sites emblématiques de l’archipel (meisho-e) et l’impression de recueils illustrés, tels des guides de voyages ou des calendriers lunaires, dont les illustrations commencent à être vendues à l’unité. Le retour à la paix intérieure et une certaine prospérité liés à la période Edo (1603–1868) du nom de la nouvelle capitale politique (et future Tokyo) favorisent l’éclosion de la demande pour ces xylographies. La notion de série demeure, ainsi les Trente-six vues du mont Fuji d’Hokusai (1760–1849), Les Cinquante-trois Stations de la route du Tōkaidō d’Hiroshige (1797–1858)… L’ukiyo-e anoblit aussi l’usage du support papier comme outil de communication : affiches, prospectus, programmes, notamment pour le théâtre kabuki.
Si le mouvement et la demande intérieure s’essoufflent au cours du XIXe siècle, la restauration Meiji rouvre le Japon au commerce international et les estampes séduisent de nouveaux collectionneurs en Europe. L’ukiyo-e influence l’Art nouveau et certains impressionnistes (Van Gogh, Toulouse-Lautrec, Monet…) d’autant plus que les Frères Goncourt se font les chantres du japonisme. Le Dr Mettler était d’ailleurs client auprès d’Hayashi Tadamasa, importateur le plus avisé sur la place de Paris (actif entre 1890 et 1906).
En xylogravure, le motif est gravé en relief sur une plaque en bois de cerisier, plus rarement de catalpa (contrairement au cuivre où c’est l’incision en creux qui retient l’encre). Les premières sont éditées vers 1670 en noir et blanc, mais devant l’engouement des amateurs, les éditeurs introduisent la couleur. Suzuki Harunobu (1725 ?–1770) perfectionne et popularise l’« estampe de brocart » (nishiki-e) avec souvent une douzaine de teintes (et autant de plaques) à partir de 1764. L’impression se fait sans presse : le papier d’origine végétale (fibres de mûrier) est appliqué sur le bois encré avec un tampon circulaire (baren) fait d’une ficelle de chanvre roulée, couverte de feuilles de bambous. Pour certains tirages plus précieux (gaufrages, fonds micacés, etc.), l’imprimeur soumet le papier à des manipulations supplémentaires. Ces estampes sont le fruit d’une étroite collaboration entre éditeur, graveur, imprimeur et artiste signataire dont le dessin original disparait lors de l’opération de gravure.
économes et foisonnantes
Les deux premières salles abritent des formats horizontaux, essentiellement des paysages. Beaucoup sont d’Hiroshige (un tiers du fond bâlois) : vues du Tōkaidō, Lieux célèbres de la capitale de l’Est… Ses larges aplats étagent des plans successifs vers l’horizon qui accueillent des personnages caractérisés par leur activité, une bande sombre (bleu le plus souvent, mais pas toujours) ferme le ciel en un dégradé qui ramène le regard vers la scène et, par contraste de densité, donne de la profondeur à l’espace représenté.
Hokusai pousse le procédé jusqu’à une quasi-abstraction. À peine une silhouette, un bateau ponctuent l’immensité, les couleurs magnifient les plages de blancs – des espaces en intemporelle suspension jouant l’ambiguïté : liquide, solide ou nébuleux ? – en écho aux neiges éternelles du mont Fuji, l’environnement accède ainsi à une dimension quasi spirituelle (La rivière Tama dans la province de Musashi | Bushû Tamagawa, vers 1830).
Quelquefois les effets du vent rappellent cette respiration de la nature avec les cerfs-volants (Le sanctuaire de Tenjin à Yushima | Yushima Tenjinja, 1834) ou les kakémonos accrochés aux branches par Shunman (vers 1757–1820, Surimono entouré de poètes | yokoganaba, vers 1800) [ou ce surréaliste envol de feuilles d’arbres et de papier mêlées du Coup de vent d’Hokusai, non présenté, qui a inspiré Jeff Wall].
Hiroshige est sensible aux anecdotes et les Cent vues d’Edo (1856–1858) fourmillent de saynètes avec ses acteurs et ses spectateurs partis prenants d’une foule dont la métropole est en pleine croissance (près d’un million d’habitants au début du XVIIIe siècle). Souvent il « encombre » le premier plan, cette enivrante chorégraphie des ombrelles de Cerisiers en fleurs à Asuka (Asukayama hanami no zu, 1853) ou une structure construite avec un goût pour les charpentes complexes, qui ouvre vers les lointains et, agrandi, affirme une ville en pleine ébullition. Sa gourmandise évoque les tableaux de genre de la Renaissance flamande et dépeint le familier avec un luxe de détails où les jeux voire les rires sont perceptibles.
S’y ajoute une vigueur dans le choix et le traitement des couleurs : à partir de 1829, le bleu de Prusse (chimique), moins fragile et plus dense que le bleu d’origine naturelle, se généralise et les gestes d’encrage sur les aplats leur donnent du corps quand ils ne sont pas habités comme certains ciels (étoiles, flocons…).
immatérielle palpitation
Dans les salles suivantes, le visiteur pénètre dans les intérieurs et rencontre les familiers sur des formats surtout verticaux : les bijin célébrant la beauté des geishas et des courtisanes. Les artistes s’attardent sur le raffinement des somptueuses chevelures noires, parées de peignes et d’épingles d’écaille, de laque ou de nacre, sur la débauche des tissus aux motifs si variés, géométriques ou à fleurs, et aux coupes si sophistiquées, sur les accessoires et les armes aussi, car les acteurs de kabuki représentés dans leurs rôles exhibent le pendant masculin d’Yoshiwara, ce quartier des plaisirs.
Par les pleins et déliés de son trait, Kuniyoshi (1798–1861) accentue leur vigueur, ou celle des drapés des kimonos…
La plupart du temps, la figure humaine est juste une courbe avec quelques traits qui indiquent la bouche, le nez, les yeux et les sourcils qui sont les traces les plus épaisses, même si Sharaku (1770–1825, actif en 1794–95) saigne les visages de grandes bouches coléreuses ou dubitatives.
Quand le plan s’élargit le décor prend vie, ainsi ces ombres sur les paravents chez Eizan (1787–1867) : Rassemblement d’élégantes beautés | Fūryū bi no uchi soroi, (1811–14).
Kunisada (1786–1865) grand spécialiste des acteurs de kabuki, emplit le cadre avec une prolifération de détails sur l’acteur dont ces estampes valorisent le statut de star.
Dans ces portraits, les échanges entre les différents personnages rendent palpables les jeux de pouvoir, de hiérarchie, la rivalité ou la complicité. Leur expressivité passe par le corps entier, les postures, les vêtements, l’activité, le rictus éventuel n’en est qu’un prolongement affirmant l’agressivité d’un personnage qui incarne avec fougue un système guerrier.
Et le visiteur retrouve Hiroshige tout aussi à l‘aise dans la restitution des combats – L’Histoire de la revanche des frères Soga (Soga monogatari zuye, 1848) – que dans la poésie des paysages.
trouble jeu
Utamaro est plus économe et délicat restituant avec tendresse ces femmes agitant des éventails, des miroirs avec ce trouble jeu entre l’avant l’arrière et une discrète (et parfois intrigante) mise en abîme. Certains spécialistes lui prêtent même des allusions bouddhistes dans ses compositions (triade d’Amida).
Ce flottement au-delà de la réalité objective sait esquisser l’immatérielle présence de l’Univers, ce dialogue subtil et vivifiant entre les êtres et leur environnement et trouve un écho ironique dans les incidents anecdotiques d’Hiroshige, comme si les humains étaient des dominos sur un tapis de jeu. [L’extrémité griffue de La Grande Vague de Kanagawa d’Hokusai, non présentée, en est la plus célèbre illustration.]
Au fil des cimaises et de cette mise en beauté fine et délicate de l’Ukiyo-e, ce Levant si lointain nous apparaît soudain familier et vivant. Cependant, si, selon les chroniqueurs, la hiérarchie sociale était gommée à Yoshiwara, l’accès et les commodités que l’habitué pouvait s’y offrir dépendaient de sa fortune…
Un monde flottant sans doute moins idyllique que ne l’affiche la profonde légèreté de ces envoûtantes images qui suggèrent avec une sublime évidence où réside le sens de la création : dans l’art de décrire des objets ordinaires tels que les réfléchiront les miroirs bienveillants du futur, de trouver dans les objets qui nous entourent cette tendresse embaumée que seule la postérité saura discerner et apprécier en ces temps lointains où les petits riens de notre simple quotidien auront pris d’eux-mêmes un air exquis, un air de fête (Vladimir Nabokov, 1925).
la tyrannie du masque
Après la répétition + Persona d’après Ingmar Bergman
Ivo van Hove
#THÉÂTRE
représentation du 22 mars 2024 à La Filature (Mulhouse)

La troisième soirée du portrait d’Ivo van Hove conjugue deux textes reprenant les dialogues des films éponymes d’Ingmar Bergman. Tous deux mettent en jeu le théâtre, l’équilibre délicat entre la représentation et la sincérité, la porosité entre vie réelle et fictive.
Persona, c’est le masque de théâtre romain, s’il détermine le caractère, il permet cependant à l’incarnation personnelle de surgir, par la parole de l’acteur notamment. Les deux pièces brassent ce rapport au masque rendu vif pour la première par le lieu, un plateau de théâtre voué au jeu de masques, et pour la seconde par l’actrice qui rejette l’artifice de la parole. Et il y a une cohérence d’imposer cet ordre-là : le texte de 1984 évoque la mécanique sociale en partie articulée par le « masque », celui de 1966 resserre la question sur l’individu, le corps brut…
Cette perspective ouvre aussi en miroir la trajectoire d’une vie vouée à la représentation et la part personnelle du lien entre le metteur en scène et son actrice (après Persona, Bergman s’installe dans l’île où le film a été tourné et partagera avec Liv Ullman douze ans de vie et de collaboration).
Henrik Vogler (Charles Berling) passe sa vie en scène tel un oracle obstiné dont les illusions s’effritent. Il arpente le plateau à petits pas chiffonnés, de jardin à cour, de cour à jardin. Ce refuge et cette retenue assurent le raisonnable, ils compensent une forme d’échec (il vit seul depuis huit ans, il le dit) et canalisent la frustration récurrente que révèle ce ressassement des mêmes pièces (cinq fois Le songe de Strindberg). Et si souvent la production est conditionnée par le choix de l’actrice principale : offrir le masque qui masque le désir…
Il se confesse à Anna, la fille de la comédienne qui avait incarné le même rôle des années auparavant, mais sa mère lui avait préféré un comédien… Il suggère qu’il a épousé Rachel (dont il est maintenant séparé) par dépit.
La jeune Anna s’avoue comédienne malgré elle et se plaint d’affronter depuis toujours le faux : ses parents comédiens jouaient même leurs scènes de ménage ! Et là, ne la mimétise-t-il pas avec sa mère ? Justine Bachelet joue sur le fil cette fragilité de comédienne convaincue d’être mauvaise. Henrik le lui dit avec un enthousiasme indulgent et la filme en direct : pour scruter le masque, l’en délester ?
Quand Rachel débarque, il est évident que si le lien est rompu, il n’a pas été rien. Peut-être même qu’Henrik en a fui l’intensité… et le glissement vers la folie avec laquelle Rachel cohabite (tant bien que mal). Elle tente de la conjurer par le corps, et par ses gestes, l’intensité de ses déplacements, Emmanuelle Bercot déploie une énergie permanente qui repousse le gouffre. L’amour est une construction de la psyché (et des mots ?), le désir ouvre au réel : l’accouplement serait forcément vrai…
Henrik évacue cet autre masque… car il y a Anna.
Et le vrai, soudain et ductile : cet avortement avoué, dénié, avoué à nouveau, autrement… et les corps désirants. Toujours, quand même.
Les machinistes entrent, évacuent les accessoires… ce fatras qu’Henrik décline d’une production à l’autre.
Ne restent pour Persona que le plateau nu, les trois cloisons qui l’enferment et cette table où repose le corps clinique an-érotique d’Élisabeth comme préparée pour le scalpel du légiste.
Rachel sera Élisabeth (toutes deux ont été tétanisées par le même mutisme dans Électre) : je est une autre… avec la même combustion sur les lèvres de la folie dont le corps dépouillé de tout même des mots ne parvient pas à se débarrasser.
Anna devient Alma, l’infirmière chargée de veiller ce corps devenu masque obstiné du silence. Et loin de tout : les parois tombent.
Le plateau nu entouré d’eau devient cette île (scénographie vibrante et inspirée de Jan Versweyveld).
S’ouvre un temps à habiter et Alma le nourrira de mots : sa vie racontée en confiance, en générosité. Elle dit son corps aussi avec cet avortement. Les deux femmes se trouvent, s’enthousiasment dans la tempête. Face aux machines à vent.
Mais peut-on faire confiance à une actrice ?
Ivo van Hove travaille avec de grands acteurs et leur ouvre l’espace pour s’exprimer. Avec lui, la machinerie du théâtre s’affiche* (ceci est mon masque…), les corps des acteurs lui sont livrés et il dirige cette bataille avec la crudité impitoyable des anatomies affrontées, saisies par les lumières, cinglées par les rafales, nappées par l’eau, les fumées. Chez lui, la beauté n’est pas à l’endroit du désir, mais naît de l’expression envoûtante de la grâce ou malsaine de la souffrance que savent offrir les comédiens, une friction qui subjugue et noue la conscience du spectateur.
Faut-il être infantile pour être un artiste à notre époque comme le suggère Bergman ? Et jouer avec le masque des mots ?
Ou pas ?
Chaque mot est comme une souillure inutile du silence et du néant (Samuel Beckett)…
* rappelant ici le dispositif de mise à distance de l’outil cinéma imaginé par Bergman dans Persona.
avec Emmanuelle Bercot, Charles Berling, Justine Bachelet,
Mama Prassinos, voix d’Isabelle Huppert
texte Ingmar Bergman, traduction Daniel Loayza
mise en scène Ivo van Hove
dramaturgie Peter van Kraaij
scénographie, lumière Jan Versweyveld
conception sonore Roeland Fernhout
costumes An D’Huys
dans l’ombre du tumulte
On achève bien les chevaux
Ballet de l’OnR & Cie des Petits Champs
#DANSE
représentation du 8 mars 2024 à La Filature (Mulhouse)
captation disponible en replay sur France TV jusqu’au 9/01/2025 (gratuit, compte nécessaire)

« Danser au XXIe siècle » est un axe essentiel dans la réflexion et le travail de Bruno Bouché. Avec Les ailes du désir (2021), il avait creusé la proximité entre cinéma et danse. L’été dernier, « pour créer ensemble une nouvelle forme de danse-théâtre », il a associé le CCN • Ballet de l’Opéra national du Rhin à La Compagnie des Petits Champs de Clément Hervieu-Léger et Daniel San Pedro qui assurent la co-mise-en-scène. Le choix s’est porté assez naturellement sur On achève bien les chevaux : l’histoire d’Horace McCoy (1935) se déroule presque intégralement lors d’un marathon de danse (et offre accessoirement une unité de lieu).
La production a été créée le 6 juillet 2023 au festival d’été de Châteauvallon. Elle est reprise à La Filature pour inaugurer la Quinzaine de la Danse et dans la saison 2023-2024 de l’OnR.
Le roman de McCoy est une descente aux enfers et à une époque particulière : les années trente avec la grande dépression et une misère généralisée. Une des motivations des concurrents était de manger à leur faim. Pour cela il fallait rester dans la course : un marathon de danse est surtout un marathon. Le combat de gladiateurs avec ses pouces levés ou baissés n’est pas loin.
Cela est dit, un peu. Mais le roman s’ouvre par le meurtre de Gloria, le spectacle par le nettoyage du parquet pour les danseurs…
Ne pas jouer la noirceur est un choix de l’équipe (la violence omniprésente a été en partie évacuée : celle du directeur Socks, la présence de la pègre, un règlement de compte qui fait deux morts…) avec le souhait (l’obligation ?) de valoriser le corps de ballet. Les défis, les derbys qui permettaient de pimenter et rythmer le marathon, en sont l’occasion et déclinent le joli registre de la troupe. Ainsi la netteté dans la réalisation des gestes, des pas sur des morceaux très populaires dans les fêtes ou le solo en tutu de Deia Cabalé (sur Giselle)… Les numéros s’enchaînent et installent une logique de music-hall. Ce savoir-faire enthousiaste, attentif à l’esthétique, est le produit d’une dense et permanente énergie… pas vraiment en cohérence avec l’immense fatigue induite par des semaines de marathon.
C’est seulement après les derbys, vers la fin, que les corps livrés à eux-mêmes – chacun pour soi décrète Socks – trouvent des pauses de moiteur, que la chorégraphie suggère un peu l’état d’éreintement des organismes ou que le trompettiste Noé Codjia offre un beau moment de suspension embaumé du parfum du roman et, au-delà des compétiteurs, de cet épuisement du monde (C. Mingus).
Cette succession de pas de deux (le plus souvent) et de la meute qui court dans l’arène après les dollars permet de préserver le côté foutraque de l’évènement débordant volontiers la concision chorégraphique. Le mouvement orbital facilite aussi l’alternance de la mise en avant près de la rampe des danseurs (pour le spectacle) et des comédiens (pour la narration).
Gloria (Clémence Boué) s’impose en vrai lien avec le roman. D’emblée en marge, très vite rebelle, sa robe rouge sang proclame son destin tragique et elle surnage comme le dernier Humain, seule consciente que cet « orchestre du Titanic » endiablé n’est qu’une course à l’abîme travaillée par la mort. Avec son comparse Robert (Josua Hoffalt), elle habite avec densité et justesse sa partie dansée (le spectacle leur offre quelques figures) et s’avère plus à l’aise dans le mouvement que les danseurs avec les mots (dans la captation à Lyon, sa belle présence était déjà perceptible).
La lumière les isole tour à tour pour quelques moments réflexifs (reliquats des monologues intérieurs du roman) où Robert tente, avec une retenue désemparée, de saisir qui est cette femme au bord d’un si vertigineux désespoir.
L’adaptation est économe en répliques, une bonne moitié étant dévolue au micro des chauffeurs de salle. Socks, en meneur de jeu (Daniel San Pedro), et ses acolytes viennent régulièrement encourager le public du soir (très bienveillant, pas comme celui du roman excessivement voyeur) à scander le rythme du morceau avec l’envie de transformer le spectacle en aventure collective et festive.
Le choix des costumes comme des musiques fait glisser la compétition vers l’après-guerre (où les marathons périclitaient) et l’excitation des trente glorieuses : ce n’est plus tout à fait la même histoire et le drame de la pauvre Gloria reste dans l’ombre de ce tumulte ébouriffant animé par le mantra de Socks : Tout va bien !
Le spectacle est touffu, plaisant et atypique, mais sans la dimension déchirante hurlée par les cuivres grinçants du jazz, les mots de McCoy et des livres, des films inspirés par cette période douloureuse d’avant-guerre.
Dansez, dansez sinon nous verrons que nous sommes perdus…
avec Daniel San Pedro (Socks),
Clémence Boué (Gloria), Josua Hoffalt (Robert)
et Claude Agrafeil, Louis Berthélémy, Luca Besse,
Stéphane Facco, Juliette Léger, Muriel Zusperreguy,
le CCN • Ballet de l’Opéra national du Rhin
les musiciens Noé Codjia, M’hamed El Menjra,
Maxime Georges, David Paycha
costumes Caroline de Vivaise
scénographie Bogna G. Jaroslawski, Aurélie Maestre
lumières Alban Sauvé
son Nicolas Lespagnol-Rizzi
@Quinzaine de la Danse
6e édition du 7 au 26 mars 2024
#DANSE
Espace 110 (Illzach), La Filature, CNC–Ballet de l’Opéra du Rhin, Musée des Beaux-Arts (Mulhouse), La Passerelle (Rixheim)
11 spectacles du 7 au 26/03/2024
Pour la 6e édition, le Ballet de l’Opéra national du Rhin est devenu avec trois spectacles un partenaire de proposition majeur du Festival créé en 2017 par Thomas Ress, directeur de l’Espace 110 (Illzach). À l’époque, il n’imaginait pas l’ampleur que prendrait la manifestation ni le maillage sur le territoire tant vers les publics que la mutualisation des moyens avec les structures partenaires depuis 2019 : La Filature et le CCN • Ballet de l’OnR.
Le programme avec 11 spectacles pour 36 évènements décline toutes les formes de la chorégraphie d’aujourd’hui : grands et petits formats, créations et reprises, propositions participatives, ateliers, conférences, cinéma et expositions dans des lieux institutionnels ou atypiques, en gymnase, au musée, en quartiers et aussi à la patinoire olympique !
Ouverture à La Filature le 7 mars à 20 h avec la création sur ses terres mulhousiennes de On achève bien les chevaux (CCN • Ballet de l’OnR). Étape importante du parcours de Bruno Bouché et son questionnement – la danse au XXIe siècle –, le spectacle inspiré du roman d’Horace McCoy revendique la rencontre du théâtre et de la danse. Il partage la direction artistique avec Clément Hervieu-Léger et Daniel San Pedro. Neuf comédiens de leur Compagnie des Petits Champs rejoindront la troupe du CCN et les cinq musiciens présents sur scène (Filature : 7, 8 & 10.03)
Mise en bouche dès le 5 mars avec une répétition publique à 19 h (entrée libre).
Deux jeunes compagnies sont invitées pour leurs créations.
Gounouj de Léo Lérus (passé par la Batsheva Dance Company et la compagnie LEV de Sharon Eyal) avec sa Compagnie Zimarèl est inspiré par sa culture guadeloupéenne et les danses caribéennes, notamment le gwoka (Filature : 8 & 9.03).
Grains où les six danseurs de la Compagnie Simon Feltz (Strasbourg) s’empareront du langage tant vocal que corporel lors des rapports amoureux (soutenue par le réseau L’EstDanse, Filature : 21 & 22.03).
Une ambition de la manifestation est de porter la danse vers de nouveaux publics : au Gymnase Schoenacker (Mulhouse), à l’Espace 110 (Illzach) et à La Passerelle (Rixheim) avec Kamuyot d’Ohad Naharin (15, 18, 19 & 22.03) et Charcoal de Caroline Grosjean à partir de 2 ans (Espace 110 : 20.03 + scolaires).
La proposition sans doute la plus spectaculaire (Benoît André, directeur de la Filature, insiste sur la proximité avec les danseurs) est Murmuration de la troupe canadienne Le Patin Libre à la patinoire olympique (22-24.03) avec le soutien de la Délégation générale du Québec à Paris dont bénéficie aussi « M » une œuvre polymorphe et colorée créée par la chorégraphe québécoise Marie Chouinard (Filature : 26.03).
Pour être complet : Tout-Moun inspiré d’Édouard Glissant (Filature : 12.03) et Body bagarre_le jeu, spectacle ludique et participatif (Espace 110 : 15.03).
Trois danseurs du CCN reprendront les Visites dansées d’Aurélie Gandit au Musée des Beaux-Arts de Mulhouse (21 & 22.03).
Enfin en clôture festive et en entrée libre : Yellow Party du chorégraphe Mickaël Phelippeau avec un DJ set de Barbara Butch le 26 mars à partir de 21 h à La Filature.
the space between
Dan Flavin
Dédicaces en lumière
#EXPOSITION
Kunstmuseum Basel | Neubau du 02.03 au 18.08.2024
Commissaires : Josef Helfenstein, Olga Osadtschy
à paraître en mai : catalogue en allemand ou en anglais, 256 p., 49 CHF
du mardi au dimanche de 10h à 18h (20h le mercredi)

Dan Flavin (1933–1996) a une histoire intense et compliquée avec Bâle. En 1975, une double exposition portée par Carlo Huber, directeur de la Kunsthalle, et Franz Meyer, directeur du Kunstmuseum, permet à l’artiste américain d’exposer cinq installations dans le premier et, dans le second, de découvrir Urs Graf (1485–1529) et de créer pour le patio du Hauptbau untitled (in memory of Urs Graf). Mais cette proposition imaginée comme pérenne a mis des années à emporter l’adhésion de la commission artistique du musée.
Avec 58 travaux, cette grande exposition rétrospective privilégie ceux que Dan Flavin a dédicacés à des personnalités ou des causes. Faut-il voir dans ces adresses une stratégie narrative comme le suggère les commissaires ?
La cage d’escalier du Neubau – avant même d’entrer dans l’exposition – est révélateur du travail de Dan Flavin : sur le mur du palier du 2e étage en face des marches est accroché un agrandissement d’untitled (1961, 13 mots en lettrage manuscrit), mais surtout ce vaste espace baigne dans la lueur vert d’eau d’untitled (to you, Heiner, with admiration and affection, 1973) exposé sur la mezzanine. Le terme « situations » qu’utilise Dan Flavin pour évoquer ses pièces prend ici tout son sens. L’œuvre n’existe pas qu’en soi – comme une toile circonscrite par son cadre ou l’objet qu’a concrètement fabriqué l’artiste visible sur cette mezzanine (salle 5) –, mais génère une entité immatérielle bien plus large qui contamine même le spectateur devenu partie prenante de l’œuvre.

Critiques ou collègues évoquent souvent le minimalisme, celui-ci renvoie au corpus limité produit industriellement que Flavin utilise : quatre tailles de tubes fluorescents (61, 122, 183 ou 244 cm, des anneaux à partir de 1972) disponibles en six couleurs (les primaires, rouge bleu jaune, plus les vert, rose, ultraviolet) et quatre tons de blancs. Ce choix implique une forme de radicalité, mais comme quand Matisse applique la peinture brute telle qu’elle sort du tube.
Si Flavin utilise des lampes fluorescentes standards, il agence le nombre, les couleurs, l’orientation, les rythmes, la perception directe ou indirecte de la source lumineuse inventant une infinie variété de possibilités qui chacune créera une « image gazeuse » au chromatisme généreux et en interaction avec l’espace d’accrochage qu’elle fécondera. Comme Don Judd, il était extrêmement attentif à l’installation de ses œuvres. D’ailleurs la scénographie bâloise a proscrit tout éclairage additionnel et les cartels sont remplacés par un livret de salles.
Quelquefois Flavin assemble une petite série : untitled (to a man, George McGovern) 2, (1972, salle 4) ou untitled (to my dear bitch, Airily) 2 (1985, AC).
Si la lumière est aussi impalpable qu’invasive, elle sait être péremptoire et créer des barrières qui segmentent l’espace (untitled, 1964, salle 2 ou untitled, 1973, salle 5).
Et l’apposition de situations à distance comme untitled (to Barnett Newman) one & four (1971, salle 8) ou untitled (for John Heartfield) (1990, 7 pièces salle 9) produit un jeu entre l’éblouissement tranchant des lampes et l’ombre luminescente qui hante le between.
De prime abord, l’élément de base démultiplié évoque l’usage fonctionnel dans les parkings ou les usines, cependant l’élaboration colorée et formelle d’objets individualisés renvoie à une utilisation plus esthétique voire festive comme pour des vitrines ou des boîtes de nuit. Mais l’artiste sait toujours forger une puissance évocatrice comme avec le rouge strident de l’anguleux monument 4 for those who have been killed in ambush (to P. K. who reminded me about death), 1966, salle 3) contre la guerre du Vietnam.
Par sa pratique, Dan Flavin conforte une méfiance vis-à-vis du statut d’artiste et du vocabulaire du milieu : J’ai heureusement échappé à toute formation professionnelle biaisée dans les écoles d’art. J’ai créé ma propre « éducation » artistique, à tâtons. […] j’étais incapable de croire en la peinture comme une fin en soi, suffisante et pratique. (1989)
La salle 7 se permet un clin d’œil à l’exposition de 1975 avec des dessins d’Urs Graf. Elle présente aussi un ensemble de croquis et de notes permettant de voir les logiques d’élaborations des pièces ainsi que ses admirations et ses connivences : Matisse, Apollinaire, Tatlin, Jaspers Johns, Don Judd… qui sont aussi des dédicataires. Ses adresses indiquent plutôt des parentés, des proximités d’idées (politiques, artistiques) ou des reconnaissances (amicales, professionnelles). Sa façon à lui d’affirmer l’ancrage de ses images gazeuses.
Gazeuses et insaisissables comme la vie…
discrétion assurée
Femmes de génie
Les artistes et leur entourage
#EXPOSITION
Kunstmuseum Basel | Hauptbau du 02.03 au 30.06.2024
Commissaires : Bodo Brinkmann, Katrin Dyballa, Ariane Mensger
catalogue en allemand, 288 p., 48 CHF
du mardi au dimanche de 10h à 18h (20h le mercredi)
entrée libre dans les collections en semaine à partir de 17h (sauf jours fériés)

Ouvert dans le Hauptbau en même temps que l’exposition consacrée à Dan Flavin, Genialen Frauen est coproduit avec le Bucerius Kunst Forum de Hambourg (14.10.2023 – 28.01.2024).
Des Femmes pleines de génie (pour éviter toute ambiguïté conjugale) réunit dix-neuf artistes femmes et une centaine de toiles, certaines confrontées à celle de leur maître, leur père, leur mari… L’accrochage se concentre sur les monarchies d’Europe de l’ouest – de l’Italie à la mer du Nord – du XVIe siècle au début du XIXe.
Par la suite, avec le déclin de l’aristocratie et l’industrialisation, la donne change progressivement : le cadre est moins corseté et les artistes ne sont plus aussi dépendants des commandes.
Les plus connues, Artemisia Gentileschi et Élisabeth Vigée Le Brun sont bien sûr évoquées dans le catalogue, mais ne figurent pas sur les cimaises car le propos est de mettre en avant des artistes restées dans l’ombre de leurs pairs masculins. Le parcours est thématique, mais tend à remonter vers le nord et à avancer dans la chronologie comme si le froid et le temps canalisaient la fougue perceptible chez les Italiennes et ramenaient leurs consœurs à la raison : rester dans l’intimité du foyer en pratiquant le portrait et la nature morte.
À l’époque, accéder à l’autonomie, et plus encore à la reconnaissance, relevait pour une femme de la gageure : il était inimaginable voire formellement interdit aux femmes d’entrer dans une école, une académie ou une corporation. Celles qui arrivaient à s’imposer prolongeaient une tradition dynastique et se formaient dans l’atelier du père, du mari… Et certaines, comme Rachel Ruysch (1664–1750), parvenaient même à dépasser leur mentor en réputation. Mais des flous subsistent souvent, car leur part dans la production des ateliers n’est pas forcément bien identifiée.
Des autoportraits témoignent d’ailleurs de leur engagement dans les activités artistiques et les montrent au luth, au clavecin avec une partition (Sofonisba Anguissola, Marietta Robusti, Lavinia Fontana). Ce privilège des milieux favorisés permettait quelquefois à la fille d’un noble, d’un bourgeois aisé d’entamer une carrière de peintre (Sofonisba Anguissola, 1532–1625).
Mais régulièrement mariages et grossesses les renvoyaient vers leur statut de femme au foyer (Judith Leyster, 1609–1660)…
La plus connue présentée dans l’exposition est Marietta Robusti, dite la Tintoretta (vers 1554/55–1614). Très jeune, elle a assisté son père Jacopo Robusti, dit Tintoretto (1518/19–1594) à Venise avant de devenir elle-même une peintre à succès. Des études de têtes attestent qu’elle était une vraie force de proposition dans l’atelier.
Et les dessins de ces femmes sont souvent remarquables, ainsi les planches botaniques et entomologiques à la fois rigoureuses et pleines de fantaisie de Maria Sibylla Merian (1647–1717).
Cette maîtrise se retrouve dans les deux cabinets du 1er étage où s’affichent les travaux de trois graveuses : Diana Mantovana (vers 1547–1612), Magdalena de Passe (1600–1638) et Maria Katharina Prestel (1747–1794).
Si tous les genres sont représentés dans l’exposition, les sujets sont majoritairement des portraits et des natures mortes. Il était difficile pour une femme de décrocher des commandes plus ambitieuses : fresques, grands retables… Des genres plus côtés et aussi spectaculairement présents dans l’espace public. Ainsi il était facile pour les chroniqueurs, les historiens d’oublier ces femmes artistes dont les œuvres restaient pour la plupart dans l’espace privé, instinctivement ils étendaient vers la postérité l’ombre dans laquelle leur époque maintenait ces Genialen Frauen.
conjurer le rat race
Chœur des amants de Tiago Rodrigues
#THÉÂTRE
représentation du vendredi 16 février 2024 au Théâtre municipal / Comédie de Colmar

Tiago Rodrigues a créé la pièce, sa première, à Lisbonne en 2007. Elle interroge le couple. Treize ans plus tard, il la reprend, la réécrit. Le recul (et le confinement qui est mentionné ?) lui donne la profondeur du temps. Ce temps à deux. Confrontés au temps…
La Filature avait programmé sa dernière création l’an passé : Dans la mesure de l’impossible. Peu après, en juillet 2023, Tiago Rodrigues a pris la direction du Festival d’Avignon.
À l’opéra, il y a le duo : il permet d’organiser la parole en compréhension pour le spectateur malgré la superposition des voix. Au théâtre ce procédé est rare. Tiago Rodrigues s’est risqué à écrire toute une pièce avec deux voix qui se superposent : un homme (Grégoire Monsaingeon), une femme (Alma Palacios), un couple fusionnel (ils le disent), et au long cours.
Ce qu’ils (se) disent et en même temps : le quotidien, les petites tâches, des choses concrètes pour que la vie avance – à deux, à trois car il y a un enfant.
Ils sont debout face au public, côte à côte, comme en voiture. En voiture on est obligé d’aller au même endroit…
Leurs mots sont presque les mêmes. Presque : les pronoms changent (je, tu) mais cela accrédite l’accord. Les choses déraillent quand le souvenir déraille : sur la gauche. Non ! sur la droite. Là ils se regardent : se remettent en accord par les yeux. Et domestiquent les mots.
Au début, ils sont effectivement en voiture. Ils vont à l’hôpital. En urgence, en affolement : elle est victime d’un accident respiratoire grave.
Le temps, donc la mort se pose sur leur couple.
Puis s’envole mais ouvre ce possible et interpelle sur l’usage du temps.
Et ce mantra ressassé : On a le temps…
On a le temps ! leur façon de conjurer sa fuite. Par les mots…
Qui se taisent. Un temps. Un petit temps après la grande peur. La densité des retrouvailles. Ce moment de grâce : le tea time. Avec le silence !
Mais les mots reviennent. Avec les enjeux. Derrière les petites choses, il y avait, il y a à nouveau la vie. La vie telle qu’on nous la fait avec ses obligations, ses règles, et ces enjeux qu’on nous dit tous les jours : quoi penser, quoi faire !
Alors ils rêvent de jardin, puis de forêt pour gagner le silence. Et prendre le temps !
Mais la forêt n’est pas silencieuse. La vie n’est pas silencieuse.
On a le temps… On a surtout les mots !
Mais peut-être que les mots ne retiennent pas la vie…
On peut résumer une vie, la raconter plus rapidement que ce qu’elle n’a duré, mais on ne peut pas résumer l’amour.
avec Grégoire Monsaingeon & Alma Palacios
scénographie Magda Bizarro & Tiago Rodrigues
lumière Manuel Abrantes
costumes Magda Bizarro
lieto barocco :
la possibilité du miracle
Polifemo de Porpora
#OPÉRA
représentation du dimanche 11 février à l’Opéra national du Rhin (Strasbourg)

Créé en février 1735 au King’s Theatre de Londres, ce drama per musica a été spécifiquement écrit pour réunir les stars de l’époque, les castrati Farinelli (Aci) et Senesino (Ulisse), la Cuzzoni (Galatea), la Bertolli (Calipso) et la basse Antonio Montagnana (Polifemo).
Si la cohérence du livret est fragile, la musique de Porpora se hisse à des sommets proches de son rival, Haendel.
Pour la création française presque trois siècles plus tard, l’Opéra national du Rhin a fait appel à une distribution de très haut vol emmenée par Emmanuelle Haïm.
Le librettiste Paolo Rolli s’abreuve surtout à deux sources : Ovide pour les amours d’Acis et Galathée contrariés par Polyphème et deux épisodes distincts de l’Odyssée pour les démêlés du cyclope avec Ulysse et l’idylle de ce dernier avec Calypso. Le metteur en scène Bruno Ravella résout ces diffractions par la mise en abîme : lors du tournage d’un péplum à Cinecittà, l’actrice jouant la nymphe s’éprend d’un décorateur provoquant la jalousie du comédien qui interprète Polifemo. Celui-ci, comme dans le livret, fait le lien entre les deux histoires, la réelle et la fictive (les aventures cinématographiques d’Ulysse). Au passage, les conditions de peintre et de star transposent joliment le statut de mortel et de divinité.
Le Concert d’Astrée et sa cheffe enthousiasment d’emblée. Emmanuelle Haïm, en affût permanent vers ses instrumentistes et le plateau, est d’une prodigieuse et communicative énergie et toujours d’une fascinante précision. Sa fougue détaille les couleurs d’une instrumentation chatoyante, la pulsation des nombreux récitatifs accompagnés (14 !) qui tendent la dramaturgie et tirent vers la modernité du durchcomponiert (avec même quelquefois un parfum déjà mozartien), et embrase les envolées élégiaques qui s’épanouissent en moments de pure poésie !
Le rideau s’ouvre sur un plateau quasi nu avec seulement deux tours d’éclairage. Les machinistes, la script s’affairent. Les comédiens (cinq des chanteurs) arrivent, échangent, commentent le scénario. Ils restent prudents – l’ouvrage est long (3 h), exigeant pour les voix – et se rapprochent de l’avant-scène : dans cette black box, le son s’évapore facilement vers les cintres.
L’allant des bois, des cors qui donne un rafraîchissant esprit de pastorale avec ses promesses d’amour, est un peu en décalage avec l’image technique et sombre de la scène, mais le duetto Galatea Calipso (n° 4b) permet déjà de goûter le beau mariage entre le timbre clair et charnu de Madison Nonoa et celui vibrant et cuivré de Delphine Galou.
La basse nette et sonore avec un joli « creux » de José Coca Loza (Polifemo), agile et précis dans les vocalises, compose un personnage vaniteux et irascible, très insistant envers sa partenaire. Mais le rôle est ingrat : amoureux éconduit, moins bien servi par la partition (en nombre d’airs) et chantant des coulisses quand son personnage sur scène est une machine.
Paul-Antoine Bénos-Djian (Ulisse) en blouson de cuir roule des mécaniques, manifestement il a fait un détour par le passegiato. En vedette du film, le contralto déroule, un brin bravache, son Core avvezzo al furore (n° 11), et sait ourler de tons diaprés son timbre d’un métal sec mais pur.
Les peintres rapprochent leur grande échelle de la fosse, Aci, vêtements de travail tachés, y grimpe. Au centre du cadre de scène, la projection est idéale, amplifiée par le cyclorama qui est descendu : un paysage mystérieux entre Turner et Böcklin.
En primo uomo, Franco Fagioli exprime son amour inquiet, frémissant (n° 12 & 13) et avec une ardente et jubilatoire facilité enlumine les da capo, vocalisant avec autant de netteté que de virtuosité : une apesanteur incarnée qu’écoutent au-delà du public, la cheffe et tous les musiciens.
Cette générosité contagieuse libère ses collègues d’autant que les éléments de décor rendent dès lors le dispositif plus favorable acoustiquement.
Ses fresche aurette offrent une belle transition vers le tournage.
Une grosse panavision remplace l’échelle et filme le péplum volontiers parodique : le costume d’Ulisse est une musculature en carreau de chocolat et les nymphes des Tahitiennes de music-hall (air tendu et difficile de Nerea, n° 14, mené avec maestria par Alysia Hanshaw de l’Opéra Studio).
Au fil du spectacle, la caméra et le perchiste disparaissent, ne restent que les tours d’éclairages. Cette affirmation du factice qui joue le factice légitime l’invraisemblable, le rend parfois drôle : un charmant troupeau de moutons sur roulettes, des effets spéciaux à la Ed Wood (un machiniste actionne à vue le bras du cyclope).
La production joue habilement des changements d’échelle passant de marionnettes affrontant le géant debout sur l’Etna à Ulisse planté triomphant sur la gigantesque tête du cyclope. Entretemps elle s’attarde sans accrocs à l’intimité du couple Aci & Galatea : niché dans la charpente du décor, leur duetto (n° 43) est un pur moment de grâce !
Au fil du spectacle, Franco Fagioli semble monter en enthousiasme. Régulièrement il esquisse quelques pas de danse, il gère avec aisance son instrument sur la longueur (la fatigue n’affecte jamais le haut de la tessiture) et déploie avec tact et délicatesse d’enivrantes vocalises comme lors de cet aérien dialogue en écho avec le hautbois de Jean-Marc Philippe (Lusingato dalla speme, n° 32). L’ampleur de son ambitus (3 octaves) est plus sensible dans l’Alto Giovo du III (n° 59). Une incarnation superlative, presque surnaturelle !
Si Madison Nonoa est moins prolixe dans les cadenze – elle fréquente aussi un autre répertoire –, elle dessine une Galatea pleine d’assurance à la projection claire, lumineuse avec d’admirables cantabiles : sa déploration d’Aci est particulièrement émouvante (nos 47 & 48).
Le rocher qui terrasse Aci est un projecteur tombé des cintres à l’instigation de la basse que la guardia civile viendra arrêter lors du Lieto fine.
L’entame de ce dernier – un terzetto bientôt amplifié en coro par les trois autres voix – ravive le bel appariement des timbres en guise, espérons-le, d’au revoir !
D’autres bijoux figurent certainement parmi les presque quarante opéras qu’a composés le Napolitain.
Franco Fagioli, Aci
Madison Nonoa, Galatea
Paul-Antoine Bénos-Djian, Ulisse
José Coca Loza, Polifemo
Delphine Galou, Calipso
Alysia Hanshaw, Nerea
décors et costumes Annemarie Woods
lumières D.M. Wood
tempo fuggit
Strasbourg 1560-1600. Le renouveau des arts
#EXPOSITION
Strasbourg, Musée de l’Œuvre Notre-Dame du 2 février au 19 mai 2024
commissariat : Cécile Dupeux, conservatrice en chef du Musée de l’Œuvre Notre-Dame
catalogue dense et documenté, 276 p., 45 €
3 place du Château – 67000 Strasbourg | tél. : +33 (0)3 68 98 50 00
tous les jours sauf lundi de 10 à 13 h et de 14 à 18 h (en continu les samedis et dimanches)

(détrempe sur toile, 64 x 173 cm, Musées de la Ville de Strasbourg)
Les expositions du Musée de l’Œuvre-Notre-Dame documentent régulièrement le foisonnement artistique de la ville. « Strasbourg 1560-1600. Le renouveau des arts » revendique cette continuité après « Strasbourg 1200-1230. La révolution gothique » et « Strasbourg 1400, Un foyer d’art dans l’Europe gothique », voire « Regards sur Hans Baldung Grien » en 2019 où les gravures du peintre bénéficiaient d’une belle et large mise en contexte. Deux personnalités de l’époque Tobias Stimmer (1539–1584) et Wendel Dietterlin (1551–1599) tissent le fil conducteur de cette dernière saison de la Renaissance rhénane.
En 1529, la messe catholique est supprimée dans toutes les églises de Strasbourg (vote des échevins du 20.02) et les premiers réformateurs strasbourgeois, influencés par le Zurichois Ulrich Zwingli, proscrivent les « images » dans les lieux de cultes. La production artistique marque le pas et les artistes se tournent vers un artisanat voisin (l’orfèvrerie notamment).
Mais progressivement l’Église strasbourgeoise se rapproche (pour des raisons plus politiques que religieuses) des conceptions luthériennes moins strictes et la demande renaît dans le cadre privé, puis s’invite à nouveau dans l’espace public (après la signature de l’intérim d’Augsbourg en 1548, les catholiques peuvent à nouveau célébrer la messe à la cathédrale).
La mise à jour et la restauration des projets de Tobias Stimmer pour le buffet de l’horloge astronomique de la cathédrale (vers 1571) – présentés ici pour la première fois au public (salle 4) – ont été le catalyseur de la proposition.
Sur ces dix grands formats en grisaille, le blanc lumineux valorise les carnations et les musculatures, l’inventive fantaisie du décor que ce soient les animaux (paons, dindes, cerfs, fauves, hippogriffes, etc.) ou les chars qu’ils tractent, tous semblent en fougueuse parade dans les nuées suggérées par quelques lignes enlevées. Chaque divinité symbolise un des jours de la semaine et les signes du zodiaque enjolivent les roues.
Dans la salle voisine, figurent ses projets pour les quatre âges de la vie également à la détrempe sur toile avec en regard les sculptures en bois polychrome réalisées d’après ses modèles.
L’énergique élan avec une luxuriance dans le trait et les détails où la présence d’un crâne ou d’un tibia sait suggérer avec délicatesse l’ombre de la mort est au service de la chevauchée du temps et emblématique du maniérisme ornemental dans les pays germaniques.
Tobias Stimmer bénéficiait d’une belle réputation dans sa Suisse natale, quand il est recruté pour réaliser ce décor. Il s’implante durablement dans ce foyer intellectuel et universitaire avec la Haute École (l’actuel Gymnase Jean Sturm fondé en 1538) qu’est Strasbourg et participe activement à son effervescence éditoriale. Ses très nombreuses gravures illustrent les publications des maisons d’édition de Bernard Jobin et de la famille Rihel (près de trois cent titres chacune). Une trentaine d’entre eux sont exposés, écrits par des auteurs comme Fischart (pamphlets et adaptation allemande de Rabelais), l’historien Sleidan, le mathématicien Dasypodius (concepteur de l’horloge), Specklin (architecte des fortifications de la ville) ou Wendel Dietterlin.
Ce dernier publie l’Architectura en 1593 qui sera révisé et réédité régulièrement jusqu’à la fin du XVIIe siècle. Son traité témoigne d’un goût beaucoup plus effusif avec la tentation d’une surenchère baroque. Il reflète l’intense activité de Dietterlin comme décorateur de plus en plus sollicité par les bourgeois nombreux à vouloir embellir de peintures murales leur cité qui compte alors 26 000 habitants. Si beaucoup de ses réalisations ont disparu lors de la grande percée (1910–1960), le parcours offre une belle place aux documents graphiques qui témoignent d’une nouvelle conception de l’espace urbain.
La salle des administrateurs récemment restaurée permet de se faire une idée du cadre de vie de l’époque avec ses admirables boiseries qui inventent des motifs voire des illusions de personnages ou d’animaux en jouant avec le veinage.
De même l’escalier à vis de la cour et l’aile ouest du musée avec au rez-de-chaussée sa salle de la Loge (Sommerhaus, accessible en attendant sa rénovation) datent du XVIe siècle.
Le catalogue édité sous la direction de Cécile Dupeux et Jean-David Huhardeaux Touchais est dense, abondamment documenté et illustré (276 p., 45 €).
L’exposition est l’occasion de rééditer un fac-similé de l’Architectura de Wendel Dietterlin (64 p., 20 €), ainsi qu’une édition famille d’un livre de modèles de 1538, le Kunstbüchlein d’Heinrich Vogtherr, (74 p., 15 €) : Petit livre d’art étrange et merveilleux. Modèles d’hier pour aujourd’hui, à la fois document, mais aussi possible livre de coloriage pour les plus jeunes.
éloge de la complexité
Jeff Wall à Beyeler
#EXPOSITION
Riehen (Bâle), Fondation Beyeler du 28 janvier au 21 avril 2024
commissariat : Sam Keller, directeur de la Fondation Beyeler, & Martin Schwander
beau catalogue en anglais ou en allemand, 208 p., 58 €

Diapositive dans caisson lumineux, 226 x 360,8 cm / Courtesy of the artist © Jeff Wall
Avec cette rétrospective Jeff Wall, c’est seulement la deuxième monographie que la Fondation Beyeler consacre à un photographe, un artiste absent des cimaises de la région depuis presque vingt ans (Schaulager Basel, 2005).
Avec 55 œuvres dans onze salles, des pièces plus anciennes, parfois emblématiques et connus, sont accrochées en regard de toiles (il revendique le mot) des deux dernières décennies, certaines étant montrées pour la première fois.
Présent à Riehen, l’artiste a activement participé à l’élaboration de l’exposition et du catalogue.
La première salle impressionne : de grands formats rétroéclairés donnent le sentiment d’être au dernier étage d’un immeuble dont les vastes baies ouvrent sur Vancouver. Une entrée majestueuse dans le monde du photographe canadien dont l’une des caractéristiques est l’ampleur autant dans la restitution de l’espace que dans ses compositions élaborées souvent comme les peintures d’histoire au XIXe siècle (lui-même évoque l’inspiration de La mort de Sardanapale (Delacroix) pour son premier projet : The Destroyed Room, 1978). Ses admirations sont perceptibles et assumées : Manet (poses très ostensibles des Summer Afternoons, 2013), Hokusai (A Sudden Gust of Wind (after Hokusai), 1993) ou la sophistication des vêtements et du clair-obscur hollandais (After ‘Spring Snow’ by Yukio Mishima, chapter 34, 2002). L’articulation des lignes directrices dans le cadre lui permet de préserver cette profondeur dans les œuvres plus intimes (Diagonal Composition, 1993).
Sa démarche est connue : un long travail préparatoire (qui n’est pas sans rappeler Hopper qui scénarisait ses toiles avant de peindre) avec mise en scène, souvent en studio, et postproduction (il utilise le digital depuis 1993). Pourtant Wall affirme avec netteté la dimension documentaire de ses créations. L’hyperréalisme inhérent au médium n’est qu’un ingrédient. Ses photos « cinématographiques » élaborent un subtil jeu de contrastes, d’affrontements qui restituent le monde dans sa cruauté.
Ainsi dans In front of a night-club (2006), le vendeur de fleurs est noyé dans la jeunesse, l’énergie et l’aisance des fêtards. Leur indifférence (presque tous lui tournent le dos) renforce la brutalité de sa condition de laissé-pour-compte. Même le spectateur peut devenir complice s’il ne prend pas ce temps du regard qui ouvre à l’empathie. L’hyperréalisme photographique renforce précisément les oppositions entre l’ancien des colonnes aux chapiteaux pseudo-ioniens et le prix des pizzas sommairement griffonné, l’effort vestimentaire du quinquagénaire – je m’habille pour le client – et le clinquant tourné vers l’affirmation du soi des jeunes. Pour autant personne ne rayonne de bonheur, les mines sont tristes, la cigarette semble une addiction nécessaire et le geste d’offrir des fleurs appartenir au passé… Un monde ou plutôt une cohabitation passive de mondes qui ne partagent plus grand-chose, où les individus sont dépositaires d’un corps à socialiser dans un domaine public où ça tangue et diffracte sous les injonctions contradictoires (travail vs loisirs, production vs consommation…).
La proposition peut être plus énergique comme dans Actor in two roles (2020) : quatre adolescentes en bataille, tout en os et avec l’agressivité du rose fluo, fusillent du regard la féminité de quatre jeunes femmes fleurs dont les poses valorisent l’arrondi des hanches (mais sans outrancière sexualisation). Une affirmation revendicative s’impose à un instinct plus diffus, mais toutes sont tributaires d’enjeux prescrits que semble attester leur seul point commun : les lunettes. Pour corriger une myopie sur le monde ou aiguiser un regard partisan ?
S’il pointe la diffraction, il suggère aussi l’assimilation par des similitudes de motifs, comme si l’environnement phagocytait ses usagers : le peignoir et le tapis (Staircase & two rooms, 2014) ou la robe et les poufs (A woman with necklace, 2021).
Il sait aussi être poétique (quoique la mort rôde) dans The Flooded Grave (2000) où la tombe remplie d’eau abrite un luxuriant écosystème marin. L’hyperréalisme devient discrètement surréaliste et le spectateur peut s’amuser à découvrir toutes les créatures qui l’ont colonisé comme un aquarium.
Ce jeu avec le rire et le morbide se retrouve dans Dead Troops Talk (1992) ou Dressing poultry (2007).
Ou il invente un délire spatial presque cosmique avec la paperasse emportée par le vent (A Sudden Gust of Wind).
La pathologie moderne de l’esprit est dans l’hyper-simplification qui rend aveugle à la complexité du réel. (Edgar Morin / Introduction à la pensée complexe, 1990)
Jeff Wall réinvente en somptueuses images la pensée complexe à l’opposé du manichéisme mainstream et suggère que ce dernier est d’autant plus brutal que rien n’est aussi tranché qu’il l’affirme car les choses s’imposent de façon sournoise, discrète, mais impitoyable.
l’abstraction en jubilation baroque
art KARLSRUHE 2024
#SALON
art KARLSRUHE 2024 du 22 au 25 février2024
Messe Karlsruhe | Messeallee 1, D-76287 Rheinstetten
L’édition 2024 de la foire d’art contemporain, la première de la nouvelle direction composée d’Olga Blaß, historienne de l’art, et Kristian Jarmuschek, galeriste et président de la Fédération des galeristes et marchands d’art allemands, retrouve ses dates traditionnelles : fin février.
Le format est plus concentré, 177 galeries (au lieu de 220) originaires de treize pays exposeront dans quatre halls. L’espace dédié à la sculpture est étendu et un nouveau dispositif « re:discover » permet de (re)découvrir vingt artistes injustement négligés par le marché de l’art.
Parmi les galeries présentes cette année, majoritairement allemandes, Radial, implanté à Strasbourg, est l’une des rares à représenter la région.
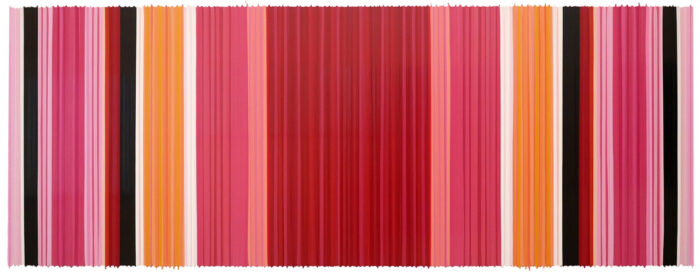
Portrait du galeriste, Frédéric Croizer, avec sa proposition, son projet et ses mots.
galerie Radial
__ le stand
Cette année, j’avais envie de revenir avec des propositions que les gens n’avaient pas encore vues. C’est un exercice assez délicat. Il y a des artistes que j’ai bien installés en Allemagne et donc je suis attendu avec ces artistes et, en même temps, je considère qu’il faut aussi bousculer un peu les règles et prendre le risque de consacrer quelques mètres carrés à un artiste que les gens vont découvrir et on ne sait pas si l’acceptation de l’artiste va être immédiate ou si ça va prendre du temps.
Mon stand (Hall 1 C24) sera consacré à un solo show de Frank Fischer. C’est un artiste suisse assez international.
Il y aura aussi deux découvertes.
Marc Van Cauwenbergh, un artiste américain d’origine belge que j’ai rencontré à New York et qui a fait une série spécifiquement pour la galerie : New York City of Colours. Marc Van Cauwenbergh n’a jamais été montré en Allemagne. Ce sera vraiment une découverte pour le public allemand.
Et ensuite Robert Schad. Lui est connu en Allemagne, mais c’est la première fois que je montrerai ses sculptures sur mon stand. Dans l’esprit de découverte, j’ai décidé de renouer avec les sculptures monumentales : j’en exposerai une qu’on ne puisse pas louper et qui marque tout de suite une identité.
Après j’aurai une programmation avec le côté lyrique d’Alain Clément, les œuvres très minimalistes du suédois Lars Strandh et celles en papier d’un jeune artiste espagnol, Javier Léon Pérez.
__ le projet de la galerie
Les États-Unis ont été vraiment une expérience formatrice pour ce que je fais aujourd’hui. J’ai habité plusieurs fois à New York de 2003 à 2009, à Boston aussi.
Il se trouve que ma meilleure amie à New York était journaliste et représentante permanente pour art actuel [magazine consacré à l’art contemporain international créé en 1999]. Elle avait les portes ouvertes partout, avait fait les interviews des plus grands artistes du monde. Du coup, j’ai rencontré plein de gens, j’ai découvert comment les galeries fonctionnent, comment les institutions fonctionnent. On allait aussi énormément dans les maisons de vente aux enchères. Je voyais les coulisses du métier et la différence de travail entre une galerie privée, une institution, une maison de vente. Ce n’est pas les mêmes gens, les mêmes stratégies. J’ai aussi compris les liens, les ramifications qui existent, mais dont on n’a pas connaissance quand on est néophyte.
Et donc… cette idée a germé : de faire une galerie d’art. J’avais envie de faire quelque chose qui me plaît vraiment, dans laquelle je puisse me sentir à l’aise et de travailler avec des gens où les voyants étaient au vert humainement pour que l’aventure puisse durer. C’est un peu ça l’idée au départ.
En fait j’ai raisonné à l’inverse.
J’ai commencé à fantasmer sur les possibles et je me suis dit : je voudrais travailler avec untel, avec untel et je m’étais fait une short list. Le challenge c’était que ces artistes me disent : oui. Et c’était assez compliqué. J’avais majoritairement des artistes qui n’étaient pas français. Et comment convaincre quelqu’un qui tourne déjà bien de travailler avec quelqu’un qu’il ne connaît pas, en France et dont la galerie à Strasbourg n’existe pas encore…
Certains m’ont tout de suite dit oui parce qu’il y avait une affinité.
D’autres, il a fallu un petit peu œuvrer. Mais ils ont compris que mon projet était sérieux, que je connaissais leur travail et que je ne m’étais pas simplement fié à des photos. Le fait de parler anglais convenablement aussi a permis de débloquer des situations. Ils se sont dit : ce gars va nous défendre.
J’ai pris la décision définitive d’ouvrir la galerie à partir du moment où les artistes de ma short list m’ont dit qu’ils étaient d’accord pour travailler avec moi.
J’ai ouvert au mois d’octobre 2010.
__ les débuts
J’ai vraiment commencé de zéro. Mes premiers clients importants étaient des Suisses que je connaissais comme ça, mais je n’avais pas l’impression qu’ils avaient un goût pour l’art. Eux m’ont beaucoup aidé au départ et m’ont mis le pied à l’étrier. Après le bouche-à-oreille a fait son chemin.
__ les collectionneurs
Pour moi les vrais collectionneurs, c’est un peu un fantasme… et j’ai l’impression que ça existe toujours ! Il y a quand même des gens qui m’achètent des œuvres d’une façon régulière donc je ne sais pas si on peut les appeler des collectionneurs ? En principe oui.
Je pense que ce qui n’existe plus c’est un côté dynastique où, si on avait des aïeux collectionneurs d’art, par imprégnation on le devenait aussi. Là je pense que ça a un peu explosé.
Des gens plus jeunes commencent à arriver chez moi. Ils n’ont pas d’allergie à l’idée d’acquérir des œuvres d’art, simplement comme ce n’est pas leur environnement, ils vont avoir plus de réticences à franchir le pas. Et ils sont sur d’autres projets : le crédit de la maison, le travail, la carrière, les enfants à nourrir… Et c’est un travail d’aller les chercher
__ la ligne éditoriale
Je pense qu’il y a des forces, qu’il y a des vraies démarches artistiques dans chaque artiste avec lequel je travaille. Je n’ai pas l’impression que radical soit le bon terme alors que certains journalistes ou certains collectionneurs me le renvoient dès le début…
J’aurais pu fantasmer d’avoir une galerie qui ressemble à des galeries plus installées, d’avoir une programmation comme Denise René par exemple ou Lahumière ou La Ligne à Zurich, d’être dans ce côté ultra-spécialisé.
Mais moi ce qui m’intéresse, c’est aussi le côté humain qui est complètement subjectif et intuitif.
Par exemple j’ai vraiment eu envie de travailler avec Alain Clément. Je connais son travail depuis que je suis adolescent. Je savais qu’il était un peu en dehors du cadre de ce que je montre d’habitude, mais je me suis dit que cette galerie doit me ressembler et donc au bout d’un moment, il est légitime d’avoir des exceptions qui apparaissent. Si on veut développer une certaine radicalité, il ne faudrait pas succomber à des exceptions.
En même temps, j’ai l’impression que c’est ce que les gens attendent d’un galeriste, de choisir des artistes qu’il a envie de défendre. C’est l’inverse de la facilité.
__ les artistes
Le nombre d’artistes, c’est un truc prépondérant. On ne peut pas faire du bon travail pour plein de gens. Pour organiser des choses, essayer de faire en sorte qu’elles durent, il faut être concentré sur ce qu’on fait.
Alors oui… je veux prendre mon temps. Il y a la curiosité, après il y a le temps de la découverte et puis la décision : est-ce qu’on peut ajouter quelqu’un à son programme ? Si je commence une nouvelle collaboration, j’ai aussi envie que l’artiste ait sa singularité dans mon programme, que ce soit une proposition autonome parmi les autres et en même temps qui prenne sens.
Par exemple Robert Schad, je savais très bien ce qu’il faisait, j’avais déjà soulevé ses sculptures, donné des coups de main à un confrère pour les transporter. J’ai vu pendant des années la progression de son travail et du coup j’ai eu envie de travailler avec lui…
__ créer la confiance
Si on prend l’origine des choses, la Renaissance par exemple, les artistes répondaient à une commande, le donneur d’ordre était très précis et l’artiste devait s’y conformer avec le plus de brio possible.
On pourrait avoir des commanditaires qui voudraient avoir la main sur la création de l’œuvre – par exemple pour des questions de communication, de marketing si c‘est une entreprise. Mais maintenant le regard que les artistes ont sur leur œuvre est complètement différent.
Mon rôle est de créer la rencontre et la compréhension entre le client et l’artiste. Bien sûr on va discuter, il y a un objectif, il y a des contraintes spatiales pour la création d’une œuvre, et ça va être entendu de la part de l’artiste, mais au bout d’un moment il y a de la part de mon client un lâcher-prise et il accepte de donner libre cours à la créativité de l’artiste qui va créer une œuvre qui est 100 % son œuvre. Si on a un artiste qu’on aime, voire qu’on admire, si on commande une œuvre, on sera forcément content du résultat.
Moi j’interviens pour créer cette confiance.
C’est aussi la mission du galeriste de déclencher ce type d’opportunité : avoir des séries entières d’œuvres produites pour la galerie. C’est une sacrée marque de confiance de la part de l’artiste. C’est aussi une manière pour les collectionneurs de voir comment se passe la collaboration entre un artiste et une galerie.
Pour l’instant, il y a un projet qui est déjà réalisé avec la photographe Estelle Lagarde. Et là je travaille sur un projet avec l’artiste suisse Franck Fischer.
__ les galeries vs les institutions
J’observe que les artistes d’autres nationalités ont tous un parcours institutionnel aussi ! Tous mes artistes allemands par exemple sont dans de multiples musées. Et depuis pratiquement toujours.
En France, soit on a l’aura pour avoir des subsides de l’État ou alors on fait carrière avec des galeries. Mais faire les deux, c’est très compliqué, ou si ça se rejoint, c’est en fin de carrière si on a un bon parcours commercial. L’inverse par contre n’est jamais vrai, je crois.
Pour moi il y a quelque chose qui ne fonctionne pas dans cette idée. Si les artistes veulent avoir une activité qui soit pérenne, c’est bien le rôle des collectionneurs, des galeristes d’acquérir des œuvres d’artistes en cours de parcours.
Les artistes qui ont un parcours uniquement institutionnel se coupent complètement de la partie commerciale, ça semble être complètement antinomique. L’institution peut apporter un coup de projecteur sur un artiste, peut valoriser son parcours, sa reconnaissance, mais un musée ne va pas acheter des œuvres tous les ans à tout le monde.
La régularité de revenus c’est quand même les galeries qui peuvent l’apporter. Et il n’y a pas de différence de qualité a priori.
__ les perspectives
C’est un métier qui est extrêmement compliqué. On est sujet à un tas de variations. J’ai eu la chance de travailler avec des artistes qui ont tous fait un super beau parcours. Une part de mes clients du début clairement ne peut plus acheter les œuvres des mêmes artistes aujourd’hui. Il a fallu que j’aille chercher des clients qui soient capables de mettre un petit peu plus d’argent dans les artistes que je représente.
Mais l’acquisition d’œuvres d’Alain Clément ou d’Ewerdt Hilgemann ou d’un autre va être faite par rencontre avec l’œuvre, par passion, mais pas envisagée comme placement financier.
Je suis dans une niche où je m’adresse quasiment exclusivement à des passionnés.
On ne peut pas être uniquement factuel en disant : vous cherchez un tableau noir ? Tiens j’en ai un, il fait telle taille, il va sur le mur. Non !
C’est une profession qui a un côté irrationnel
Les gens viennent chercher quelque chose de précis et une fois qu’ils l’ont obtenu, la deuxième acquisition, elle est déjà quasiment sur les rails, au moins dans la tête. Parce qu’une fois qu’on a l’œuvre qui avait une destination spéciale, on a envie d’autre chose. C’est quand on ne se pose plus de questions, qu’on fait les meilleurs choix. À partir du moment où ils ont découvert un artiste et qu’ils aiment l’artiste, la question de l’œuvre en elle-même ne se pose presque plus.
De toute façon pour faire ce métier, il faut être optimiste.
le corps en jeu
Frisbee !
Sports et loisirs, Collection Würth
#EXPOSITION
Erstein, Musée Würth du 27 janvier au 15 septembre 2024
commissariat : Marie-France Bertrand, Estelle Zech
catalogue de belle tenue en allemand accompagné d’un livret avec la traduction en français (32 €)
entrée gratuite de 10h à 17h (18h le dimanche), fermé le lundi

Les JO 2024 offrent l’opportunité au musée d’évoquer grâce aux œuvres de la collection Würth le nouveau rapport à l’espace et au temps né de l’industrialisation : « sports, loisirs & jeux ».
L’article est paru en mars dans Novo n°72 (p. 30)
l’usage de la folie
Phèdre de Jean Racine
#THÉÂTRE
représentation du 27 janvier à la Comédie de Colmar

Après un classique contemporain très réussi : La nuit juste avant les forêts de Bernard-Marie Koltès (octobre 2021), Matthieu Cruciani s’empare de Phèdre de Jean Racine : un grand classique en alexandrins. Un théâtre indémodable plus de trois siècles après ? Son travail tend à le montrer !
La vie est un perpétuel chantier.
Le décor : une vaste salle dans un palais, en cours ou en attente de travaux. Un espace proche de l’épure avec quelques tissus gris qui protègent de la poussière, celle du temps aussi, avec sans doute un instinctif désir que les choses ne bougent pas, ne changent pas. Les personnages les retireront à l’occasion, en dévoileront les secrets : l’immuable fatum – le massacre du minotaure – ou les atavismes – une bouteille de whisky et quelques verres… et un grand miroir : celui des illusions.
Pour chaque acte, les personnages changent de costumes – contemporains – donnant du temps au temps : une discrète entorse à l’unité du théâtre classique.
Les thèmes de Carla Pallone s’invitent en bande-son, accentuent les moments de tensions comme si la musique appuyait là où ça fait mal…
L’œuvre s’ouvre avec Hippolyte (Maurin Ollès). Il confesse son amour pour Aricie et, dans ses aveux, il expose : les querelles dynastiques, celles des dieux, les destins à conquérir ou assignés, les tensions et malentendus qui en découlent, une transmission empesée par le rythme alexandrin. Comme peu après quand la jeune femme (Ambre Febvre) déterminée, énergique, mais avec une projection de voix fragile, le provoque avant d’accepter de fuir avec lui.
La vie surgit avec Phèdre : une femme en être, en émotions ! Elle subit le reste en serrant les dents. Une femme amoureuse : elle n’est que cela, à la folie, n’a aucune envie d’être autre chose. Pourtant elle bataille, se soumet à la loi, évacue son amour pour Hippolyte en fuyant sa présence. Mais ça déborde de partout. Tellement qu’elle veut mourir depuis des semaines ! Et si personne dans le palais n’en connaît la cause, cet effondrement se voit, se sait.
De bout en bout, Hélène Viviès porte ce destin, le vit – y survit – et le déroule avec une intense sincérité, par-delà l’alexandrin, telle une symphonie avec ses strettes et ses andantes, ses fortes et ses pianissimi, s’astreignant à un maestoso noble et fissuré face au mur des conventions. Face à Thésée.
Mais Thésée est annoncé mort.
Sa propre mort est suspendue quelques heures : les chaînes tombent, le volcan peut entrer en éruption !
Si la donne change, les enjeux restent. Fine et calculatrice, Œnone (Lina Alsayed) distille avec une lucidité clinique le nouveau périmètre des pouvoirs, détaille comment en tirer bénéfice, une stratège altière qui, dans sa gourmandise, arme la malédiction vers la fatale issue (y compris la sienne).
Car Phèdre n’est pas de cette eau-là. Elle bouillonne : Thésée mort, elle n’est plus adultère et l’inceste est formellement évacué.
Elle prend toute sa nouvelle liberté, sans calcul, et se livre. Et s’y fracasse !
Le retour de Thésée ne sera que le coup de grâce.
Son maître et sa meute – costard cravate noirs – reviennent prendre possession de ce qui lui appartient, envahissent l’espace depuis la salle et il réclame des comptes – comme le Hunding de Chéreau à Bayreuth (1976-1980) ou un chef mafieux de Coppola ou Scorsese avec ses portes flingues.
Droite, sédimentée par la volonté, Phèdre affronte son mari en statue dorée : ce lamé qui semble la tenir debout. Mais la trahit aussi avec la traîne qui s’en détache.
Thésée (Thomas Gonzalez), velléitaire et emporté – dans un accès de colère, il arrache les bâches plastiques vers la terrasse –, affirme son patriarcat mortifère, autoritaire sans pour autant s’embarrasser des conventions dont il se revendique le garant – il arpente le plateau en slip.
C’est dans sa robe à fleurs noires du début que Phèdre viendra mourir à ses pieds : les belles âmes n’appartiennent à personne.
Thésée restera seul, isolé dans l’absurdité d’un pouvoir immuable et assassin.
Les travaux produisent des ruines…
Actuel Racine avec ses alexandrins ?
Le récit tendu et habité de Théramène (Philippe Smith) nous submerge par sa sanguinaire folie : la mort d’Hippolyte, fruit de la malédiction et des calculs de son père avec la féroce complicité des dieux.
Cette monstruosité ne nous renvoie-t-elle pas à celle surgie à nos portes en Ukraine, à Gaza ?
Les divinités des anciens incarnent ces pulsions barbares tapies dans nos consciences et prêtes à nous contaminer.
Tant de mots les disent. Les mots sales comme les qualifiait Christian Bobin.
Et les grandes douleurs sont muettes comme l’extinction de Phèdre… qui ainsi échappe aux mots. Et leur folie !
avec Lina Alsayed (Œnone), Jade Emmanuel+ (Ismène & Panope),
Ambre Febvre (Aricie), Thomas Gonzalez (Thésée),
Maurin Ollès (Hippolyte), Philippe Smith (Théramène),
Hélène Viviès (Phèdre)
mise en scène Matthieu Cruciani
scénographie Nicolas Marie, lumière Kelig Le Bars
création musicale Carla Pallone
costumes Pauline Kieffer
+membre de la jeune troupe
en répétitions à la CdC
répétition du 11 janvier à la Comédie de Colmar
Pour nourrir cette complicité qu’il entretient avec son public depuis qu’il codirige la Comédie de Colmar, Matthieu Cruciani a ouvert une répétition de Phèdre et évoqué son travail sur la pièce avec les nombreux spectateurs présents.
Début du cinquième acte à quinze jours de la première.
Tu frémiras d’horreur si je romps le silence.
Les mots de Phèdre (I, 3).
Pourtant d’Euripide à Racine en passant par Sénèque et tant d’autres tombés dans l’oubli des encyclopédies, beaucoup de mots ont été mis dans la bouche de la fille de Minos. Même la Phèdre et Hippolyte (titre originel) de Racine s’est retrouvée dès le surlendemain de sa création (1.01.1677) en concurrence avec celle de Nicolas Pradon créée sur une scène voisine.
Pourtant la monstruosité est omniprésente, dans les mots – 18 occurrences de monstre –, et le metteur en scène relève que personne ne veut jouer cette pièce : dans les dix premières minutes tous les personnages annoncent qu’ils vont partir !
Aussi l’espace sera en friche : une pièce encore en travaux que s’est appropriée Hippolyte dans un palais secondaire avec vue sur la mer, un matelas contre un mur, des chaises en plastique comme dans une salle d’attente et des personnages en transit – une cravate défaite, un bagage, un peignoir…
Le théâtre classique a ses règles d’unité, de bienséance. Matthieu Cruciani se permet certaines libertés et souhaite insuffler une dynamique cinéma : l’espace évolue au fil des actes, bande son de Carla Pallone. Et il insiste sur la jeunesse de Phèdre, une certaine marginalité d’Hippolyte.
Et toujours les mots : le lexique de Phèdre, c’est 3 000 mots, moins que le vocabulaire d’un élève du cours élémentaire. Une économie de la tragédie que Rameau avait bien compris notamment avec la mort de Phèdre* : Quelle plainte en ces lieux m’appelle ? Pas de da capo, pas de vocalises : le texte avant tout, le thrène des chœurs écrin du texte magnifié jusqu’à l’extinction, la beauté de la ligne lui ouvrant l’éternité du silence…
Le soir de la répétition Phèdre (Hélène Viviès) n’avait pas de mots : Matthieu a arrêté la répétition avant sa scène finale (ne pas spoiler ?). Le public les découvrira à partir du 25 janvier.
* Hippolyte et Aricie (1733), livret de l’abbé Simon-Joseph Pellegrin, inspiré en partie de la Phèdre de Racine
Papierkram
L’araignée de Charlotte Lagrange
#THÉÂTRE
représentation du vendredi 19 janvier 2024 à l’Espace 110 (Illzach)
encore 6 autres dates jusqu’au 7/06/2024

Installée à Strasbourg depuis 2013, la compagnie La Chair du Monde interroge le politique par le biais de l’intime « en postulant que l’intime est toujours déjà politique ». La pièce créée en mars 2020 est éditée chez Théâtre Ouvert.
En amont, Charlotte Lagrange a rencontré lors d’une résidence d’écriture à Montbéliard des éducateurs, des avocats, des juristes, des attachés parlementaires, des référents administratifs de l’ASE (Aide Sociale à l’Enfance). Tous refusaient d’être enregistrés, tous dénonçaient « un système dysfonctionnel » rendant impossible l’accueil décent des MNA (Mineurs Non Accompagnés)…
Du théâtre documenté sans être documentaire.
Elle n’a pas de nom, seulement sa conscience de femme, de mère avec ses ressentis, ses émotions (le mensonge la révolte) et une empathie instinctive. Pourtant il ne faudrait pas, tout le monde le lui dit, ses collègues, son mari : ce n’est que du travail. Car elle peine à trouver l’équilibre entre l’humanité – d’une nécessaire évidence face à ces jeunes êtres bien réels qui montent tant bien que mal leurs dossiers – et sa mission de fonctionnaire intraitable chargée de faire appliquer les règles. Le système est dysfonctionnel : il est au croisement des gesticulations politiques empêtrées dans l’urgence du temps médiatique et le dur de la bureaucratie qui avance à la vitesse géologique et dont elle est une des petites mains.
Pourtant elle a changé de bureau : elle ne s’occupe plus des MNA. Mais ça la travaille ! Encore, toujours !
Vous enregistrez ? Est-ce que vous enregistrez là ? Parce que moi je ne veux pas.
Si ça ne vous dérange pas, je ne préfère pas. Sinon je ne parle pas…
Un malaise obsessionnel ! Comment rester humaine face à cette logique hygiéniste qui contamine sans qu’on n’y prenne garde, pousse à la brutalité sous couvert de bonne volonté : ces coups de dossier assénés par son N+1 ou ces marrons apportés pas sa N+2 contre l’araignée qui a élu domicile dans son bureau… Elle l’a appelée Renée (allusion à renaître) et l’observe fascinée et défiante : une figure d’altérité – je reste humaine – et l’incarnation de la toile nasse qu’elle tisse…
Comme l’écrit Nuruddin Farah (Dons, 1986) : « Il est dans la nature de la bureaucratie de se perpétuer elle-même ». D’ailleurs elle met en place son propre monde avec sa propre langue infestée par tous ces acronymes balisant le labyrinthe vers la régularisation : une oralité bureaucratique où se mélangent les mots étranges de l’administration et les mots étrangers en bambara ou en soninké appris de ces interlocuteurs. Une religion du Papierkram qui fait plus rimer bureaucratie avec théocratie qu’avec démocratie. Ce Sprachekram emporte Marushka Jury dans un ballet phonétique où elle disperse par généreuse poignée les dossiers empilés autour d’elle. Et elle danse, joyeuse, délirante, sous ce caisson de néons qui surplombe le plateau-bureau devenu aquarium. Bientôt il pleure et trempe l’interprète et sa paperasse d’une eau lustrale : un lâcher-prise où elle constate qu’il est « de plus en plus difficile de changer les choses de l’intérieur. » Et que, malgré la bonne volonté, « Chacun entrait quelque part en « collaboration » avec un système qu’il dénonçait. »
Restent ces jeunes, ces Êtres, ces enfants qu’a si bien saisis Peter Handke et que dit sur son smartphone la voix de Bruno Ganz : le Lied vom Kindsein* qu’elle traduit à la volée.
Avant de proférer cette litanie de prénoms. De destins !
* Chant de l’Être Enfant, le sein allemand suggérant une dimension ontologique, qui ouvre Les Ailes du Désir de Wim Wenders (Der Himmel über Berlin, 1987).
Le mot allemand Papierkram est un équivalent péjoratif de paperasserie. Sprache, c’est la langue.
avec Marushka Jury
texte et mise en scène Charlotte Lagrange
scénographie Camille Riquier, lumières Kevin Briard
création sonore Mélanie Péclat