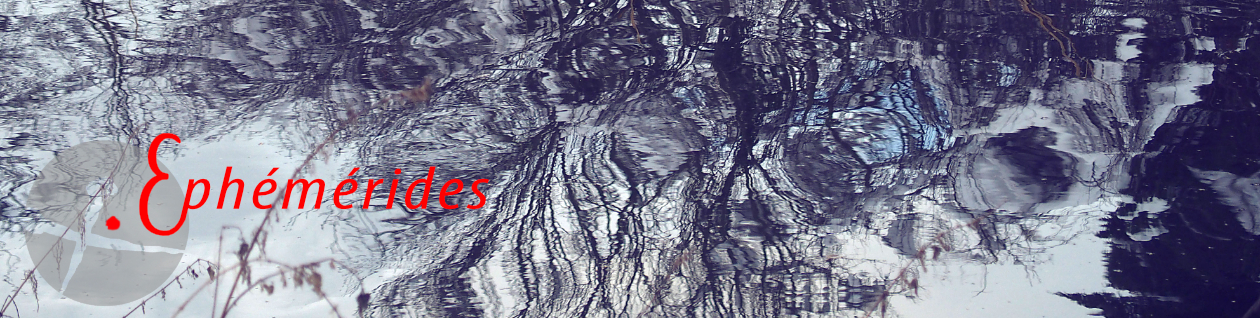un regard et des choix – forcément subjectifs – sur l’offre culturelle 2024…
#LIVRES : La mémoire des murs (F. Saur/L. Maechel), La société de l’expérience. Le consumérisme réinventé (Steven Miles)
#EXPOSITIONS : Mitsuo Shiraishi « Ailleurs » (Galerie Courant d’Art, Mulhouse), When We See Us (Kunstmuseum Basel | Gegenwart)
__
Kunstmuseum Basel : Dan Flavin Dédicaces en lumière / Femmes de génie / Made in Japan, Estampes d’Hiroshige, Kunisada & Hokusai
Fondation Beyeler : Jeff Wall / Exposition d’été
Art | Basel 2024 (Messe Basel), Couleur, Gloire et Beauté (Musée Unterlinden, Colmar), Frédéric Croizer, galeriste (art KARLSRUHE 2024), Made in Germany (Musée des Beaux-Arts et d’Archéologie, Besançon) & Maîtres et merveilles (Musée des Beaux-Arts, Dijon), Frisbee ! (Musée Würth Erstein), Strasbourg 1560-1600. Le renouveau des arts (Musée de l’Œuvre Notre-Dame, Strasbourg), Raymond-Émile Waydelich
#THÉÂTRE & MUSIQUE : Une exposition (Cie Quai n°7 – Juliette Steiner), Le Conte d’hiver (Shakespeare/J. Delille), Jean Rondeau (Louis Couperin, Unterlinden), les 400 ans du clavecin Ruckers (Unterlinden), Après la répétition + Persona (Bergman/I. van Hove), On achève bien les chevaux (B. Bouché, C. Hervieu-Léger, D. San Pedro), Chœur des amants (T. Rodrigues), Polifemo (Porpora/Haim, Ravella), Phèdre (Racine/Cruciani), L’araignée (Lagrange)
@SAISONS 2024-25 : Opéra national du Rhin • La Filature (Mulhouse) • Comédie de Colmar • Espace 110 (Illzach)
@avant-papier sur présentation de presse et documents remis
Sur la page d’accueil, des informations actualisées sur les évènements encore accessibles.
εphεmεrides 2023 • 2022 • 2021 • 2020 • 2019 • 2018
le silence d’après…
Mitsuo Shiraishi « Ailleurs »
#EXPOSITION
Galerie Courant d’Art, 10 rue des Tanneurs à Mulhouse du 20 septembre au 12 octobre
10–12h & 14h30–18h du mardi au vendredi
10–12h30 & 14h–18h le samedi
tél 03.89.66.33.77

Christian Lang n’avait plus consacré d’exposition personnelle à Mitsuo Shiraishi depuis 2002 ! L’artiste japonais établi à Mulhouse restait pourtant bien présent dans le paysage avec des monographies importantes : à Mulhouse avec « Hakumeï » à la Bibliothèque Municipale en 2017 et au musée des Beaux-Arts en 2018, aux médiathèques de Thann et Cernay en 2021 (gravures) et l’an passé au musée Pierre-Noël à Saint-Dié.
Son travail atypique, délicat et méditatif sait intelligemment mettre à distance notre époque tonitruante en cultivant le doute et un silence stupéfait.
Souvent ses titres d’expositions cultivent l’oxymore – « Si près, si loin » à Saint-Dié, « L’ombre des lampadaires » à Thann Cernay, « Ténèbres Lumineuses » à Mulhouse. Rien d’anodin à ce jeu qui suggère la tension présente dans ses peintures ou ses gravures d’une sérénité inconfortable.
Le paysage en dresse la scène, ample, riche, mais radicale : une zone désertique, une forêt dense, un pic montagneux, d’impressionnants précipices, un tronçon de ville… Sa touche est attentive et délicate, sa virtuosité sait faire vibrer la tumultueuse ivresse d’un ciel, miroiter une lueur au-delà des frondaisons, cingler d’argent une fane léchée par le soleil… Le plaisir du rendu est palpable et érige un piédestal au drame qui se joue ou plus précisément à ce qu’il en reste après – longtemps après –, quand les comptes semblent soldés. Les décombres sont purgés et seul subsiste un reliquat épuré révélateur d’un monde échu, trace troublante de ce qui fut, souvenir ostensiblement banal, quelquefois symptôme inquiétant d’une pathétique ambition : lampadaire, cabine téléphonique, banc ou chaise, distributeurs automatiques, rails, échelles ou escalier, manège…
La poésie naît de cette dissonance entre l’intangible et luxuriante immensité et ce fragment dont exsudent encore l’affairement passé et son inanité.
L’artiste dit volontiers que ce qui l’intéresse c’est le rapport, la distance finalement, entre les humains. Et dans cet ordre, car le lien de plus en plus est devenu mise à distance. Ainsi les humains glissent naturellement hors de ses cadres. Les rares silhouettes visibles s’avèrent être des épouvantails ou des mannequins articulés pour dessinateur.
S’il voue une admiration inconditionnelle à Breughel, c’est que le Brabançon peint avec gourmandise ses contemporains dans leurs activités souvent champêtres. Cinq cents ans plus tard, notre environnement s’est artificialisé et nos échanges interpersonnels sont médiatisés par la technologie. Or les solutions techniques entretiennent le mal qu’elles prétendent soigner (Jacques Ellul / Le bluff technologique, 1988) et la part d’humanité devient si ténue qu’il ne voit pas l’occasion de représenter les humains… Et effectivement la matière du monde est ailleurs, dès 1956, Günther Anders pointait L’Obsolescence de l’homme…
Aussi il ne peut que nous livrer quelques signes matérialisant la possibilité de l’échange, de la solidarité, de la paix.
Aux machineries massives qui affirment le pouvoir, il préfère la légèreté : ces grands huit éthérés qui tentent de conquérir le ciel, la fragilité des réverbères, des perches ou des échelles soumis au précaire équilibre entre la Nature et un collectif organisé et conquérant.
Si l’absurde peut faire penser à Magritte, ce dernier l’assène péremptoirement. Chez Mitsuo Shiraishi – qui affirme clairement : je ne suis pas surréaliste –, il s’impose par le vide qui enfle plus on regarde ses peintures et qu’il partagerait plutôt avec De Chirico. Mais l’Italien offre un espace à habiter d’une incandescente solennité, réceptacle d’une attente mécanique du temps, celui de Mitsuo s’habille de l’absence immobile et dilatée d’après, le temps échu d’un immuable artificiel et défait, défait car artificiel.
Se tisse alors un nouveau lien entre un humain réel – le spectateur – et un semblable non identifié présent hors-cadre que la trace fait timidement exister dans un vaste espace pouvant accueillir La grâce… qui ne peut entrer que là où il y a un vide pour la recevoir (Simone Weil / La Pesanteur et la Grâce, 1947).
La mémoire des murs
photographies Françoise Saur, texte Luc Maechel
#LIVRE
chez Médiapop Éditions, septembre 2024, (160 p., 25 €)

Après l’exposition des photographies de Françoise Saur au Centre Socio-Culturel Agora en juillet 2022 – reprise à la médiathèque de Cernay à l’automne 2023 –, parait le livre qui restitue le travail de mémoire mené de 2021 à 2024 dans le quartier Bel-Air au sud de Cernay.
Les témoignages des habitants ont été collectés par des étudiants en 3e année de licence d’histoire à l’Université de Haute-Alsace et par Luc Maechel. Les membres du Conseil Citoyen du Bel-Air et Céline Steiner, Nora Klarzynski, Ben Mansouri pour Agora ont soutenu et accompagné le projet.
texte du 4e de couverture
Ce livre est un voyage dans l’histoire d’un quartier populaire sorti de terre en pleine crise du logement dans les années soixante-dix. Le BTP, l’automobile, les filatures sont gourmandes en main-d’œuvre et attirent des populations d’origine maghrébine ou rurale qui quittent les fonds de vallées. Les baraques édifiées dans la hâte de l’après-guerre laissent la place à un grand ensemble en béton. Ainsi commence l’aventure du quartier Bel-Air.
Fin des années quatre-vingt-dix, sous couvert de mixité et d’amélioration des conditions de vies, les politiques de dédensification et de rénovation débutent et le quartier entame sa mue.
Le changement est aussi culturel et symbolique. Les habitants, certains installés là depuis plus de cinquante ans, avec des enfants, des petits enfants, vivent difficilement ces bouleversements : le Bel-Air a forgé leur identité sur trois générations.
Emprunter des images, des mots à leurs vécus, au sensible, permet de découvrir qu’à Cernay comme dans tant d’autres cités en France, ces petites mains de l’industrie ont une histoire, des visages, une vie : un ouvrage pour préserver la mémoire de leurs murs, celle du quartier Bel-Air.
Une histoire de transmission et une polyphonie salutaire.
régression narcissique
La société de l’expérience. Le consumérisme réinventé
de Steven Miles
#LIVRE
aux Éditions l’Échappée, avril 2024, (256 p., 20 €)
Essai, collection Pour en finir avec, trad. de l’anglais par Galaad Wilgos

Le succès du consumérisme comme « mode de vie » tient en partie au fait qu’il modèle notre vie sans que nous nous en rendions compte (p. 37). Steven Miles étaye son analyse en montrant comment ça agit dans l’univers des loisirs et du tourisme, du travail, des technologies (réseaux sociaux, IA), de l’espace urbain et de l’architecture, du sport, des coffee shop : une plongée dans les coulisses – et malheureusement le succès – de cette manipulation du consommateur.
Son livre est très référencé (nombreuses mentions dans le texte), ce qui alourdit un peu la lecture (toutefois aisée pour un essai). Prudent et mesuré, l’auteur questionne, emploie le conditionnel et discute régulièrement les options défendues par certains collègues.
La culture de consommation orientée vers la famille, qui avait pris son essor dans les années 1950, a été supplantée par une version beaucoup plus individualisée, centrée sur la transformation de soi. (p. 217)
Marquée par une insatisfaction grandissante des consommateurs, l’accumulation de produits trouvait peu à peu ses limites (s’y ajoutaient progressivement celles liées à la planète), d’autant que le champ des loisirs ouvrait aussi la possibilité d’interroger la quête de sens. Le marché s’empresse d’investir le domaine pour générer des profits et surtout planter sa vision : les produits ne sont pas simplement des produits, mais aussi des moyens pour vivre des expériences (p. 72). Le capitalisme entame une mue pour accompagner et vendre un monde de la réinvention perpétuelle : chaque nouvelle expérience étant censée nous rapprocher du moi « parfait » (p. 33), de l’expérience fabriquée à l’échelle industrielle (p. 22). C’est grâce à cela que le capitalisme s’est réinventé. Il met désormais le moi au centre (p. 23).
Se généralise ainsi un nouveau mode de vie/consommation où ‘consommer plus’ devient un moyen d’épanouissement avec – pour en attester : ça fait partie du contrat – l’obligation de le faire savoir. L’individu n’est plus désormais ce qu’il consomme ou son mode de consommation, mais bien plutôt le récit qu’il en présente au monde. (p. 230)
Les avancées technologiques, l’omniprésent smartphone notamment, avec Internet et les réseaux sociaux permettent de facilement capter « le temps de cerveau disponible » et contrôler l’allégeance aux nouveaux prédicats.
Le culte de l’ego est le piège que le marché dépose dans nos consciences et l’imago le moyen d’entériner l’illusion de son accomplissement. Sauf que le capitalisme de consommation garde la main, il imagine et fournit les produits, les idéaux et les canaux de diffusion… Le libre arbitre reste limité à l’offre proposée dans le cadre de cet écosystème : une façade qui permet de consolider un système socio-économique assimilant la liberté au choix (p. 23).
Le marché est à la fois d’une grande habileté. Il nous revend sous forme de produits ce qu’il a détruit (les traditions, la nature, etc.) et de plus en plus sous forme d’expériences (écomusée, loisirs nature, etc.). Une illusion fluide remplace la matérialité impossible à restituer et impose même la conviction que les causes de la souffrance se trouvent en nous et non dans le contexte social, économique et culturel plus large. […] l’individu devient donc responsable de son propre sort (p. 225, un concept abondamment et remarquablement développé par Eva Illouz).
Il est aussi d’une grande prétention, car, même virtuels, ses produits restent plombés par l’obsolescence et maintiennent l’individu dans la frustration (qui sera évidemment profitable au marché qui vendra un produit de plus). L’individu baigne dans une sorte d’ersatz de vie sociale, et la conséquence ultime de cette mascarade est l’isolement psychique et social. (p. 30)
Les promoteurs du capitalisme de consommation pourraient reprendre ces mots de Valère Novarina : Notre futur est votre avenir. Donnez-nous votre présent. Votre argent m’intéresse. (L’Acte inconnu, 2007)
Et après lecture, vous ne verrez sans doute plus tout à fait vos contemporains de la même façon…
l’ami Raymond…
disparition de Raymond-Émile Waydelich
#ARTS PLASTIQUES
Raymond-Émile Waydelich (14.09.1938 – 9.08.2024)

Raymond-Émile Waydelich nous a quittés un vendredi soir d’août.
Artiste attachant, généreux, pétri d’humanité et toujours joyeux !
Ferrette lui avait consacré une rétrospective durant l’été 2022.
L’année précédente, il m’avait accordé une interview lors d’une résidence aux Éditions Bucciali dont il était un des artistes marquants.
Toujours actif, j’ai pris la photo ci-contre mi-décembre lors d’un vernissage chez Marc Felten et fin janvier, il signait encore ses épreuves chez Rémy…
Sans toi, Raymond, l’Alsace a beaucoup moins d’oxygène !
Avec Raymond, c’est un jeune homme de 85 ans qui s’en va…
Ces dernières années, il était surtout connu pour son facétieux bestiaire : des silhouettes noires – beaucoup d’animaux, mais aussi des humains souvent aux bras levés et des bateaux, des voitures… – affrontés à des éléments de décor aux couleurs franches – le vert de la végétation, le bleu de l’eau et le rouge de la charcuterie !
Ses images circulaient facilement, beaucoup étaient des gravures composées chez l’ami Rémy : une joyeuse et inventive complicité de près de quarante ans qu’ils partageaient également avec Mitsuo. Mais il y avait aussi ses bronzes au rictus carnassier et, lors des expositions, il n’hésitait pas à accrocher un vrai saucisson pour amplifier l’élan vorace de certains !
Facilement reconnaissable, son style était franc et économe avec de larges aplats, des lignes énergiques et enlevées (l’érudit reconnaîtra les appropriations, les clins d’œil) au service d’un univers très personnel dont l’humour grinçant et la fantaisie délurée renvoyaient au nôtre tenaillé par une atavique avidité – la nourriture, le sexe. L’attestaient les dents acérées et les expressions tendues de ses créatures – loups, crocodiles, cerfs, sangliers, rhinocéros, coqs, oies… ou d’inquiétants personnages léonins quelquefois assis sur un trône d’inspiration grecque.
Il n’est pas anodin que ses figures se soient cristallisées avec la découverte en 1984 des vases minoens. En ce début de civilisation (vers 1 700 av. J.-C.), les techniques étaient au point et les céramiques s’exportaient, se diffusaient. Leur décor aux gestes limpides liés à la mer, à la terre, aux rituels dessinait les images d’une société plus élaborée, plus ambitieuse et qui transcendait les logiques de survie. C’était aussi les traces d’un monde nouveau qui s’éveillait, grandissait là, au cœur de la Méditerranée, en rencontrait d’autres… Saurait-il avancer vers un chemin d’humanité capable d’apprivoiser les bas instincts ? Quelques siècles plus tard, le doute était permis et Raymond, par précaution, ajoutait les flèches pour s’y orienter, mais peut-être aussi indiquer que l’esprit de certains cherchait une voie alternative à cette sauvagerie. Quelquefois il les appuyait de quelques mots de conjuration : I love you, Help, Hopla ! Car sous l’esprit bon enfant et joyeux perçait l’effarement devant les massacres (on liquide la terre entière, c’est dingue !), mais aussi devant l’abandon en bord de route des animaux domestiques…
Parallèlement, il imaginait d’autres pièces à partir d’objets dénichés dans les puces ou les greniers avec ce goût de croiser les traces du passé, de les assembler pour imager une nostalgie d’un futur revisitée à la sauce Waydelich. Et il revendiquait ce plaisir de tricher pour la bonne cause : cuire ses peintures pour leur donner la patine légèrement craquelée de toiles anciennes (Memories painting), exposer ses créatures imaginaires au musée zoologique (1981) ou ces poteries « crétoises » au musée archéologique (2011).
Cet art de la provocation – il vouait une réelle admiration à Marcel Duchamp (Il cassait la baraque) et Joseph Beuys – lui avait permis d’être le représentant de la France à la Biennale de Venise en 1978 avec L’homme de Frédehof dédié à Lydia Jacob dont il inventait la vie et l’œuvre. Et il était très à l’aise avec cette culture populaire – qu’incarnait aussi cette cousette strasbourgeoise du début du XXe siècle – et il l’intégrait volontiers dans ses propositions (Caveau du futur, 1995).
Sous la bonhomie du vieux monsieur qui s’enthousiasmait pour la Schmierwurscht, les vieux westerns, les cartoons (il nous envoyait des extraits par messagerie), Raymond savait aussi s’émerveiller devant la modernité : faire des photos ou des vidéos pendant son travail pour le bonheur de les partager instantanément avec son réseau d’amis, tout cela à la pointe de son smartphone.
Et il ne faut pas oublier son soutien actif à l’ARAHM, L’Art au-delà du Regard, la Banque alimentaire (j’en oublie peut-être).
Grâce à son œuvre polymorphe et son humour, Raymond rendait la réalité moins barbare et il subordonnait son activité de peintre à celle de marchand de bonheur.
Un humanisme que nos hommes et femmes de pouvoir ont soigneusement rangé dans le placard de leurs discours, car le monde est beaucoup plus dangereux et irrespirable aujourd’hui que quand j’ai commencé à te filmer il n’y a pas si longtemps : en 2021…
Oui, Raymond, ton oxygène était tonifiant et aérait notre univers confiné !
Par bonheur, ton héritage, tes images, tes objets, ton souvenir nous en préservent quelques bulles !
thaumaturge filiation
Le Conte d’hiver de Shakespeare
#THÉÂTRE
représentation du vendredi 2 août 2024 au Théâtre du Peuple, Bussang

Pour sa première saison d’été, la nouvelle directrice Julie Delille a choisi de programmer un Shakespeare peu joué : Le Conte d’hiver dont elle revendique l’issue positive. Luc Bondy l’avait monté en 1988 (aux Amandiers de Nanterre et au Festival d’Avignon) dans une traduction de Bernard-Marie Koltès qu’utilise cette production. Une des singularités de la pièce est l’ellipse temporelle de seize années entre les scènes VIII et IX : la figure du Temps vient huiler cette transition et boucher les trous narratifs.
Le Conte d’hiver, c’est Othello sans Iago. Pas de Credo… cet abysse ontologique d’une humanité sans issue (même si c’est Boito & Verdi qui l’ont cristallisée), mais un Lieto fine où la génération d’après pousse la porte du bonheur…
Aucun des personnages n’organise de mise en scène pour attiser le soupçon, pas d’épiphanie d’où la jalousie jaillirait et surtout personne n’alimente la rumeur, tout au contraire : tous affirment avec fermeté la fidélité d’Hermione. Sans convaincre. Léontes, roi de Sicile, envenime lui-même les petits détails, les jeux de mains voulus par la bienséance à la dimension du crime pour légitimer son postulat : l’adultère de la reine Hermione. Difficile d’entrer dans cette jalousie irrationnelle sauf par le biais d’un farouche déni de réalité et par la folie. Très vite, Baptiste Relat mure son personnage dans un entêtement voué à une solitude intérieure, il s’emporte quand quelqu’un le contredit avec des éclats froids et menaçants, évitant de croiser le regard de quiconque, avant de replonger dans son trou noir qui nourrit son pouvoir de nuisance.
Les hautes cloisons coulissantes imaginées par Clémence Delille enferment les personnages sur l’avant-scène d’autant plus que certaines portes sont fictives (comme une pièce de boulevard noire où les portes ne pourraient même plus claquer). Ses costumes sombres et racés évoquant la Renaissance tardive et les lumières d’Elsa Revol inscrivent les huit scènes siciliennes dans un univers carcéral amplifié par les sonorités d’orgue de Julien Lepreux.
Piégée, Hermione (Laurence Cordier) ne parvient guère à illuminer cette nasse. Ses déplacements avec Polixènes, roi de Bohême et amant supposé (Laurent Desponds) sont tous preuves à charge et abondent son infidélité. Sinon, tétanisée par l’injustice, elle martèle avec force et conviction son innocence.
Paulina (Élise de Gaudemaris) est la seule à tenir tête à la déraison par ses manigances (agir loin du regard du fou !) et consolide une arche narrative entre cette déraison initiale et la résolution sicilienne.
Le Temps (Gérard Lévy), sorte de dieu antique, qui passe devant un ciel étoilé – un rideau d’avant-scène sombre, mais visuellement envoûtant – en saupoudre aussi quelques indices.
Seize ans plus tard, le plateau et les portes s’ouvrent vers la nature radieuse (succès du passage d’un vrai troupeau de moutons qui traverse ensuite la grange) accentuant l’atmosphère champêtre des réjouissances de la fête de la tonte. La cornemuse remplace l’orgue, l’ambiance est enjouée, d’inspiration folklorique. Les costumes sont plus colorés – avec une discrète touche slave : la Bohême ? La troupe y participe avec enthousiasme et certains y trouvent un espace de jeu (Véronique Damgé en Autolycus) avec un visible plaisir qu’ils veulent partager avec le public qui est séduit. Les rôles sérieux sont plus à la peine (Yvain Vitus en Camillo).
Laurence Cordier qui joue aussi la bergère Perdita, fille abandonnée d’Hermione et Léontes, a gagné sa liberté de mouvement, s’impose en ferment de vie et, un brin provocante, tient la dragée haute au roi de Bohême.
Retour à la sombre Sicile pour le final avec un Léontes prostré, sorte de Philippe II, dont la contrition aurait dévoré les mots. Les comptes sont soldés et actent le passage de témoin vers la nouvelle génération : Perdita et Florizel, héritier de Bohême (Valentin Merilho).
Les portes de cet antre spectral s’ouvrent vers l’impressionnant hêtre. À contrejour, le décor avec la tache rouge de vie à cour, prend tout son sens plastique. En ombres chinoises, les silhouettes montent vers la lumière pour être inondées de soleil. La scène est particulièrement poétique cet après-midi-là avec le vent qui anime la végétation.
Le projet de Julie Delille accentue cette dichotomie entre l’ancien sombre et crépusculaire – ce presque noir et blanc sicilien – et l’allant de la relève – en couleur avec cette douce accession à la polychromie dans le dernier tableau.
Sa direction d’acteurs éclaire aussi ses choix pour résoudre l’équation de Bussang : laisser filer cet enthousiasme au jeu, cette complicité avec la salle quelquefois facile pour préserver l’unité du spectacle au-delà du statut professionnel ou non des comédiens (en 2022, Simon Delétang préférait un rituel chorégraphique disciplinant les corps pour son Hamlet).
Dans le cadre enchanteur de Bussang, elle revendique aussi l’optimisme – comme Shakespeare qui avait écarté la figure de Iago dans cette pièce tardive.
Avec une part de candeur ?
Vous êtes en harmonie à présent ! Mais je broierai les clefs qui règlent ce concert. (Iago dans la scène IV d’Othello).
le cœur supplante le corps
Made in Germany
Maîtres et merveilles
#EXPOSITIONS
Made in Germany, Peintures germaniques des collections françaises (1500-1550)
co-commissariat : Amandine Royer, conservatrice des arts graphiques et Virginie Guffroy, conservatrice des beaux-arts
Besançon, Musée des Beaux-Arts et d’Archéologie du 4 mai au 23 septembre 2024
10h-12h30 & 14h-18h, sans interruption les week-end, fermé le mardi
Maîtres et merveilles, Peintures germaniques des collections françaises (1370-1530)
commissariat : Lola Fondbertasse, conservatrice chargée des collections médiévales
Dijon, Musée des Beaux-Arts du 4 mai au 23 septembre 2024
10h-18h30 tous les jours sauf le mardi
« Peintures germaniques des collections françaises (1370-1550) »
programme de recherche de l’Institut National d’Histoire de l’Art (INHA)
commissariat scientifique : Isabelle Dubois-Brinkmann & Aude Briau
catalogue commun aux trois musées, en français ou en allemand, 416 p., 39 €
➕ Couleur, Gloire et Beauté | Colmar, Musée Unterlinden du 4 mai au 23 septembre 2024

À Besançon et Dijon, deux expositions contribuent à la restitution du programme de recherche de l’Institut National d’Histoire de l’Art (INHA) : Peintures germaniques des collections françaises (1370–1550).
Celle du Musée des Beaux-Arts de Dijon se concentre sur le début de la période – avant le protestantisme avec 75 œuvres exposées – et illustre comment la représentation au-delà de la diversité des « réalismes » se met au service du message de l’Église.
Le Musée des Beaux-Arts et d’Archéologie de Besançon, riche de ses cinq Cranach légués par Jean Gigoux (1806–1894) et complétés par six autres en prêt, documente le glissement de la représentation vers la sphère intime et le portrait durant la première moitié du XVIe siècle avec 70 œuvres (25 ont été restaurées pour l’occasion, les peintures germaniques étant plutôt mal considérées en France).
Lors de la période médiévale, souvent, les chairs étaient torturées, pourrissantes, les os en saillis éclataient la peau qui tombaient en lambeaux, c’étaient les gueules d’enfer dévorant les damnés, les danses de mort, les transis et ces créatures voraces et terrifiantes qui tourmentaient les vifs.
La période qui suit se détache progressivement de cette imagerie saisissante et morbide, s’oriente vers une approche plus positive, où la résurrection ouvre la perspective du paradis même si la barbarie de la crucifixion en est le préalable imposé par le narratif eschatologique.
Si les artistes sont parfaitement capables de restituer précisément les traits (les exemples abondent dans les trois expositions), s’ils maîtrisent une forme de perspective qui se perfectionnera au contact des Italiens, leur propos est ailleurs. Il s’agit d’accompagner la foi, de l’ancrer dans la promesse du royaume de Dieu et l’itinéraire du Christ en est une étape généreuse d’exemplarité. Les images s’en inspirent pour inspirer le fidèle. Elles reflètent aussi le changement qui s’opère à partir du XIVe siècle dans la spiritualité chrétienne avec la Devotio moderna qui rayonne et se formalise avec L’Imitation de Jésus-Christ (vers 1427). Pour le pratiquant, le sentiment supplante le rituel.
Les fonds des retables, des peintures dépeignent un paysage édénique, les plus anciens sous sa forme symbolique, la dorure quelquefois brochée et qui réfléchit la lumière des bougies. Les protagonistes s’en détachent affichant leur implication dans la scène peinte, mais selon des attitudes codifiées. Les visages aux traits souvent peu différenciés, mais expressifs sont empreints de dignité, de noblesse, signifiant l’empathie, la bienveillance, la patience, la douleur… que prolongent les gestes avec une attention particulière aux mains. La gestuelle est apaisante, les doigts des Saints offrent Jésus en exemple et incarnent l’humanité irradiant cette paix presque surnaturelle des attitudes dans la peinture du début de la Renaissance – ou le corps humain ne parle pas seulement pour soi mais exprime aussi les codes de l’expérience religieuse. (Siri Hustvedt : Les mystères du rectangle, 2005)
La luxuriance des ailes (anges, archanges, angelots) et le traitement des vêtements le plus souvent d’époque s’attardent en drapés virtuoses dont les chatoyants rouges sang sont une somptueuse allusion au sacrifice, où les bleus de Marie l’identifient aux cieux, ce qu’accomplira l’Assomption.
Et les Annonciations sont nombreuses évoquant l’acte le plus féminin et le plus généreux qui soit : donner la Vie, ouvrant la voie à la compassion mariale, à ce rôle privilégié d’intercesseur dévolu à la Vierge et qui prendra de l’ampleur. Le christianisme, en rendant possible la représentation du féminin maternel avait dépassé la rigueur de la Loi au profit de l’imaginaire. (Roland Barthes : La chambre claire. Note sur la photographie, 1980).
L’iconographie ne brandit plus la malédiction du péché originel et le bestiaire satanique avec l’ostentation de la souffrance et la perspective de l’enfer, mais l’exemple à suivre : le Christ (ou les Saints).
L’hystérie des bourreaux subsiste, mais leurs contorsions exagérées les disqualifient.
Le morbide se limite à une mâchoire devant l’antre du dragon affrontant Saint-Georges (Nikolaus Schit, vers 1500) et les Saints portent sereinement l’emblème de leur martyre.
Les crânes deviennent supports de méditation avec les Mélancolies, comme celle de Lucas Cranach l’Ancien exposée à Besançon (1532, issue du fond des Unterlinden de Colmar).
Le cœur supplante le corps et écarte ses outrances.
vers l’intime
À partir du XVe siècle, les donateurs s’invitent au pied de la croix, avancent, timidement encore, leur individualité pour la mettre au service de la foi.
Au même moment, le protestantisme très influent dans le Saint Empire se montre réservé sur les images dans les lieux de culte.
Ainsi la commande glisse vers le privé, mais préserve cette chorégraphie symbolique des mains, des gestes même si le sens évolue : les poses affirment le statut social, les hiérarchies, le pouvoir et les liens. Les traits sont désormais ressemblants au modèle : le commanditaire et sa famille. La mode s’invite (facilitant le travail de datation) et affirme l’individualité, la richesse (les bagues sont nombreuses). Les peintres s’inspirent de sujets littéraires ou mythologiques au prétexte d’illustrer la morale (avec ambiguïté puisque c’est aussi l’occasion d’offrir aux regards la nudité féminine : Lucrèce de Cranach, vers 1540).
Les jeux de mains (de vilains quelquefois) restent, mais prennent un tour plus concret quand la femme du Couple mal assorti plonge la sienne dans la bourse du vieillard (Cranach, 1530) ou celle de Mathaüs Schwartz qui touche le luth (Hans Maler, 1526). Des portraits denses et vifs dans un fascinant entre-deux : le genre s’émancipe, se cherche, n’est pas encore compassé par la parade. Besançon nous emmène sur ce troublant passage de la figure humaine vouée au rôle de spectateur de la paix mystique vers celui d’acteur intime préservant un temps noblesse et sérénité. À ce titre, le volet bisontin s’impose comme le plus captivant des trois (textes pertinents des cartels).
Il présente aussi un chef-d’œuvre conservé à la bibliothèque municipale : le Livre de prières de l’empereur Maximilien Ier qui demanda à de grands artistes de son temps – Hans Baldung, Hans Burgkmair, Albrecht Altdorfer et son atelier, Jörg Breu – d’orner les marges de dessins originaux. Un exemplaire unique imprimé sur parchemin qu’il est possible de feuilleter en ligne.
care and show…
Art | Basel 2024
#SALON
Art | Basel du 11 au 16 juin 2024
(journées vip les 11 & 12, tout public à partir du 13)
direction : Maike Cruse
Messe Basel | Messeplatz, CH–4005 Basel

Art | Basel est une marque mondiale : Bâle, Miami Beach, Hong Kong, Paris. Comme toutes les marques, elle se vend. Cher.
Le public que le tarif n’impressionne pas (67 CHF) est nombreux. Plusieurs files d’une cinquantaine de mètres s’étirent avant le contrôle des billets à l’ouverture d’Unlimited. Dans l’après-midi, la foule est compacte dans les circulations plus étroites de la foire elle-même : 285 galeries dont 22 primo participantes issues de 40 pays. L’effet vip est retombé en cette première journée publique, l’effervescence demeure : 91 000 visiteurs sur la semaine, toutes entrées confondues.
Art | Basel, c’est principalement deux espaces : Unlimited (hall 1) et Galleries (hall 2). D’autres propositions moins formelles jalonnent les halls : Feature (regroupé en D1–D16), Statements, Edition, Kabinett, Conversations, Magazines, Film (au Stadtkino).
En 2024, un parcours Artworks s’invite dans les rues de Bâle depuis la Mittlere Rheinbrücke et Merian jusqu’à la Messeplatz, essentiellement sur les abords de la Clarastrasse : 22 œuvres en accès libre avec occasionnellement des performances (commissariat : Stefanie Hessler). Enfin l’imposante Honoring Wheatfield – A Confrontation d’Agnes Denes (2024) accueille les visiteurs et restera en place quelques semaines.
Unlimited est une vitrine pour le public qui va dans les musées, apprécie l’art contemporain, veut voir ce qui se vend et espère découvrir (avant les autres :-) ce qui se vendra demain. La scénographie est élaborée avec les galeries prêteuses et leur permet de présenter des pièces spectaculaires, en taille notamment, mais aussi des vidéos ou des séries complètes avec une ambition muséographique (commissariat : Giovanni Carmine). Petite innovation cette année, le public peut voter pour désigner son œuvre préférée*.
Le dispositif combine le concret de l’évènement (les affaires et l’argent, ici avec beaucoup de zéros) et le storytelling qui avance un réel très objectif au départ, suggérant que l’art n’est pas dans une bulle, que l’art est actif, engagé, en prise avec la vie et le monde. The Americans et Marcados l’affirment dès l’entrée.
Sur la gauche, The Americans (1955–1957) de Robert Frank (1924–2019) est le portrait d’une nation en plein essor et quelquefois ivre d’elle-même : 84 photographies en noir et blanc, fruits d’un voyage de deux ans à travers l’Amérique profonde et superficielle. Des tirages réalisés en 1983 par Ed Grazda sous la supervision du photographe, une caution qui assurent une authenticité d’œuvre majeure à ces fascinants clichés d’autant que la série complète est réunie pour la première fois (mais le geste esthétique, la valeur anthropologique prolongée par des textes de Jack Kerouac, Simone de Beauvoir, Erskine Caldwell, William Faulkner, Henry Miller et John Steinbeck, se sont concrétisés par une édition en livre en 1958 et sa réimpression se trouve facilement en librairie à 39 €).
Sur la droite, Marcados (1981–1983) de Claudia Andujar (née en 1931) placardent bout à bout sur une longue cloison 87 portraits de Yanomami avec un numéro en sautoir (marqués) : des photos de face, en noir et blanc aussi, de membres de cette communauté indigène au nord du Brésil décimée au cours des années quatre-vingt par les mineurs d’or illégaux – et à nouveau, quarante ans plus tard, sous la présidence de Bolsonaro !
Le média photo, surtout ainsi, rend l’ancrage sur le terrain indiscutable, exhibe la réalité palpable, émouvante voire dramatique (et aussi, si l’on suit Roland Barthes, cette « attestation » qui produit la Mort en voulant conserver la vie).
Vers le fond du hall, se voit, s’entend le militantisme d’Henry Taylor – le slogan End war and racism… dominant les 35 mannequins grandeur nature et sans tête habillés en activistes Black Panthers : Untitled (2022) –, mais aussi de la prémonitoire Intifada : The Endless Rhizomes of Revolution (2016) de Kader Attia – les fers à béton, les gravats qui la composent pourraient provenir de la bande de Gaza ruinée méthodiquement depuis huit mois – ou la (vraie) fresque de Keith Haring (Untitled (FDR NY) #5-22, 1984) – peinte sur une clôture bordant l’East River Drive à New York, démontée et dispersée en 1985, remontée ici quasi intégralement, 46,80 m.
L’ambition d’évoquer, d’exposer sans concession le monde par le choix des œuvres est nette et ferme.
Dans d’autres installations, le réel se revendique par sa matérialité têtue : une vraie coccinelle emballée par Christo (Wrapped 1961 Volkswagen Beetle Saloon, 1963–2014), le riz de Wolfgang Laib (Brahmanda, 2014–2022), les dalles en granite de Jenny Holzer (Survival, 1989)…
Ces gestes s’exposent dans un espace-temps ample accordant la latitude d’une surenchère aux artistes accueillis qui ne se privent pas de profiter de ce confort, de ce luxe. Certains retrouvent l’ampleur des fresques médiévales (Salvo : Il Trionfo du San Giorgio, 1974, ou Dominique Fung : A Tale of Ancestral Memories, 2023), The Extended Line de Chiharu Shiota (2023–2024) occupe la hauteur de la halle sur 16 x 9 m, Ugo Rodinone dresse un arbre entier pour luminous light (2023), etc.
Et surtout, ici on soigne l’art, c’est visible, ostensible même : de nombreuses petites mains veillent sur les œuvres, filtrent poliment s’il faut limiter les entrées d’un stand ou empêcher l’accès, assurent très gentiment la médiation explicitant les pièces exposées. Ce sont surtout des jeunes femmes : pantalons, blouses, quelquefois une doudoune matelassée (le printemps est frisquet), un uniforme (dégenré) identique et blanc entre l’infirmière et le cosmonaute, voire le personnel travaillant en milieu réfrigéré. Ne manquent que les gants en latex…
Imperceptiblement le réel s’évapore vers un univers fantomatique – Tarkovski ou Enterprise ou cet hors du monde de L’année dernière à Marienbad ? – amplifié par des montages surprenants, mobiles pour certains, agaçants parfois, comme issus d’un monde parallèle, mécaniste, pulsant de photons vitaminés sur des écrans géants. Les visiteurs flottent dans cette succession de moments voulus apostrophant ou éthérés. Sans sérénité pourtant : la rumeur est permanente, le son des vidéos ou des installations déborde (un peu) des stands. Même les espaces de relaxation sont sonorisés (il y a forcément une musique-produit pour nos besoins). Une bulle remuante où l’absence de silence prescrit un recueillement bruyant et actif.
Et Miriam Cahn plante sur ses tons pastels saturés les trous béants de regards atterrés vers nos congénères… (ARCHITEKTURTRAUM, 2001, 33 éléments)
Le public se plie volontiers à ce rituel déambulatoire et collecte les clichés à coups de smartphone. Ceux qui poussent leur look jusqu’à se promener en œuvre d’art sont rares, mais quelques-uns se distinguent par un vêtement : un chapeau, une veste, un pantalon qu’on ne mettrait pas en ville… L’ostentation passe par l’accessoire de mode, de luxe : l’écosystème de l’art international aujourd’hui. Même si cette ambition esthétique diffracte un peu dans un hangar…
D’opportuns cartels avec QRC (pour anglophones uniquement), mais identiques et systématiques sont présents dans tout le salon. Si Unlimited est classé par artistes, ailleurs celui par galeries s’impose.
Galleries se déploie sur deux niveaux autour d’un espace circulaire : La Prairie, le restaurant central où les négociations peuvent se poursuivre. Les coursives sont plutôt étroites, l’espace est compté et pousse vers une course sans fin (à l’inverse d’Unlimited ou art-Karlsruhe ou St-art où il est facile de faire des allers-retours et de savoir si on a tout vu). Ici on peut continuer à tourner, zigzaguer, ce sont les œuvres qu’on a vues, repérées qui arrêtent le regard et indiquent qu’on est déjà passé là. Au bout d’un moment, on avance avec le sentiment de s’égarer dans un Carceri de Piranèse…
Au fil de la visite, il y a des choses intéressantes ou moins, du travail délicat sur le papier (Minjung Kim) et d’autres matériaux, du kitsch, de la provocation (quelquefois facile et primaire dans l’idée comme dans le geste). Mais il y a aussi de nombreuses pièces de Léger, Braque, De Chirico, Magritte, Van Doghen, Max Bill, Baselitz, Basquiat, Richter, Paula Rego… des dessins d’Egon Schiele ! Et d’émouvantes découvertes d’autant que les œuvres présentées s’échelonnent de la fin du XIXe jusqu’à aujourd’hui. Une profondeur dans le temps et un nombre d’œuvres qu’on pourrait trouver dans un musée : 250 ans, c’est enthousiasmant et revigorant.
Cependant les galeries les mieux pourvues en grands noms sont bondées et il y a des visites guidées qui ramènent une petite meute. Les stands sont déserts à certains moments, pleins à d’autres : ce sont des circulations de foire, de proximité, pas celles d’un musée avec la latitude de la contemplation.
Art | Basel est un lieu marchand qui s’adresse prioritairement à ses acheteurs et se doit de leur ménager un univers feutré propice au négoce (et à ce temps d’admiration en amont pour ce type d’achat « irrationnel »). Avec un tarif plus proche d’un musée, il y aurait deux, trois, quatre fois plus de monde ?
Une piste serait de proposer aussi un billet au tarif musée pour accéder uniquement à Unlimited en prolongement du nouveau parcours. L’organisation du lieu s’y prête et Bâle bénéficie d’un public d’habitués avec ses nombreuses expositions d’art contemporain au fil de l’année. À moins que ce parcours Artworks soit seulement un geste marketing vers la ville afin de mieux préserver la bulle de l’art fair… mais très certainement le monde n’attend pas les artistes pour avoir conscience de sa propre violence, de sa propre obscénité (Jakuta Alikavazovic, 2022).
* Le lauréat est Francisco Sierra avec Guppy (2024) :
48 panneaux de bois montés sur des reliefs concaves,
chacun (6,5 x 6,5 cm) peint à l’huile d’un guppy grandeur nature
(le poisson arc-en-ciel très prisé en aquariophilie d’eau douce).
=> prochain épisode à Paris du 18 au 20 octobre 2024
avec 194 galeries au Grand Palais, plein tarif : 44 €
avant l’Aube…
@La Filature | saison 24 25
#THÉÂTRE, DANSE, MUSIQUE
La Filature (Mulhouse)
56 spectacles et 5 expositions du 27 septembre 2024 au 21 juin 2025
Ouverture des abonnements le samedi 22 juin et de la billetterie le 2 juillet

Le public est de retour même plus nombreux qu’avant la pandémie !
Malgré cet engouement et l’augmentation des recettes propres, la tension et les inquiétudes budgétaires demeurent… Le directeur Benoit André revendique la culture comme un sanctuaire à préserver. La manière de fréquenter la maison évolue et lui et son équipe travaille à favoriser cette ouverture vers de nouveaux publics.
C’est le sens de la nouvelle saison qui proposera 56 spectacles tous genres confondus avec une attention particulière portée aux femmes, le portrait notamment sera consacré à Jacqueline Caux, spécialiste des musiques minimalistes, découvreuse de la techno et passionnée des musiques arabes surtout quand elles sont un moyen d’émancipation pour les artistes femmes.
La galerie présentera cinq expositions. L’intrigante Oro Verde est accrochée depuis le 8 juin : un polar mytho documentaire retraçant la révolution du peuple Purhépecha au Mexique. Un hommage au photographe mulhousien Olivier Metzger décédé en 2022 suivra en septembre.
Deux des six créations sont imaginées par l’invitée de la saison Jacqueline Caux : une carte blanche qui esquisse son (auto)portrait ?
Le 11.12, Jeff Mills & Kamilya Jubran, le pionnier de la musique techno de Détroit et la joueuse de oud, compositrice et chanteuse palestinienne improviseront en direct.
Le 15.05, Variations autour de l’harmonie réunira le Quatuor Diotima et Les Métaboles autour de trois figures du minimalisme (Steve Reich, Philip Glass et Gavin Bryars).
Invitée le 17.05, Ghanili, Le passé est présent sera chanté par la joueuse de oud syrienne Waed Bouhassoun.
Autres créations, le jazz, hip-hop… de Time is Color (Cédric Hanriot, 27.09), Les Abîmés de Catherine Verlaguet & Bénédicte Guichardon dans le cadre du Festival Momix (31.01 & 1.02), alarm clocks… le 01.02 où la chorégraphe Sud-africaine Robyn Orlin réunira l’inclassable chanteuse Camille avec le chœur d’hommes Phuphuma Love Minus (chant d’exil zoulou a cappella) et Sa place est dans un musée où Aurélie Gandit (5 & 6.11) creusera le sillon entamé lors des deux précédentes éditions de la Quinzaine de la Danse.
Celle-ci annonce de belles promesses en mars notamment Exit Above d’Anne Teresa De Keersmaeker (5.03), Naharin’s Virus d’Ohad Naharin & The Batsheva Ensemble (20 & 21.03, leur Kamuyot sera repris hors les murs du 23 au 30.04) et le Ballet de l’Opéra national du Rhin dansera trois pièces de William Forsythe les 14 & 16.03. Mais également Et si tu danses (Mariette Navarro & Marion Lévy, 5.03), Maldonne (Leïla Ka, 19 & 20.03), Unblock Project (Étienne Rochefort, 19.03) et une Soirée roller le 18.03 à l’Espace 110.
À noter Le Banquet des merveilles (6.05) du nouvel artiste complice Sylvain Groud qui avait conçu la chorégraphie participative de Music for 18 musicians en juin 2023.
Dans l’offre théâtre, les classiques s’invitent avec Dans la solitude des champs de coton de Bernard-Marie Koltès (Maya Bösch, 15-17.10), Histoire de géants d’après Rabelais (Youssouf Abi-ayad, 8 & 9.11), Quichotte de Cervantes (Gwenaël Morin, 27-29.11), Phèdre de Racine avec Anna Mouglalis dans le rôle-titre (Anne-Laure Liégeois, 26 & 27.03), Makbeth de Shakespeare par le Munstrum Théâtre, compagnie en résidence (22 & 23.05).
Au printemps, le Mulhousien Bernard Bloch reviendra à La Filature avec Les pères ont toujours raison inspiré de ses rencontres avec Heiner Müller (25 & 27.03 en français, le 26 en allemand, surtitré en D ou F) et Mathias Moritz avec On ne choisit pas ses fantômes (14 & 15.05) après son féroce Hôtel Proust soutenu en 2022 par les Scènes d’automne en Alsace dont ce sera la 12e édition (4–13.11).
Une programmation touffue et polymorphe avec encore de la musique, du cirque, des marionnettes, des spectacles qui envahiront le parvis, des manifestations festives allant des Nuits de l’étrange pour Halloween aux Soirées Sunset en passant par le club sandwich ou des répétitions publiques pour éblouir tous les publics.
à l’ombre des Carpathes
@Comédie de Colmar | saison 24 25
#THÉÂTRE, DANSE, MUSIQUE
Comédie de Colmar
plus de 75 levers de rideau du 10 septembre 2024 au 20 juin 2025
Ouverture des abonnements le vendredi 14 juin et de la billetterie le 20 août

La présentation de saison frémissait des inquiétudes sur le financement de la culture – en général – qu’amplifiait le chaos politique (et économique…). Dans la programmation à partir de septembre, il y aura 21 propositions contre 33 en 2022–23 : 12 projets, 12 équipes, 12 soutiens en moins… La raison du Small is Beautifull l’emporte ! Matthieu Cruciani et Émilie Capliez affirment cependant leur volonté de faire vivre les spectacles, autant ceux produits à la CC en prolongeant les aventures par des tournées que ceux accueillis.
Enfin la saison sera assaisonnée d’un (joyeux !) parfum de tératologie venant des Carpathes !
La trompette d’Airelle Besson (avec Lionel Suarez à l’accordéon) ouvrira la saison en partenariat avec le Colmar Jazz Festival (10/09).
L’artiste interprète composera aussi la musique de la production d’Émilie Capliez : Le Château des Carpathes d’après le roman de Jules Verne (27/02–8/03) : musique (l’intrigue tourne autour d’une cantatrice), mais aussi vidéo (prémonition de l’écrivain !) et une gourmandise pour les créatures fantastiques qui s’invitent en fil rouge de la saison.
Le tisserand Bottom promènera sa tête d’âne dans une création musicale inspirée du Songe d’une nuit d’été de Shakespeare : Faire le mur (3–6/12, puis tournée jusqu’au 7/06 dans douze communes), un format léger avec quatre musiciens comédiens conçu pour le dispositif Hors les murs.
Les codirecteurs revendiquent aussi leur fidélité : un spectacle n’est qu’une brique de l’œuvre, de la réflexion d’un auteur, d’un metteur en scène et il importe de les suivre. Après Rêver Molière (2022) et Le Talent d’Achille qui sera repris (9 & 10/01), Youssouf Abi-ayad montera Histoires de Géants d’après Rabelais (4–6/11), un spectacle soutenu par les Scènes d’automne en Alsace.
Retour également de Jean-Christophe Folly (La nuit juste avant les forêts) comme auteur et interprète de Salade, tomate, oignons (28–30/04).
Les spectateurs retrouveront aussi Pierre Maillet dans la première des quatre créations de la saison : Et j’en suis là de mes rêveries (15–19/10) d’après le roman (1 000 p.) du cinéaste Alain Guiraudie avec un parfum de polar qui devient un film, le spectacle est imaginé par Maurin Ollès, artiste associé de la CC.
Les classiques reprennent la main avec Le Misanthrope de Molière (25–28/03) mis en scène par Simon Delétang qui a fait un passage remarqué dans la maison et surtout a offert une très belle programmation à Bussang (2017–2022) notamment son diptyque Hamlet durant l’été 2022.
Mais aussi avec Onéguine (13 & 14/03) d’après le roman de Pouchkine (et Tchaikovski) dans un dispositif bi frontal spécifique : jeu et musique en direct, mais enregistré et remixé vers les casques des spectateurs pour une immersion plus fine (il sera possible, mais dommage, de s’en passer).
La scène invitera tous les genres – musique, danse, etc. – favorisant une offre élargie aux plus jeunes : Funny Game (14–17/05) pour les tout-petits (à partir de 3 ans), une plongée (familiarisation) dans l’œuvre de Mozart et nous (18–20/12) et dans l’univers du manga avec Un jour, j’irai à Tokyo (23–25/04).
Mais le théâtre, c’est aussi un regard critique sur le monde d’aujourd’hui : Les Forces Vives (10 & 11/10) et les mots de Simone de Beauvoir, les coulisses des concours de miss où il faut Tenir Debout (18–21/11), Internet et ses dérives dans Rapt (11 & 12/12), la radio de Silence Vacarme (23 & 24/01), le hip-hop des 1 200 tours (3 & 4/04) et la reprise de Quand j’étais petite je voterai dans la grande salle (9/11)..
Le partenariat avec l’OnR se poursuit : Kamuyot (chorégraphie vitaminé repris au collège Molière les 5–7/05) et Brundibár (24 & 27/05), l’histoire d’un joueur d’orgue de barbarie, composé en 1938 par Hans Krása classé musicien dégénéré, interné en 1942 à Theresienstadt (Terezín), assassiné à Auschwitz.
Enfin le coup de cœur de Matthieu de la saison passée en lien avec Pôle Sud (à Strasbourg le 25/03) interroge le handicap par la danse : Une tentative presque comme une autre.
La Comédie cultive toujours cette volonté de tisser (et renforcer) le lien avec le public, de développer aussi une envie de culture à travers le théâtre : répétitions publiques, etc. et surtout la 5e édition d’Encrages#5 pour élaborer un spectacle avec des comédiens non-professionnels encadrés par Thierry Simon et Léna Rossetti (création les 19 & 20 juin et inscriptions ouvertes jusqu’en novembre pour y participer).
Vénus écorchée
Une exposition
#THÉÂTRE
représentation du 31 mai à La Filature, Mulhouse
reprise durant la saison 2024-25 à l’Espace 110 le 27.09.2024

Après les coulisses du théâtre, Juliette Steiner plonge le spectateur dans celles de l’art contemporain. Durant des siècles, la place des femmes comme créatrices était claire : elles n’en avaient quasiment aucune (à quelques rares exceptions près). Avec la modernité, les portes semblaient s’ouvrir (doucement). Juliette Steiner prend un malin plaisir à montrer qu’il n’en est peut-être rien. Et elle s’attaque à du lourd : Marcel Duchamp.
Musique minimaliste susurrée
un masque s’avance muet sans genre
Gardez le silence !
une des consignes de l’œuvre testament…
celle de Julia Armutt décédée deux ans plus tôt
artiste performeuse et surtout femme de !
Une œuvre posthume à produire à créer à sept
l’accrochage de l’exposition hommage.
À huit car la défunte hante le plateau…
Protocole !
L’exécutrice testamentaire, c’est Rose Lemercier, fille du galeriste qui a lancé la carrière de Marcel Després, le mari de Julia, grâce à l’œuvre : La femme en boîte. Elle a réuni ses proches – les musiciennes Joa et Fred qui partageaient ses performances et sa colocation, deux artistes complices Ingrid et Alexis – mais aussi Richard, le critique emblématique de la phallocratie régnante (mais réputé spécialiste de l’artiste !) et bien sûr sa fille Estelle, enceinte, venue spécialement du Japon car elle avait besoin de prendre cette distance avec sa mère : Maman, j’ai peur de devenir une de tes œuvres.
Comme ils ne se fréquentaient pas – Julia compartimentait –, ils découvrent l’envergure insoupçonnée de l’artiste et surtout son rôle dans la réussite de son mari.
Si Services (2021) restait dans l’anecdote, Juliette Steiner qui a une formation de plasticienne semble ici dans son élément et sait donner une autre dimension à sa proposition.
Ses masques ne sont pas des masques de théâtre mais des créations plastiques « muettes ». Ils passent de mains en mains et incarnent les fantômes du passé – Marcel quelquefois et surtout Julia définitive ombre errante. Les souvenirs, l’histoire resurgissent avec des touches d’humour (noir). Le spectacle stimule la curiosité (tout particulièrement des amateurs d’art contemporain) avec d’habiles clins d’œil, chatouillant même le polar. Des femmes artistes s’invitent, La femme écorchée de Julia rappelle Louise Bourgeois et une tirade sur l’araignée mélomane son œuvre la plus connue : Maman (càd Mutter / Mutt-R).
Mais surtout, les allusions à Marcel Duchamp – même s’il n’est formellement évoqué que dans la feuille de salle – abondent et donnent un corps vibrant et révélateur au projet : l’époux s’appelle Marcel D., Armutt évoque ouvertement R. Mutt, signataire de la Fontaine de Duchamp et diffracte cet épisode fondateur de l’art conceptuel jusqu’au point de bascule – abyssal – de la pièce cautérisé par la poésie (un arrangement du Requiem de Mozart, un tableau vivant évoquant la lumière d’un La Tour…).
Des cloisons caisses à la fois cimaises et cabinets de curiosités glissent, s’ouvrent, se retournent, dévoilent et balisent avec grâce et fluidité l’univers et la vie de Julia (scénographie de Violette Graveline).
Les souvenirs sont des fictions suggère Julia dont la mémoire est écorchée dans Une exposition post-mortem et ce spectacle gigogne qui distille la mécanique de la spoliation.
À la fin, retour au silence.
Au noir aussi…
mise en scène, dramaturgie, direction artistique Juliette Steiner
textes à partir du plateau Cie Quai n°7 & Olivier Sylvestre
avec Camille Falbriard, Ludmila Gander, Ruby Minard, Logan Person,
Yanis Skouta, Naëma Tounsi, Ondine Trager
lumière Ondine Trager
scénographie Violette Graveline
son & musique Ludmila Gander, Naëma Tounsi
foisonnante vitalité
When We See Us
Un siècle de peinture figurative panafricaine
#EXPOSITION
Kunstmuseum Basel | Gegenwart du 25.05 au 27.10.2024
Commissaires : Tandazani Dhlakama, Koyo Kouoh
en collaboration avec Anita Haldemann, Maja Wismer, Daniel Kurjaković
catalogue en anglais, allemand et français, 336 & 120 p., 59 CHF
du mardi au dimanche de 11h à 18h

L’exposition est riche et touffue avec plus de 200 œuvres de 161 artistes du continent mais aussi de la diaspora. Elle investit la totalité du Gegenwart et a été élaborée en 2022 par Koyo Kouoh pour le Zeitz MOCAA qu’elle dirige depuis 2019. Installé au Cap (Afrique du Sud), le Museum of Contemporary Art of Africa est le plus grand au monde dédié à l’art contemporain africain.
Le parcours déploie six thématiques sur les quatre niveaux du musée : Triomphe et émancipation, Sensualité, Spiritualité, Le quotidien, Joie et allégresse, Repos.
Le catalogue en anglais bénéficie d’un tiré à part avec les versions allemandes et françaises des textes qui permet d’élargir l’audience de ce gisement créatif peu présent sur les cimaises du vieux continent surtout avec une telle exhaustivité.
Au-delà de la grande diversité des styles, des sujets, des techniques, l’exposition est d’une étonnante unité. Le visiteur a le sentiment d’être au même endroit en dépit de la taille du territoire documenté : il y a les artistes qui vivent et travaillent en Afrique Noire, mais aussi ceux, assez nombreux, installés aux USA, au Brésil, à Haïti, mais aussi en Grande-Bretagne, République dominicaine, France, Cuba, Bahamas, Italie, Portugal.
Koyo Kouoh évoque le puissant ciment de la Black Joy, mais les toiles – que l’expression picturale soit simple ou élaborée – partagent surtout une belle et sincère vitalité, semblent naître d’une instinctive spontanéité et sont innervées d’une énergie qui impose le sujet avec une puissante évidence, sans forcément s’appesantir sur une mise en contexte.
Le cadre se limite souvent à de simples aplats nets et sans coquetterie – ainsi ils renforcent l’apaisement des deux visages d’Espero que ya le dijiste a tu madre de nosotras (Tiffany de Alfonseca, 2020). Certains cependant travaillent très attentivement le fond pour convoquer les esprits, suggérer l’immatériel : la fougue nocturne exsudant d’un indigo sourd chez Tunji Adeniyi-Jones (Turbulent Youth, 2021), l’extatique assomption lunaire de Dominic Chambers (Blue Parks Lovers, 2020), la stroboscopie gelée de Moké (Kin oyé ou Couloir Madiokoko à Matonge, 1983) ou le paysage allusif et mystique de Pamela Phatsimo Sunstrum (The Two I, 2020).
Quand il y a des annotations, voire des textes plus amples et engagés, une empreinte de l’histoire (statuaire traditionnelle, etc.), cela relève plutôt du clin d’œil ou de l’humour que d’un militantisme revendicatif.
Si des influences (occidentales) sont perceptibles, plutôt qu’une filiation, elles s’imposent comme des évidences partagées, un inconscient collectif assimilé que les artistes s’approprient à leur manière souvent originale.
Si Teju d’Amoako Boafo (2029), fait penser à des personnages de Schiele, le traitement plastique est très différent. Ou la pâte généreuse et festive de The Birthday Party (Esiri Erheriene-Essi, 2021) ou cette segmentation en surfaces géométriques du corps d’I Can’t Keep Making the Same Mistake (Yoyo Lander, 2021) dont la perception reste pourtant intensément organique ou cet esprit expressionniste qui se retrouve de Charles White (The Bridge Party, 1938) à Michael Armitage (The Dumb Oracle, 2019).
À l’occasion, l’artiste sait être sophistiqué et subtilement provoquant comme Roméo Mivekannin avec Le modèle noir, d’après Félix Vallotton (2019). Si dans l’original de 1913, la Noire regarde la Blanche allongée, chez Mivekannin, elle fixe le spectateur. La cigarette au bec renforce l’effronterie du regard et renvoie au modèle de Vallotton : l’Olympia. Ainsi le peintre renverse les valeurs : chez Manet la servante noire n’existe que par le blanc des vêtements, des yeux (à peine), chez Mivekannin, la femme blanche est en effacement. L’Africaine, elle, émerge outrageusement du fond noir qui remplace le vert de Vallotton et tombe conquérant tel une eau mortuaire prête à engloutir la dormeuse. Dernier détail : le support est un vrai drap (la broderie de l’ourlet passe verticalement à la limite des cheveux de la femme couchée) : jeu discret et subtil en habile écho à l’orgie de literie de l’Olympia !
Plutôt que réalisme, il y a compilation afin de restituer un univers, une réalité comme la noce de Matundu Tanda (Untitled, 1988), le Corbillard des Pauvres d’Emma Pap’ (1987) ou Un mardi de Carnaval de Philomé Obin (1960) – étonnamment peu festif. Dans ces cas, l’artiste joue parfois avec les échelles et crée un fourmillement rappelant les scènes de genre ou la vie des Saint(e)s.
La maîtrise technique est là, fascinante : cette ivresse du rouge sur rouge de Lady Gift of a Foreign Land d’Eniwaye Oluwaseyi (2021) !
La synthèse aussi sait être claire et détaillée (Zandile Tshabalala : Two Reclining Women, 2020), torturée de linéaments (Chris Ofili : Within Reach 7, 2002–2003), d’un graphisme constructiviste (Romare Bearden : Jazz Rhapsody, 1982), d’un harmonieux élan articulant les masses colorées (Thenjiwe Niki Nkosi : Ceremony, 2020), jusqu’à l’exigeante économie de Sungi Mlengeya (Constant III, 2019) où l’épure quasi abstraite (et pourtant figurative) profite du contraste peau noire sur support blanc. À l’inverse, d’autres jouent la nuit d’où surgit le blanc des yeux qui fixent le regardeur (Lynette Yiadom-Boakye : A Culmination, 2016).
La peinture se complète souvent de collages : découpages de papiers, de magazines, mais aussi de grandes pièces de tissu comme Cornelius Annor (The Conversation, 2020), voire de bijoux comme sur The Abduction of Ganymede (Devan Shimoyama, 2019).
Au siècle dernier certains peignaient des enseignes : Moustapha Souley (Untitled), Augustin Okoye (Women Perming Styles) ou Johnny Arts (Ozor International Barber also Specialist in Hair Dying and Shamporing, 1962).
Si naïveté il y a, elle serait plutôt dans l’appropriation de l’univers occidental : la suburb avec sa Mercedes de Richard Onyanco (Drosie in Malindi, 1992), la foi dans la révolution Obama (Chéri Chérin) ou d’autres « valeurs » (look, etc.).
Comme le relève la commissaire Koyo Kouoh, L’art est un sismographe extrêmement sensible permettant de lire et d’interpréter les secousses du temps : celles d’un siècle qui a vu la décolonisation et peine aujourd’hui à endiguer la colonisation économique… Mais cette exposition donne à voir qu’en dépit des convulsions de l’histoire, les êtres font toujours irruption avec leur réel foisonnant, leurs identités.
Comme le suggère le titre !
Au rez-de-chaussée, le Studio Gegenwart aménagé spécialement pour ce programme accueillera ateliers, conférences, spectacles…
comme à la Maison…
@Espace 110 | saison 24 25
#THÉÂTRE, DANSE, MUSIQUE
Espace 110, Centre Culturel Illzach, Scène conventionnée d’intérêt national « art et création »
abonnements et billetterie à partir du 3 juin
inscriptions pour les activités à partir du 10 juin

Annonce de saison avec tambours et trompettes : la singularité de l’Espace 110 et l’engagement de son équipe sont reconnus au niveau national. L’Espace 110 est désormais Scène conventionnée d’intérêt national « art et création » et bénéficie du label « Architecture contemporaine remarquable » pour le bâtiment construit en 1984 par Dominique Laburte et Gérard Sutter. C’est aussi l’occasion d’inaugurer les locaux rénovés (avec la fierté que cela ne se voit pas :-)
Ainsi l’emblème qui incarnera la saison 24 25 est la Maison.
Un autre choix fort – de communication – est de mettre en écho les spectacles et l’offre d’activités. C’est lisible dans la plaquette avec le spectacle à gauche et les propositions liées à droite. C’était mis en scène lors de la présentation partagée par le directeur Thomas Ress et les trois responsables des publics, des activités, de la bibliothèque. Une façon d’attirer les spectateurs vers les activités (il y en a 130) et vice versa. De suggérer aussi que toute la famille illzachoise mange ensemble à la même table plutôt que chacun pioche dans le frigo pour aller manger dans son coin…
Et surtout que tous partagent une Maison commune où plusieurs spectacles essayent d’entraîner vers plus de douceur, la douceur du chez-soi.
Il y a la poésie du dompteur de bulles de savon, Sébastien Kauffmann (Déambulation, 6-8.12), la douceur promise par Anne Laure Hagenmuller (Les courants d’air, 7 & 8.12) pour devancer Noël (spectacles gratuits).
Polywere (18.01) pour fuir un monde de brutes ou tel que le pointe Ich wàrt uf de Theo (18.10) ou 1972 (31.01) – l’année du rapport Meadows.
Celle du conte mexicain Des larmes d’eau douce (24.01) pour adoucir la sécheresse ou de Disparaître : Fantômes ! (7.02) pour se préserver ou de Jérémy Fisher (4.04) pour attendrir le regard sur l’altérité (c’est la nouvelle création de Thomas Ress et sa Compagnie des Rives de l’Ill) ou pour la prolonger au-delà du carnaval (Nous quartier libre, 5.04) ou la conquérir malgré le handicap (Frédéric, 3.05) ou les lieux communs : Friendly (9.05) et Soudain, chutes et envols (16.05).
La saison commence dès cet été avec des spectacles gratuits : La tortue de Gauguin (Luc Amoros) et Spoutnik (15.06), Colt (31.08).
La Compagnie Hélios ouvre la saison avec Tchékov (6-14.09) avant que Juliette Steiner ne présente le fruit (très savoureux) de sa résidence : Une exposition (27.09).
Sans oublier…
La musique avec trampoline obligé (Loops, 29 & 30.09), avec le mariage des percussions et du gamelan (Polyphème, 5.10), à Quatre mains (5.11) et Fergessen (Stevensongs, 13.12).
La danse avec la Quinzaine du 5 au 21 mars en partenariat avec La Filature, le Ballet du Rhin pour accueillir Kaori Ito en Robot, l’amour éternel (11.03), les Planètes (15.03) et Justine Berthillot sur roller (Desorden, 18.03).
Et bien sûr la BD avec Un jour, j’irai à Tokyo avec toi ! (une histoire du manga en France, 11 & 12.10), Mille secrets de poussins (13.11) et Bouchka (20.11) en écho à Bédéciné avec Philippe Fenech (série Idéfix) comme invité (16 & 17.11).
sous l’or,
La fleur et le sang se confondent*
Couleur, Gloire et Beauté
#EXPOSITION
Colmar, Musée Unterlinden du 4 mai au 23 septembre 2024
de 9h à 18h tous les jours sauf le mardi
co-commissariat : Camille Broucke, chargée des collections d’art ancien et directrice
& Magali Haas, responsable des collections d’arts graphiques
« Peintures germaniques des collections françaises (1370-1550) »
programme de recherche de l’Institut National d’Histoire de l’Art (INHA)
commissariat scientifique : Isabelle Dubois-Brinkmann & Aude Briau
➕ Besançon, Musée des Beaux-Arts et d’Archéologie
➕ Dijon, Musée des Beaux-Arts
du 4 mai au 23 septembre 2024
catalogue commun aux trois musées, en français ou en allemand, 416 p., 39 €
*Maryse Condé (Moi, Tituba sorcière… 1986)

peinture à l’huile et à tempera sur bois (épicéa) | Musée Unterlinden, Colmar
Depuis 2014, l’Institut National d’Histoire de l’Art (INHA) porte un ambitieux programme de recherche : le Répertoire des peintures germaniques (REPEG). La restitution publique de ce travail « Peintures germaniques des collections françaises (1370–1550) » mené sous la direction d’Isabelle Dubois-Brinkmann, conservatrice en chef du patrimoine, est l’occasion d’une triple exposition avec un catalogue commun. Ce foisonnant panorama est présenté par les musées de trois villes ayant partagé à un moment le destin du Saint-Empire Romain Germanique : le Musée des Beaux-Arts et d’Archéologie de Besançon, le Musée des Beaux-Arts de Dijon, le Musée Unterlinden de Colmar.
[=> l’article sur les deux autres expositions]
Dans la chapelle de l’Ackerhof, le mauve pastel des cimaises agrippe la neige des murs et crée les venelles d’une cité mystique avec ses échappées et ses ouvertures – ogivales bien entendu. Le dispositif s’accorde à la nature des pièces présentées : beaucoup d’éléments de retables avec des volets, des caisses, des prédelles et leurs peintures sur bois : recto et verso ! Des ensembles souvent victimes des aléas du temps : l’évolution du goût, des mœurs et le commerce en ont démembré et éparpillé beaucoup (hors celui d’Issenheim, un seul retable est complet). Grâce au projet, certaines œuvres ont été dénichées dans le recoin d’une chapelle ou d’une réserve, quelquefois dégradées (parmi les nombreux prêts l’étonnant revers de retable peint en grisaille sur fond émeraude de l’église Saint-Georges à Marckolsheim : Vierge à l’enfant au croissant de lune, Christ en croix & généalogie du Christ, vers 1490–1500). Si le travail de recherche a permis d’identifier un Schongauer (retable de saint Barthélemy et sainte Marie-Madeleine vers 1470) et un Dürer (La Crucifixion avec le donateur Kaspar zu Rhein vers 1492–93, validation en cours), ces expositions ont offert l’opportunité de restaurer six ensembles d’œuvres pour les présenter au public.
Sur ce fond délicat (choisi car ce ton est quasi absent de la palette de l’époque), les pourpres, les bleus francs et tranchés des peintures scandent la violence du sang et la sérénité de la maternité. Et puis, omniprésent, l’or remplace les cieux, les paysages, enlumine des auréoles amples et élaborées imposant la lumière céleste.
Cet éclat et cette profusion colorée dressent à la fois l’irrépressible aspiration au paradis et le laborieux chemin pour y accéder. Car ce qui happe le visiteur, ce sont les visages qui surgissent de ces fonds dorés : nombreux, expressifs, quelquefois d’une facture maladroite, souvent d’une grande maîtrise, mais toujours touchants d’humanité. Une impression que renforcent les costumes contemporains : la foule au pied des croix, les martyrs, la meute armée faisant irruption à Gethsémani… Il y a quelques trognes et la grâce des femmes, cette tendresse inclinée vers l’Enfant, cette empathie de Gabriel, la douleur devant les dépouilles, la sérénité des saintes sous la torture.
Le collectif devient la somme active d’individualités aux destins liés par la foi dans cette rédemption conquise par la souffrance sacrificielle du Fils. Les donateurs s’affichent volontiers à genoux et en miniature s’affirmant guides d’un peuple accordé à leur credo. D’autant qu’à l’époque, la mort moissonne (l’espérance de vie plafonne à quarante ans) et les communautés sont réduites (Dijon compte 13 000 habitants en 1474, Strasbourg 16 000 intra-muros en 1444).
Le gothique influence les pièces les plus anciennes avec la présence de transis, la corruption des corps qui renvoient à la finitude et à la vanité de toutes choses. Quand ce morbide-là se contracte, le cinglant du rouge s’invite dans les amples drapées des vêtements, des tentures, l’envers des ailes… Les artistes en restituent l’onctuosité des plis et replis, le flamboiement des jeux d’ombres, l’enrichissent de nombreux et somptueux détails avec une inventive précision : ces plumes de paons dont les yeux ont la forme de cœurs, le lys aux pieds de la Vierge (Martin Schongauer : retable de Jean d’Orlier, 1470–75) ou cette implication curieuse et amusée de personnages annexes comme ces anges qui épient avec tendresse et bienveillance suggérant une porosité entre l’ici et l’au-delà (retable de Sainte-Marguerite, Maître des études de draperies vers 1484–85 ou Cinq saintes en pied, vers 1500). La touche d’espièglerie, la perplexité sont dévolues aux animaux (chiens, chevaux, âne et bœuf de la nativité) ou aux emblèmes des Saints (le porc de saint Antoine du retable d’Orlier).
Même quand le programme est strictement théologique comme la Sainte Trinité (trône de grâce) avec Marie, Saint-Jean l’évangéliste et des anges, (Maître des études de draperies, vers 1480–85), les visages et les expressions se font singuliers, ici, sur un agencement textile qui évoque un voile de Véronique aux dimensions du salut exhibé par le Père.
Un glissement s’opère, les scènes religieuses articulent les personnages jusqu’à devenir une galerie de portraits et les auréoles se font plus discrètes. Le protestantisme réticent à l’ostentation des images favorise ce mouvement vers l’essence de la foi et les peintres interpellent la figure humaine, cette créature faite à l’image de Dieu… La commande privée parachève la bascule avec les portraits de plus en plus nombreux et désormais sur fonds neutres (majoritairement sombres…) : les Bruyn, Cranach, Holbein.
Hans Baldung Grien clôture à la fois le parcours et un cycle (deux portraits et deux saints). Sa peinture tourmentée transcende l’enfer de la corruption héritée du gothique et interpelle le fondement de ce destin imposé par la chute (cf. Sacré | Profane, Karlsruhe 2019). Comme ses collègues désormais, son tragique délaisse les dorures, ils prennent sans doute conscience que le kitsch1 est un paravent qui dissimule la mort. (Milan Kundera, L’insoutenable légèreté de l’être, 1984).
1 en référence au jeu de mots du titre, clin d’œil revendiqué à la série télévisuelle – Amour, Gloire et Beauté – et à son univers kitsch : paillettes, glamour, pullulement de personnages…
__ médiation & animations
Le retable de Mathis Gothart Nithart dit Grünewald, récemment restauré sous l’expertise de l’ancienne directrice Pantxika De Paepe (qui a aussi initié ce volet colmarien et collaboré au catalogue), est bien sûr une des pièces importantes de l’exposition, de même que celles des collections permanentes présentées dans l’aile ouest du cloître.
Là, salle 6, Marion Poulizac et Alicia Stemplowski achèveront la restauration in situ du retable de la vie de la Vierge (vers 1480, huile sur bois, provenant de l’ancienne église des franciscains de Colmar). C’est la première des quatre stations d’un parcours pédagogique « familles » : Matériaux et techniques | Les fonctions des peintures (et des retables) | Peintres, ateliers et commanditaires | Les centres de production et l’évolution des goûts (indiqués par une signalétique enfantine qui fritte un peu avec les œuvres exposées).
__ maquette tactile du Retable

À l’occasion de cette exposition, la maquette tactile2 du Retable d’Issenheim retrouve sa place au sein de la chapelle à proximité des panneaux de Grünewald.
Réalisée en 2012 par le sculpteur et ébéniste Jean-Jacques Erny en collaboration avec Philippe Bury, membre de l’association L’Art au-delà du Regard, elle est composée de trois panneaux, eux-mêmes divisés en trois parties. Chacun d’eux reprend à l’échelle 1/4 l’une des trois ouvertures du polyptyque : la crucifixion, la nativité et l’ensemble sculpté par Nicolas de Haguenau.
Elle permet aux visiteurs mal ou non-voyants de saisir par le toucher la complexité et la composition du chef-d’œuvre. Un nouveau texte à disposition de tous les visiteurs (qui sera bientôt enregistré dans les audioguides) complète le dispositif apportant d’autres précisions notamment sur les couleurs.
L’installation de cette maquette est une étape du programme Art et Santé du Musée Unterlinden – le caring muséum – que souhaite développer la nouvelle directrice Camille Broucke : le musée doit être un espace de bien-être et accessible à tous notamment aux publics dits à « besoins spécifiques » et éloignés des musées pour des raisons de santé, sociales ou économiques. Une réflexion est en cours pour aménager un parcours dans tout le site d’ici 2026.
Deux visites sensibles sont programmées les 8 juin et 9 novembre à 14 h.
La mezzanine de la chapelle avec vue sur le Retable est aménagée en espace de médiation (écrans tactiles), d’expérimentation et de création notamment pour les 7–12 ans.
Le détail des animations proposées est régulièrement mis à jour sur l’agenda du musée.
2 elle a pu être réalisée grâce au mécénat des ROTARY Clubs de Colmar, Deux-Brisach, INNER WHEEL et ROTARACT
attraction expérimentale
Dance with Daemons
Beyeler | Exposition d’été 2024
#EXPOSITION
Riehen (Bâle), Fondation Beyeler du 19.05 au 11.08.2024
Conçu par Sam Keller, Mouna Mekouar, Isabela Mora, Hans Ulrich Obrist, Precious Okoyomon, Philippe Parreno et Tino Sehgal en étroite collaboration avec les participants et participantes
en partenariat avec LUMA Foundation

Avec son Exposition d’été, la Fondation Beyeler souhaite expérimenter : elle a invité plus d’une quarantaine d’artistes à s’approprier et à investir l’ensemble du site, mais aussi à dialoguer et à se mettre en espace avec les œuvres de son fond. L’ancien et le nouveau, de Cézanne à Precious Okoyomon et Dozie Kanu pour les plus jeunes (nés en 1993).
Cette présentation se veut aussi en perpétuelle mutation avec une activité performative continue et seize titres qui s’égraineront au fil de l’été.
Figure importante de l’art contemporain, Philippe Parreno a fédéré les énergies et, dès l’entrée, sa monumentale installation Membrane (13,60 m de haut, 2023) monopolise spectaculairement l’attention (sans doute encore plus la nuit…). Un brouillard artificiel l’assiège régulièrement (600 buses) – de même qu’au nord le Hase en bronze (2013) de Thomas Schütte –, mais le chaland identifiera plutôt un effet spécial qu’un geste artistique (de Fujiko Nakaya).
La pluie des jours précédents et l’« eau potable » diffusée maintenaient la végétation humide offrant une magnifique déclinaison de verts printaniers : la nature est une remarquable et délicate coloriste !
Vers l’ouest, la projection contre le ciel sur écran LED géant d’Untitled (nuage) de Dominique Gonzalez-Foerster (2024) joue la résonance/dissonance avec le véritable ciel. Mais de plus loin, avec la grue d’un côté, les deux Roche Towers de l’autre, les vaches en pâturage champêtre en avant-plan, la lecture change : un objet technologique parmi d’autres…
Et si le Snowman de Peter Fischli & David Weiss (présent depuis 2020) est mentionné, les bancs de Jenny Holzer (Living Series, 1989) sur la promenade ouest ne le sont pas…
En intérieur, l’exposition décline l’abécédaire des 26 salles inventoriant les artistes présentés (y compris dans les toilettes : Ian Cheng, Thousand Lives, 2023–24) et leurs œuvres en rapprochements, confrontations, avec mise à distance ou immersion, voire intervenants…
Dans la partie sud (C–J), le visiteur aura plaisir à retrouver 97 œuvres de la collection dans des arrangements inattendus, parfois provocants ou drôles (Dumas Hodler Léger Mondrian Stingel Tillmans Van Gogh Warhol, pour ne citer que les plus représentés). Apposition souvent serrée… et provisoire : les régisseurs de la maison les décrochent, les déplacent, les stockent, en ramènent d’autres… un ballet d’estive où les appariteurs sont parties prenantes d’une performance perpétuelle, actifs (et soigneux) contrairement au statique Painter de Duane Hanson (1977, T). D’ailleurs dans le foyer (C), une dizaine de grandes toiles sont en attente d’accrochage (Wade Guyton, Untitled, 2023–24).
À l’autre extrémité (Y), 34 sculptures issues du fond créent des couples physiquement très proches, quelquefois improbables et qui se défient souvent du regard : Giacometti vs Picasso ou Brancusi ou Lipchiz, Bourgeois vs Koons, Schütte vs Schütte…
This Joy de Tino Sehgal (2020, 60 min, six transcriptions de l’Ode à la Joie) diffusée dans l’espace voisin (Z) en assure le fond sonore. Des intervenants la psalmodient, la dansent avec une gestuelle évoquant le tai-chi, le public peut s’allonger là voire y participer.
Entre ces deux pôles, s’invitent les propositions des artistes partenaires.
Les plus gourmandes en espace focalisent l’attention : la tension techno-organique de The End of Imagination VI & VII d’Adrián Villar Rojas (2024, 2 salles : O & P), l’écolo-méditative A Library as Large as the World (Federico Campagna, Frida Escobedo, 2024, K), le très techno et captatif Dream Bed (Carsten Höller avec Adam Haar, 2024, V), les aires de projections (L, M, N) ou, plus discrets mais jalonnant le parcours, le livret de photos de Rachel Rose (What Time is Heaven, 2024) ou les Chair (2024) de Dozie Kanu. Régulièrement le visiteur croisera un comédien qui déambule et déclame en anglais.
L’érudit peut s’amuser à identifier les auteurs car il n’y a aucun cartel. Un livret de salles (en anglais) permet cependant de retrouver assez facilement l’information.
Ces dispositifs destinés à surprendre, éventuellement impliquer le visiteur restent chics sans rien de choquant, ils réduisent un peu l’espace de circulation et surtout prolongent l’impression initiale. Membrane de Parreno avec ses filins, ses capsules mobiles renvoie à l’esthétique du Luna Park, ensuite la taille « stand » des œuvres les plus visibles, le kitsch de certaines pièces – aspect cartoon (Pink Panther, 1988) ou poupée gonflable (Titi, 2004–09) de Koons –, le surcroit de rumeur (son de certaines installations) et l’affairement (régisseurs, intervenants…) évoquent une foire du trône (très classy), d’autant plus que traîne une odeur de graillons (le micro-ondes de The End of Imagination fonctionne réellement) et qu’un lounge (S) est intégré au parcours.
À Paris, la Fondation Pinault peut facilement plonger le visiteur en immersion, le site est vertical, caractéristique renforcée par le cylindre de Tadao Ando. À Riehen, la spacieuse et lumineuse galerie tout en longueur de Renzo Piano offre l’espace et la latitude de prendre son temps, et Christian Bobin dans L’homme joie (2012) en suggère l’épaisseur : Le poème, un cercle de silence aux pierres brûlantes.
pierres brûlantes… ces œuvres cueillies au fil d’un temps approfondi.
L’effervescence programmée à Beyeler cet été ne prend-elle pas le contresens de cette poésie que le lieu musée savait préserver ?
autres chemins
@Opéra national du Rhin, saison 2024–2025
#OPÉRA & DANSE
Opéra national du Rhin (Strasbourg), La Filature (Mulhouse), Comédie de Colmar & Théâtre Municipal (Colmar)
abonnements jusqu’au 3 septembre, billetterie à l’unité ensuite
En 2024-2025, le directeur Alain Peroux souhaite musarder Hors les chemins. Si la saison qui s’achève s’articulait autour de quelques « stars », ce sont celles en devenir (hors Natalie Dessay, mais dans une proposition atypique) que sa programmation mettra en lumière. Pour leur permettre de trouver leur chemin ?
Dix opéras, quatre ballets, et toutes les nouvelles productions sont coproduites : une façon de préserver la bonne santé financière de l’institution et une grille tarifaire sous les 100 €.
Abonnements jusqu’au 3 septembre, billetterie à l’unité ensuite.
Mise en bouche de la saison lors de musica (sept) : un opéra de chambre contemporain (5 chanteurs & 20 musiciens de l’OPS) de George Benjamin, le dernier élève d’Olivier Messiaen, Picture a day like this créé à Aix-en-Provence en juillet 2023. Depuis l’ouvrage bénéficie d’un engouement rare : dix productions sont déjà programmées dans trente villes à travers le monde.
Bizarrement l’un des plus beaux opéras de Hændel, Ariodante n’a jamais été programmé par l’OnR. Le projet adopte une autre approche que le récent Polifemo : le chef Christopher Moulds fait travailler un orchestre classique pour trouver les couleurs et la sonorité baroques. En novembre, il retrouvera l’Orchestre Symphonique de Mulhouse qu’il avait déjà dirigé pour Alcina en 2021.
Le spectacle est coproduit avec le Covent Garden dans une mise-en-scène de Jetske Mijnssen (vue à l’OnR en 2019 : La divisione del mondo de Legrenzi).
Aux côtés d’Emöke Baráth et Christophe Dumaux, Adèle Charvet tiendra le rôle-titre (l’an passé, elle avait créé Le journal d’Hélène Berr, monodrame de Bernard Foccroulle).
Elle sera aussi Charlotte dans un one shot de Werther (en concert le 2.02.2025 à Strasbourg).
Deux autres classiques avec Les Contes d’Hoffmann (jan-fév), en version originale avec les scènes parlées, où Lenneke Ruiten chantera les quatre rôles féminins et Jean-Sébastien Bou les quatre de baryton, l’Autrichien Attilio Glaser étant Hoffmann, et La Traviata (mars-avril) avec Martina Russomanno (prise de rôle) et Julia Muzychenko en alternance dans Violetta.
Deux ouvrages s’adressent plutôt au jeune public : Les Trois Brigands (Opéra volant de la saison en nov-déc) commandé à Didier Puntos inspiré de Tomi Ungerer en écho à Strasbourg – Capitale mondiale du livre UNESCO 2024 et Brundibár, l’histoire d’un joueur d’orgue de barbarie, composé en 1938 par Hans Krása classé musicien dégénéré, interné en 1942 à Theresienstadt (Terezín), assassiné à Auschwitz.
Pierre-André Weitz, collaborateur attitré d’Olivier Py, montera la «musikalische Komödie» de Franz Lehár Giuditta (mai-juin) dans la version française créée à Bruxelles en 1936.
Peer Gynt d’Edvard Grieg sera donné en version de concert par l’OPS et son directeur musical Aziz Shokhakimov (14-16 fév à Strasbourg).
Et les habitués strasbourgeois retrouveront les récitals (Orliński, Degout, Petersen, Stemme, Prégardien, Lindsey).
L’esprit de Broadway clôturera la saison lyrique avec Sweeney Todd de Stephen Sondheim (juin-juillet). Reprenant un rôle tenu, entre autres, par Angela Lansbury (créatrice), Emma Thompson, mais aussi Angelika Kirchschlager, Natalie Dessay sera Mrs Lovett pour Barrie Kosky qui avait mis en scène un étouffant (et beau) Pelléas en 2018. Humour noir garanti selon Alain Peroux.
Côté danse
Noces en octobre, avec Nous ne cesserons pas sur la sonate en si mineur de Liszt inspiré du rêve de Jacob qui hante Bruno Bouché (prolongeant Célèbre la terre pour l’ange sur une chaconne de Bach), puis l’oratorio de Stravinski joué par les Percussions de Strasbourg, le chœur de l’OnR et chorégraphié par la québécoise Hélène Blackburn.
Pour les fêtes de fin d’année, Rubén Julliard, jeune chorégraphe issu de la troupe, promet une superproduction festive (140 costumes) avec Casse Noisette.
En mars*, le Ballet rendra hommage à William Forsythe pour ses 75 ans avec trois pièces (2 reprises et 1 entrée au répertoire du Ballet de l’OnR).
Enfin, stimulant spectacle du Projet de territoire, Kamuyot d’Ohad Naharin sera repris d’avril à juin dans des gymnases pour aller vers d’autres publics.
Outre musica, l’OnR s’implique dans le festival Arsmondo (consacré à la Méditerranée en 2025) et la *Quinzaine de la danse (7e édition du 5 au 23 mars 2025, région mulhousienne).
Chrysoline Dupont succèdera le 1er juillet 2026 à Alain Perroux, comme directrice générale de l’Opéra national du Rhin.
Communiqué de presse du 5.07.2024
l’ange à la harpe
les 400 ans du clavecin Ruckers
#EXPOSITION & MUSIQUE
Colmar, Musée Unterlinden d’avril 2024 à janvier 2025
concerts les 12.05 (18 h), 4.10 (19 h) & 6.10 (15 h & 17 h 30)
présentation des deux Ruckers dans la nef de l’Ackerhof du 9 octobre à janvier 2025
de 9h à 18h tous les jours sauf le mardi

Le clavecin Ruckers du musée Unterlinden a été achevé en 1624 à Anvers par Ioannes (1578–1642), aîné de la deuxième génération de la dynastie. Cet anniversaire est l’occasion d’une programmation autour de l’instrument dont quatre concerts.
En automne dans la nef de l’Ackerhof, les visiteurs pourront admirer l’instrument ainsi qu’un de ses cousins (daté de 1612) prêté par le musée d’Amiens/Cité de la Musique. Avec un peu de chance, ils les entendront sonner à l’occasion d’une des masters classes prévues in situ.
Les curieux, les audacieux peut-être, qui s’aventurent au premier étage du cloître des Unterlinden d’ordinaire boudé par les visiteurs pressés, peuvent y découvrir un des joyaux du musée qui est à la fois une œuvre d’art et un instrument d’une exceptionnelle qualité ! Installé la plupart du temps dans le coin nord-ouest du déambulatoire, le clavecin Ruckers, couvercle rabattu, apparaît comme un grand coffre laqué de noir avec une décoration géométrique dorée, le piétement est plus chamarré avec ses colonnettes d’inspiration ionique abondamment couvertes de feuilles d’or.
Si la chance leur sourit, un ou une claveciniste joue l’instrument et le son délicat et fruité envahit les travées avec la netteté piquante des aigus, la chaleur enveloppante des graves surtout si le registre du luth est activé.
S’ils s’approchent, la table d’harmonie est visible avec les oiseaux du décor original et la rosace portant la signature de Ioannes : ses initiales encadrant un ange jouant de la harpe. La bordure interne des éclisses et des échines préserve également une frise caractéristique des Flandres.
Le nom de Ruckers est au clavecin ce que Stradivarius est au violon.
Le fondateur Hans Ruckers (1555–1598) assied la réputation du nom à partir de 1575 et forme ses deux fils qui reprendront l’atelier avant que le cadet Andreas I (1579–1652) ne fonde le sien dont héritera son fils Andreas II (1607–1655). L’aîné Ioannes (1578–1642), sans successeur direct, formera son neveu Ioannes Couchet (1615-1655), fils de leur sœur Catherina.
Grâce à la qualité et l’ampleur de leur son, les instruments de ces trois générations se sont vendus à travers toute l’Europe et il en subsiste aujourd’hui une centaine dont cinq seulement sont en état de jeu.
Cependant le goût et l’écriture musicale évoluaient et variaient d’un pays, d’une tradition à l’autre. Ainsi l’instrument est mis au goût du jour à Paris en 1680 : un « petit ravalement » où les deux claviers sont alignés et un second jeu de huit pieds rajouté sans modifier ni la caisse d’origine, ni la structure interne. Le couvercle est peint à cette occasion avec la joute musicale d’Apollon et de Pan sous l’écoute du roi Midas inspirée des Métamorphoses d’Ovide, le piétement est sans doute aussi réalisé à ce moment-là.
Vers 1720, un éminent facteur parisien, Antoine Vater (1689-après 1759) augmente l’étendue des claviers toujours sans élargissement de la caisse, pour l’adapter aux exigences de la littérature pour clavecin de François Couperin et Jean-Sébastien Bach.
En 1778, le clavecin est mentionné dans l’inventaire du château de Condé-en-Brie (Aisne) où il demeure jusqu’à son classement en 1966. Avant de le mettre en vente en 1980, le dernier propriétaire Xavier de Sade le fait restaurer par le facteur Christopher Clarke qui veille encore aujourd’hui sur l’instrument. La Société Schöngauer s’en porte acquéreur pour enrichir sa collection d’instruments anciens. Il est inauguré par Gustav Leonardt lors d’un concert l’année suivante. Depuis de prestigieux interprètes (Blandine Verlet, Bob van Asperen, Lisa Crawford, Christophe Rousset, Christine Schornsheim notamment, Jean Rondeau désormais) l’ont choisi pour leurs enregistrements, une trentaine à ce jour.
@concerts, conférences, visites, animations
Le dimanche 12 mai, Jean Rondeau, jeune et brillant claveciniste formé au CNSM de Paris, a lancé cette saison anniversaire avec les Suites en Ré, en La, en Fa de Louis Couperin.
Le vendredi 4 octobre (19 h), Christine Schornsheim sera accompagnée de Mayumi Hirasaki & Jonas Zschenderlein (violons), Christian Goosses (alto), Werner Matzke (violoncelle) pour les concertos de clavecin de J.-S. Bach, une occasion rare d’écouter le Ruckers en dialogue avec un ensemble.
Le dimanche 6 octobre, deux concerts permettront de se mettre dans l’oreille la sonorité des deux instruments : le Ruckers de 1612 avec Jean-Luc Ho interprétant L’héritage de Lully (Lully, Muffat, d’Anglebert, Buxtehude, Bach) à 15 h, puis celui du musée avec Christophe Rousset dans Froberger, Louis & François Couperin à 17 h 30.
En complément de ces concerts, des conférences (les facteurs de clavecin Christopher Clarke & Émile Jobin, Jean-Luc Ho, l’historienne Florence Gétreau…), des visites guidées, des animations à destination des plus jeunes (Atelier famille|Happy family) et des « publics empêchés » (le 9.11 à 14 h).
Le détail est régulièrement mis à jour sur l’agenda du musée.
l’éclat de l’épure
Jean Rondeau joue Louis Couperin
Suites en ré, en la, en fa
#MUSIQUE
concert du dimanche 12 mai à La Piscine (Colmar, Musée Unterlinden)
La semaine précédant le concert, le claveciniste a enregistré ces trois Suites et quelques autres pièces de Louis Couperin (1626–1661) dans cette même salle de La Piscine (CD à paraître à l’automne chez ∑rato).
C’était le premier des quatre concerts célébrant le 400e anniversaire du clavecin Ruckers des Unterlinden suivi d’une précieuse (et souvent amusante) conférence du facteur de clavecin Christopher Clarke qui bichonne l’instrument depuis quarante ans.
Avec son allure d’éternel étudiant – cheveux en bataille, chemise au col ouvert, aux manches retroussées –, Jean Rondeau jette un regard un peu étonné vers le public. Il salue timidement, puis s’assied.
Silence. Regard concentré et tactile, il tend la main. Échange vibratoire avec l’instrument. Sans contact : fonder la connivence, s’accorder sur une respiration partagée, un ancrage réciproque dans le rythme, l’intensité. Pour l’élévation.
Ses doigts attentivement touchent le clavier, distillent le premier accord, en ré mineur, ouvrent l’espace au son : un velours pointilliste. Tout semble soudain facile, naturel, d’une lumineuse évidence : la séduction de l’épure que le claveciniste tend en profondeur pour en livrer l’éclat.
Si Bach reste attentif à la séduction mélodique, Louis Couperin est plus austère. Mais les suites (comme chez Bach) sont surtout des danses : allemande, courante, sarabande, canaries…
La danse est affaire de gestes. De geste musical aussi : transcender par l’inventivité la mesure assignée par la chorégraphie.
Aussi l’interprète change de registre : après des sonorités d’orgue, il offre un poudroiement sautillant de chitarrone, puis des éclats de soleil (Canaries) pour revenir avec l’ostinato plus sévère de la Chaconne à des graves ronds et soutenus en résonance avec les aigus cristallins. La variable mécanique (que magnifie le Ruckers) amplifie la diversité des pièces et la légèreté pure et dansante de l’interprétation. Lors des saluts, comme le fait un chef ou un soliste pour l’orchestre, il indiquera le Ruckers pour que public applaudisse l’instrument.
L’auditeur devine un puissant flux qui noue mains bras cœur mémoire et intelligence, avec les doigts qui accomplissent la mise en son nette et habitée. Si la tête du musicien frémit, appuie le geste, d’un mouvement quelquefois plus vif, plus ample, le corps entier vit la pièce, participe à une dramaturgie visuelle : le buste prend ses distances d’avec le clavier, les doigts à bout de bras effleurent les touches, puis la tête ramène le corps vers l’instrument, le musicien s’incline en une ardente écoute qui rappelle cette façon de glisser l’oreille le long du manche qu’avait Rostropovitch pour écouter vivre le son de son Stradivarius Duport.
Le Prélude à l’imitation de Froberger est aérien, puis l’Allemande ramène le terrestre. Sur le fil, il ménage l’ouverture aux silences : une vigilante attention à la respiration de chaque pièce. Avec le changement de registre, le chatoyant se fait plus métallique et bondissant.
La Suite en fa s’ouvre en lumière avant le Tombeau (celui de M. de Blancrocher, dernière pièce de la suite). L’allemande fréquente les dissonances avec un parfum contemporain. La netteté acidulée évoquant un piccolo en pulvérise quelques fragrances qui sont bientôt contaminées par le glas moiré de la basse presque orchestrale : une danse de mort touffue et claire. L’écho affirmé des aigus l’interroge, elle se laisse emporter un temps… Un temps seulement.
Trois notes, finales. Comme gelées. Morendo.
Long silence d’ébène et d’os*. En éclat suspendu.
* les touches du Ruckers sont en tilleul avec un placage d’ébène (marches) et d’os (feintes)
l’envers du monde
Made in Japan.
Estampes d’Hiroshige, Kunisada et Hokusai
#EXPOSITION
Kunstmuseum Basel | Neubau du 16.03 au 21.07.2024
Commissaires : Judith Rauser, Hans Bjarne Thomsen
catalogue en allemand, 240 p., 48 CHF
du mardi au dimanche de 10h à 18h (20h le mercredi)
entrée libre dans les collections en semaine à partir de 17h (sauf jours fériés)

Le Kunstmuseum Basel possède un fond de 350 estampes japonaises qui proviennent majoritairement d’un legs du chimiste et collectionneur d’art bâlois Carl Mettler (1877–1942) au Kupferstichkabinett. Anita Haldemann, directrice a.i. et du cabinet des estampes, souhaitait les montrer au public et aussi poursuivre ce travail sur la mémoire du musée (comme fin 2022 avec Le collectionneur Curt Glaser). 110 pièces (rares pour certaines) de cet âge d’or des XVIIIe et XIXe siècles ont été sélectionnées pour cette exposition et restaurées par Annegret Seger sous l’expertise des commissaires Judith Rauser et Hans Bjarne Thomsen.
Les estampes japonaises s’inscrivent à la confluence d’une tradition picturale célébrant les quatre saisons (shiki-e) ou les sites emblématiques de l’archipel (meisho-e) et l’impression de recueils illustrés, tels des guides de voyages ou des calendriers lunaires, dont les illustrations commencent à être vendues à l’unité. Le retour à la paix intérieure et une certaine prospérité liés à la période Edo (1603–1868) du nom de la nouvelle capitale politique (et future Tokyo) favorisent l’éclosion de la demande pour ces xylographies. La notion de série demeure, ainsi les Trente-six vues du mont Fuji d’Hokusai (1760–1849), Les Cinquante-trois Stations de la route du Tōkaidō d’Hiroshige (1797–1858)… L’ukiyo-e anoblit aussi l’usage du support papier comme outil de communication : affiches, prospectus, programmes, notamment pour le théâtre kabuki.
Si le mouvement et la demande intérieure s’essoufflent au cours du XIXe siècle, la restauration Meiji rouvre le Japon au commerce international et les estampes séduisent de nouveaux collectionneurs en Europe. L’ukiyo-e influence l’Art nouveau et certains impressionnistes (Van Gogh, Toulouse-Lautrec, Monet…) d’autant plus que les Frères Goncourt se font les chantres du japonisme. Le Dr Mettler était d’ailleurs client auprès d’Hayashi Tadamasa, importateur le plus avisé sur la place de Paris (actif entre 1890 et 1906).
En xylogravure, le motif est gravé en relief sur une plaque en bois de cerisier, plus rarement de catalpa (contrairement au cuivre où c’est l’incision en creux qui retient l’encre). Les premières sont éditées vers 1670 en noir et blanc, mais devant l’engouement des amateurs, les éditeurs introduisent la couleur. Suzuki Harunobu (1725 ?–1770) perfectionne et popularise l’« estampe de brocart » (nishiki-e) avec souvent une douzaine de teintes (et autant de plaques) à partir de 1764. L’impression se fait sans presse : le papier d’origine végétale (fibres de mûrier) est appliqué sur le bois encré avec un tampon circulaire (baren) fait d’une ficelle de chanvre roulée, couverte de feuilles de bambous. Pour certains tirages plus précieux (gaufrages, fonds micacés, etc.), l’imprimeur soumet le papier à des manipulations supplémentaires. Ces estampes sont le fruit d’une étroite collaboration entre éditeur, graveur, imprimeur et artiste signataire dont le dessin original disparait lors de l’opération de gravure.
économes et foisonnantes
Les deux premières salles abritent des formats horizontaux, essentiellement des paysages. Beaucoup sont d’Hiroshige (un tiers du fond bâlois) : vues du Tōkaidō, Lieux célèbres de la capitale de l’Est… Ses larges aplats étagent des plans successifs vers l’horizon qui accueillent des personnages caractérisés par leur activité, une bande sombre (bleu le plus souvent, mais pas toujours) ferme le ciel en un dégradé qui ramène le regard vers la scène et, par contraste de densité, donne de la profondeur à l’espace représenté.
Hokusai pousse le procédé jusqu’à une quasi-abstraction. À peine une silhouette, un bateau ponctuent l’immensité, les couleurs magnifient les plages de blancs – des espaces en intemporelle suspension jouant l’ambiguïté : liquide, solide ou nébuleux ? – en écho aux neiges éternelles du mont Fuji, l’environnement accède ainsi à une dimension quasi spirituelle (La rivière Tama dans la province de Musashi | Bushû Tamagawa, vers 1830).
Quelquefois les effets du vent rappellent cette respiration de la nature avec les cerfs-volants (Le sanctuaire de Tenjin à Yushima | Yushima Tenjinja, 1834) ou les kakémonos accrochés aux branches par Shunman (vers 1757–1820, Surimono entouré de poètes | yokoganaba, vers 1800) [ou ce surréaliste envol de feuilles d’arbres et de papier mêlées du Coup de vent d’Hokusai, non présenté, qui a inspiré Jeff Wall].
Hiroshige est sensible aux anecdotes et les Cent vues d’Edo (1856–1858) fourmillent de saynètes avec ses acteurs et ses spectateurs partis prenants d’une foule dont la métropole est en pleine croissance (près d’un million d’habitants au début du XVIIIe siècle). Souvent il « encombre » le premier plan, cette enivrante chorégraphie des ombrelles de Cerisiers en fleurs à Asuka (Asukayama hanami no zu, 1853) ou une structure construite avec un goût pour les charpentes complexes, qui ouvre vers les lointains et, agrandi, affirme une ville en pleine ébullition. Sa gourmandise évoque les tableaux de genre de la Renaissance flamande et dépeint le familier avec un luxe de détails où les jeux voire les rires sont perceptibles.
S’y ajoute une vigueur dans le choix et le traitement des couleurs : à partir de 1829, le bleu de Prusse (chimique), moins fragile et plus dense que le bleu d’origine naturelle, se généralise et les gestes d’encrage sur les aplats leur donnent du corps quand ils ne sont pas habités comme certains ciels (étoiles, flocons…).
immatérielle palpitation
Dans les salles suivantes, le visiteur pénètre dans les intérieurs et rencontre les familiers sur des formats surtout verticaux : les bijin célébrant la beauté des geishas et des courtisanes. Les artistes s’attardent sur le raffinement des somptueuses chevelures noires, parées de peignes et d’épingles d’écaille, de laque ou de nacre, sur la débauche des tissus aux motifs si variés, géométriques ou à fleurs, et aux coupes si sophistiquées, sur les accessoires et les armes aussi, car les acteurs de kabuki représentés dans leurs rôles exhibent le pendant masculin d’Yoshiwara, ce quartier des plaisirs.
Par les pleins et déliés de son trait, Kuniyoshi (1798–1861) accentue leur vigueur, ou celle des drapés des kimonos…
La plupart du temps, la figure humaine est juste une courbe avec quelques traits qui indiquent la bouche, le nez, les yeux et les sourcils qui sont les traces les plus épaisses, même si Sharaku (1770–1825, actif en 1794–95) saigne les visages de grandes bouches coléreuses ou dubitatives.
Quand le plan s’élargit le décor prend vie, ainsi ces ombres sur les paravents chez Eizan (1787–1867) : Rassemblement d’élégantes beautés | Fūryū bi no uchi soroi, (1811–14).
Kunisada (1786–1865) grand spécialiste des acteurs de kabuki, emplit le cadre avec une prolifération de détails sur l’acteur dont ces estampes valorisent le statut de star.
Dans ces portraits, les échanges entre les différents personnages rendent palpables les jeux de pouvoir, de hiérarchie, la rivalité ou la complicité. Leur expressivité passe par le corps entier, les postures, les vêtements, l’activité, le rictus éventuel n’en est qu’un prolongement affirmant l’agressivité d’un personnage qui incarne avec fougue un système guerrier.
Et le visiteur retrouve Hiroshige tout aussi à l‘aise dans la restitution des combats – L’Histoire de la revanche des frères Soga (Soga monogatari zuye, 1848) – que dans la poésie des paysages.
trouble jeu
Utamaro est plus économe et délicat restituant avec tendresse ces femmes agitant des éventails, des miroirs avec ce trouble jeu entre l’avant l’arrière et une discrète (et parfois intrigante) mise en abîme. Certains spécialistes lui prêtent même des allusions bouddhistes dans ses compositions (triade d’Amida).
Ce flottement au-delà de la réalité objective sait esquisser l’immatérielle présence de l’Univers, ce dialogue subtil et vivifiant entre les êtres et leur environnement et trouve un écho ironique dans les incidents anecdotiques d’Hiroshige, comme si les humains étaient des dominos sur un tapis de jeu. [L’extrémité griffue de La Grande Vague de Kanagawa d’Hokusai, non présentée, en est la plus célèbre illustration.]
Au fil des cimaises et de cette mise en beauté fine et délicate de l’Ukiyo-e, ce Levant si lointain nous apparaît soudain familier et vivant. Cependant, si, selon les chroniqueurs, la hiérarchie sociale était gommée à Yoshiwara, l’accès et les commodités que l’habitué pouvait s’y offrir dépendaient de sa fortune…
Un monde flottant sans doute moins idyllique que ne l’affiche la profonde légèreté de ces envoûtantes images qui suggèrent avec une sublime évidence où réside le sens de la création : dans l’art de décrire des objets ordinaires tels que les réfléchiront les miroirs bienveillants du futur, de trouver dans les objets qui nous entourent cette tendresse embaumée que seule la postérité saura discerner et apprécier en ces temps lointains où les petits riens de notre simple quotidien auront pris d’eux-mêmes un air exquis, un air de fête (Vladimir Nabokov, 1925).
la tyrannie du masque
Après la répétition + Persona d’après Ingmar Bergman
Ivo van Hove
#THÉÂTRE
représentation du 22 mars 2024 à La Filature (Mulhouse)

La troisième soirée du portrait d’Ivo van Hove conjugue deux textes reprenant les dialogues des films éponymes d’Ingmar Bergman. Tous deux mettent en jeu le théâtre, l’équilibre délicat entre la représentation et la sincérité, la porosité entre vie réelle et fictive.
Persona, c’est le masque de théâtre romain, s’il détermine le caractère, il permet cependant à l’incarnation personnelle de surgir, par la parole de l’acteur notamment. Les deux pièces brassent ce rapport au masque rendu vif pour la première par le lieu, un plateau de théâtre voué au jeu de masques, et pour la seconde par l’actrice qui rejette l’artifice de la parole. Et il y a une cohérence d’imposer cet ordre-là : le texte de 1984 évoque la mécanique sociale en partie articulée par le « masque », celui de 1966 resserre la question sur l’individu, le corps brut…
Cette perspective ouvre aussi en miroir la trajectoire d’une vie vouée à la représentation et la part personnelle du lien entre le metteur en scène et son actrice (après Persona, Bergman s’installe dans l’île où le film a été tourné et partagera avec Liv Ullman douze ans de vie et de collaboration).
Henrik Vogler (Charles Berling) passe sa vie en scène tel un oracle obstiné dont les illusions s’effritent. Il arpente le plateau à petits pas chiffonnés, de jardin à cour, de cour à jardin. Ce refuge et cette retenue assurent le raisonnable, ils compensent une forme d’échec (il vit seul depuis huit ans, il le dit) et canalisent la frustration récurrente que révèle ce ressassement des mêmes pièces (cinq fois Le songe de Strindberg). Et si souvent la production est conditionnée par le choix de l’actrice principale : offrir le masque qui masque le désir…
Il se confesse à Anna, la fille de la comédienne qui avait incarné le même rôle des années auparavant, mais sa mère lui avait préféré un comédien… Il suggère qu’il a épousé Rachel (dont il est maintenant séparé) par dépit.
La jeune Anna s’avoue comédienne malgré elle et se plaint d’affronter depuis toujours le faux : ses parents comédiens jouaient même leurs scènes de ménage ! Et là, ne la mimétise-t-il pas avec sa mère ? Justine Bachelet joue sur le fil cette fragilité de comédienne convaincue d’être mauvaise. Henrik le lui dit avec un enthousiasme indulgent et la filme en direct : pour scruter le masque, l’en délester ?
Quand Rachel débarque, il est évident que si le lien est rompu, il n’a pas été rien. Peut-être même qu’Henrik en a fui l’intensité… et le glissement vers la folie avec laquelle Rachel cohabite (tant bien que mal). Elle tente de la conjurer par le corps, et par ses gestes, l’intensité de ses déplacements, Emmanuelle Bercot déploie une énergie permanente qui repousse le gouffre. L’amour est une construction de la psyché (et des mots ?), le désir ouvre au réel : l’accouplement serait forcément vrai…
Henrik évacue cet autre masque… car il y a Anna.
Et le vrai, soudain et ductile : cet avortement avoué, dénié, avoué à nouveau, autrement… et les corps désirants. Toujours, quand même.
Les machinistes entrent, évacuent les accessoires… ce fatras qu’Henrik décline d’une production à l’autre.
Ne restent pour Persona que le plateau nu, les trois cloisons qui l’enferment et cette table où repose le corps clinique an-érotique d’Élisabeth comme préparée pour le scalpel du légiste.
Rachel sera Élisabeth (toutes deux ont été tétanisées par le même mutisme dans Électre) : je est une autre… avec la même combustion sur les lèvres de la folie dont le corps dépouillé de tout même des mots ne parvient pas à se débarrasser.
Anna devient Alma, l’infirmière chargée de veiller ce corps devenu masque obstiné du silence. Et loin de tout : les parois tombent.
Le plateau nu entouré d’eau devient cette île (scénographie vibrante et inspirée de Jan Versweyveld).
S’ouvre un temps à habiter et Alma le nourrira de mots : sa vie racontée en confiance, en générosité. Elle dit son corps aussi avec cet avortement. Les deux femmes se trouvent, s’enthousiasment dans la tempête. Face aux machines à vent.
Mais peut-on faire confiance à une actrice ?
Ivo van Hove travaille avec de grands acteurs et leur ouvre l’espace pour s’exprimer. Avec lui, la machinerie du théâtre s’affiche* (ceci est mon masque…), les corps des acteurs lui sont livrés et il dirige cette bataille avec la crudité impitoyable des anatomies affrontées, saisies par les lumières, cinglées par les rafales, nappées par l’eau, les fumées. Chez lui, la beauté n’est pas à l’endroit du désir, mais naît de l’expression envoûtante de la grâce ou malsaine de la souffrance que savent offrir les comédiens, une friction qui subjugue et noue la conscience du spectateur.
Faut-il être infantile pour être un artiste à notre époque comme le suggère Bergman ? Et jouer avec le masque des mots ?
Ou pas ?
Chaque mot est comme une souillure inutile du silence et du néant (Samuel Beckett)…
* rappelant ici le dispositif de mise à distance de l’outil cinéma imaginé par Bergman dans Persona.
avec Emmanuelle Bercot, Charles Berling, Justine Bachelet,
Mama Prassinos, voix d’Isabelle Huppert
texte Ingmar Bergman, traduction Daniel Loayza
mise en scène Ivo van Hove
dramaturgie Peter van Kraaij
scénographie, lumière Jan Versweyveld
conception sonore Roeland Fernhout
costumes An D’Huys
dans l’ombre du tumulte
On achève bien les chevaux
Ballet de l’OnR & Cie des Petits Champs
#DANSE
représentation du 8 mars 2024 à La Filature (Mulhouse)
captation disponible en replay sur France TV jusqu’au 9/01/2025 (gratuit, compte nécessaire)

« Danser au XXIe siècle » est un axe essentiel dans la réflexion et le travail de Bruno Bouché. Avec Les ailes du désir (2021), il avait creusé la proximité entre cinéma et danse. L’été dernier, « pour créer ensemble une nouvelle forme de danse-théâtre », il a associé le CCN • Ballet de l’Opéra national du Rhin à La Compagnie des Petits Champs de Clément Hervieu-Léger et Daniel San Pedro qui assurent la co-mise-en-scène. Le choix s’est porté assez naturellement sur On achève bien les chevaux : l’histoire d’Horace McCoy (1935) se déroule presque intégralement lors d’un marathon de danse (et offre accessoirement une unité de lieu).
La production a été créée le 6 juillet 2023 au festival d’été de Châteauvallon. Elle est reprise à La Filature pour inaugurer la Quinzaine de la Danse et dans la saison 2023-2024 de l’OnR.
Le roman de McCoy est une descente aux enfers et à une époque particulière : les années trente avec la grande dépression et une misère généralisée. Une des motivations des concurrents était de manger à leur faim. Pour cela il fallait rester dans la course : un marathon de danse est surtout un marathon. Le combat de gladiateurs avec ses pouces levés ou baissés n’est pas loin.
Cela est dit, un peu. Mais le roman s’ouvre par le meurtre de Gloria, le spectacle par le nettoyage du parquet pour les danseurs…
Ne pas jouer la noirceur est un choix de l’équipe (la violence omniprésente a été en partie évacuée : celle du directeur Socks, la présence de la pègre, un règlement de compte qui fait deux morts…) avec le souhait (l’obligation ?) de valoriser le corps de ballet. Les défis, les derbys qui permettaient de pimenter et rythmer le marathon, en sont l’occasion et déclinent le joli registre de la troupe. Ainsi la netteté dans la réalisation des gestes, des pas sur des morceaux très populaires dans les fêtes ou le solo en tutu de Deia Cabalé (sur Giselle)… Les numéros s’enchaînent et installent une logique de music-hall. Ce savoir-faire enthousiaste, attentif à l’esthétique, est le produit d’une dense et permanente énergie… pas vraiment en cohérence avec l’immense fatigue induite par des semaines de marathon.
C’est seulement après les derbys, vers la fin, que les corps livrés à eux-mêmes – chacun pour soi décrète Socks – trouvent des pauses de moiteur, que la chorégraphie suggère un peu l’état d’éreintement des organismes ou que le trompettiste Noé Codjia offre un beau moment de suspension embaumé du parfum du roman et, au-delà des compétiteurs, de cet épuisement du monde (C. Mingus).
Cette succession de pas de deux (le plus souvent) et de la meute qui court dans l’arène après les dollars permet de préserver le côté foutraque de l’évènement débordant volontiers la concision chorégraphique. Le mouvement orbital facilite aussi l’alternance de la mise en avant près de la rampe des danseurs (pour le spectacle) et des comédiens (pour la narration).
Gloria (Clémence Boué) s’impose en vrai lien avec le roman. D’emblée en marge, très vite rebelle, sa robe rouge sang proclame son destin tragique et elle surnage comme le dernier Humain, seule consciente que cet « orchestre du Titanic » endiablé n’est qu’une course à l’abîme travaillée par la mort. Avec son comparse Robert (Josua Hoffalt), elle habite avec densité et justesse sa partie dansée (le spectacle leur offre quelques figures) et s’avère plus à l’aise dans le mouvement que les danseurs avec les mots (dans la captation à Lyon, sa belle présence était déjà perceptible).
La lumière les isole tour à tour pour quelques moments réflexifs (reliquats des monologues intérieurs du roman) où Robert tente, avec une retenue désemparée, de saisir qui est cette femme au bord d’un si vertigineux désespoir.
L’adaptation est économe en répliques, une bonne moitié étant dévolue au micro des chauffeurs de salle. Socks, en meneur de jeu (Daniel San Pedro), et ses acolytes viennent régulièrement encourager le public du soir (très bienveillant, pas comme celui du roman excessivement voyeur) à scander le rythme du morceau avec l’envie de transformer le spectacle en aventure collective et festive.
Le choix des costumes comme des musiques fait glisser la compétition vers l’après-guerre (où les marathons périclitaient) et l’excitation des trente glorieuses : ce n’est plus tout à fait la même histoire et le drame de la pauvre Gloria reste dans l’ombre de ce tumulte ébouriffant animé par le mantra de Socks : Tout va bien !
Le spectacle est touffu, plaisant et atypique, mais sans la dimension déchirante hurlée par les cuivres grinçants du jazz, les mots de McCoy et des livres, des films inspirés par cette période douloureuse d’avant-guerre.
Dansez, dansez sinon nous verrons que nous sommes perdus…
avec Daniel San Pedro (Socks),
Clémence Boué (Gloria), Josua Hoffalt (Robert)
et Claude Agrafeil, Louis Berthélémy, Luca Besse,
Stéphane Facco, Juliette Léger, Muriel Zusperreguy,
le CCN • Ballet de l’Opéra national du Rhin
les musiciens Noé Codjia, M’hamed El Menjra,
Maxime Georges, David Paycha
costumes Caroline de Vivaise
scénographie Bogna G. Jaroslawski, Aurélie Maestre
lumières Alban Sauvé
son Nicolas Lespagnol-Rizzi
the space between
Dan Flavin
Dédicaces en lumière
#EXPOSITION
Kunstmuseum Basel | Neubau du 02.03 au 18.08.2024
Commissaires : Josef Helfenstein, Olga Osadtschy
catalogue en allemand ou en anglais, 256 p., 49 CHF
du mardi au dimanche de 10h à 18h (20h le mercredi)

Dan Flavin (1933–1996) a une histoire intense et compliquée avec Bâle. En 1975, une double exposition portée par Carlo Huber, directeur de la Kunsthalle, et Franz Meyer, directeur du Kunstmuseum, permet à l’artiste américain d’exposer cinq installations dans le premier et, dans le second, de découvrir Urs Graf (1485–1529) et de créer pour le patio du Hauptbau untitled (in memory of Urs Graf). Mais cette proposition imaginée comme pérenne a mis des années à emporter l’adhésion de la commission artistique du musée.
Avec 58 travaux, cette grande exposition rétrospective privilégie ceux que Dan Flavin a dédicacés à des personnalités ou des causes. Faut-il voir dans ces adresses une stratégie narrative comme le suggère les commissaires ?
La cage d’escalier du Neubau – avant même d’entrer dans l’exposition – est révélateur du travail de Dan Flavin : sur le mur du palier du 2e étage en face des marches est accroché un agrandissement d’untitled (1961, 13 mots en lettrage manuscrit), mais surtout ce vaste espace baigne dans la lueur vert d’eau d’untitled (to you, Heiner, with admiration and affection, 1973) exposé sur la mezzanine. Le terme « situations » qu’utilise Dan Flavin pour évoquer ses pièces prend ici tout son sens. L’œuvre n’existe pas qu’en soi – comme une toile circonscrite par son cadre ou l’objet qu’a concrètement fabriqué l’artiste visible sur cette mezzanine (salle 5) –, mais génère une entité immatérielle bien plus large qui contamine même le spectateur devenu partie prenante de l’œuvre.

Critiques ou collègues évoquent souvent le minimalisme, celui-ci renvoie au corpus limité produit industriellement que Flavin utilise : quatre tailles de tubes fluorescents (61, 122, 183 ou 244 cm, des anneaux à partir de 1972) disponibles en six couleurs (les primaires, rouge bleu jaune, plus les vert, rose, ultraviolet) et quatre tons de blancs. Ce choix implique une forme de radicalité, mais comme quand Matisse applique la peinture brute telle qu’elle sort du tube.
Si Flavin utilise des lampes fluorescentes standards, il agence le nombre, les couleurs, l’orientation, les rythmes, la perception directe ou indirecte de la source lumineuse inventant une infinie variété de possibilités qui chacune créera une « image gazeuse » au chromatisme généreux et en interaction avec l’espace d’accrochage qu’elle fécondera. Comme Don Judd, il était extrêmement attentif à l’installation de ses œuvres. D’ailleurs la scénographie bâloise a proscrit tout éclairage additionnel et les cartels sont remplacés par un livret de salles.
Quelquefois Flavin assemble une petite série : untitled (to a man, George McGovern) 2, (1972, salle 4) ou untitled (to my dear bitch, Airily) 2 (1985, AC).
Si la lumière est aussi impalpable qu’invasive, elle sait être péremptoire et créer des barrières qui segmentent l’espace (untitled, 1964, salle 2 ou untitled, 1973, salle 5).
Et l’apposition de situations à distance comme untitled (to Barnett Newman) one & four (1971, salle 8) ou untitled (for John Heartfield) (1990, 7 pièces salle 9) produit un jeu entre l’éblouissement tranchant des lampes et l’ombre luminescente qui hante le between.
De prime abord, l’élément de base démultiplié évoque l’usage fonctionnel dans les parkings ou les usines, cependant l’élaboration colorée et formelle d’objets individualisés renvoie à une utilisation plus esthétique voire festive comme pour des vitrines ou des boîtes de nuit. Mais l’artiste sait toujours forger une puissance évocatrice comme avec le rouge strident de l’anguleux monument 4 for those who have been killed in ambush (to P. K. who reminded me about death), 1966, salle 3) contre la guerre du Vietnam.
Par sa pratique, Dan Flavin conforte une méfiance vis-à-vis du statut d’artiste et du vocabulaire du milieu : J’ai heureusement échappé à toute formation professionnelle biaisée dans les écoles d’art. J’ai créé ma propre « éducation » artistique, à tâtons. […] j’étais incapable de croire en la peinture comme une fin en soi, suffisante et pratique. (1989)
La salle 7 se permet un clin d’œil à l’exposition de 1975 avec des dessins d’Urs Graf. Elle présente aussi un ensemble de croquis et de notes permettant de voir les logiques d’élaborations des pièces ainsi que ses admirations et ses connivences : Matisse, Apollinaire, Tatlin, Jaspers Johns, Don Judd… qui sont aussi des dédicataires. Ses adresses indiquent plutôt des parentés, des proximités d’idées (politiques, artistiques) ou des reconnaissances (amicales, professionnelles). Sa façon à lui d’affirmer l’ancrage de ses images gazeuses.
Gazeuses et insaisissables comme la vie…
discrétion assurée
Femmes de génie
Les artistes et leur entourage
#EXPOSITION
Kunstmuseum Basel | Hauptbau du 02.03 au 30.06.2024
Commissaires : Bodo Brinkmann, Katrin Dyballa, Ariane Mensger
catalogue en allemand, 288 p., 48 CHF

Ouvert dans le Hauptbau en même temps que l’exposition consacrée à Dan Flavin, Genialen Frauen est coproduit avec le Bucerius Kunst Forum de Hambourg (14.10.2023 – 28.01.2024).
Des Femmes pleines de génie (pour éviter toute ambiguïté conjugale) réunit dix-neuf artistes femmes et une centaine de toiles, certaines confrontées à celle de leur maître, leur père, leur mari… L’accrochage se concentre sur les monarchies d’Europe de l’ouest – de l’Italie à la mer du Nord – du XVIe siècle au début du XIXe.
Par la suite, avec le déclin de l’aristocratie et l’industrialisation, la donne change progressivement : le cadre est moins corseté et les artistes ne sont plus aussi dépendants des commandes.
Les plus connues, Artemisia Gentileschi et Élisabeth Vigée Le Brun sont bien sûr évoquées dans le catalogue, mais ne figurent pas sur les cimaises car le propos est de mettre en avant des artistes restées dans l’ombre de leurs pairs masculins. Le parcours est thématique, mais tend à remonter vers le nord et à avancer dans la chronologie comme si le froid et le temps canalisaient la fougue perceptible chez les Italiennes et ramenaient leurs consœurs à la raison : rester dans l’intimité du foyer en pratiquant le portrait et la nature morte.
À l’époque, accéder à l’autonomie, et plus encore à la reconnaissance, relevait pour une femme de la gageure : il était inimaginable voire formellement interdit aux femmes d’entrer dans une école, une académie ou une corporation. Celles qui arrivaient à s’imposer prolongeaient une tradition dynastique et se formaient dans l’atelier du père, du mari… Et certaines, comme Rachel Ruysch (1664–1750), parvenaient même à dépasser leur mentor en réputation. Mais des flous subsistent souvent, car leur part dans la production des ateliers n’est pas forcément bien identifiée.
Des autoportraits témoignent d’ailleurs de leur engagement dans les activités artistiques et les montrent au luth, au clavecin avec une partition (Sofonisba Anguissola, Marietta Robusti, Lavinia Fontana). Ce privilège des milieux favorisés permettait quelquefois à la fille d’un noble, d’un bourgeois aisé d’entamer une carrière de peintre (Sofonisba Anguissola, 1532–1625).
Mais régulièrement mariages et grossesses les renvoyaient vers leur statut de femme au foyer (Judith Leyster, 1609–1660)…
La plus connue présentée dans l’exposition est Marietta Robusti, dite la Tintoretta (vers 1554/55–1614). Très jeune, elle a assisté son père Jacopo Robusti, dit Tintoretto (1518/19–1594) à Venise avant de devenir elle-même une peintre à succès. Des études de têtes attestent qu’elle était une vraie force de proposition dans l’atelier.
Et les dessins de ces femmes sont souvent remarquables, ainsi les planches botaniques et entomologiques à la fois rigoureuses et pleines de fantaisie de Maria Sibylla Merian (1647–1717).
Cette maîtrise se retrouve dans les deux cabinets du 1er étage où s’affichent les travaux de trois graveuses : Diana Mantovana (vers 1547–1612), Magdalena de Passe (1600–1638) et Maria Katharina Prestel (1747–1794).
Si tous les genres sont représentés dans l’exposition, les sujets sont majoritairement des portraits et des natures mortes. Il était difficile pour une femme de décrocher des commandes plus ambitieuses : fresques, grands retables… Des genres plus côtés et aussi spectaculairement présents dans l’espace public. Ainsi il était facile pour les chroniqueurs, les historiens d’oublier ces femmes artistes dont les œuvres restaient pour la plupart dans l’espace privé, instinctivement ils étendaient vers la postérité l’ombre dans laquelle leur époque maintenait ces Genialen Frauen.
conjurer le rat race
Chœur des amants de Tiago Rodrigues
#THÉÂTRE
représentation du vendredi 16 février 2024 au Théâtre municipal / Comédie de Colmar

Tiago Rodrigues a créé la pièce, sa première, à Lisbonne en 2007. Elle interroge le couple. Treize ans plus tard, il la reprend, la réécrit. Le recul (et le confinement qui est mentionné ?) lui donne la profondeur du temps. Ce temps à deux. Confrontés au temps…
La Filature avait programmé sa dernière création l’an passé : Dans la mesure de l’impossible. Peu après, en juillet 2023, Tiago Rodrigues a pris la direction du Festival d’Avignon.
À l’opéra, il y a le duo : il permet d’organiser la parole en compréhension pour le spectateur malgré la superposition des voix. Au théâtre ce procédé est rare. Tiago Rodrigues s’est risqué à écrire toute une pièce avec deux voix qui se superposent : un homme (Grégoire Monsaingeon), une femme (Alma Palacios), un couple fusionnel (ils le disent), et au long cours.
Ce qu’ils (se) disent et en même temps : le quotidien, les petites tâches, des choses concrètes pour que la vie avance – à deux, à trois car il y a un enfant.
Ils sont debout face au public, côte à côte, comme en voiture. En voiture on est obligé d’aller au même endroit…
Leurs mots sont presque les mêmes. Presque : les pronoms changent (je, tu) mais cela accrédite l’accord. Les choses déraillent quand le souvenir déraille : sur la gauche. Non ! sur la droite. Là ils se regardent : se remettent en accord par les yeux. Et domestiquent les mots.
Au début, ils sont effectivement en voiture. Ils vont à l’hôpital. En urgence, en affolement : elle est victime d’un accident respiratoire grave.
Le temps, donc la mort se pose sur leur couple.
Puis s’envole mais ouvre ce possible et interpelle sur l’usage du temps.
Et ce mantra ressassé : On a le temps…
On a le temps ! leur façon de conjurer sa fuite. Par les mots…
Qui se taisent. Un temps. Un petit temps après la grande peur. La densité des retrouvailles. Ce moment de grâce : le tea time. Avec le silence !
Mais les mots reviennent. Avec les enjeux. Derrière les petites choses, il y avait, il y a à nouveau la vie. La vie telle qu’on nous la fait avec ses obligations, ses règles, et ces enjeux qu’on nous dit tous les jours : quoi penser, quoi faire !
Alors ils rêvent de jardin, puis de forêt pour gagner le silence. Et prendre le temps !
Mais la forêt n’est pas silencieuse. La vie n’est pas silencieuse.
On a le temps… On a surtout les mots !
Mais peut-être que les mots ne retiennent pas la vie…
On peut résumer une vie, la raconter plus rapidement que ce qu’elle n’a duré, mais on ne peut pas résumer l’amour.
avec Grégoire Monsaingeon & Alma Palacios
scénographie Magda Bizarro & Tiago Rodrigues
lumière Manuel Abrantes
costumes Magda Bizarro
lieto barocco :
la possibilité du miracle
Polifemo de Porpora
#OPÉRA
représentation du dimanche 11 février à l’Opéra national du Rhin (Strasbourg)

Créé en février 1735 au King’s Theatre de Londres, ce drama per musica a été spécifiquement écrit pour réunir les stars de l’époque, les castrati Farinelli (Aci) et Senesino (Ulisse), la Cuzzoni (Galatea), la Bertolli (Calipso) et la basse Antonio Montagnana (Polifemo).
Si la cohérence du livret est fragile, la musique de Porpora se hisse à des sommets proches de son rival, Haendel.
Pour la création française presque trois siècles plus tard, l’Opéra national du Rhin a fait appel à une distribution de très haut vol emmenée par Emmanuelle Haïm.
Le librettiste Paolo Rolli s’abreuve surtout à deux sources : Ovide pour les amours d’Acis et Galathée contrariés par Polyphème et deux épisodes distincts de l’Odyssée pour les démêlés du cyclope avec Ulysse et l’idylle de ce dernier avec Calypso. Le metteur en scène Bruno Ravella résout ces diffractions par la mise en abîme : lors du tournage d’un péplum à Cinecittà, l’actrice jouant la nymphe s’éprend d’un décorateur provoquant la jalousie du comédien qui interprète Polifemo. Celui-ci, comme dans le livret, fait le lien entre les deux histoires, la réelle et la fictive (les aventures cinématographiques d’Ulysse). Au passage, les conditions de peintre et de star transposent joliment le statut de mortel et de divinité.
Le Concert d’Astrée et sa cheffe enthousiasment d’emblée. Emmanuelle Haïm, en affût permanent vers ses instrumentistes et le plateau, est d’une prodigieuse et communicative énergie et toujours d’une fascinante précision. Sa fougue détaille les couleurs d’une instrumentation chatoyante, la pulsation des nombreux récitatifs accompagnés (14 !) qui tendent la dramaturgie et tirent vers la modernité du durchcomponiert (avec même quelquefois un parfum déjà mozartien), et embrase les envolées élégiaques qui s’épanouissent en moments de pure poésie !
Le rideau s’ouvre sur un plateau quasi nu avec seulement deux tours d’éclairage. Les machinistes, la script s’affairent. Les comédiens (cinq des chanteurs) arrivent, échangent, commentent le scénario. Ils restent prudents – l’ouvrage est long (3 h), exigeant pour les voix – et se rapprochent de l’avant-scène : dans cette black box, le son s’évapore facilement vers les cintres.
L’allant des bois, des cors qui donne un rafraîchissant esprit de pastorale avec ses promesses d’amour, est un peu en décalage avec l’image technique et sombre de la scène, mais le duetto Galatea Calipso (n° 4b) permet déjà de goûter le beau mariage entre le timbre clair et charnu de Madison Nonoa et celui vibrant et cuivré de Delphine Galou.
La basse nette et sonore avec un joli « creux » de José Coca Loza (Polifemo), agile et précis dans les vocalises, compose un personnage vaniteux et irascible, très insistant envers sa partenaire. Mais le rôle est ingrat : amoureux éconduit, moins bien servi par la partition (en nombre d’airs) et chantant des coulisses quand son personnage sur scène est une machine.
Paul-Antoine Bénos-Djian (Ulisse) en blouson de cuir roule des mécaniques, manifestement il a fait un détour par le passegiato. En vedette du film, le contralto déroule, un brin bravache, son Core avvezzo al furore (n° 11), et sait ourler de tons diaprés son timbre d’un métal sec mais pur.
Les peintres rapprochent leur grande échelle de la fosse, Aci, vêtements de travail tachés, y grimpe. Au centre du cadre de scène, la projection est idéale, amplifiée par le cyclorama qui est descendu : un paysage mystérieux entre Turner et Böcklin.
En primo uomo, Franco Fagioli exprime son amour inquiet, frémissant (n° 12 & 13) et avec une ardente et jubilatoire facilité enlumine les da capo, vocalisant avec autant de netteté que de virtuosité : une apesanteur incarnée qu’écoutent au-delà du public, la cheffe et tous les musiciens.
Cette générosité contagieuse libère ses collègues d’autant que les éléments de décor rendent dès lors le dispositif plus favorable acoustiquement.
Ses fresche aurette offrent une belle transition vers le tournage.
Une grosse panavision remplace l’échelle et filme le péplum volontiers parodique : le costume d’Ulisse est une musculature en carreau de chocolat et les nymphes des Tahitiennes de music-hall (air tendu et difficile de Nerea, n° 14, mené avec maestria par Alysia Hanshaw de l’Opéra Studio).
Au fil du spectacle, la caméra et le perchiste disparaissent, ne restent que les tours d’éclairages. Cette affirmation du factice qui joue le factice légitime l’invraisemblable, le rend parfois drôle : un charmant troupeau de moutons sur roulettes, des effets spéciaux à la Ed Wood (un machiniste actionne à vue le bras du cyclope).
La production joue habilement des changements d’échelle passant de marionnettes affrontant le géant debout sur l’Etna à Ulisse planté triomphant sur la gigantesque tête du cyclope. Entretemps elle s’attarde sans accrocs à l’intimité du couple Aci & Galatea : niché dans la charpente du décor, leur duetto (n° 43) est un pur moment de grâce !
Au fil du spectacle, Franco Fagioli semble monter en enthousiasme. Régulièrement il esquisse quelques pas de danse, il gère avec aisance son instrument sur la longueur (la fatigue n’affecte jamais le haut de la tessiture) et déploie avec tact et délicatesse d’enivrantes vocalises comme lors de cet aérien dialogue en écho avec le hautbois de Jean-Marc Philippe (Lusingato dalla speme, n° 32). L’ampleur de son ambitus (3 octaves) est plus sensible dans l’Alto Giovo du III (n° 59). Une incarnation superlative, presque surnaturelle !
Si Madison Nonoa est moins prolixe dans les cadenze – elle fréquente aussi un autre répertoire –, elle dessine une Galatea pleine d’assurance à la projection claire, lumineuse avec d’admirables cantabiles : sa déploration d’Aci est particulièrement émouvante (nos 47 & 48).
Le rocher qui terrasse Aci est un projecteur tombé des cintres à l’instigation de la basse que la guardia civile viendra arrêter lors du Lieto fine.
L’entame de ce dernier – un terzetto bientôt amplifié en coro par les trois autres voix – ravive le bel appariement des timbres en guise, espérons-le, d’au revoir !
D’autres bijoux figurent certainement parmi les presque quarante opéras qu’a composés le Napolitain.
Franco Fagioli, Aci
Madison Nonoa, Galatea
Paul-Antoine Bénos-Djian, Ulisse
José Coca Loza, Polifemo
Delphine Galou, Calipso
Alysia Hanshaw, Nerea
décors et costumes Annemarie Woods
lumières D.M. Wood
tempo fuggit
Strasbourg 1560-1600. Le renouveau des arts
#EXPOSITION
Strasbourg, Musée de l’Œuvre Notre-Dame du 2 février au 19 mai 2024
commissariat : Cécile Dupeux, conservatrice en chef du Musée de l’Œuvre Notre-Dame
catalogue dense et documenté, 276 p., 45 €
3 place du Château – 67000 Strasbourg | tél. : +33 (0)3 68 98 50 00
tous les jours sauf lundi de 10 à 13 h et de 14 à 18 h (en continu les samedis et dimanches)

(détrempe sur toile, 64 x 173 cm, Musées de la Ville de Strasbourg)
Les expositions du Musée de l’Œuvre-Notre-Dame documentent régulièrement le foisonnement artistique de la ville. « Strasbourg 1560-1600. Le renouveau des arts » revendique cette continuité après « Strasbourg 1200-1230. La révolution gothique » et « Strasbourg 1400, Un foyer d’art dans l’Europe gothique », voire « Regards sur Hans Baldung Grien » en 2019 où les gravures du peintre bénéficiaient d’une belle et large mise en contexte. Deux personnalités de l’époque Tobias Stimmer (1539–1584) et Wendel Dietterlin (1551–1599) tissent le fil conducteur de cette dernière saison de la Renaissance rhénane.
En 1529, la messe catholique est supprimée dans toutes les églises de Strasbourg (vote des échevins du 20.02) et les premiers réformateurs strasbourgeois, influencés par le Zurichois Ulrich Zwingli, proscrivent les « images » dans les lieux de cultes. La production artistique marque le pas et les artistes se tournent vers un artisanat voisin (l’orfèvrerie notamment).
Mais progressivement l’Église strasbourgeoise se rapproche (pour des raisons plus politiques que religieuses) des conceptions luthériennes moins strictes et la demande renaît dans le cadre privé, puis s’invite à nouveau dans l’espace public (après la signature de l’intérim d’Augsbourg en 1548, les catholiques peuvent à nouveau célébrer la messe à la cathédrale).
La mise à jour et la restauration des projets de Tobias Stimmer pour le buffet de l’horloge astronomique de la cathédrale (vers 1571) – présentés ici pour la première fois au public (salle 4) – ont été le catalyseur de la proposition.
Sur ces dix grands formats en grisaille, le blanc lumineux valorise les carnations et les musculatures, l’inventive fantaisie du décor que ce soient les animaux (paons, dindes, cerfs, fauves, hippogriffes, etc.) ou les chars qu’ils tractent, tous semblent en fougueuse parade dans les nuées suggérées par quelques lignes enlevées. Chaque divinité symbolise un des jours de la semaine et les signes du zodiaque enjolivent les roues.
Dans la salle voisine, figurent ses projets pour les quatre âges de la vie également à la détrempe sur toile avec en regard les sculptures en bois polychrome réalisées d’après ses modèles.
L’énergique élan avec une luxuriance dans le trait et les détails où la présence d’un crâne ou d’un tibia sait suggérer avec délicatesse l’ombre de la mort est au service de la chevauchée du temps et emblématique du maniérisme ornemental dans les pays germaniques.
Tobias Stimmer bénéficiait d’une belle réputation dans sa Suisse natale, quand il est recruté pour réaliser ce décor. Il s’implante durablement dans ce foyer intellectuel et universitaire avec la Haute École (l’actuel Gymnase Jean Sturm fondé en 1538) qu’est Strasbourg et participe activement à son effervescence éditoriale. Ses très nombreuses gravures illustrent les publications des maisons d’édition de Bernard Jobin et de la famille Rihel (près de trois cent titres chacune). Une trentaine d’entre eux sont exposés, écrits par des auteurs comme Fischart (pamphlets et adaptation allemande de Rabelais), l’historien Sleidan, le mathématicien Dasypodius (concepteur de l’horloge), Specklin (architecte des fortifications de la ville) ou Wendel Dietterlin.
Ce dernier publie l’Architectura en 1593 qui sera révisé et réédité régulièrement jusqu’à la fin du XVIIe siècle. Son traité témoigne d’un goût beaucoup plus effusif avec la tentation d’une surenchère baroque. Il reflète l’intense activité de Dietterlin comme décorateur de plus en plus sollicité par les bourgeois nombreux à vouloir embellir de peintures murales leur cité qui compte alors 26 000 habitants. Si beaucoup de ses réalisations ont disparu lors de la grande percée (1910–1960), le parcours offre une belle place aux documents graphiques qui témoignent d’une nouvelle conception de l’espace urbain.
La salle des administrateurs récemment restaurée permet de se faire une idée du cadre de vie de l’époque avec ses admirables boiseries qui inventent des motifs voire des illusions de personnages ou d’animaux en jouant avec le veinage.
De même l’escalier à vis de la cour et l’aile ouest du musée avec au rez-de-chaussée sa salle de la Loge (Sommerhaus, accessible en attendant sa rénovation) datent du XVIe siècle.
Le catalogue édité sous la direction de Cécile Dupeux et Jean-David Huhardeaux Touchais est dense, abondamment documenté et illustré (276 p., 45 €).
L’exposition est l’occasion de rééditer un fac-similé de l’Architectura de Wendel Dietterlin (64 p., 20 €), ainsi qu’une édition famille d’un livre de modèles de 1538, le Kunstbüchlein d’Heinrich Vogtherr, (74 p., 15 €) : Petit livre d’art étrange et merveilleux. Modèles d’hier pour aujourd’hui, à la fois document, mais aussi possible livre de coloriage pour les plus jeunes.
éloge de la complexité
Jeff Wall à Beyeler
#EXPOSITION
Riehen (Bâle), Fondation Beyeler du 28 janvier au 21 avril 2024
commissariat : Sam Keller, directeur de la Fondation Beyeler, & Martin Schwander
beau catalogue en anglais ou en allemand, 208 p., 58 €

Diapositive dans caisson lumineux, 226 x 360,8 cm / Courtesy of the artist © Jeff Wall
Avec cette rétrospective Jeff Wall, c’est seulement la deuxième monographie que la Fondation Beyeler consacre à un photographe, un artiste absent des cimaises de la région depuis presque vingt ans (Schaulager Basel, 2005).
Avec 55 œuvres dans onze salles, des pièces plus anciennes, parfois emblématiques et connus, sont accrochées en regard de toiles (il revendique le mot) des deux dernières décennies, certaines étant montrées pour la première fois.
Présent à Riehen, l’artiste a activement participé à l’élaboration de l’exposition et du catalogue.
La première salle impressionne : de grands formats rétroéclairés donnent le sentiment d’être au dernier étage d’un immeuble dont les vastes baies ouvrent sur Vancouver. Une entrée majestueuse dans le monde du photographe canadien dont l’une des caractéristiques est l’ampleur autant dans la restitution de l’espace que dans ses compositions élaborées souvent comme les peintures d’histoire au XIXe siècle (lui-même évoque l’inspiration de La mort de Sardanapale (Delacroix) pour son premier projet : The Destroyed Room, 1978). Ses admirations sont perceptibles et assumées : Manet (poses très ostensibles des Summer Afternoons, 2013), Hokusai (A Sudden Gust of Wind (after Hokusai), 1993) ou la sophistication des vêtements et du clair-obscur hollandais (After ‘Spring Snow’ by Yukio Mishima, chapter 34, 2002). L’articulation des lignes directrices dans le cadre lui permet de préserver cette profondeur dans les œuvres plus intimes (Diagonal Composition, 1993).
Sa démarche est connue : un long travail préparatoire (qui n’est pas sans rappeler Hopper qui scénarisait ses toiles avant de peindre) avec mise en scène, souvent en studio, et postproduction (il utilise le digital depuis 1993). Pourtant Wall affirme avec netteté la dimension documentaire de ses créations. L’hyperréalisme inhérent au médium n’est qu’un ingrédient. Ses photos « cinématographiques » élaborent un subtil jeu de contrastes, d’affrontements qui restituent le monde dans sa cruauté.
Ainsi dans In front of a night-club (2006), le vendeur de fleurs est noyé dans la jeunesse, l’énergie et l’aisance des fêtards. Leur indifférence (presque tous lui tournent le dos) renforce la brutalité de sa condition de laissé-pour-compte. Même le spectateur peut devenir complice s’il ne prend pas ce temps du regard qui ouvre à l’empathie. L’hyperréalisme photographique renforce précisément les oppositions entre l’ancien des colonnes aux chapiteaux pseudo-ioniens et le prix des pizzas sommairement griffonné, l’effort vestimentaire du quinquagénaire – je m’habille pour le client – et le clinquant tourné vers l’affirmation du soi des jeunes. Pour autant personne ne rayonne de bonheur, les mines sont tristes, la cigarette semble une addiction nécessaire et le geste d’offrir des fleurs appartenir au passé… Un monde ou plutôt une cohabitation passive de mondes qui ne partagent plus grand-chose, où les individus sont dépositaires d’un corps à socialiser dans un domaine public où ça tangue et diffracte sous les injonctions contradictoires (travail vs loisirs, production vs consommation…).
La proposition peut être plus énergique comme dans Actor in two roles (2020) : quatre adolescentes en bataille, tout en os et avec l’agressivité du rose fluo, fusillent du regard la féminité de quatre jeunes femmes fleurs dont les poses valorisent l’arrondi des hanches (mais sans outrancière sexualisation). Une affirmation revendicative s’impose à un instinct plus diffus, mais toutes sont tributaires d’enjeux prescrits que semble attester leur seul point commun : les lunettes. Pour corriger une myopie sur le monde ou aiguiser un regard partisan ?
S’il pointe la diffraction, il suggère aussi l’assimilation par des similitudes de motifs, comme si l’environnement phagocytait ses usagers : le peignoir et le tapis (Staircase & two rooms, 2014) ou la robe et les poufs (A woman with necklace, 2021).
Il sait aussi être poétique (quoique la mort rôde) dans The Flooded Grave (2000) où la tombe remplie d’eau abrite un luxuriant écosystème marin. L’hyperréalisme devient discrètement surréaliste et le spectateur peut s’amuser à découvrir toutes les créatures qui l’ont colonisé comme un aquarium.
Ce jeu avec le rire et le morbide se retrouve dans Dead Troops Talk (1992) ou Dressing poultry (2007).
Ou il invente un délire spatial presque cosmique avec la paperasse emportée par le vent (A Sudden Gust of Wind).
La pathologie moderne de l’esprit est dans l’hyper-simplification qui rend aveugle à la complexité du réel. (Edgar Morin / Introduction à la pensée complexe, 1990)
Jeff Wall réinvente en somptueuses images la pensée complexe à l’opposé du manichéisme mainstream et suggère que ce dernier est d’autant plus brutal que rien n’est aussi tranché qu’il l’affirme car les choses s’imposent de façon sournoise, discrète, mais impitoyable.
l’abstraction en jubilation baroque
art KARLSRUHE 2024
#SALON
art KARLSRUHE 2024 du 22 au 25 février 2024
Messe Karlsruhe | Messeallee 1, D-76287 Rheinstetten
L’édition 2024 de la foire d’art contemporain, la première de la nouvelle direction composée d’Olga Blaß, historienne de l’art, et Kristian Jarmuschek, galeriste et président de la Fédération des galeristes et marchands d’art allemands, retrouve ses dates traditionnelles : fin février.
Le format est plus concentré, 177 galeries (au lieu de 220) originaires de treize pays exposeront dans quatre halls. L’espace dédié à la sculpture est étendu et un nouveau dispositif « re:discover » permet de (re)découvrir vingt artistes injustement négligés par le marché de l’art.
Parmi les galeries présentes cette année, majoritairement allemandes, Radial, implanté à Strasbourg, est l’une des rares à représenter la région.
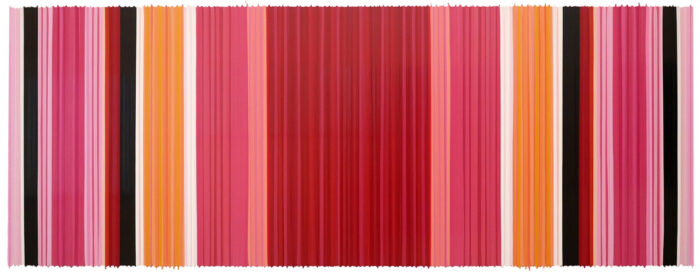
Portrait du galeriste, Frédéric Croizer, avec sa proposition, son projet et ses mots.
galerie Radial
__ le stand
Cette année, j’avais envie de revenir avec des propositions que les gens n’avaient pas encore vues. C’est un exercice assez délicat. Il y a des artistes que j’ai bien installés en Allemagne et donc je suis attendu avec ces artistes et, en même temps, je considère qu’il faut aussi bousculer un peu les règles et prendre le risque de consacrer quelques mètres carrés à un artiste que les gens vont découvrir et on ne sait pas si l’acceptation de l’artiste va être immédiate ou si ça va prendre du temps.
Mon stand (Hall 1 C24) sera consacré à un solo show de Frank Fischer. C’est un artiste suisse assez international.
Il y aura aussi deux découvertes.
Marc Van Cauwenbergh, un artiste américain d’origine belge que j’ai rencontré à New York et qui a fait une série spécifiquement pour la galerie : New York City of Colours. Marc Van Cauwenbergh n’a jamais été montré en Allemagne. Ce sera vraiment une découverte pour le public allemand.
Et ensuite Robert Schad. Lui est connu en Allemagne, mais c’est la première fois que je montrerai ses sculptures sur mon stand. Dans l’esprit de découverte, j’ai décidé de renouer avec les sculptures monumentales : j’en exposerai une qu’on ne puisse pas louper et qui marque tout de suite une identité.
Après j’aurai une programmation avec le côté lyrique d’Alain Clément, les œuvres très minimalistes du suédois Lars Strandh et celles en papier d’un jeune artiste espagnol, Javier Léon Pérez.
__ le projet de la galerie
Les États-Unis ont été vraiment une expérience formatrice pour ce que je fais aujourd’hui. J’ai habité plusieurs fois à New York de 2003 à 2009, à Boston aussi.
Il se trouve que ma meilleure amie à New York était journaliste et représentante permanente pour art actuel [magazine consacré à l’art contemporain international créé en 1999]. Elle avait les portes ouvertes partout, avait fait les interviews des plus grands artistes du monde. Du coup, j’ai rencontré plein de gens, j’ai découvert comment les galeries fonctionnent, comment les institutions fonctionnent. On allait aussi énormément dans les maisons de vente aux enchères. Je voyais les coulisses du métier et la différence de travail entre une galerie privée, une institution, une maison de vente. Ce n’est pas les mêmes gens, les mêmes stratégies. J’ai aussi compris les liens, les ramifications qui existent, mais dont on n’a pas connaissance quand on est néophyte.
Et donc… cette idée a germé : de faire une galerie d’art. J’avais envie de faire quelque chose qui me plaît vraiment, dans laquelle je puisse me sentir à l’aise et de travailler avec des gens où les voyants étaient au vert humainement pour que l’aventure puisse durer. C’est un peu ça l’idée au départ.
En fait j’ai raisonné à l’inverse.
J’ai commencé à fantasmer sur les possibles et je me suis dit : je voudrais travailler avec untel, avec untel et je m’étais fait une short list. Le challenge c’était que ces artistes me disent : oui. Et c’était assez compliqué. J’avais majoritairement des artistes qui n’étaient pas français. Et comment convaincre quelqu’un qui tourne déjà bien de travailler avec quelqu’un qu’il ne connaît pas, en France et dont la galerie à Strasbourg n’existe pas encore…
Certains m’ont tout de suite dit oui parce qu’il y avait une affinité.
D’autres, il a fallu un petit peu œuvrer. Mais ils ont compris que mon projet était sérieux, que je connaissais leur travail et que je ne m’étais pas simplement fié à des photos. Le fait de parler anglais convenablement aussi a permis de débloquer des situations. Ils se sont dit : ce gars va nous défendre.
J’ai pris la décision définitive d’ouvrir la galerie à partir du moment où les artistes de ma short list m’ont dit qu’ils étaient d’accord pour travailler avec moi.
J’ai ouvert au mois d’octobre 2010.
__ les débuts
J’ai vraiment commencé de zéro. Mes premiers clients importants étaient des Suisses que je connaissais comme ça, mais je n’avais pas l’impression qu’ils avaient un goût pour l’art. Eux m’ont beaucoup aidé au départ et m’ont mis le pied à l’étrier. Après le bouche-à-oreille a fait son chemin.
__ les collectionneurs
Pour moi les vrais collectionneurs, c’est un peu un fantasme… et j’ai l’impression que ça existe toujours ! Il y a quand même des gens qui m’achètent des œuvres d’une façon régulière donc je ne sais pas si on peut les appeler des collectionneurs ? En principe oui.
Je pense que ce qui n’existe plus c’est un côté dynastique où, si on avait des aïeux collectionneurs d’art, par imprégnation on le devenait aussi. Là je pense que ça a un peu explosé.
Des gens plus jeunes commencent à arriver chez moi. Ils n’ont pas d’allergie à l’idée d’acquérir des œuvres d’art, simplement comme ce n’est pas leur environnement, ils vont avoir plus de réticences à franchir le pas. Et ils sont sur d’autres projets : le crédit de la maison, le travail, la carrière, les enfants à nourrir… Et c’est un travail d’aller les chercher
__ la ligne éditoriale
Je pense qu’il y a des forces, qu’il y a des vraies démarches artistiques dans chaque artiste avec lequel je travaille. Je n’ai pas l’impression que radical soit le bon terme alors que certains journalistes ou certains collectionneurs me le renvoient dès le début…
J’aurais pu fantasmer d’avoir une galerie qui ressemble à des galeries plus installées, d’avoir une programmation comme Denise René par exemple ou Lahumière ou La Ligne à Zurich, d’être dans ce côté ultra-spécialisé.
Mais moi ce qui m’intéresse, c’est aussi le côté humain qui est complètement subjectif et intuitif.
Par exemple j’ai vraiment eu envie de travailler avec Alain Clément. Je connais son travail depuis que je suis adolescent. Je savais qu’il était un peu en dehors du cadre de ce que je montre d’habitude, mais je me suis dit que cette galerie doit me ressembler et donc au bout d’un moment, il est légitime d’avoir des exceptions qui apparaissent. Si on veut développer une certaine radicalité, il ne faudrait pas succomber à des exceptions.
En même temps, j’ai l’impression que c’est ce que les gens attendent d’un galeriste, de choisir des artistes qu’il a envie de défendre. C’est l’inverse de la facilité.
__ les artistes
Le nombre d’artistes, c’est un truc prépondérant. On ne peut pas faire du bon travail pour plein de gens. Pour organiser des choses, essayer de faire en sorte qu’elles durent, il faut être concentré sur ce qu’on fait.
Alors oui… je veux prendre mon temps. Il y a la curiosité, après il y a le temps de la découverte et puis la décision : est-ce qu’on peut ajouter quelqu’un à son programme ? Si je commence une nouvelle collaboration, j’ai aussi envie que l’artiste ait sa singularité dans mon programme, que ce soit une proposition autonome parmi les autres et en même temps qui prenne sens.
Par exemple Robert Schad, je savais très bien ce qu’il faisait, j’avais déjà soulevé ses sculptures, donné des coups de main à un confrère pour les transporter. J’ai vu pendant des années la progression de son travail et du coup j’ai eu envie de travailler avec lui…
__ créer la confiance
Si on prend l’origine des choses, la Renaissance par exemple, les artistes répondaient à une commande, le donneur d’ordre était très précis et l’artiste devait s’y conformer avec le plus de brio possible.
On pourrait avoir des commanditaires qui voudraient avoir la main sur la création de l’œuvre – par exemple pour des questions de communication, de marketing si c‘est une entreprise. Mais maintenant le regard que les artistes ont sur leur œuvre est complètement différent.
Mon rôle est de créer la rencontre et la compréhension entre le client et l’artiste. Bien sûr on va discuter, il y a un objectif, il y a des contraintes spatiales pour la création d’une œuvre, et ça va être entendu de la part de l’artiste, mais au bout d’un moment il y a de la part de mon client un lâcher-prise et il accepte de donner libre cours à la créativité de l’artiste qui va créer une œuvre qui est 100 % son œuvre. Si on a un artiste qu’on aime, voire qu’on admire, si on commande une œuvre, on sera forcément content du résultat.
Moi j’interviens pour créer cette confiance.
C’est aussi la mission du galeriste de déclencher ce type d’opportunité : avoir des séries entières d’œuvres produites pour la galerie. C’est une sacrée marque de confiance de la part de l’artiste. C’est aussi une manière pour les collectionneurs de voir comment se passe la collaboration entre un artiste et une galerie.
Pour l’instant, il y a un projet qui est déjà réalisé avec la photographe Estelle Lagarde. Et là je travaille sur un projet avec l’artiste suisse Franck Fischer.
__ les galeries vs les institutions
J’observe que les artistes d’autres nationalités ont tous un parcours institutionnel aussi ! Tous mes artistes allemands par exemple sont dans de multiples musées. Et depuis pratiquement toujours.
En France, soit on a l’aura pour avoir des subsides de l’État ou alors on fait carrière avec des galeries. Mais faire les deux, c’est très compliqué, ou si ça se rejoint, c’est en fin de carrière si on a un bon parcours commercial. L’inverse par contre n’est jamais vrai, je crois.
Pour moi il y a quelque chose qui ne fonctionne pas dans cette idée. Si les artistes veulent avoir une activité qui soit pérenne, c’est bien le rôle des collectionneurs, des galeristes d’acquérir des œuvres d’artistes en cours de parcours.
Les artistes qui ont un parcours uniquement institutionnel se coupent complètement de la partie commerciale, ça semble être complètement antinomique. L’institution peut apporter un coup de projecteur sur un artiste, peut valoriser son parcours, sa reconnaissance, mais un musée ne va pas acheter des œuvres tous les ans à tout le monde.
La régularité de revenus c’est quand même les galeries qui peuvent l’apporter. Et il n’y a pas de différence de qualité a priori.
__ les perspectives
C’est un métier qui est extrêmement compliqué. On est sujet à un tas de variations. J’ai eu la chance de travailler avec des artistes qui ont tous fait un super beau parcours. Une part de mes clients du début clairement ne peut plus acheter les œuvres des mêmes artistes aujourd’hui. Il a fallu que j’aille chercher des clients qui soient capables de mettre un petit peu plus d’argent dans les artistes que je représente.
Mais l’acquisition d’œuvres d’Alain Clément ou d’Ewerdt Hilgemann ou d’un autre va être faite par rencontre avec l’œuvre, par passion, mais pas envisagée comme placement financier.
Je suis dans une niche où je m’adresse quasiment exclusivement à des passionnés.
On ne peut pas être uniquement factuel en disant : vous cherchez un tableau noir ? Tiens j’en ai un, il fait telle taille, il va sur le mur. Non !
C’est une profession qui a un côté irrationnel
Les gens viennent chercher quelque chose de précis et une fois qu’ils l’ont obtenu, la deuxième acquisition, elle est déjà quasiment sur les rails, au moins dans la tête. Parce qu’une fois qu’on a l’œuvre qui avait une destination spéciale, on a envie d’autre chose. C’est quand on ne se pose plus de questions, qu’on fait les meilleurs choix. À partir du moment où ils ont découvert un artiste et qu’ils aiment l’artiste, la question de l’œuvre en elle-même ne se pose presque plus.
De toute façon pour faire ce métier, il faut être optimiste.
le corps en jeu
Frisbee !
Sports et loisirs, Collection Würth
#EXPOSITION
Erstein, Musée Würth du 27 janvier au 15 septembre 2024
commissariat : Marie-France Bertrand, Estelle Zech
catalogue de belle tenue en allemand accompagné d’un livret avec la traduction en français (32 €)
entrée gratuite de 10h à 17h (18h le dimanche), fermé le lundi

Les JO 2024 offrent l’opportunité au musée d’évoquer grâce aux œuvres de la collection Würth le nouveau rapport à l’espace et au temps né de l’industrialisation : « sports, loisirs & jeux ».
L’article est paru en mars dans Novo n°72 (p. 30)
l’usage de la folie
Phèdre de Jean Racine
#THÉÂTRE
représentation du 27 janvier à la Comédie de Colmar

Après un classique contemporain très réussi : La nuit juste avant les forêts de Bernard-Marie Koltès (octobre 2021), Matthieu Cruciani s’empare de Phèdre de Jean Racine : un grand classique en alexandrins. Un théâtre indémodable plus de trois siècles après ? Son travail tend à le montrer !
La vie est un perpétuel chantier.
Le décor : une vaste salle dans un palais, en cours ou en attente de travaux. Un espace proche de l’épure avec quelques tissus gris qui protègent de la poussière, celle du temps aussi, avec sans doute un instinctif désir que les choses ne bougent pas, ne changent pas. Les personnages les retireront à l’occasion, en dévoileront les secrets : l’immuable fatum – le massacre du minotaure – ou les atavismes – une bouteille de whisky et quelques verres… et un grand miroir : celui des illusions.
Pour chaque acte, les personnages changent de costumes – contemporains – donnant du temps au temps : une discrète entorse à l’unité du théâtre classique.
Les thèmes de Carla Pallone s’invitent en bande-son, accentuent les moments de tensions comme si la musique appuyait là où ça fait mal…
L’œuvre s’ouvre avec Hippolyte (Maurin Ollès). Il confesse son amour pour Aricie et, dans ses aveux, il expose : les querelles dynastiques, celles des dieux, les destins à conquérir ou assignés, les tensions et malentendus qui en découlent, une transmission empesée par le rythme alexandrin. Comme peu après quand la jeune femme (Ambre Febvre) déterminée, énergique, mais avec une projection de voix fragile, le provoque avant d’accepter de fuir avec lui.
La vie surgit avec Phèdre : une femme en être, en émotions ! Elle subit le reste en serrant les dents. Une femme amoureuse : elle n’est que cela, à la folie, n’a aucune envie d’être autre chose. Pourtant elle bataille, se soumet à la loi, évacue son amour pour Hippolyte en fuyant sa présence. Mais ça déborde de partout. Tellement qu’elle veut mourir depuis des semaines ! Et si personne dans le palais n’en connaît la cause, cet effondrement se voit, se sait.
De bout en bout, Hélène Viviès porte ce destin, le vit – y survit – et le déroule avec une intense sincérité, par-delà l’alexandrin, telle une symphonie avec ses strettes et ses andantes, ses fortes et ses pianissimi, s’astreignant à un maestoso noble et fissuré face au mur des conventions. Face à Thésée.
Mais Thésée est annoncé mort.
Sa propre mort est suspendue quelques heures : les chaînes tombent, le volcan peut entrer en éruption !
Si la donne change, les enjeux restent. Fine et calculatrice, Œnone (Lina Alsayed) distille avec une lucidité clinique le nouveau périmètre des pouvoirs, détaille comment en tirer bénéfice, une stratège altière qui, dans sa gourmandise, arme la malédiction vers la fatale issue (y compris la sienne).
Car Phèdre n’est pas de cette eau-là. Elle bouillonne : Thésée mort, elle n’est plus adultère et l’inceste est formellement évacué.
Elle prend toute sa nouvelle liberté, sans calcul, et se livre. Et s’y fracasse !
Le retour de Thésée ne sera que le coup de grâce.
Son maître et sa meute – costard cravate noirs – reviennent prendre possession de ce qui lui appartient, envahissent l’espace depuis la salle et il réclame des comptes – comme le Hunding de Chéreau à Bayreuth (1976-1980) ou un chef mafieux de Coppola ou Scorsese avec ses portes flingues.
Droite, sédimentée par la volonté, Phèdre affronte son mari en statue dorée : ce lamé qui semble la tenir debout. Mais la trahit aussi avec la traîne qui s’en détache.
Thésée (Thomas Gonzalez), velléitaire et emporté – dans un accès de colère, il arrache les bâches plastiques vers la terrasse –, affirme son patriarcat mortifère, autoritaire sans pour autant s’embarrasser des conventions dont il se revendique le garant – il arpente le plateau en slip.
C’est dans sa robe à fleurs noires du début que Phèdre viendra mourir à ses pieds : les belles âmes n’appartiennent à personne.
Thésée restera seul, isolé dans l’absurdité d’un pouvoir immuable et assassin.
Les travaux produisent des ruines…
Actuel Racine avec ses alexandrins ?
Le récit tendu et habité de Théramène (Philippe Smith) nous submerge par sa sanguinaire folie : la mort d’Hippolyte, fruit de la malédiction et des calculs de son père avec la féroce complicité des dieux.
Cette monstruosité ne nous renvoie-t-elle pas à celle surgie à nos portes en Ukraine, à Gaza ?
Les divinités des anciens incarnent ces pulsions barbares tapies dans nos consciences et prêtes à nous contaminer.
Tant de mots les disent. Les mots sales comme les qualifiait Christian Bobin.
Et les grandes douleurs sont muettes comme l’extinction de Phèdre… qui ainsi échappe aux mots. Et leur folie !
avec Lina Alsayed (Œnone), Jade Emmanuel+ (Ismène & Panope),
Ambre Febvre (Aricie), Thomas Gonzalez (Thésée),
Maurin Ollès (Hippolyte), Philippe Smith (Théramène),
Hélène Viviès (Phèdre)
mise en scène Matthieu Cruciani
scénographie Nicolas Marie, lumière Kelig Le Bars
création musicale Carla Pallone
costumes Pauline Kieffer
+membre de la jeune troupe
en répétitions à la CC
répétition du 11 janvier à la Comédie de Colmar
Pour nourrir cette complicité qu’il entretient avec son public depuis qu’il codirige la Comédie de Colmar, Matthieu Cruciani a ouvert une répétition de Phèdre et évoqué son travail sur la pièce avec les nombreux spectateurs présents.
Début du cinquième acte à quinze jours de la première.
Tu frémiras d’horreur si je romps le silence.
Les mots de Phèdre (I, 3).
Pourtant d’Euripide à Racine en passant par Sénèque et tant d’autres tombés dans l’oubli des encyclopédies, beaucoup de mots ont été mis dans la bouche de la fille de Minos. Même la Phèdre et Hippolyte (titre originel) de Racine s’est retrouvée dès le surlendemain de sa création (1.01.1677) en concurrence avec celle de Nicolas Pradon créée sur une scène voisine.
Pourtant la monstruosité est omniprésente, dans les mots – 18 occurrences de monstre –, et le metteur en scène relève que personne ne veut jouer cette pièce : dans les dix premières minutes tous les personnages annoncent qu’ils vont partir !
Aussi l’espace sera en friche : une pièce encore en travaux que s’est appropriée Hippolyte dans un palais secondaire avec vue sur la mer, un matelas contre un mur, des chaises en plastique comme dans une salle d’attente et des personnages en transit – une cravate défaite, un bagage, un peignoir…
Le théâtre classique a ses règles d’unité, de bienséance. Matthieu Cruciani se permet certaines libertés et souhaite insuffler une dynamique cinéma : l’espace évolue au fil des actes, bande son de Carla Pallone. Et il insiste sur la jeunesse de Phèdre, une certaine marginalité d’Hippolyte.
Et toujours les mots : le lexique de Phèdre, c’est 3 000 mots, moins que le vocabulaire d’un élève du cours élémentaire. Une économie de la tragédie que Rameau avait bien compris notamment avec la mort de Phèdre* : Quelle plainte en ces lieux m’appelle ? Pas de da capo, pas de vocalises : le texte avant tout, le thrène des chœurs écrin du texte magnifié jusqu’à l’extinction, la beauté de la ligne lui ouvrant l’éternité du silence…
Le soir de la répétition Phèdre (Hélène Viviès) n’avait pas de mots : Matthieu a arrêté la répétition avant sa scène finale (ne pas spoiler ?). Le public les découvrira à partir du 25 janvier.
* Hippolyte et Aricie (1733), livret de l’abbé Simon-Joseph Pellegrin, inspiré en partie de la Phèdre de Racine
Papierkram
L’araignée de Charlotte Lagrange
#THÉÂTRE
représentation du vendredi 19 janvier 2024 à l’Espace 110 (Illzach)
encore 6 autres dates jusqu’au 7/06/2024

Installée à Strasbourg depuis 2013, la compagnie La Chair du Monde interroge le politique par le biais de l’intime « en postulant que l’intime est toujours déjà politique ». La pièce créée en mars 2020 est éditée chez Théâtre Ouvert.
En amont, Charlotte Lagrange a rencontré lors d’une résidence d’écriture à Montbéliard des éducateurs, des avocats, des juristes, des attachés parlementaires, des référents administratifs de l’ASE (Aide Sociale à l’Enfance). Tous refusaient d’être enregistrés, tous dénonçaient « un système dysfonctionnel » rendant impossible l’accueil décent des MNA (Mineurs Non Accompagnés)…
Du théâtre documenté sans être documentaire.
Elle n’a pas de nom, seulement sa conscience de femme, de mère avec ses ressentis, ses émotions (le mensonge la révolte) et une empathie instinctive. Pourtant il ne faudrait pas, tout le monde le lui dit, ses collègues, son mari : ce n’est que du travail. Car elle peine à trouver l’équilibre entre l’humanité – d’une nécessaire évidence face à ces jeunes êtres bien réels qui montent tant bien que mal leurs dossiers – et sa mission de fonctionnaire intraitable chargée de faire appliquer les règles. Le système est dysfonctionnel : il est au croisement des gesticulations politiques empêtrées dans l’urgence du temps médiatique et le dur de la bureaucratie qui avance à la vitesse géologique et dont elle est une des petites mains.
Pourtant elle a changé de bureau : elle ne s’occupe plus des MNA. Mais ça la travaille ! Encore, toujours !
Vous enregistrez ? Est-ce que vous enregistrez là ? Parce que moi je ne veux pas.
Si ça ne vous dérange pas, je ne préfère pas. Sinon je ne parle pas…
Un malaise obsessionnel ! Comment rester humaine face à cette logique hygiéniste qui contamine sans qu’on n’y prenne garde, pousse à la brutalité sous couvert de bonne volonté : ces coups de dossier assénés par son N+1 ou ces marrons apportés pas sa N+2 contre l’araignée qui a élu domicile dans son bureau… Elle l’a appelée Renée (allusion à renaître) et l’observe fascinée et défiante : une figure d’altérité – je reste humaine – et l’incarnation de la toile nasse qu’elle tisse…
Comme l’écrit Nuruddin Farah (Dons, 1986) : « Il est dans la nature de la bureaucratie de se perpétuer elle-même ». D’ailleurs elle met en place son propre monde avec sa propre langue infestée par tous ces acronymes balisant le labyrinthe vers la régularisation : une oralité bureaucratique où se mélangent les mots étranges de l’administration et les mots étrangers en bambara ou en soninké appris de ces interlocuteurs. Une religion du Papierkram qui fait plus rimer bureaucratie avec théocratie qu’avec démocratie. Ce Sprachekram emporte Marushka Jury dans un ballet phonétique où elle disperse par généreuse poignée les dossiers empilés autour d’elle. Et elle danse, joyeuse, délirante, sous ce caisson de néons qui surplombe le plateau-bureau devenu aquarium. Bientôt il pleure et trempe l’interprète et sa paperasse d’une eau lustrale : un lâcher-prise où elle constate qu’il est « de plus en plus difficile de changer les choses de l’intérieur. » Et que, malgré la bonne volonté, « Chacun entrait quelque part en « collaboration » avec un système qu’il dénonçait. »
Restent ces jeunes, ces Êtres, ces enfants qu’a si bien saisis Peter Handke et que dit sur son smartphone la voix de Bruno Ganz : le Lied vom Kindsein* qu’elle traduit à la volée.
Avant de proférer cette litanie de prénoms. De destins !
* Chant de l’Être Enfant, le sein allemand suggérant une dimension ontologique, qui ouvre Les Ailes du Désir de Wim Wenders (Der Himmel über Berlin, 1987).
Le mot allemand Papierkram est un équivalent péjoratif de paperasserie. Sprache, c’est la langue.
avec Marushka Jury
texte et mise en scène Charlotte Lagrange
scénographie Camille Riquier, lumières Kevin Briard
création sonore Mélanie Péclat