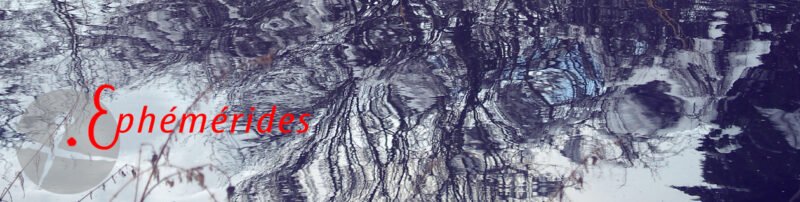un regard et des choix – forcément subjectifs – sur l’offre culturelle 2025…
#LIVRES : L’imaginaire artistique d’un Musée Zoologique (P. Ardenne, D. Payot, G. Rœsz, L. Maechel), Robert Cahen De la trame au drame (J.-P. Fargier)
#CINÉMA : Entrevues 2025, 40e édition (Zone grise, Dry Leaf, Anoche conquisté Tebas, Il manque toujours quelque chose, Sweetie, Still Playing, Bürglkopf, Lonig & Havendel) / Goliath, Germaine et moi (G. Morinière)
#EXPOSITIONS (en gras celles toujours en place) :
| Fondation Beyeler (Riehen/Bâle) : Vija Celmins / La Clef des songes / Yayoi Kusama / Lumières du Nord
| Kunstmuseum Basel : Geister Ghosts Sur les traces du surnaturel / Medardo Rosso L’invention de la sculpture moderne / Cassidy Toner. Besides the Point / Verso
| anonymous-famous, C. Hohler & R.E. Waydelich (Fondation Fernet-Branca, Saint-Louis), Véronique Arnold à Art | Basel, Le monde du vivant – 2e Biennale d’art contemporain (Bischwiller), Murmure des âmes –
Joseph Bey (Apollonia, Strasbourg), Élisabeth Bourdon (Temple Saint-Étienne, Mulhouse), Pierre Coulibeuf & Jérôme Game (galerie de La Filature, Mulhouse), Garden–Party (Musée Würth, Erstein), Mina Mond (St-Art 2025), réouverture du Musée Zoologique de Strasbourg, Un passé incontournable (Galerie Heitz, palais Rohan, Strasbourg), Bonheurs et exil – Sauveur Pascual (Mulhouse, Temple Saint-Étienne), Ressources humaines (Galerie Radial, Strasbourg), Germain Roesz, Forger lumière (Espace d’art PASO, Drusenheim), Sortie de réserves #1 (musée Unterlinden, Colmar), Le souffle de la subsistance– Regionale 26 (Kunsthalle & Filature, Mulhouse), Mémoires Croisées – R.E. Waydelich (Espace d’Art PASO, Drusenheim), Robert Weaver / Tomi Ungerer. L’illustration en action (Musée Tomi Ungerer, Strasbourg), Andrée Weschler (La Case à Preuschdorf)
#SPECTACLES VIVANTS :
All Over Nymphéas (Emmanuel Eggermont), La Perle (Sayeh Sirvani), Otello (Verdi/S. Scappucci + T. Huffman), Croire aux fauves (N. Martin/L. Werkmann), En regard (L. Lerus & S. Eyal/Ballet de l’OnR), Le roi nu & Je suis la bête (E. Schwartz & A. Sibran/Bussang 2025), Brundibár (H. Krása/S. Abello, J. Candel), Makbeth (Shakespeare/Munstrum Théâtre), On ne choisit pas ses fantômes (M. Moritz), Jérémy Fisher (M. Rouabhi/T. Ress), Le Misanthrope (Molière/S. Delétang), Phèdre (Racine/A-L Liégeois), Naharin’s Virus (O. Naharin, The Batsheva Ensemble), Planètes (J. Brabant), Robot, l’amour éternel (K. Ito), EXIT ABOVE d’après la tempête (A.T. De Keersmaeker, Rosas), Le Château des Carpathes (J. Verne/E. Capliez), 1972 (F. Cacheux, N. Öhlund), Polywere (C. Monin, C. Arthus)
@SAISONS 2025-26 : Opéra national du Rhin • La Filature (Mulhouse) • Espace 110 (Illzach) • Comédie de Colmar
@avant-papier sur présentation de presse et documents remis
Sur la page d’accueil, des informations actualisées sur les évènements encore accessibles.
εphεmεrides 2026 • 2024 • 2023 • 2022 • 2021 • 2020 • 2019 • 2018 • avant
résistance vs obsolescence

Le souffle de la subsistance – Regionale 26
#EXPOSITION
Mulhouse,
__ La Kunsthalle du 28 novembre 2025 au 11 janvier 2026
__ galerie de La Filature, Scène nationale du 27 novembre 2025 au 4 janvier 2026
commissariat Licia Demuro
La Regionale est le fruit d’une coopération transfrontalière de dix-neuf institutions en Alsace, à Bâle et dans le pays de Bade exposant 185 projets sur une vingtaine de sites.
L’accrochage mulhousien de la 26e édition est accueilli par La Kunsthalle et la galerie de La Filature, aussi la commissaire Licia Demuro l’a conçue en deux chapitres. Certains des 17 artistes sélectionnés (sur 900 propositions) exposent dans les deux structures.
Pour éclairer ses choix, Licia Demuro évoque la filiation avec l’arte povera (mouvement actif principalement de 1966 à 1992), avec les œuvres à protocole (sur lesquelles elle a travaillé au Frac Lorraine) et surtout l’articulation autour de la notion de subsistance inspirée des travaux de la sociologue Geneviève Pruvost.
En alternatives aux logiques imposées par le marché et la société de consommation qui conditionnent fermement notre quotidien (produits industriels formatés et standardisés, sous-traitance, spécialisation et délégation, anonymisation, omniprésence de la technologie…), de nouveaux usages apparaissent : circuits courts, autoproduction, low tech, etc.
La commissaire cite François Génot (non exposé) qui a intégré cette approche dans sa pratique artistique, fabriquant ses propres fusains à partir de la végétation ou du bois trouvés dans ses proximités.
La proposition est louablement écologique, elle est aussi l’occasion de produire un ample appareillage critique, documentaire, de mise en perspective des pièces exposées.
Ajouter encore du texte à ce foisonnement n’est pas forcément nécessaire (et inévitablement partial vu le nombre d’artistes et de démarches), toutes les informations sont facilement accessibles sur la page web de l’exposition ou de la galerie et pour les plus curieux de la Regionale.
À noter, la présence d’œuvres des deux derniers prix Théophile-Schuler attribués à des artistes émergents par la Société des Amis des Arts et des Musées de Strasbourg (SAAMS) à St-Art 2024 et 2025.
Yoshikazu Goulven Le Maître travaille l’animal à partir de matériaux récupérés, souvent des tissus. Cet été, il a présenté deux grandes sculptures (en métal) à la 2e Biennale d’art contemporain de Bischwiller (Le monde du vivant). À La Filature, il a installé une joyeuse volière de passereaux en chiffons, liège et muselets : Les Petits Oiseaux (2023).
Pour Valentine Cotte, travailler la glaise est une forme d’autothérapie (vidéo de la performance Massa à Erretegia en 2020). Elle croise son goût pour la culture médiévale – telle sa cotte de mailles en céramique exposée à St-Art 2025 – avec le détournement, ainsi sa Théière d’adelphité (2023) avec quatorze becs verseurs et une trace de gintsugi ou son bestiaire de (très petites) gravures imprimées sur des compresses de pharmacie (à la Filature), une occasion aussi de jouer sur les mots : la série s’intitule Tes maux (2022) et les pièces Panse-ments.
La nature est omniprésente soit comme sujet représenté, souvent comme matière première. Ainsi pour son vaste mobile Prière sylvestre (2025, graines diverses – châtaignes, cupules de glands, faines –, fil, branches), Juliette Dignat assemble des éléments végétaux glanés avec du fil en nylon industriel… compromettant un peu la conformité au postulat.
En collectant Les Outils-Bêtes (2024), Arthur Debert magnifie certes les outils anciens de son grand-père relevant notamment l’association du nom de chacun à un animal (herminette, pied de biche…), mais dans le même geste, il les désactive, les transforme en objets muséographiques : des artefacts de pratiques ancestrales échues. L’objet utilitaire disparaît au profit d’un ready-made (?) mis en beauté pour ce qu’il n’est plus… La mue et le discours qui la légitime participent ainsi à l’hommage du marché à l’ancien monde (artisanal et local) qu’il a fait disparaître justifiant en creux l’irruption du nouveau (industriel et global) censément plus performant…
Les bonnes intentions sont honorables, mais il est nécessaire d’être vigilant :
l’économie capitaliste possède le secret : elle seule en effet, parmi tous les modes de production qui se sont succédé, sait intégrer en permanence sa contestation la plus virulente et la mieux fondée pour en faire le moteur efficace de son dynamisme conquérant. (Pierre Hartmann / Dérives, divagations et dévoiements, mai 2025)
œuvres de Clara Silvina Álvarez, Boglárka Balassa, Pauline Beck, Valentine Cotte, Arthur Debert, Juliette Dignat, Eddie de Goër, Sarai Rose Duke, Mathis Esnault, Yoshikazu Goulven Le Maître, Claire Hannicq, Zoé Joliclercq, Elisa Lohmüller, Jules Maillot, Élise Planhard, Naomé Nazire Tahmaz, Hélène Thiennot
le vivant en réfraction

All Over Nymphéas d’Emmanuel Eggermont
musique Julien Lepreux
#DANSE
représentation du vendredi 14 novembre à la Comédie de Colmar
& répétition publique commentée par Emmanuel Eggermont du 7 novembre
les 6 & 7 mars à La Filature, Mulhouse, les 10, 11 & 12 mai 2026 au Maillon, Théâtre de Strasbourg
réservations Opéra national du Rhin
La chorégraphie est une recréation pour neuf danseurs – ils étaient cinq lors de la création en février 2022 – qui entre au répertoire du Ballet de l’OnR. La pièce est dédiée au chorégraphe Raimund Hoghe, dramaturge de Pina Bausch décédé en 2021.
La production est portée par la Comédie de Colmar, le Maillon (qui accueille les représentations à Strasbourg) et POLE-SUD (Strasbourg) dans le cadre de la Quinzaine de la danse (sur le territoire mulhousien en mars) et du Parcours danse.
Le titre fait allusion à l’enthousiasme de Jackson Pollock, Mark Rothko, Joan Mitchell ou Lee Krasner (adeptes du All Over) quand ils découvrent la monumentale série des Nymphéas de Claude Monet au musée de l’Orangerie.
Le bleu au sol et de deux costumes, le rose à la fin invoquent la palette des Nymphéas. C’est le « chromato » du chromato-chorégraphique que développe Emmanuel Eggermont.
Les découvertes entre les tapis bleus Monet que tirent les danseurs dévoilent par fragments le monde en miroitement fluide. Chacun d’eux l’arpente et vient y incarner êtres et créatures.
Le chorégraphique s’ancre plus volontiers dans le All Over avec les éclats de gestes, le poudroiement spatial des mains, des chefs. Ces pulsions suggérant l’action painting, le dripping produisent des hiéroglyphes mouvants, des motifs en trois dimensions.
Si la mémoire les évapore, les yeux étant sollicitée par une nouvelle trace, ils reviennent en obsessionnel ostinato. Et la vitalité du spectacle nait de cette tension de perpétuel recommencement.
L’énergique déambulation géométrique lie les danseurs costumés de sombre, les renvoie l’un à l’autre avec ces pauses de gestes saccadés, secs et tendus, animal par moments, ceux de grands échassiers juchés sur leurs pointes.
Un palimpseste de corps dispersés, déhanchés et revenant : de l’action dancing…
Le chorégraphe sait accoucher les élans de chacun et les tensions à distance entre monômes, susciter quelquefois un moment à deux ou la mise en manipulation d’un, d’une troisième.
La pièce s’ouvre selon un allant collectif, nerveux et actif, des déplacements dynamiques et architecturés.
Un andante installe un temps plus dense, plus lent, une plongée sourde et profonde, avec des danseurs plus rares. Ils introduisent quelques accessoires : plexiglas en plaque, film plastique, textures froissées dont ils se drapent quelquefois. La matière est toujours brillante et, avec les lumières veloutées d’Alice Dussart, réfléchit la peau, les couleurs de Monet.
Un maître de cérémonie, plus habillé, excentrique, sur talons hauts, hante le plateau de son indifférence détachée en contrepoint de la musique électronique pleine et rythmée, généreuses de basses de Julien Lepreux.
Émergeant de ces profondeurs, le tempo à nouveau enlevé du « cercle fou » rameute l’ensemble des danseurs aux trajectoires nettes et anguleuses comme ceux des cavaliers d’un jeu d’échecs.
Ils tracent au sol un grand cadre en poudre rose, un des tapis est tiré : la ligne se réajuste sur une autre ouvrant la figure vers l’infini.
L’infinie solitude des œuvres d’art (selon le mot* de Rainer Maria Rilke)…
* Les œuvres d’art sont d’une infinie solitude.
Mina & son muse

Mina Mond à St-Art 2025
#SALON
Strasbourg, Parc des Expositions (Halls 2 & 3) du 14 au 16 novembre 2025
Première foire d’art contemporain en région, l’édition 2025 de St-Art accueille 48 galeries (pour 62 exposants) issues de neuf pays.
Avec Les Étoiles Terrestres, elle reconduit son soutien à l’écosystème des arts verriers bien implanté en Région Grand Est.
L’émergence reste l’autre axe fort avec cette année la spectaculaire mise en lumière de l’Art Brut.
| Art Brut, Art Singulier, Outsider Art…
Sur cette frontière fluctuante entre pratique artistique et appropriation de techniques artisanales, s’affirme toujours un authentique geste créatif.
Ainsi L’Industrie Magnifique présentera avec la Ritsch-Fisch Gallerie (Strasbourg) l’œuvre monumentale de Cassandre Albert, Le Rocher, réalisé dans le cadre d’une résidence à l’île Maurice et d’une collaboration #Art for change, Plastic Odyssey et ENGEES (École Nationale du Génie et de l’Eau et de l’Environnement de Strasbourg). La pièce mêle des plastiques recyclés provenant de la collecte sur les océans (Plastic Odyssey) et le chaume (matériau traditionnel pour les toitures dans l’île).
Autre galerie connue et reconnue dans ce domaine, habituée depuis une dizaine d’années de la foire, la galerie Pol Lemétais (Toulouse) exposera dans le hall d’accueil deux pièces monumentales : une tapisserie d’Aurélia Jaubert (Nativité, 2019, canevas assemblés et cousus, 378 x 217 cm) et Le Retable Cor triatriatum (2021, aquarelle & encres sur bois, 500 x 300 cm) de Mina Mond qui avait créé l’an passé la gravure insérée dans le catalogue de la foire.
| Rencontre et échanges avec Mina Mond et son muse Fred Hurst
Un village près de Saverne, le 31 octobre. Au bout d’une impasse, le portail s’ouvre sur une cour encadrée par deux corps de bâtiments où stationnent deux caravanes vintage customisées par l’artiste.
L’atelier occupe une vaste salle au premier étage de la maison familiale. Tout est resté dans son jus. Non loin de la table de travail, un canapé et, sous une copie de L’île des morts de Bœcklin, un grand écran avec arte qui tourne (sans le son) laissent deviner le lieu de vie. Les œuvres ont progressivement envahi tout l’espace (elle produit beaucoup). Dans la pièce mitoyenne – cuisine, séjour… –, nous nous installons autour d’une table, elle aussi cernée de châssis, de cartons à dessins, de toiles…
à St-Art 2025 avec la galerie Pol Lemétais
_ le Retable Cor Triatriatum dans l’espace d’accueil
Mina Mond : C’est ma plus belle pièce, elle date de 2021. Ouvert, le Retable fait cinq mètres sur trois de haut, fermé il en fait trois sur trois et le centre reste toujours visible.
Fred Hurst : Les portes sont très belles, mais on ne les voit jamais… [En prédelle], il y a une Totentanz – une danse macabre.
M. : L’imagerie religieuse inspire beaucoup mon travail. Pas pour le côté religieux, mais parce que ça véhicule des choses assez universelles, un peu comme le folklore.
C’est une pièce qui fascine les gens parce qu’il y a énormément de détails. J’ai travaillé à la plume.
F. : À la plume sergent-major ! Tout ce qui est en couleur, les cinq mètres alignés comme ça, c’est à la plume. C’est un sacré défi. C’est d’une finesse, on dirait presque une gravure. C’est une œuvre qui n’est pas vendable, mais qui circule. Elle a été demandée en Hollande, elle est allée à Metz deux fois, à Paris, à Épinal, là à St-Art. C’est une œuvre qui sert de vitrine.
_ sur le stand de la galerie Lemétais (2D04)
M. : J’emmène un tambour que je suis en train de faire, deux Solae[1] – issues d’une série de cinq sur les piliers du protestantisme que j’avais faite pour le Temple Neuf à Metz en résonance avec la spiritualité du lieu de l’exposition Œil Chamane (rentrée 2025).
illustratrice pendant quinze ans
M. : Quand je passais mon DEA en art plastique, je me sentais proche de la figuration libre – des gens comme Robert Combaz, Jean-Charles Blais… J’avais ce côté narratif. C’était déjà un peu passé dans les années quatre-vingt-dix et on me disait toujours que j’étais trop dans l’illustration, trop figurative. La mode était à la performance, à l’installation… Je me suis forcée à faire des installations en fac, mais ce n’est vraiment pas mon truc.
En maîtrise, j’ai travaillé sur la catharsis dans les ex-voto, mais en partant de l’art populaire et d’autres artistes (Niki de Saint Phalle, Frida Kahlo, Louise Bourgeois…) qui avaient travaillé sur la façon de sublimer la souffrance et qu’on pouvait rapprocher des ex-voto dans leur construction mentale.
Quand je suis sortie de fac, je suis devenue assistante d’éducation pour gagner un peu de sous et préparer mon agrég. Pendant les heures de surveillance, je faisais de l’illustration et j’avais un blog. Philippe Manœuvre [de Rock & Folk] a remarqué mes dessins.
F. : Il lui manquait un truc, il le lui fallait dans la journée. Après, ça a duré presque dix ans.
M. : Les dix dernières années où il était rédacteur en chef [jusqu’en 2017].
C’était mon premier contrat.
virage
F. : En 2016, elle m’annonce : je ne veux plus faire d’illustration, j’en ai marre. Et elle veut se remettre à la peinture. Elle avait un nom connu, elle était reconnue sur la scène nationale, on était invité partout, on la reconnaissait dans la rue… Et elle est très fière de certains trucs.
Très vite elle a tourné la page.
M. : C’est la gravure qui m’a permis de faire le passage.
F. : Elle s’est très vite rendu compte que Marie Meïer avait beaucoup trop de présence sur Internet.
M. : Surtout le public ne s’y retrouvait plus. Je savais qu’il fallait que je sépare vraiment les deux entités.
F. : Du coup elle a changé de nom. Elle a gardé le MM : Marie Meïer / Mina Mond.
Et Mina Mond a démarré très vite en plus.
une rencontre : le galeriste Pol Lemétais
M. : J’ai eu la chance de tomber sur Pol un an après être devenue Mina Mond. En 2017 pendant St-Art, il m’appelle : « Bonjour, est-ce que vous pouvez m’apporter quelques œuvres ? ». Donc je suis arrivé avec des pièces et il m’a dit « OK je les embarque » et en janvier, il m’a présenté à New York avec une pièce sur Trump qui a été vendue. Et qui représente tellement bien ce qui se passe en ce moment !
F. : La rencontre avec Pol a été décisive. Il connaissait un peu Marie Meïer, il aimait bien le boulot mais ça ne l’intéressait pas. Il a vu la transition, il l’a vu franchir le cap par Internet. Quand il a vu Mina Mond, il l’a contactée. On ne le connaissait pas du tout.
M. : Avec Pol, ça a tout de suite roulé. C’est carré. C’est quelqu’un de très sérieux, de travailleur. Et c’est encore un galeriste qui aime les artistes ! Il a encore la curiosité pour aller chercher des choses nouvelles.
technique
M. : Ma peinture est assez lisse : je fais de la tempéra – parfois à l’œuf, à l’ancienne –, de l’aquarelle… Je travaille sur bois, sur toile.
Le bois me permet de graver dedans, de clouer du métal repoussé. C’est un autre rapport à la matière, un autre geste et ça permet de calmer l’œil par rapport à mes choses très remplies. Il y a un travail presque artisanal, j’adore ça. C’est ma manière de donner de la matière. Sur la toile, je mets de la feuille d’or…
On me rapproche souvent de l’art brut ou de l’art out, singulier ou du Low Brow aux États-Unis. On me classe dans les visionnaires parce que je travaille sans croquis, de manière automatique, sur des thèmes mystiques avec de la musique, en méditation en pleine conscience pour construire mon tableau.
Je travaille beaucoup avec les basses, j’aime la musique avec des basses. Mais ça peut être de la techno.
F. : Elle fait du tambour pour les vibrations. Elle peut se servir d’un concert aussi ou d’une marche. Des fois on va marcher. Elle sait qu’elle doit faire un tableau. Donc elle ne parle pas un moment et après elle dit : c’est bon je le vois, je l’ai. On rentre et elle commence : elle exécute les couleurs par bande comme une imprimante. Elle le fait d’une traite, il n’y a aucun croquis, jamais. Jamais !
M. : Je suis un peu hors de ce qu’on appelle l’art contemporain… qui est contemporain depuis trente ans ! [rires]
histoires, thèmes… & politique
M. : Je suis surtout une raconteuse, j’aime raconter. Je sais que ce n’est pas très contemporain, mais il y a un renouveau un peu, il y a une influence du folklore sur l’art contemporain, que ce soit dans les techniques ou dans les histoires, ou dans l’attachement à un patrimoine.
Moi j’aime l’art populaire parce que les gens l’aiment et le comprennent mieux. C’est là où l’art fonctionne, quand il y a une interaction.
F. : Chez Mina, c’est ce qui se passe : il y a souvent des gens qui pleurent devant ses tableaux. C’est arrivé plusieurs fois.
M. : Des fois je peux travailler sur des thématiques très politiques ou des choses plus personnelles, ou des histoires que je trouve… des légendes, mais aussi sur la manière d’envisager la spiritualité, la sagesse. En tout cas, il y a toujours une histoire sur les cycles de la vie : vie, mort, renaissance. La nature nous montre ça : le bois du cerf qui tombe et qui repousse, les feuilles des arbres qui tombent et qui repoussent. La mort n’est pas une finalité. On est dans un perpétuel cycle de renaissance comme un palimpseste de vies. On est chacun, un palimpseste de choses qui ont vécu avant nous.
Je pense que le destin est écrit et si on a du libre arbitre sur certaines choses, on a des points fixes auxquels on ne peut pas échapper.
Et puis il y a beaucoup de figures féminines. Il y a souvent le côté titan, mais dans le sens grec du terme, les premiers dieux telluriques, et ces femmes : les magna mater, les femmes préhistoriques, les combattantes…
Ce sont des œuvres qui vont être plus politiques.
Quand je fais ces tableaux, je réfléchis sur la politique actuelle parce que je veux faire quelque chose qui soit à la fois juste et symbolique. Ça ne te permet pas de voir le futur, mais d’anticiper des choses qui sont en capacité de se passer. Tu réfléchis aux symboles, un symbole c’est comme un chemin.
J’ai une passion, étrange certes, pour les années trente en Allemagne. Je lisais ça quand j’étais jeune, je voulais comprendre comment le « mal » arrive, comment tu arrives à accaparer l’esprit des gens pour qu’ils pensent d’une même manière, d’une manière violente et dans la haine de l’autre.
engagement
F. : En 2021, nous avons monté une association pour le secteur – les 42 communes de la Communauté de Communes Hanau La Petite Pierre. On occupe une partie du Musée du Pays de Hanau à Bouxwiller en exposant des artistes (Saba Niknam, Aurélien Lepage, Mina) qui ont des pièces qui racontent : du coup il n’y a pas de rejet.
Surtout on va faire un peu de microéditions.
M. : Faire en sorte que la microédition puisse financer une partie des ateliers avec les gens en situation de handicap, de précarité ou en rupture sociale (IME, EPAD, etc.).
Surtout mon rêve absolu, ce serait d’en faire un Creative Growth Art Center.
Ce serait mon rêve de pouvoir réussir un cercle vertueux d’autofinancement et de s’occuper en même temps de promouvoir le travail des gens qui sont parfois des années dans des centres et que tout le monde oublie. C’est classe quand même. Ça permet aux gens en situation de handicap d’être fier de ce qu’ils font.
On aimerait commencer à éditer des artistes classiques pour pouvoir éditer ensuite des artistes moins classiques, bruts et pouvoir ainsi constituer un fond, être un peu diffuseur.
style vestimentaire, tatouages…
M. : J’adore les habits. J’adore les trucs kitchs.
F. : Elle adore composer.
M. : Je compose un peu comme les peintures. C’est ma manière à moi de me sentir bien avec moi-même, avec les autres.
Je passe 70 % de mon temps dans l’atelier à être habillé comme une traîne-savates ! Donc quand je sors, j’aime bien me sentir à peu près jolie. Avec mon métier, j’ai cette liberté de pouvoir aller vers des vêtements qui me plaisent parce que je les trouve beaux. C’est juste une question de goût et de liberté de pouvoir le faire. Je peux me balader en robe, en Dirndl, avec une coiffe alsacienne, selon mon envie du moment.
Et j’aime mon crâne rasé : j’ai mes tatouages, ils ont une signification particulière (c’est les bois de cerf de la princesse de l’Oukok), je les aime, je n’ai pas du tout envie de les recouvrir.
Ce n’est pas pour les gens que je fais ça, c’est pour moi. Pour être juste la femme que je suis !
Tu n’es vraie que quand tu es toi-même.
l’art aujourd’hui
M. : On a tous une définition de l’art et différente pour chacun. L’art aujourd’hui, c’est ce qui se fait aujourd’hui et je crois qu’on ne peut plus vraiment lui donner de nom, de label.
Moi j’ai le pieux espoir que ça puisse servir à l’ouverture d’esprit, à essayer d’accepter les autres, à comprendre certaines histoires.
Je donne toujours cet exemple.
J’ai fait un tableau sur la Jungle de Calais. C’est un tableau en trois parties. Le centre est en noir et blanc, c’est une bouche d’enfer et dedans il y a plein de petits personnages qui sont perdus, d’autres qui sont agressifs, il y a des loups et des bêtes un peu monstrueuses… Ça représente les migrants coincés dans ce truc qu’on appelait la Jungle qui n’était pas hygiénique, qui était dangereuse notamment pour les femmes, des migrants coincés entre la France qui n’en veut pas, l’Angleterre qui n’en veut pas, la Manche qui n’en veut pas, coincés dans un autre enfer en fait. Quand j’expliquais ça aux gens – et je sais que parfois j’ai eu des gens de droite voire d’extrême droite –, comme ils n’étaient pas agressés par l’image, qu’ils n’avaient pas compris tout de suite que je parlais de ça, ils écoutaient et j’ai l’espoir que ce questionnement puisse générer une réflexion un peu plus ouverte sur les gens, plutôt que d’être uniquement tourné sur soi.
Quand un truc me choque, je suis obligé de le peindre. Je crois que l’art me sert aussi à ça : à descendre en pression quand c’est trop.
C’est pour ça que je fais du narratif.
Et mes tableaux sont très remplis, tu es obligé de prendre une temporalité différente, tu rentres aussi dans le symbolique.
l’ennemi ? *
M. : Ça peut être soi ou les autres.
Dans mes tableaux, parfois les gens retrouvent leurs propres traumas. Finalement l’ennemi qui est en toi, c’est peut-être aussi celui des autres. Si tu ne t’aimes pas, j’ai toujours tendance à penser que tu auras du mal à accepter les autres comme ils sont…
Faire de l’art, c’est une rage, c’est ma façon d’exprimer ma rage de vivre.
Je pense que tant que j’ai des choses à dire en peinture, j’arriverai à survivre.
* selon la question de Picasso : L’art est une arme contre l’ennemi… Mais qui est l’ennemi ?
[1] Sola gratia (« par la grâce seule »), Sola fide (« par la foi seule »), Sola scriptura (« par l’Écriture seule »), Solus Christus (« Jésus Christ seul »), Soli Deo gloria (« à Dieu seul la gloire »)
des étoiles sous le tapis

La Perle
Métamorphose de la douleur
de Sayeh Sirvani
#THÉÂTRE
représentation du 5 novembre 2025 à l’Espace 110, Illzach
Artiste associée à l’Espace 110 depuis 2023, Sayeh Sirvani avait ouvert sa collaboration avec L’ivresse des profondeurs : un émouvant voyage liquide, un seule en scène souvent près du sol.
Avec La Perle, le spectateur retrouve la même poésie attentive à l’altérité avec plus d’ampleur : la pièce se joue à trois femmes et le dispositif scénique s’approprie aussi le plateau dans sa hauteur.
un murmure dans la nuit
trois femmes rouge et or
elles chantent a cappella
recueillies ensemble à genoux
leurs mains rythment les mots
frappent le grand tapis
et puis des mots dits
très peu de mots
les mots du poète Djalâl Al-Dîn Rûmî
en français en persan en arabe
La blessure est l’endroit par lequel la lumière entre en vous.
Métamorphose de la douleur
suggère le sous-titre du spectacle
Sayeh Sirvani la transfigure en poésie
tel ce grain de sable
qui s’habille de nacre
enfle en chatoyante perfection
devient perle
poésie des images,
poésie des gestes, de la musique, des lumières
la marionnettiste déploie son envoûtant univers
avec ses créatures manipulées
entre improbable costume et Bunraku
un bestiaire de tissus
des corps multiples
vibrionnant de membres, de tentacules, de rhizomes
des volatiles, des figures hybrides
qui malgré des formes intrigantes
malgré la pénombre
semblent douces
et quelquefois bienveillantes
en complices
Myra Zbib voix lyrique et instrumentiste
exalte l’enivrant parfum oriental
(création sonore Julien Fezans)
Colline Caen voltigeuse et trapéziste
s’envole vers les cintres
invente une aérienne chorégraphie
embarque ses comparses vers les hauteurs
toutes jouent avec le souffle, les cheveux,
des gestes minuscules
et de délicates lumières
ces lumignons dont les rayons transpercent la main
telle Alice au pays des merveilles
les trois femmes entraînent le spectateur
dans un voyage facétieux et hypnotique
d’une apesanteur liquide
Plutôt qu’un théâtre d’objets, Sayeh Sirvani développe un théâtre de tissus frémissant, inventif et généreux.
Tel ce grand tapis avec ses crevés
qui peu à peu découvre l’envers des choses
se mue en rideau argenté
en miroir dispersant une brume frissonnante sur le plateau.
Certains balaient la poussière sous le tapis
Sayeh Sirvani nous dévoile les étoiles qui s’y nichent
et qui ne demandent qu’à nous illuminer !
Nota : c’est Sayeh Sirvani avec la complicité de Mathilde Nourrisson qui fabrique tout le matériel scénique (costumes, accessoires, décors…)
avec Colline Caen, Myra Zbib, Sayeh Sirvani
mise en scène & conception Sayeh Sirvani
scénographie, costumes & marionnettes Sayeh Sirvani
lumières Jean-Yves Courcoux
création sonore Julien Fezans
l’orchestre souverain

Otello
de Giuseppe Verdi
#OPÉRA
représentation du vendredi 31 novembre à l’Opéra national du Rhin (Strasbourg)
Les dernières représentations de l’avant-dernier opéra de Verdi à l’Opéra du Rhin remontent à 1977/78. Pour cette nouvelle production, Alain Perroux a confié la direction musicale à la cheffe italienne Speranza Scappucci, spécialiste de ce répertoire et longtemps assistante de Riccardo Muti. Elle dirige pour l’occasion l’Orchestre Philharmonique de Strasbourg dans l’édition critique de 1976 intégrant les modifications voulues par Verdi (épure de certaines scènes) à l’occasion de sa reprise en 1894 à Paris au Palais-Garnier (création mondiale le 5.02.1887 à la Scala de Milan).
D’emblée Speranza Scappucci place la barre très haut : énergie, netteté et une puissance sonore amplifiée par le Chœur de l’Opéra national de Lorraine qui renforce celui de l’OnR. Son corps est tendu vers le plateau, sautant quelquefois emporté par son ardeur – et l’ouragan –, avec une battue ferme, volubile et souvent un index impérieusement dressé pour pousser les interprètes. Aussi certaines interventions solistes au sein de cette furia semblent fragiles et on rêverait même d’un Exultate plus tonitruant (comme s’il venait de mater lui-même les éléments déchaînés) du ténor géorgien Mikheil Sheshaberidze qui campe pourtant un Otello de belle stature.
Elle maîtrise même le public dont une partie, à la toute fin, veut se jeter dans les applaudissements quand s’éteint la cantilène d’Otello : elle lève une main autoritaire vers la salle pour y couper court et préserver les ombres sépulcrales du morendo verdien.
Mais Otello est un opéra intime et elle sait aussi trouver des tendresses – la caresse d’une clarinette ou des violoncelles –, aviver un jaillissement de feux follets (Feu de joie du Ir) ou – déjà – l’humour de Falstaff (duo Iago Cassio au III), iriser de couleurs diaprées l’élan du duo d’amour (I), aiguiser la lancinante vénénosité d’une saillie, faire gicler les traits incisifs des violons tout en préservant le frémissement souterrain des cuivres ou des contrebasses tendu de funèbres prémonitions…
Sans oublier la triomphale polyphonie (fanfare en coulisse) pour l’arrivée de l’émissaire du Doge : belle autorité de Jasurbek Khaydarov !
Mais surtout elle sait porter et enflammer les interprètes : sa direction fait vivre et palpiter la subtile finesse de la matière instrumentale (thèmes, couleur, vibration et pulsation) qui noue les mots pour insuffler aux chanteurs l’intelligence dramaturgique de Verdi. Le IIIe acte est à ce titre éloquent : les époux prennent véritablement corps (comme personnages) lors de ce long échange où s’élabore l’implacable machinerie de l’humiliation publique que subira Desdemona peu après.
À l’inverse, la production conçue par Ted Huffman est économe. Le décor se limite à trois parois blanches (en)fermant le plateau nu légèrement brillant avec quatre doubles portes pour les entrées et les sorties. Les acteurs déplacent quelques fauteuils et, pour la fête du début, des caissettes avec le vin, etc. En deuxième partie, de grandes tables circulaires accueillent les convives du banquet offert aux ambassadeurs de Venise. Les costumes évoquent les années soixante avec une attention portée aux tenues de soirée.
Les protagonistes sont souvent assis, se touchent peu, comme si l’action se déroulait dans un café ou une salle d’attente. Une version attentive à la négociation, dépassionnée et sans sauvagerie (le revolver plutôt que l’étreinte mortelle avec le coussin préserve cette distance), les actants s’adressant souvent au quatrième mur (tempête, Credo, apartés…).
S’en dégage une certaine inertie qui permet de savourer la musique, mais ne semble guère aider à l’incarnation (Verdi et la cheffe s’en chargent, on l’a écrit).
Le metteur en scène s’accorde une certaine liberté avec la lettre du livret. Des figurants assurent l’altercation qui aboutit à la dégradation de Cassio (vaillant Joel Prieto). L’absence de chambre à coucher, de coussin, de poignard… occasionne quelquefois un décalage entre les répliques et l’action…
Avec les lumières, il joue sur les reflets, les ombres surdimensionnées projetées sur le fond ou les portes qui s’ouvrent sur des saynètes arrangées par le marionnettiste Iago.
Ce soir-là, Daniel Miroslaw est annoncé souffrant mais son Iago aussi omniprésent qu’ondoyant reste incisif avec un timbre granitique d’une belle projection. Il y a sans doute un peu de prudence dans son engagement (pas de rire à la fin de son autoritaire Credo… en cohérence avec la mise en scène), mais son interprétation ne pâtit guère de l’indisposition.
Mikheil Sheshaberidze module un Otello distingué s’isolant souvent au fond ou à face jardin, il est plus désemparé que sauvage et consumé par l’incompréhension… après !
Au début Adriana González (fine Liù il y a deux ans) se jette sur les notes avec en contrepoint de délicates mesures filées. Elle ne trouvera sa pleine palette de nuances qu’à partir du III et préservera ce raffinement lors de la longue séquence accompagnée par l’Emilia de Brigitta Listra ouvrant le IVe acte. Ainsi dans la Chanson du saule, le troisième Salce de chaque refrain s’abîme dans une expiration aussi éthérée que bouleversante.
Très économe en gestes, le final bénéficie d’une incarnation intense et accomplie des deux interprètes qui glissent tous deux vers leur impalpable extinction.
Et peut-être que l’image de ces deux corps abandonnés entre les tables du banquet est la plus révélatrice de ces destins foudroyés par une intimité jetée en pâture au corps social.
avec Mikheil Sheshaberidze, Adriana González, Daniel Miroslaw, Joel Prieto, Jasurbek Khaydarov, Brigitta Listra, Massimo Frigato, Thomas Chenhal, Young-Min Suk
Chœurs de l’Opéra national du Rhin & de l’Opéra national de Lorraine,
Orchestre philharmonique de Strasbourg
direction musicale Speranza Scappucci
mise en scène, décors Ted Huffman
costumes Astrid Klein
lumières Bertrand Couderc
temps suspendu…

Bonheurs et exil
Sauveur Pascual
#EXPOSITION
Mulhouse, Temple Saint-Étienne du 29 octobre au 23 novembre 2025
Après l’église des Jésuites de Molsheim en 2024 où il avait accroché (entre autres) une grande crucifixion dans le cadre des Chemins d’Art Sacré, Sauveur Pascual investit le Temple Saint-Étienne à Mulhouse. Il y exposera des pièces de sa précédente série Bonheurs et ses créations les plus récentes issues d’Exodes (entamés en 2022).
Avec la Méditerranée en omniprésent mirage, sa peinture est hantée par la fragilité des chemins d’enfance et la menace des destins d’exil.
Dans les premières propositions de la série Exodes, l’intensité transparente du bleu cobalt affrontait le blanc des bords de mer et des transatlantiques. La netteté du contraste installait une solarité que renforçaient les parasols et l’estive balnéaire. Souvent le cadre cérusé évoquant le bois flotté amplifiait la suggestion d’échouage des rapatriés d’Algérie hier, des Migrants aujourd’hui…
Ces plages, ces lieux restaient cependant un terrain de jeux, et d’émerveillement prolongeant ses Bonheurs : le territoire de l’enfance.
C’était en 2022… une éternité.
Depuis les rivages de la Méditerranée ont été outrageusement livrées au sang, aux armes et aux larmes. Pour beaucoup la possibilité des Bonheurs a été foudroyée ouvrant en grand les vannes de l’exil.
Cette Mare Nostrum tiraillée entre berceau et sépulcre de civilisation revient comme un Leitmotiv dans les œuvres de l’artiste avec ses plages, ses flots, ses cieux, ses navires.
Si dans les derniers opus, ses bleus restent translucides, ils se sont assourdis et colonisent le blanc. Les paquebots eux-mêmes sont déracinés, emportés dans la tourmente, suspendus telles des maquettes votives qu’invoque souvent un enfant : une timide apparition dans un halo assiégé, comme un espoir émergeant d’une mortifère déraison.
Les adultes ? De minces silhouettes nervurées comme des feuilles mortes se dissolvent en ombres errantes, quelquefois en larmes noires (même si l’artiste évite de multiplier les coulures).
Il s’affranchit aussi des échelles et un grand souffle emporte les figures vers l’ailleurs – bateaux avec leurs panaches de fumée et leurs traînes, promeneurs, baigneurs, parasols, draps de plage tels des planches de surf…
Icare (thème d’une série de 1993) a disparu, mais sa vanité forcenée essaime et assène sans état d’âme toutes ces débâcles nous écartant – collectivement – de l’essence d’Humanité.
Son choix de systématiser les grands formats sur papier et sans cadre (180 x 130 cm), de les suspendre comme des dépouilles, en renforce la commotion.
Occasionnellement il les éclabousse de fragments d’or comme des feuillets déchirés dispersés par le vent. Celui de la modernité qui s’impose au forceps d’une machinerie implacable ?
Quelquefois un rose sombre comme une plaie remplace la dominante bleue.
La transparente légèreté de la matière reste – il utilise des encres d’imprimerie (anciennes) qui préservent la densité du fond.
Des mots découpés dans d’anciens livres pour enfants avivent discrètement quelques âmes par un phylactère.
Sauveur Pascual ne donne pas de réponse, il transcrit ses doutes, sa sidération quelquefois, et tente de préserver sa foi dans l’enfance avec l’espoir que ces jeunes pousses sauront tisser l’empyrée plutôt que l’exil.
Un peintre c’est quelqu’un qui essuie la vitre entre le monde et nous avec de la lumière, avec un chiffon de lumière imbibé de silence.*
Le silence du regard, attentif et lucide.
* Christian Bobin / L’homme joie, 2012
passagers du vent

Murmure des âmes
Joseph Bey
#EXPOSITION
Strasbourg, Apollonia european art exchanges du 25 octobre au 7 décembre 2025
En 2019, Joseph Bey a entrepris un voyage au Japon sur l’île de Shikoku, une destination très populaire depuis le XVIIe siècle pour son pèlerinage dédié à Kōbō-Daishi. Il consiste à faire le tour de l’île à pied et à se recueillir dans les 88 temples. Une marche immersive de deux mois. Une expérience physique, sensorielle autant que spirituelle.
Selon l’école bouddhiste Shingon, les âmes restent présentes après la mort, accompagnent les vivants, les protègent, dialoguent entre elles aussi. Une intense présence de l’immatériel que l’ascèse de la marche, les rituels dans les temples rendent perceptible. Dans le cimetière du mont Koya, les rencontres avec les âmes des défunts surprennent si on n’y prend garde. Sur des stèles, les photos des défunts permettent de mettre un visage sur certaines d’entre elles.
À son retour, Joseph Bey a imaginé une mise en espace-temps qui mythifie ce cimetière aux 200 000 tombes de Koyasan. Le dispositif suggère au fil des stations comment ces âmes se rencontrent, dialoguent et intermédient avec les vivants qu’ils peuvent croiser.
Des échanges vibratoires tissés de respect et d’attention à l’Ouvert (au sens de Rilke) suggérant la circulation de flux verticaux (vivants/défunts), mais aussi horizontaux (migrants)…
Un parcours entre contemplation artistique et immersion mystique
entre Orient et Occident
avec les murmures du temps échu irradiant des œuvres…
Vues des anges, les cimes des arbres peut-être
sont des racines, buvant les cieux ;
et dans le sol, les profondes racines d’un hêtre
leur semblent des faîtes silencieux.
Pour eux, la terre, n’est-elle point transparente
en face d’un ciel, plein comme un corps ?
Cette terre ardente, où se lamente
auprès des sources l’oubli des morts.
Rainer Maria Rilke
Poèmes français : Portrait intérieur, XXXVIII (1926)
et pour en savoir plus sur le travail de Joseph Bey :
__ son accrochage à la Galerie Courant d’art (Mulhouse) au printemps 2023
__ Les piliers du monde d’AJAA installés dans le Parc à Sculptures du Nouveau Bassin, Mulhouse (permanent et en accès libre depuis février 2019)
__ le chant des plaques (4’) & à travers l’oculaire (2’30), vidéos réalisées lors de son exposition monographique à l’Espace d’Art Contemporain André-Malraux à Colmar en 2018
magie du réel

Robert Weaver / Tomi Ungerer.
L’illustration en action
#EXPOSITION
Strasbourg, Musée Tomi Ungerer – Centre international de l’Illustration du 17 octobre 2025 au 15 février 2026
commissaires Morgane Magnin & Anna Sailer
Tous les trois ou quatre mois, le Musée Tomi Ungerer – Centre international de l’Illustration – renouvelle presque intégralement ses accrochages. À chaque fois, la directrice Anna Sailer trouve un axe judicieux permettant de mettre en valeur les œuvres d’autres artistes issus des collections (ou pas), mais toujours en lien avec le fond Tomi Ungerer.
Cet automne, il accueille sur ses cimaises le travail de Robert Weaver (1924–1994), un pionnier du visual journalism, et contextualise ainsi un chapitre essentiel de l’itinéraire américain de Tomi Ungerer.
Avec la Grande Dépression, la Seconde Guerre mondiale, la concurrence de la télévision ensuite, les chiffres de ventes des magazines baissent, aussi vers la fin des années-cinquante, les directeurs artistiques tels Leo Lionni (Fortune) ou Richard Gangel (Sports Illustrated) recrutent des artistes, des illustrateurs comme Robert Weaver, Franklin McMahon, Ronald Searle, Tomi Ungerer et les envoient sur le terrain. Les sujets couverts restent grand public : évènements politiques et sportifs, tournages à Hollywood, mais aussi faits divers et crimes…
Robert Weaver impose sa patte qui privilégie des angles et des cadrages audacieux (comme Elia Kazan au cinéma à la même époque). Ses dessins au crayon gras noir sont souvent rehaussés de gouache, d’aquarelle aiguisant le caractère des personnages croqués ou pour figurer en page de couverture voire illustrer des pochettes de disques (jazz), des publicités, etc. Un raffinement sans concession qui lui permet de restituer les tensions sociales et racistes de l’Amérique des Trente Glorieuses.
Un peu plus âgé que Tomi Ungerer, l’américain devient son mentor.
Bob Weaver […] a exercé sur moi une énorme influence. Il m’a révélé le potentiel visuel de l’Amérique. (2008)
C’est d’ailleurs grâce à l’amitié des deux artistes et par l’intermédiaire de Tomi Ungerer que le musée a pu acquérir en 2007 ces 83 pièces auprès d’une des filles de Robert Weaver (seule l’Université de Chicago a un fond de cette importance).
En comparaison le regard de l’Alsacien est plus acide, plus satirique et il isole avec gourmandise des personnages cueillis dans le public d’une tribune ou des situations cocasses et… révélatrices ! Quand il élabore en 1974 son ouvrage America (Dessins de1956 à 1971)… il n’a qu’à puiser dans le foisonnant vivier de ses archives !
Revenu en Europe, il gardera ce goût du reportage. Il se plongera ainsi dans le milieu carcéral et, en 1985, dans celui des dominas à Hambourg pour dessiner Schutzengel der Hölle.
Avec l’essor des médias en ligne, le reportage dessiné est en repli.
Pour conclure, les dernières cimaises affichent les dessins d’audience d’Olivier Dangla pour Le Monde (procès des attentats de janvier 2015), un des rares domaines où il trouve encore une place.
Mais sans doute que sans le regard acéré de ces journalistes dessinateurs, la presse mainstream est encore plus mainstream…
étourdissante submersion

Yayoi Kusama
#EXPOSITION
Riehen (Bâle), Fondation Beyeler du 12 octobre 2025 au 25 janvier 2026
commissariat Mouna Mekouar, Leontine Coelewij, Stephan Diederich
catalogue en anglais ou en allemand, 298 p., 56 CHF, 56 €
Avec des pièces qui n’ont jamais été exposées en Europe (la moitié vient du Japon), la Fondation Beyeler consacre une importante monographie à Yayoi Kusama, la première de cette envergure en Suisse. Conçue en étroite collaboration avec l’artiste et son studio, elle réunit plus de 300 œuvres, occupe presque les deux tiers de la Fondation et couvre plus de sept décennies de carrière.
Si lors de ses interviews, la Japonaise convoque ouvertement sa pathologie de « dépersonnalisation », celle-ci n’est pas le sujet de son œuvre, même si elle revendique le rôle curatif de sa pratique artistique (une autothérapie)… Et manifestement ça fonctionne : elle a 96 ans !
Dès 1934, son environnement lui offre ses sujets : plantes, insectes, semences… Mais elle ne cherche pas à restituer la beauté de la nature. Ses travaux de 1939 et surtout à partir de 1945 s’intéressent aux trames, aux structures, à ce qui fait tenir ensemble… et croître. L’organique, le biomorphique…
Pour autant son approche n’est pas scientifique, elle s’inscrit dans une perspective orientale : [en 1948] je peignais sans relâche des images réalistes de citrouilles. […] je m’asseyais en méditation zen […], je me confrontais à l’esprit de la citrouille, oubliant tout le reste et concentrant mon esprit entièrement sur la forme qui se trouvait devant moi. […] j’ai passé près d’un mois face à une simple citrouille. Je regrettais même de devoir prendre le temps de dormir. (2011)
Malgré sa créativité débordante, elle doit se battre pour aller étudier à Kyoto – sa famille, des pépiniéristes et semenciers aisés, est très conservatrice. Assez vite elle trouve le cadre de la peinture traditionnelle (nihonga) contraignant et se forme en autodidacte à la peinture à l’huile.
La qualité de son travail est rapidement reconnue puisqu’à 23 ans, elle a sa première exposition personnelle à Matsumoto – Tokyo suivra – avec 200 pièces. Le caractère compulsif de sa pratique qui caractérisera toute sa carrière est déjà manifeste et cette dimension est sensible à Riehen.
Ces peintures de jeunesse – et elles sont nombreuses à Beyeler – sont très touchantes et d’autant plus précieuses (et sans doute révélatrices) qu’elle en a détruit beaucoup avant de partir aux États-Unis.
Des figures constituées de points, de taches, de traits, de lignes, de grilles s’organisent selon une interprétation discrètement fantasmatique de la croissance, de l’expansion, des flux et émergent de ses fonds le plus souvent d’un noir profond : la matière primordiale, le néant ?
Elle identifie aussi des constantes d’une espèce à l’autre, ainsi ces deux plantes d’Encounter (1954) dont le calice sommital évoque un poisson (à gauche), un oiseau (à droite).
Si certains travaux font penser à Max Ernst ou Joan Miró (Rain in City, 1952), il y a aussi cette suspension métaphysique incluant le titre (The Configuration of Desire, 1954) qui rappelle, sans être figurative comme le catalan, l’atmosphère de certaines toiles de Salvador Dali.
Ses îles (de 1953) sont obsessionnellement couvertes d’écailles et plantées par endroits de coquelicots (?). The Night (1953) évoque une fleur avec des étamines et, en flamboyante couronne, les points rouges des anthères : les dots déjà. Plutôt qu’à l’abstraction, ses compositions aspirent à la dématérialisation, ainsi son autoportrait en simple grille ovale (1995) ou en tournesol rouge (1950) – la forme des pétales évoque ici les flammes stylisées de la peinture médiévale et la bouche est déportée en externe comme une fonction accessoire…
Le point ou pois (dot), le plus souvent rouge à cette époque, évoque le disque solaire du drapeau japonais : Le pois est le soleil qui symbolise l’énergie du monde et de notre vie (1968).
Son expatriation et son installation aux États-Unis, Seattle en 1957, puis à New York en 1958, ont été facilitées grâce à l’appui et l’admiration de Georgia O’Keeffe avec laquelle elle avait noué une correspondance.
De vastes huiles – certaines atteignant 10 m de longueur –, les Infinity Net (exposées en 1961) naissent de ce nouveau sentiment de liberté. Des fonds presque uniformes sont couverts d’innombrables taches juxtaposées qui laissent planer le doute : ces dots sont-ils posés en surface ou des ouvertures vers ce qui est derrière, vers l’infini ?
Mes peintures ignoraient la composition et n’avaient pas de centre. La monotonie produite par les motifs répétitifs déconcertait les spectateurs, et l’hypnotisme et la sérénité que les peintures engendraient les plongeaient dans un vertige de « néant ». (1975)
Dans cet effervescent contexte, elle diversifie les techniques et les pratiques.
Des collages sous l’influence de Max Ernst et bientôt de sa proximité avec Joseph Cornell de 1966 jusqu’à son décès en 1972, des happenings et des performances collectives (1967–69) d’inspiration anticapitaliste et pacifiste avec un mot d’ordre : Self-Obliteration (des vidéos sont visibles en salle 11). En 1969, elle s’essaye à la mode (elle y reviendra en 2012 en collaborant avec Vuitton).
Et elle innove.
Ses premières soft sculptures (sculptures molles) datent de 1961 : Accumulation #I, Aggregation : One Thousand Boats Show (1963) ou Phalli’s Girl (salle 4). Des objets (fauteuil, barque, chaussure, valise, etc.) sont couverts d’une accumulation de formes phalliques en tissu rembourré dont les silhouettes rappellent aussi celles qui entourent son autoportrait de 1950… Avec la prolifération des pièces et l’utilisation de miroirs, ses installations prennent de l’ampleur jusqu’à devenir des environnements immersifs tel Infinity Mirror Room – Phalli’s Field (1965).
Désormais elle s’affirme sculptrice (entretien avec Damien Hirst, 1998).
Lors des Trente Glorieuses, il y avait comme un saut dans le vide : en art, tout était permis… cependant il était souhaitable de trouver ou de donner du sens aux œuvres.
Avec ses envahissants multiples (phallus, dots), ses références végétales (Pumpkin/citrouille, Sprouting), la dynamique visuelle (polka dot pattern), Kusama travaille le vide lui-même, tente de créer une matière qui permet de le percevoir, non comme absence mais comme présence proliférante et structurée horizontalement à l’inverse de l’étrange jungle de la société civilisée (1964) organisée verticalement : pyramidale et hiérarchisée.
Par cette tension, elle l’inscrit dans une dimension quasi astronomique en cohérence avec les théories d’expansion de l’univers. Notre planète n’est qu’un pois parmi des millions d’autres corps célestes […] Nous devons nous abandonner dans tous ces pois, nous perdre dans le flot incessant de l’éternité. (1968)
L’oblitération qu’elle prône vise à être en cohérence avec l’abyssale insignifiance de l’Homme dans la création. Le contraire de l’ego !
Dans Driving Image, 1959–66 (non présenté) tous les objets de l’installation (mannequins, mobiliers, accessoires, etc.) sont couverts de dots, comme mitraillés et finalement traversés par l’univers, presque éclatés en atomes. De la scène ne reste que l’image abstraite et irréelle de l’univers cosy de départ.
L’astrophysicienne Katie Macken en relève la logique spatiotemporelle : L’auto oblitération de Kusama est notre futur tout autant que notre passé. (2025)
À New York, […] avoir un état d’esprit poétique est impossible. L’environnement uniforme étrangement mécanisé et standardisé lui pèse comme la perte d’humanité et de confusion, la violence des médias, la pollution… (2017 & 1975)
En 1973, elle rentre définitivement au Japon et, en 1977, elle opère un choix radical : J’ai emménagé dans une chambre ouverte à l’hôpital où je suis resté depuis. J’ai construit un studio en face de l’hôpital, et c’est là que je travaille chaque jour, faisant la navette entre les deux bâtiments.
Ces dispositions n’entament pas sa créativité, elle publie un premier roman en 1978 (d’autres suivront), ni sa notoriété : d’importantes rétrospectives lui sont consacrées de 1984 à 1987 au Japon et en 2017, elle ouvre son propre musée à Tokyo.
Avec les sculptures gonflables à partir de 1996, ses propositions changent de dimension : les installations deviennent monumentales et le visiteur pénètre dans un hypnotique tourbillon de tentacules rhizomateux contaminés de Polka dots avec un jeu subtil qui mélange les motifs en deux et trois dimensions démultipliés par les reflets sur les parois réfléchissantes. Ainsi Infinity Mirrored Room – The Hope of the Polka Dots Buried in Infinity Will Eternally Cover the Universe (2025) a été expressément créée pour la Fondation et installée dans la grande salle de presse au sous-sol. Une envoûtante caverne jaune d’or enivrée d’une vertigineuse chorégraphie de pois avec au milieu un cube miroir (à l’intérieur les couleurs noir/jaune s’inversent) qui approfondit l’immersion dans l’environnement performatif de l’artiste japonaise.
Le parcours propose trois autres dispositifs immersifs, le plus grand est installé dans le parc (Infinity Mirrored Room – Illusion Inside the Heart, 2025). Non loin le bassin ouest accueille le Narcissus Garden (1966/2025) et ses 1 200 boules en acier inoxydable.
L’exposition de la Fondation Beyeler est impressionnante et immersive. La dimension folie est physiquement sensible, pas celle que Kusama revendique, plus précisément l’expression d’une folie généralisée et, en même temps, malgré sa production phénoménale, l’impossibilité de la circonvenir, encore moins de la conjurer. Yayoi Kusama a grandi pendant la guerre sino-japonaise (1937–45) amplifiée par la guerre du Pacifique (1941–45), elle a 16 ans lors des bombardements d’Hiroshima et Nagasaki… Son engagement pacifiste innerve sa carrière et sa création : On ne peut pas éradiquer la violence avec plus de violence. (1968)
Quatre-vingts ans plus tard, l’artiste continue d’affirmer sa farouche détestation de la guerre et martèle encore son exhortation à inventer un autre monde. En témoigne le titre de la série entamée en 2021 (toujours en cours) dont l’accrochage livre ses vives fulgurances :
Every Day I Pray for Love *
et Prier, n’est-ce pas rêver le jour ? **
Celui d’après la barbarie !
* Chaque jour je prie pour l’’amour
** Pascal Quignard (L’amour la mer, 2022)
mémoire d’outre-monde

Croire aux fauves
d’après Nastassja Martin / Laure Werkmann
#THÉÂTRE
représentation du mercredi 15 octobre à la Comédie de Colmar dans le cadre des Scènes d’Automne en Alsace
en tournée jusqu’au 21 mai 2026
La pièce s’empare du récit de la reconstruction de l’anthropologue Nastassja Martin qui a frôlé la mort lors d’un affrontement avec un ours au Kamtchatka. L’actrice-metteuse en scène Laure Werkmann incarne elle-même cette femme, l’une des quatre héroïnes de la métamorphose, une tétralogie portée par sa compagnie Lucie Warrant et présentée en intégralité – avec un enthousiaste visiblement partagé – par les six théâtres partenaires de cette 13e édition des Scènes d’Automne en Alsace.
Nastassja Martin est anthropologue. Les âmes sauvages (2016), son premier livre est une adaptation de sa thèse après une immersion chez les Gwich’in en Alaska (2009). En 2015, elle traverse le détroit de Béring et séjourne chez les Évènes où elle a été confrontée à cet ours. Croire aux fauves (2019) raconte cet épisode et À l’est des rêves (2022) évoque l’ensemble de sa mission.
Des expériences au long cours, précieuses et attentives avec un regard particulièrement lucide et une analyse pertinente des conséquences désastreuses de l’extractivisme notamment et de la modernité (américaine comme soviétique/russe) tant sur l’environnement subarctique que sur les cultures animistes des peuples autochtones de ces régions.
Ces textes* sont passionnants, éclairants et documentés, mais restent ceux d’une scientifique, plus analytiques que surgis d’une rumination intime ou noués par le feu d’une conversation.
Laure Werkmann qui a aussi signé l’adaptation jongle entre une envie de transmettre ces idées dans leur intelligente complexité et celle de faire théâtre.
La conférence inaugurale est mise en scène comme un échange avec le public qui restitue la richesse de ces positions et pointe les attitudes coloniales toujours à l’œuvre ou ces assignations distillées par l’espace médiatique. Elle s’en échappe en déchirant le fond blanc de son piolet, mais des fragments de discours réémergeront à l’occasion avec parfois quelques formules affûtées.
L’actrice balance entre ce développement d’idées qu’elle partage avec conviction et ses moments de femme : son désarroi de patiente livrée aux certitudes tâtonnantes des médecins, l’intimité bienveillante avec l’infirmière russe, la complicité avec sa mère ou autour du feu de camp.
La metteuse en scène sait rythmer la trajectoire de Nastassja avec des moments brutaux ou déchirants (jeu avec le fond de papier blanc) et des éléments de décor mobiles qui nous mènent du théâtre à la montagne, des hôpitaux aux Alpes… avec un beau travail de la lumière et du son (musique flottante constellée de gouttes de piano, rock russe à un moment).
Le final façon music-hall tout en strass et paillettes où elle marque sa joue d’une blessure en paillettes rouges fait de la ruine du corps l’écho de la ruine du monde semblant attester que le spectacle (au sens de Guy Debord) l’emporte encore et toujours…
* Influencés par Philippe Descola, son directeur de thèse, et Bruno Latour, ils documentent entre autres la bipartition nature/culture, vision occidentale dominante, qui permet de considérer la nature strictement comme une ressource évacuant les effets induits et les impacts négatifs de son exploitation (y compris touristique).
avec Laure Werckmann
régie Cyrille Siffer & Zélie Champeau
scénographie Angéline Croissant
lumière Philippe Berthomé
musique Olivier Mellano
costumes Pauline Kieffer
»l’équilibre des mystères«
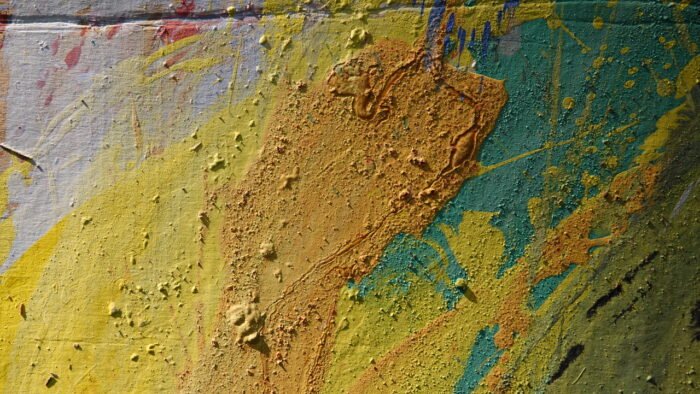
Germain Roesz | Forger lumière
#EXPOSITION
Drusenheim, Espace d’art PASO du 9 octobre au 28 novembre 2025
+ 14 plakats installées dans l’espace public (Jardins de l’Altwasser, allée du Rhin)
commissariat et textes de Germain Roesz, catalogue 52 p.
À Drusenheim, Germain Roesz est surtout connu comme le curateur des expositions temporaires, le plus souvent des monographies consacrées à des artistes contemporains qui comptent dans le bassin rhénan. Mais ce n’est qu’une des facettes de ses engagements dans le monde culturel.
Également poète, longtemps professeur en théorie, pratique et sciences des arts à l’Unistra, auteur de notices, de catalogues, etc., il nous propose ici de découvrir son activité de plasticien avec « une exposition un peu rétrospective », à l’Espace d’art Paso mais aussi dans les Jardins de l’Altwasser et l’allée du Rhin.
Dès le titre on reconnaît la patte du poète.
Forger la lumière aurait été banal voire prétentieux.
Forger lumière interroge, interpelle et ouvre vers un espace mystérieux qui se partage (a minima entre l’artiste et le visiteur), qui suggère un élan aussi, incite à la réflexion et engage vers un travail (tel celui de la parturiente) méditatif. Le rôle de l’artiste est d’ouvrir des portes sans dévoiler au regardeur ce qu’il va découvrir derrière. L’inverse des assertions autoritaires qui quotidiennement nous apostrophent pour tenter de nous définir… de l’extérieur. Germain Roesz par sa pratique, ses propositions « d’élucidation », nous emmène vers son intériorité afin de nous confronter à la nôtre.
des bleus liquides, des rouges fruités, des jaunes solaires
où que regarde le visiteur, il y a jaillissement
petit ou grand format, pièces accrochées ou posés, en deux ou trois dimensions,
des bois trouvés, des branches en chorégraphie rendues revivantes par la couleur qui « est une figure de la lumière ».
La tension va à l’abstraction (mais pas que, quelquefois s’esquisse un corps, un vêtement). À ses débuts, elle foisonnait et les peintres aspiraient à la liberté, à la libération du geste. Germain Roesz les fréquentait, les interrogeait avec curiosité et gourmandise (ses connaissances sont encyclopédiques). L’admiration et la filiation demeurent.
L’abstraction est aussi une façon de tenir à distance les contraintes sociétales et de revenir à la (vraie ?) matière du monde, de la faire surgir dans son énergie organique, d’en prolonger l’éclosion – tout comme l’extraordinaire déclinaison des verts au printemps (et dont l’arrangement change d’une année à l’autre !).
Dans son introduction il précise qu’il a écarté le noir de sa palette.
Une façon instinctive de quitter le deuil « de la misère, de l’injustice, de ce qui m’insupporte du monde qui m’entoure » pour la joie, la lumière, la couleur et, c’est peut-être ça qui le caractérise le plus, une exubérance de jeune homme toujours vivace et dans tous les territoires qu’il cultive.
Ainsi dans le catalogue, chaque toile bénéficie d’une note réflexive (pas un commentaire théorique) comme si c’était un collègue qui l’avait peinte, avec une forme d’empathie pour comprendre son propre travail et découvrir ses « éblouissements intérieurs » (1992). C’est particulièrement touchant, surtout dans ce monde où les dogmatismes (y compris en art) s’affirment avec tranchant.
Et dans ce va-et-vient, on sent une immense culture qui n’a qu’une vocation : grandir encore et toujours.
Un enthousiasme à la partager aussi !
Comme ces vers qui, ici et là, s’écrivent sur les cimaises en écho aux œuvres :
« Alterner les contraires c’est faire l’équilibre des mystères. »
traquer l’invisible

Geister Ghosts
Fantômes Sur les traces du surnaturel
#EXPOSITION
Kunstmuseum Basel | Neubau du 20 septembre au 8 mars 2026
commissaire Eva Reifert (Kunstmuseum Basel), conseillers Andreas Fischer & Susan Owens
publication en allemand et en anglais, 136 p., 20 CHF
du mardi au dimanche de 10h à 18h (20h le mercredi)
Le double titre Geister Ghosts – systématiquement en miroir inversé sur les visuels – intègre les deux nuances de la proposition avec la dimension spirituelle du terme allemand et celle plus terrifiante du vocable anglais.
Si l’exposition installe par moments une atmosphère de maison hantée, elle est ancrée par choix dans la culture occidentale à partir du XIXe siècle où la photographie notamment s’efforce de fournir des preuves sur l’au-delà avant de se tourner vers des œuvres postérieures puisant leur inspiration dans cet univers.
À l’origine de l’exposition, il y a ces nombreuses photographies du XIXe (Geisterfotografie) qui tentent de rendre visible l’invisible. Le projet y trouve son pivot et la salle 3 documente abondamment cet aspect grâce au fond de l’Institut für Grenzgebiete der Psychologie und Psychohygiene à Fribourg (D) et l’expertise de son chercheur associé Andreas Fischer.
Le XIXe siècle a été le siècle des fantômes par excellence. (Susan Owens)
L’époque est encore amplement innervée de superstitions et de religion, mais de plus en plus la science, la technologie offrent des moyens de visualiser les manifestations paranormales, voire d’apporter des éléments de preuves sur une vie après la mort ou dans un monde parallèle avec la conviction que si les défunts sont quelque part ils peuvent revenir !
De nombreuses œuvres ou archives montrent cette fascination pour les phénomènes surnaturels, les efforts pour les documenter et les discuter aussi, car il y avait les maladresses de manipulation (la chaleur des mains qui impressionne la plaque photosensible), des polémiques, des supercheries (doubles expositions des plaques…) et des procès, mais aussi de troublants témoignages : celui de Thomas Mann qui a assisté à une séance ou du psychanalyste Carl Gustav Jung dont un couteau s’était spectaculairement brisé en quatre morceaux (fragments visibles en mezzanine, salle 5). Le matériel écrit (livret de visite, publication) documente généreusement ces aspects.
Le parcours illustre aussi le rôle des médiums et présente une déclinaison d’écritures ou de dessins (souvent émouvants) effectués sous la dictée d’entités décédées – les seconds seront intégrés dans l’art brut (Madge Gill).
La cabane de Rachel Whiteread (Poltergeist, 2020), réputée fracassée par un esprit frappeur en colère et entièrement repeinte en blanc, assure une spectaculaire transition vers le XXe siècle.
Si certains phénomènes ont trouvé entretemps une explication rationnelle, les artistes préservent le doute. Ils s’en jouent avec ambiguïté (Toyen, Max Ernst ou Paul Klee), des clins d’œil quelquefois (René Magritte, Tony Oursler) ou l’envie de (se) faire peur, insidieusement comme le poétique Principles of Closure (2023) de Ji Hye Kim, en suggérant avec évanescence la source traumatique du destin spectral (Claudia Casarino) ou ostensiblement par la taille des pièces (Thomas Schütte, Katharina Fritsch). Certains lorgnent vers le spectaculaire en rameutant les ectoplasmes (Mike Kelley, Susan MacWilliam) ou vers la fiction et Hollywood (Cornelia Parker) renouant avec une forme de grandiloquence présente dans les toiles plus anciennes accrochées au début (salle 2) et inspirées de la Bible (Benjamin West), de Shakespeare (Robert Thew d’après Füssli, Eugène Delacroix, William Blake) même si certaines sont subtilement oniriques (Odilon Redon).
La scénographie s’inspire de ce cinéma de genre avec un (court) montage d’extraits de films sur le mur d’entrée et en utilisant dans le premier espace le dispositif du « Pepper’s Ghost » nimbant dans une subtile ambiance fantomatique le beau marbre de Ryan Gander : tell my mother not to worry (II) (2012).
Le même artiste préserve le mystère dans la dernière salle, vide en apparence, mais brassée d’un courant d’air modulé et parfumé : Looking for something that has already found you (The Invisible Push), 2019.
Et sur le site Web du KMB, la traditionnelle flèche est remplacée par un petit fantôme qui volette sur la page au gré des déplacements de la souris 😉
Dans cette présentation du Kunstmuseum, l’effrayant reste gentiment ludique (et fort didactique), mais comme le suggère Emily Dickinson (1830–1886) dont les vers rythment le magazine :
Point n’est besoin d’être une Chambre – pour être Hanté –
Point n’est besoin d’être une Maison –
Le Cerveau a des Couloirs – qui surpassent l’Espace Matériel –
gli occhi di Medusa
réouverture après travaux
du Musée Zoologique de Strasbourg
#EXPOSITION
réouverture du musée lors des Journées du patrimoine
avec BiodiverCité. Les animaux de la ville du 19.09.2025 au 31.12.2026
commissaires Simon Malivoire de Camas, conservateur & Samuel Cordier, conservateur et directeur du MZS
conseillères scientifiques Adine Hector, responsable du département Écologie du Territoire & Marie-Laure Desigaux, chargée de mission « animal en ville », Ville et Eurométropole de Strasbourg.
10–13h & 14–18h, en continu le week-end, fermé le lundi
Le Musée Zoologique de Strasbourg a rouvert ses portes le 19 septembre après six années de travaux et propose un nouveau parcours de médiation scientifique. L’objectif est d’en faire un des maillons du Jardin des sciences avec le planétarium, le musée de sismologie, le jardin botanique, l’observatoire astronomique et l’institut d’anatomie.
La première exposition temporaire est consacrée à la biodiversité : BiodiverCité. Les animaux de la ville (jusqu’au 31.12.2026).
Une visite de presse (12 juin) a permis de se faire une première idée. Elle se limitait à la collection Hermann et se prolongeait par la galerie des oiseaux. Une grande partie des collections était déjà en place ce jour-là et les conservateurs préparaient les derniers spécimens pour achever l’installation avant les congés d’été.
statues de plumes
de peau de becs
la peau sans les os
la mort
et le toc
pour magnifier leur beauté
celle d’avant
celle de leur vie
volatilisée
ici les dépouilles sont mises en spectacle
vivantes au-delà du vivant
empaillées hier
naturalisées aujourd’hui
des beautés immobiles
avec des inclinations enjôleuses ou mutines
un brin de sauvagerie quelquefois
une moue étonnée ou empathique
l’esquisse d’un sourire
le charme de babines gourmandes
ou carnassières
la promesse d’une confidence sur le bout du bec
des merveilles d’expressivité
Donald Duck
dans la peau d’un vrai canard
avec le chatoyant raffinement de vraies plumes
la nature reconstituée
en fascinantes images
discrètement anthropomorphisée
et les regards
profonds
aiguisés
défiants ou attendrissants
enchâssés entre les plumes les poils
des perles de verre
brillantes et noires
ou plantées d’une pupille
sur un iris blanc ou jaune ou rouge
des yeux aveugles de poupée
des yeux miroirs
où le visiteur s’invite en minuscule caméo
depuis la pénombre des vitrines
des centaines de regards
nous renvoient notre destin de Méduse
à son regard pétrifiant
à notre complicité consentante
à la prédation des chasseurs
au dépouillage des taxidermistes
nos pas arpentent ce cimetière
avec ses cadavres
aux grâces prudentes
à l’étrangeté ensorceleuse
aux plumages chamarrés
des objets d’admiration
des objets définitifs
en surface tout est d’origine
c’est la provoquante ingénuité de Marilyn
empaillée
avec ses vraies boucles blondes
sa bouche sensuelle
sa mouche sous la pommette gauche
et sa peau de femme
la peau qu’ont caressée Miller et Kennedy
toute la peau tendue sur une forme en synthétique
un spécimen plus ressemblant
qu’au musée Grévin ou Tussaud
ici l’enveloppe passée est convertie en sépulcre
ailleurs la momification bénéficie au défunt
lui fournit le viatique pour l’au-delà de la mort
ici les morts paradent pour les vivants
dans leur simulacre de vie
en une sarabande collective et bariolée
de l’enluminure clinique
où même les œufs
flottants comme des planètes dans l’éther
sont des coquilles vides
ici l’expertise perfectionne
une économie de la mort
pour instruire et éblouir les vivants
sur la Vie
grâce à la vie absente
notre regard émerveillé exige le cadavre
et en voyeur de la mort
triche avec la vie
les cartels disent
la zoologie la géographie
l’état de la connaissance
mais les mots ne sauvent pas le monde
ils sont le lieu de sa défaite
ils entretiennent l’illusion d’échapper
à la barbarie du monde
à la tyrannie de la mort
fugitivement
ici le silence règne en destin
La pace è dei sepolcri!
La paix est celle des tombeaux !
comme le cingle Rodrigo* à la face du pouvoir
ces statues sont muettes
elles ont des bouches et ne nous parlent pas
elles ont des yeux et ne nous voient pas […]
la mort est toujours un pays où l’on va en perdant la mémoire**
même la mémoire de la mort
* Verdi / Don Carlo (Atto I, scena 4)
** Alain Resnais, Chris Marker / Les statues meurent aussi (1953)
postlude et ouverture automnale
on pille des Nègres, sous prétexte d’apprendre aux gens à les connaître et les aimer,
c’est-à-dire, en fin de compte, à former d’autres ethnographes
qui iront eux aussi les « aimer » et les piller.
Michel Leiris (lettre du 19.09.1931)
L’écrivain lui-même aurait pu remplacer Nègres et ethnographes par Nature et naturalistes…
Il avait été recruté comme secrétaire archiviste de la mission Dakar-Djibouti dirigée par l’ethnographe Marcel Griaule. L’expédition a traversé l’Afrique de mai 1931 à février 1933 et a « prélevé » de nombreux biens culturels (beaucoup sont visibles aujourd’hui au musée du quai Branly), mais aussi, pour le Museum d’histoire naturelle, des animaux vivants et d’autres naturalisés : des centaines d’oiseaux et des milliers d’insectes ! Dans les lettres à son épouse puis dans L’Afrique fantôme, il documente les conditions de cette collecte : rapines, spoliations… D’ailleurs, suite à la parution de l’ouvrage en 1934, il se brouille avec la plupart des membres de l’équipe notamment le chef d’expédition.
Ces pratiques relevaient clairement d’un pillage colonial et, ces dernières années, les musées commencent à répondre favorablement aux demandes de restitutions de certaines pièces émanant d’États africains.
Si la collecte était similaire pour les animaux, le cadre (légal, administratif…) est plus flou et les spécimens ont été dénaturés (peaux tannées et tendues sur des modèles en paille, en matières synthétiques).
La science, plus précisément la façon européenne de s’approprier la connaissance, servait d’alibi à ces agissements. Une métaphore en illustre l’esprit : Quand les Orientaux veulent comprendre une fleur, ils s’installent face à elle et s’efforcent de se mettre à sa place, de « devenir la fleur », les Occidentaux, eux, vont la disséquer…
Si l’origine de sa collection est antérieure (beaucoup de dons remontent à 1840–1870), le Musée Zoologique de Strasbourg est aussi l’héritier de cette culture scientifique, de cette forme de civilisation. Avec 1 200 000 pièces (naturalisations, mais aussi ensembles séchés ou préservés dans l’alcool, préparations ostéologiques), il couvre un panorama plutôt exhaustif de la biodiversité sur les cinq continents. Quelques spécimens sont particulièrement précieux : des espèces difficilement observables (cœlacanthe) ou aujourd’hui disparues (thylacine, grand pingouin).
L’institution possède aussi un riche fonds d’ouvrages anciens et de modèles pédagogiques (supports de transmission des savoirs) : L’Histoire naturelle des oiseaux de Georges-Louis Leclerc de Buffon et ses 1 008 planches peintes à la main, les modèles en papier mâché du docteur Auzoux et ceux en verre de Léopold et Rudolf Blaschka. Ces derniers constituent un ensemble unique en France, il est exposé en intégralité dans le nouveau parcours.
Celui-ci présente 1 800 spécimens dont certains ont été restaurés pour la réouverture (une rotation est prévue par la suite). Plus accessible (handicap, cartels en trois langues…), il se déploie sur trois étages et décline cinq séquences : l’histoire des collections et leur rôle dans la recherche, l’enseignement, la compréhension du vivant, l’écosystème du Rhin supérieur et la biodiversité régionale, celui des océans (illustré par la baie de Sagami au Japon) notamment leur rôle dans la régulation du climat, la nature au laboratoire à travers ses travaux (moustiques & abeilles) et un espace dédié aux expositions temporaires.
Les habitués retrouveront « dans son jus » la galerie des oiseaux et la collection Hermann créée au XVIIIe siècle – un cabinet de curiosité implanté près de Saint-Thomas qui est à l’origine du musée – qui incarnent le MZS dans la mémoire collective : l’ancien mobilier – des vitrines aux châssis en bois – a été conservé et rénové.
« BiodiverCité. Les animaux de la ville », la première exposition temporaire, invite à découvrir une trentaine d’espèces au sein de cinq milieux représentatifs de l’urbain : la rue, les égouts, le parc, la cathédrale, la friche. Le parcours est agrémenté par les dessins de Valentine Plessy, illustratrice naturaliste.
sans oublier…
À partir de 1981 et jusqu’à sa fermeture pour travaux, le musée ouvrait régulièrement ses cimaises à des artistes pour exposer leurs œuvres en écho, en dialogue et/ou inspirées de ses collections.
Paru en avril 2025 chez Association des Presses Universitaires de Strasbourg et initié par l’Association des Amis du Musée Zoologique de Strasbourg, L’imaginaire artistique d’un Musée Zoologique (144 p., 186 ill., 40 €) restitue cet important champ de réflexion et de création autour de l’art animalier hanté par le génie du lieu.
faire confiance à la transe

En regard
Léo Lérus / Sharon Eyal
#DANSE
représentation du jeudi 18 septembre à 20 h à La Filature, Mulhouse
en tournée jusqu’au 4.05.2026
Léo Lérus rencontre Sharon Eyal en 2005 quand il intègre la Batsheva Dance Compagny. Par la suite, plusieurs collaborations naissent de cette proximité et il l’assiste sur le beau Love cycle présenté à La Filature en octobre 2021.
En mars 2024 lors de la Quinzaine de la Danse, Bruno Bouché découvre avec enthousiasme son Gounouj et propose de monter un diptyque avec une création de Léo Lérus « Ici » et « The Look » (2019) de Sharon Eyal qui entre au répertoire du Ballet de l’OnR.
passeggiata
une plage ou une place
un territoire de rencontre
une fille un garçon s’y rejoignent, s’y jaugent
d’autres jeunes gens s’agrègent
short et teeshirt blanc et sable
une passeggiata rythmée par le son caribéen
une légèreté enlevée
un être ensemble ludique et facétieux
du partage effervescent
et une bouillonnante géométrie de la déambulation sur le vaste plateau de La Filature
les douze danseurs dessinent des droites des courbes qui se joignent, se croisent et ploient
à tour de rôle, seul, par paire, les individualités s’affranchissent de la rigueur des trajectoires
les corps se revendiquent libres
les gestes arachnéens des bras des jambes dessinent la singularité de chacun
à la maîtrise classique comme contemporaine des danseurs du Ballet du Rhin, Léo Lérus infuse la sève de ses racines
gwo-ka : danse traditionnelle stimulant/provoquant les percussions
léwòz : réunions nocturnes pour résister à l’asservissement
ou bigidi = jamais ne tombe
piétinements feintes esquives
des jeux de jambes nerveux
des corps en déséquilibre en torsion ou bondissants, évoquant des sauts d’Arlequin
des corps hiéroglyphes qui racontent et vivent de microhistoires et tissent des liens et dont l’enthousiasme provoquant appelle la musique (Denis Guivarc’h)
sur le fond vers le bas, une lumineuse nappe colorée fascine et mue, en jaune rouge vert bleu
mais elle reste sous la menace du long et lourd pendrillon noir et d’une nuée sombre dévalant des cintres
le gris vorace couvre l’enchantement des pastels
le son enfle évoquant une locomotive lancée*
la tourmente bouleverse et disperse le groupe
la lumière cisaille les corps déhanchés affrontés, gèle les mouvements en poses tétanisées
l’adversité stimule les efforts et les rangs se resserrent
à nouveau
plus forts
et cherchent retrouvent la solidarité du collectif dru et compact
le rideau descend
lentement
voile leur destin
leur envie d’avenir est manifeste
leurs doutes aussi
* le son du cyclone Maria enregistré en 2017 par le chorégraphe
fleur noire
si Love, Chapter 3 : The Brutal Journey of the Heart était spectaculairement énergique The Look est tout en retenue
au début
mais tout aussi envoûtant
les dix-huit danseurs font cercle, noués et de dos en justaucorps noir
le plantureux bourgeon d’une fleur nocturne qui vibre au gré de microgestes secs et nets : secousses minuscules des têtes des épaules
en imperceptible croissance, le pulsatile organisme est soumis au flux de capricieuses bourrasques
en saisissant contraste avec la musique répétitive et bondissante d’Ori Lichtik : d’électroniques et jaillissantes percussions obsessionnellement ourlées de cordes ondoyantes
l’affrontement image son est hypnotique
il enfle en espace, en puissance, en densité avec le martèlement des basses qui saisissent aux tripes
émerge en pistil, le visage pâle, les bras aériens d’un danseur (Miguel Lopes)
et le bourgeon s’ouvre, grandit, monte en vie, en rythme
les autres bras nus et blancs s’extraient, s’agrippent et dessinent une frise ivoire sur la pulpe sombre des corps
les visages se tournent et l’amplifient
la légèreté des demi-pointes active la dérive incertaine d’un noir nénuphar flottant sur le plateau
pulsions de galériens, impulsions de marionnettes et la fleur s’ouvre, éparpille ses spores, ensemence le territoire
une dispersion retenue par une attraction magnétique et centripète
la musique s’offre des sonorités extrême-orientales, revient à un fracas de machines sous une lumière économe suggérant la caverne de Platon
le corps collectif se réarme en submersive pulsation
se recueille en être animal végétal
et humain
Autant chez Léo Lérus les danseurs diffractent de la ligne – avec un désir d’émancipation ? –, Sharon Eyal fait naître une transe hallucinatoire qui subjugue les individus et les soude en un gigantesque cœur battant dans l’infini…
la terre serait née d’une fleur nous dit Anne Sibran (Enfance d’un chaman, 2017).
avec les danseurs du Ballet de l’Opéra national du Rhin
Ici [création], pièce pour 12 danseurs
chorégraphie Léo Lérus
composition sonore Denis Guivarc’h
costumes Bénédicte Blaison
lumières Chloé Bouju
The Look [entrée au répertoire], pièce pour 18 danseurs
chorégraphie Sharon Eyal
musique Ori Lichtik
costumes Rebecca Hytting
lumières Alon Cohen
les coulisses du temps

Pierre Coulibeuf · Jérôme Game
Réunis : séparés
#EXPOSITION
galerie de La Filature, Scène nationale de Mulhouse du 18 septembre au 16 novembre 2025
commissariat Emmanuelle Walter
exposition présentée dans le cadre des Journées de l’architecture 2025
En invitant pour une exposition partagée les deux artistes, Emmanuelle Walter souhaitait qu’ils imaginent une proposition qui à la fois séduise et interpelle par la mise en résonance des différents médias – textes, sons, images fixes ou animées – tout en produisant du sens.
Une exposition ambitieuse allant bien au-delà d’une pause d’entracte ou d’avant spectacle.
Des images d’abord. Celles de Pierre Coulibeuf.
Puissantes et installées dans le temps.
Dans le champ des corps en jeu, avec l’autre, avec l’espace.
Certains plans évoquent Tarkovski : des femmes à la fenêtre, une attente en prise avec l’ample respiration des éléments – vents paysages ciel océan. La marche aussi pour s’y immerger.
Du son, mais pas toujours, et aucune parole. L’échange passe par les regards, les gestes, les contacts. Et le temps. La densité du temps.
Quand il travaille avec un chorégraphe – Benoît Lachambre pour A Magnetic Space (2008) – ou des performeuses – Vânia Rovisco, Andresa Soares, Véronique Nosbaum – l’emprise de l’espace sur les corps se fait plus heurté. Oppressant parfois.
Et le rythme est à contretemps des impérieuses injonctions ambiantes (urgence, productivisme…). Même les choix techniques l’attestent. Pierre Coulibeuf est cinéaste, travaille en argentique (16 ou 35 mm) et ce sont des photogrammes réalisés à partir des rushs qu’accueillent les cimaises (en collaboration avec le photographe Jean-Luc Moulène pour Le Démon du passage, 1995/2006).
Les mots, ici, sont le domaine de Jérôme Game, poète, professeur d’esthétique à la HEAR (mais sa palette est bien plus vaste).
Les mots de (grands) cartels qui documentent des images absentes. Ils donnent les informations habituelles (techniques utilisées, dimensions, date et source), mais en prolongent la description qui… balbutie, doute, s’avorte suggérant la tension autoritaire des mots.
Les mots écrits des frises au-dessus des images de Pierre. Eux aussi tronqués, ressassés et semblant sédimenter la difficulté à communiquer des êtres filmés.
Les mots dits par l’auteur lui-même. Trois haut-parleurs diffusent des cartels sonores qui pareillement triturent la langue, la mettent en doute, en scansion (on pense à Joyce).
Si l’on ajoute la chanteuse (Véronique Nosbaum dans ENIGMA, 2022), dès l’entrée, le visiteur est nimbé dans un bruissement (sans que cela ne gêne la compréhension quand il est à proximité d’une des sources) qui l’incite à flâner, à se laisser envoûter par l’atmosphère.
Ce qui insiste, ce qui persiste dans l’image, c’est ce qui change (Jérôme Game) : la mise en expographie de Pierre Coulibeuf et Jérôme Game assume sa fragilité, ouvre quelques pistes sur comment exposer les mots, et en creux la difficulté à donner du sens [à] aujourd’hui…
Une exposition à l’intersection des mots, des sons, des images qui suggère de prendre le temps, celui de regarder, de lire, d’écouter, mais affirme aussi le choix des artistes de prendre le temps de fabriquer ensemble. Et trouver du sens malgré tout…
ludiques démystifications

Cassidy Toner. Besides the Point
#EXPOSITION
Kunstmuseum Basel | Hauptbau du 22 août 2025 au 11 janvier 2026
commissaire Alice Wilke
HANDS ON, publication d’artiste en allemand et en anglais, photos Cassidy Toner, textes Maja Wismer & Alice Wilke, 85 p., 29 CHF
Le Gegenwart étant actuellement fermé, trois des cinq salles d’exposition temporaire du Hauptbau accueillent le travail de Cassidy Toner, la lauréate 2025 de l’important Prix Culturel Manor qui vise à promouvoir l’art contemporain et offrir un tremplin aux jeunes artistes en Suisse.
Née en 1992 aux États-Unis, mais active à Bâle, l’artiste a réalisé in situ un gigantesque dessin mural et présente une vingtaine de sculptures en céramique, une vidéo et une installation avec des objets moulés en résine synthétique et en étain.
Les vastes baies de la salle principale font face au dessin couvrant deux murs : It looks nice outside. Il s’amuse des à-côtés du Déjeuner sur l’herbe (1863) d’Édouard Manet : restes de victuailles, panier et bouteille renversés, rapine de fourmis…
Ce choix de démystifier des icônes du patrimoine artistique se retrouve dans les pièces en céramique. De l’impressionnant Hercule Farnèse, elle ne garde que le tronc rabattu – béquille rendue nécessaire par son déhanchement – et la peau du lion de Némée (premier des douze travaux et un des attributs du demi-dieu).
Ce moignon d’arbre, figure récurrente de la série, est à la fois phallique et fragile : une timide feuille perce sur l’un, un autre est enlacé par un serpent (échappé du jardin d’Éden ?) ou coiffé d’un sachet de caisse (en céramique aussi).
Quelques figures voisinent avec cette forêt amputée : un billet de banque fatigué de passer de mains en mains, un réveil énervé de claironner le temps qui passe, une clef éreintée à force d’être malmenée…
Le ton chaleureux des glaçures et l’expressivité anthropomorphisée de certaines pièces renforcent la séduction de ces clins d’œil. Cassidy Toner prend visiblement plaisir à repérer et à mettre en scène dans ses terres cuites ces grains de réalité dont la présence et quelquefois l’entêtement réfutent les postures avantageuses et le triomphalisme ambiant.
Dans la salle voisine, la vidéo en anglais « En garde » est plus tapageuse. Un gardien entraîne ces phrases toutes faites qu’il répète à longueur de journée, un peu comme devant un miroir, sauf qu’il arpente le musée désert (et ses récurrents fuck expriment aussi quelques frustrations). C’est essentiellement des plans larges avec dans le champ certaines œuvres du Kunstmuseum.
À côté, une installation conçue comme un espace interstitiel avec un distributeur vendant des cigarettes, une céramique à moitié déballée, des outils qui traînent au sol amènent la (vraie) gardienne à prévenir les visiteurs et… mimétiser la vidéo ! En moins énervée 🙂
En septembre, la parution de HANDS ON prolongera la proposition. Cette publication est le fruit d’un travail photographique entamé par l’artiste avec son smartphone en 2014. Dans chaque cliché, une main intrusive vient systématiquement perturber le sujet photographié emblématique de l’univers lifestyle : un contrepoint provoquant ou ludique au glamour pasteurisé relayé par nos médias, cette extase de la communication pour reprendre l’expression de Jean Baudrillard.
Un travail sage et agréable qui devrait s’autoriser à être plus subversif !
Mehr Licht !

#EXPOSITION
Temple Saint-Étienne (Mulhouse) du 12 septembre au 26 octobre 2025
Deux ans après « Quand dix mille vues entrelacées apprivoisent la lumière », Élisabeth Bourdon revient au Temple Saint-Étienne pour six semaines avec ses dernières créations. Elles explorent avec beaucoup de liberté son travail innovant sur la couleur et la lumière.
Mehr Licht ! Mehr Licht ! *
ce cri de Goethe sur son lit de mort sonne comme une soudaine et ultime révélation pour ce théoricien (contesté) de la couleur !
Loin de ce tragique, les derniers travaux d’Élisabeth Bourdon approfondissent cette métamorphose de la couleur vers et par la lumière !
Depuis 2019, elle utilise comme support la surface de luminaires led (60 x 60 ou 30 x 30 cm) et y applique en attentive superposition des diapositives, des négatifs, des clichés radiologiques… Désormais elle s’affranchit de la contrainte du matériau et ces films cellulose sont devenus sa terre glaise pour faire surgir la lumière. Incandescente, colorée et apprivoisée !
Ses dernières pièces sont de subtiles compositions abstraites qui se jouent de la géométrie : des fulgurances qui cinglent filtrent strient suturent les couches successives – au besoin un trait de peinture vitrail attise ou affine ces vives saignées.
De près, se découvre la délicate convergence de motifs patiemment sélectionnés et agencés (sculptures, peintures, architectures…) dont elle utilise la dominante tonale et formelle…
Jouant de cette transparence, la télécommande des dispositifs led permet de varier l’intensité et la chaleur de la lumière, un peu comme si une œuvre déclinait à elle seule la série complète des façades de la cathédrale de Rouen de Monet !
Et il n’est pas anodin qu’Élisabeth Bourdon aime exposer au Temple Saint-Étienne où son art du vitrail réinventé dialogue avec les verrières du XIVe qui enluminent l’édifice.
* Plus de lumière !
échos de la tyrannie

saison d’été 2025 à Bussang
#THÉÂTRE
Le Roi Nu (Evgueni Schwartz / Sylvain Maurice)
Je suis la bête (Anne Sibran / Julie Delille)
représentations du samedi 1er août 2025 au Théâtre du Peuple, Bussang
Cette année, l’usage du Fagus (le hêtre) est un peu atypique – très poétique au demeurant – et Julie Delille semble vouer une grande affection à ce paysage, cet arbre.
L’après-midi Sylvain Maurice, metteur en scène invité, propose Le Roi Nu d’Evgueni Schwartz, auteur satirique et engagé (contre Staline), mais dénonçant aussi la lâcheté et le consensus mou, inévitables bâtards de la tyrannie (cf. Le Dragon).
Le spectacle du soir est la reprise d’une proposition que la directrice a créée en 2018 dans le Berry (jeu et mise en scène). Cette subtile performance à ras de terre interpelle l’animalité, la parole… et le pouvoir !
vertigineuse vanité
Chez Sylvain Maurice, le fond est ouvert dès l’entrée du public.
Avec les roulements de tambour caractéristiques, il convoque l’univers du cirque : des clowns ou des nains déboulent de la forêt. Avec leur groin rouge, on identifie rapidement les cochons du porcher Henri (Mikaël-Don Giancarli). Le bouffon (Hugues Dutrannois) ou le tisserand évoquant Groucho Marx prolongeront le circassien, mais c’est plutôt l’esprit du music-hall qui structure le spectacle et cette option fonctionne très bien.
L’intrigue amoureuse entre le porcher et la princesse est assez naïve, les personnages, les situations sont souvent cocasses et avec le strass et les paillettes dont le roi abuse, il suffit de pas grand-chose pour rendre ridicule son hallucinante vanité. Le déplacement de praticables – des boîtes à malices en forme d’escaliers – rythme la production en une succession de numéros où le roi se la jouera même meneur de boys band (I am the king). Les deux musiciens (Laurent Grais & Dayan Korolic), installés dans les loggias à cour et jardin, ponctuent ces changements et interviennent en étroite complicité des jeux de scènes.
Manuel Le Lièvre joue le roi avec gourmandise abusant des menaces de mort à la moindre contrariété. Il alterne les costumes au mauvais goût assumé, mais doit se contenter d’un coquillage doré en guise de cache-sexe (par une météo bien frisquette) – et d’une couronne ! – pour descendre la colline et faire son entrée « triomphale » pour le mariage (applaudissements très nourris pour ce moment rituel).
Les autres (les « vieux »…) font carpettes et la logorrhée des plus prolixes (Nadine Berland, Jacques Courtot) se contorsionne en phrases alambiquées pour entretenir l’ego du souverain, une illusion d’intelligence camouflant leur impuissance gavée de lâcheté.
Seuls Henri, son comparse Christian (Maël Besnard) et la princesse (Hélène Rimenaid) se rebellent en manipulant autant les courtisans que le roi.
Le public rit de bon cœur tout au long du spectacle tant des situations que des bons mots du texte.
La pièce reste proche du conte – l’allusion à La Princesse au petit pois d’Andersen est régulière – et ruse avec la censure de l’époque, en vain : elle montre trop l’imbécillité et l’arrogance des puissants (la plupart des pièces de Schwartz ont été créées après sa mort (1958) lors du Dégel sous Khrouchtchev). Ici, au théâtre, c’est drôle, réjouissant et cela ne serait pas bien grave si, dans le réel, ils n’avaient un tel pouvoir de nuisance !
nocturne animal
Pour la pièce du soir Je suis la bête d’Anne Sibran d’après son roman (2007), l’entrée se fait au compte-gouttes pour « enfermer » le public avec Méline dans le noir du placard.
Un jour, ils m’ont poussée dans un placard, puis ils ont refermé la porte. Et je ne les ai jamais revus.
Au début seule la voix de l’actrice trouble ce noir, puis peu à peu en émergent visage mains et pieds, un travail au sol ponctué des phrases du monologue de Méline : un récit très ancré sur le corps, animal par nécessité.
Camouflée de sombre, Julie Delille s’invente en gestes, en maintien de sauvagerie avec des affûts, des exaltations, jouant parfois de sa longue chevelure. Elle n’apparaîtra en pleine lumière que lors de son jeu avec les abeilles.
Par moments, la luminosité se fait plus intense, mais elle ne va jamais au-delà d’un large ovale blafard comme un étang éclairé par le clair de lune.
Cette pénombre subtile et délicate libère une lumière impalpable qui s’accroche à la brume, affleure la matière du plateau (une peau souple sous laquelle se glisse quelquefois la comédienne) faisant vivre un univers nocturne et frémissant entre faim, chasse, survie…
À la fin, un sfumato nocturne révèle imperceptiblement le paysage et le Fagus en silhouette romantique (lumières d’Elsa Revol).
La création sonore d’Antoine Richard soutient discrètement la narration entre musique, bruitages et vibrant Waldweben*.
Le récit – langue inventive et profonde d’Anne Sibran – est comme une lente respiration convoquant les péripéties de la vie de cet enfant jusqu’à sa friction avec les humains entamée avec l’homme des abeilles.
Sa parole fragile questionne la légitimité de cette hiérarchie homme animal et Méline, victime de cette prise de pouvoir – sur son corps notamment –, regagne la sylve, avec ici son cher Fagus.
Le dernier tableau prolonge la poésie et, après les saluts, Julie Delille invite à savourer le moment et l’inspiration du lieu avant d’aller la rejoindre dans la clairière pour un bord de plateau qui devient ici un bord de forêt.
*murmures de la forêt (interlude du Siegfried de Wagner)
la contagion du sacrifice

_performance d’Andrée Weschler lors du vernissage de
FRAGMENTS MCMXCV – MMXXV de Pierre Gangloff
#EXPOSITION
La Case à Preuschdorf du 28 juin au 13 juillet 2025
FRAGMENTS MCMXCV – MMXXV de Pierre Gangloff
#PERFORMANCE
du 29 juin d’Andrée Weschler, artiste performeuse & plasticienne
À l’occasion du vernissage de son exposition FRAGMENTS MCMXCV – MMXXV (30 ans de création) à la Case à Preuschdorf, Pierre Gangloff a invité l’artiste Andrée Weschler, très active à Singapour pendant une trentaine d’années, à se produire en performance.
Lors de leurs échanges en amont de cette création, outre ses propres œuvres – un certain nombre inspiré par la peinture et les thématiques médiévales –, il avait évoqué la Marie Madeleine en extase du Caravage (Maria Maddalena in estasi, 1606).
Regard sur sa prestation…
petits gestes de régie
d’abord
tendre le rouge velours
installer l’espace
rassurant
l’espace du rite
poser le corps
longuement
le chauffer un peu
mouvement pendulaire
en aérienne ébriété
gauche droite gauche
et le regard
surtout le regard
circulaire attentif
puis pénétrant
regard écarquillé
d’un bleu métallique
surligné en héroïne de manga
une plongée en soi
une montée en densité
ouvrant le regard intérieur
qui agrandit le corps
étend ses prolongements
jambes torse et tête bras et mains
regard aveugle pourtant
sauf à toi
en toi
une conscience immobile
et puissante
à la dimension de la scène
de la salle
un temps suspendu
de silence
de présence
un premier geste naît
instinctif évident
presque indifférent
la main cueille l’œuf
métaphore du monde
fragile compact
replié sur l’origine
le dresse vers le ciel
l’applique sur la voûte qui l’incarne
et appuie jusqu’à ce qu’il cède
montre sa fragilité
la fragilité du monde
pourtant il résiste
les deux mains se conjuguent
le regard le cou le souffle enflent
s’insurgent
en vain
le corps entier s’y emploie
l’Eve Madeleine doit s’incliner
être en travail comme pour une parturition
jusqu’à l’explosion
et un temps suspendu
étale et religieux
le silence unanime de la sidération
éparpillement des doigts
en ascension
geste rituel
dispersant les fragments
de l’azur vers le rouge velours
les autres œufs
facilement s’enchaînent
brisures plus nets
plus conformes
et gober la lune
ou le soleil
le blanc lustral
le jaune d’or
s’abreuver à la source
de ce flux du monde
la bouche en gourmandise
la noblesse grecque déligné en profil
comme sur un papyrus égyptien
et les caresses contre le bras la joue
cette onctuosité de l’échange
avant de fracasser le dur
en abrupte explosion
accouchant du liquide éclat
sept
comme les péchés capitaux
les notes de la gamme
le blanc des sept coquilles
craquent sous les pas
des cosses du temps
en délicate effraction
sur le sang du velours
le regard s’incline
se redresse vers l’infini
déposant l’énergie du rite
prenant congé de Marie Madeleine
du silence aussi
prenant le temps
de descendre de l’extase au siècle
et la sanctifier
en ponctuation finale
d’un humble merci
retour vers les mots
qui s’égayeront de l’inessentiel
tous ces mots qui font semblant
semblant que le monde reste en état de marche
_Towards Happiness, Prosperity & Progress:
Reflections on the Singapore Spirit*
* Vers le bonheur, la prospérité et le progrès : réflexions sur l’esprit singapourien
#EXPOSITION
Singapore, The Private Museum du 2 octobre au 7 décembre 2025
commisaires Andrea Fam, Deborah Lim, John Z. W. Tung, Kirti Upadhyaya, Michael Lee, Michelle Ho
À l’occasion du 60e anniversaire de Singapour, l’exposition rassemble 60 artistes singapouriens ou basés à Singapour, 60 œuvres d’art et 6 conservateurs pour une réflexion approfondie sur l’esprit singapourien.
Dernière étape du programme 2025 du Private Museum, elle conclue une année riche d’exploration artistique et culturelle.
Parmi les artistes invités, Andrée Weschler qui présente une installation avec trois pièces restituant sa performance : Hairy Virgin.
l’épure du qualitatif

Sortie de réserves #1
#EXPOSITION
Colmar, Musée Unterlinden du 9 juillet 2025 au 2 mars 2026
conservation Camille Broucke, Casey Ackermann, Magali Haas, Vincent Husser, Raphaël Mariani, Lisa Michel, Corentin Pellegrini, Léa Rosenfeld, Christelle Varin-Bey
du mercredi au lundi de 9h à 18h (fermé le mardi + 1.11 & 25.12)
Comme son nom l’indique, l’accrochage Sortie de réserves #1 (l’estampille suggère que d’autres suivront) présente des pièces qui ne sont pas exposées dans le parcours permanent. Il affiche aussi son ambition pédagogique : des cartels expliquent à chaque fois les raisons de cette absence avec en creux quelques clefs sur le fonctionnement du musée et la gestion de ses missions.
Petite incursion dans les coulisses de la muséographie…
Les musées sont les héritiers des cabinets de curiosités de la Renaissance (studiolo en italien, Wunderkammer en allemand) où s’exposaient aussi bien des dents de narval (censément de licorne :), des nautiles (très prisés), des sculptures antiques que des toiles de maître de l’époque. Quand ils se transforment en musées (à partir de la fin du XVIIe siècle), ils conservent ce côté fourre-tout avec plusieurs registres d’accrochage et une logique quantitative : donner à voir le « monde » dans toute sa richesse et sa diversité. Les photos de la chapelle où est conservé le Retable d’Issenheim avant 1914 et celle de son aménagement récent en témoignent. En 1903, Joris-Karl Huysmans, en visite aux Unterlinden, évoque un véritable « bric-à-brac ». Ces dernières années, comme dans la plupart des musées, une ambition à la fois scientifique, pédagogique et de mise en valeur des pièces a conduit à alléger les présentations et ainsi à en écarter certaines qui ont rejoint les réserves.
Avec des œuvres datées du médiéval jusqu’au XXe siècle, la proposition documente cette évolution et aussi des choix esthétiques, comme pour l’art contemporain de privilégier les avant-gardes et la seconde École de Paris au détriment du figuratif et des artistes locaux. Des impératifs de conservation (notamment pour les objets archéologiques, il y a deux vitrines) ou des changements de paradigme (statut des copies) jouent également.
La scénographie est fine, lisible, s’inscrit dans la logique épurée désormais de rigueur et installe une forme de dialogue avec le public voire de complicité avec les habitués.
Des titres rythment le parcours et en transcrivent l’esprit :
Je suis une copie
Je n’ai pas de cadre
Je suis en cours d’étude
Je suis en chantier de collection
Je suis régionaliste mais pas avant-gardiste
Je ne suis pas de la région
J’attends une place dans le parcours permanent
La grande photo des réserves (incluse dans la communication sur l’exposition) donne même une jolie et intrigante profondeur à l’espace quand on revient sur ses pas.
l’éloquence du silence

Vija Celmins
#EXPOSITION
Riehen (Bâle), Fondation Beyeler du 15 juin au 21 septembre 2025
commissariat Theodora Vischer et James Lingwood
catalogue en anglais ou en allemand, 208 p., 62,50 CHF, 58 €
Avec Vija Celmins, et après Wayne Thiebaud en 2023, la Fondation Beyeler nous offre une autre belle découverte venue d’outre-Atlantique. Une ample rétrospective pleine de douceur et de sérénité !
Née à Riga en 1938, elle suit ses parents qui fuient l’avancée russe et migrent vers les États Unis en 1948 où la jeune femme fait ses études d’art. Indianapolis, Los Angeles, le Nouveau-Mexique, New York puis Long Island où elle vit et travaille encore aujourd’hui. Près de l’océan !
Durant sa carrière, elle n’a réalisé qu’environ 220 peintures, dessins et sculptures. L’exposition n’en réunit pas moins de 90 allant des années soixante à 2024 et a été organisée en étroite collaboration avec l’artiste.
des objets quotidiens
d’abord
deux lampes (Lamp. #1, 1964)
comme les yeux du fond braqués sur l’observateur
une plaque de cuisson (Hot Plate, 1964)
sa fiche et son fil tendus comme un manche vers la main du spectateur
le feu sourd d’un calorifère tenu à distance par la grille (Heater, 1964)
pas de flamme mais une couleur dense surgi du fond
d’un enfer épais situé bien au-delà de la toile
et sans la pliure entre l’horizontale du sol et la verticale de la paroi
en abstraction
le prosaïque n’intéresse pas Vija Celmins
elle fuit le trivial, l’engouement pour le sériel
cet univers matérialiste et proliférant que font claquer Warhol, Lichtenstein et tant d’autres
hyperréaliste ?
quand elle peint une lettre, elle falsifie les timbres (Letter, 1968)
et le plus souvent elle peint l’impossible
des bombardiers en plein vol
un champignon atomique
un incendie
le sol lunaire
un mouvant, un inaccessible dont la photo peut saisir l’instantané
pas la peinture de chevalet
entre distance et intimité, quelque part mon œuvre ment *
pourtant elle gèle pour l’éternité ces dynamiques phénoménales
et si elle travaille d’après photographies
la matérialité de la toile reste vibrante
comme les couches, nombreuses
et les passages au flou pour sortir du motif, accéder au blanc du support
progressivement les artefacts disparaissent
l’humain ne compte pas / plus
ou si elle le peint, il brûle : Burning Man (1968)
et ses machines sont des engins de mort
l’écume de sa microscopique mise en spectacle
or Vija Celmins traque l’essentiel
et l’homme dans la Création compte pour si peu
elle peint ses premiers ciels dès la fin des années soixante
des nuages
et aussi la houleuse surface de l’océan
suivront les confins galactiques
des sols enneigés
des toiles d’araignées
la surface de coquillages
la résille craquelée de céramiques
et récemment ces aériennes chorégraphies de flocons de neige
son hyperréalisme n’est qu’un (ardent) prétexte
il ordonnance la possibilité de l’espace dans les deux dimensions du support
le traitement du sujet articule le rapport au sujet du spectateur
le minutieux rendu mobilise son regard et l’emmène ailleurs
vers une abstraction spatiale
et une olympienne éternité
en général la peinture organise la profondeur en plans successifs, échelonnés de l’avant-plan vers l’horizon
une illusion élaborée souvent avec gourmandise
Vija Celmins commence en amont
elle installe l’accrétion (la distance-attraction) entre le spectateur et le plan du support avant de le subjuguer vers son au-delà
le motif et le frémissement lumineux médiatisent cet accès à la profondeur
aspire le corps du regardeur comme le ferait un trou noir
mais pour élargir ses perspectives
et, par cette dissémination, l’embarquer vers une vaste concentration
cette tension est présente dès ses débuts
ces phares « surexposés » braqués vers le public (Truck, 1966)
ces forteresses volantes en suspension
cette amorce de tableau de bord (Porsche, 1966–67)
ces terrains désertiques sans repère sans ciel qui sont la continuité du parquet qu’il foule dans le musée
jusqu’à la neige avec la si fine bande de sol (qui pourrait être une couche de nuages)
l’espace vient vers le spectateur et installe son corps en vecteur actif qui se déploie dans cette étendue dense épaisse et qui transperce la toile au-delà des confins représentés
une totalité où le geste de l’artiste bien présent organise la fascination qui hypnotise le regard
le temps est suspendu
ouvre un voyage dans le futur antérieur
une pure expérience du regard qui fait que sa matière est narrative *
avec ce jeu de trituration de la profondeur
la slow painter – comme elle se définit elle-même – peint l’insondable éternel
ce temps qui ne s’arrête jamais
sauf brièvement dans les représentations de Vija Celmins
* les citations sont extraites d’un entretien avec l’artiste en février 2025 (cf. catalogue)
suturer le nid de flammes

#SALON
Art | Basel
direction : Maike Cruse
Bâle (CH) du 18 au 22 juin 2025
Pendant quelques jours Art|Basel s’invite à la Messe de Bâle et déborde généreusement dans la ville. Les institutions dédiées toute l’année à la culture, notamment à l’art contemporain, font écho à l’évènement pour proposer une semaine festive autour des arts visuels.
L’habitué retrouvera Unlimited, vaste espace muséal scénographié par le commissaire Giovanni Carmine en lien avec les galeries présentes. Dans le hall voisin, plus de 4 000 artistes des cinq continents sont présentés par les 200 exposants de Galleries.
Parmi elles, la galerie bâloise Stampa (Hall 2.1 / S17) montre depuis une demi-douzaine d’années le travail de Véronique Arnold : une des rares artistes régionales à bénéficier de cette visibilité.
| Véronique Arnold avant Art|Basel
Habituellement le peintre caresse la toile du pinceau.
Véronique Arnold, elle, la pique, la transperce.
Non pas pour la blesser mais pour suturer !
Un geste thaumaturgique pour dénouer des nœuds.
Elle est sensible à l’ambivalence.
Le vêtement, le drap protègent, mais peuvent aussi être râpeux s’ils sont en lin.
Et surtout le tissu est mémoire.
Mémoire de pratiques ancestrales (quelquefois disparues) où le corps, les mains s’impliquent comme le tissage et la teinture des kelsch.
Mémoire du vêtement qui perpétue la présence de celui ou celle qui l’a porté.
Elle choisit ses tissus, ses matières, ses tuniques, ses kimonos avec beaucoup de soin et les brode de figures, de motifs, de mots. Ceux délicats de poètes, de philosophes (comme Rûmî, Mandelstam, Rilke, Nietzsche) ou ceux émus, intimes de personnes qu’elle a rencontrées et écoutées lors de projets, de résidences, voire dans un café.
Ses broderies amplifient le cri silencieux des corps absents.
Le fil qu’elle utilise a souvent la couleur du sang comme chez Louise Bourgeois dont elle admire l’audace et la manière de montrer la cruauté par les mots, la répétition et la couture.
Certaines pièces rappellent la diaphane souffrance des Disremembered (2014–15 & 2020–21) de Doris Salcedo et, comme la Colombienne, elle expérimente la création partagée et collective.
Un art où les traces transcrites ouvrent à la mémoire concrète du monde.
Un art qu’elle souhaite : habité.
En amont de la foire bâloise, voici les mots de l’artiste recueillis lors d’un échange sensible dans son atelier (22.05) :
les kelsch
Enfant, j’ai vécu dans une famille alsacienne. Il y a encore dans le grenier chez ma mère des tissus qui ont été teints au pastel bleu*. En hiver après les travaux des champs, on faisait des kelsch – on avait le temps… – et donc il y avait plein de tuniques en lin, des draps en lin… Quand j’étais petite, j’ai dormi dans des draps en lin : il y a à la fois le côté très frais en été, mais aussi très rugueux.
Pour une série (broderie sur lin, 2020), j’avais travaillé avec des femmes et je leur avais demandé de me parler de leurs désirs, de ce qu’elles avaient vécu, des sites de rencontres aussi. J’avais transcrit ça sur ces peaux rêches parce que c’était souvent des témoignages un peu durs avec des notions d’abandon, de tristesse, de solitude ou de joie, tout un répertoire d’émotions.
J’aime bien impliquer des gens dans mon travail. Je pense qu’un artiste est une membrane sensible au contact du monde…
Seul on ne perçoit pas grand-chose… Le retrait [dans l’atelier] est juste là pour transcrire.
* On faisait des teintures en rouge et en bleu, en Alsace c’était avec deux plantes : la garance et le pastel ; et c’est fascinant qu’à partir d’une plante, on ait des couleurs tellement vives.
les frivolités
Dans ma famille, on ne parlait pas beaucoup. Le seul moment où quelqu’un m’écoutait, c’était quand j’étais chez ma grand-mère maternelle. Sur un petit banc au vert, elle faisait des frivolités – des formes de broderie qu’elle avait apprise d’une sœur au couvent : que des petits ronds les uns après les autres. Elle faisait des petits ronds à longueur de journée et elle me disait : raconte-moi quelque chose, qu’est-ce que tu as fait, qu’est-ce que tu as découvert… pour moi cette forme de broderie c’est aussi raconter, il y a narration.
Un jour, je lui ai dit : j’aimerais tellement apprendre les frivolités. Elle m’a dit : tu as autre chose à faire dans la vie ! Ça m’a tellement frustré ! Je pense que ça a été ça [le déclencheur]… Et puis les femmes dans ma famille faisaient aussi des vêtements, ma mère m’amenait chez la couturière du village pour les fêtes… des choses comme ça.
La création ou l’écriture, c’est un trésor inouï, inépuisable aussi.
Quand j’étais enfant, je ne comprenais pas du tout le monde qui m’entourait. J’ai ce souvenir très précis. Je ne comprenais pas le fonctionnement de ma famille, je ne comprenais pas pourquoi il fallait aller à l’école… je me disais : bon je vais faire semblant mais ce n’est pas moi !
Là je peux être moi-même : la création, c’est un privilège inouï !
le Japon et les kimonos
Il y a une quinzaine d’années, j’étais allé au Japon grâce à Christine Ferber qui m’avait invitée deux années de suite au salon du chocolat à Tokyo. La découverte du Japon a été pour moi immense. Immense ! J’avais tout le temps ce sentiment d’une très grande poésie, partout, dans les corps, dans les œuvres d’art, dans les vêtements, dans les céramiques…
Et pour les Japonais la nature est peuplée d’esprits.
Au jardin des mousses Kokedera à Kyoto, j’ai vraiment senti un esprit. J’en ai parlé à mon amie japonaise qui est maître de cérémonie du thé. Elle m’a dit : mais oui, je l’ai senti en même temps que toi…
Il y a une coexistence entre les fantômes du passé, les ancêtres, les esprits et les humains, il n’y a pas de séparation franche entre les états de l’être. Pour moi prendre un kimono, c’est parler de cette fluidité-là de l’être. Il n’y a rien de séparé, on est constitué des mêmes éléments que… cette théière.
J’avais une exposition là-dessus : We are the universe (Nous sommes l’univers).
J’ai mis mon corps là-dedans pour essayer de sentir un peu le cosmos. C’était une idée de vertige métaphysique : sous le ciel étoilé, dans cet univers, comment c’est possible d’être vivant ?
Il y a un élan de vie, un désir de vie dans chaque chose, dans chaque être.
C’est ça qui est fascinant quand je présente un vêtement, il y a quelque chose de peuplé, de fantomatique aussi.
Le kimono blanc avec les broderies roses [EROS : écritures inconscientes illisibles, 2024], c’est une soie floquée semi-transparente où j’ai écrit en écriture miroir et en écriture positive. À chaque fois que j’écrivais une lettre, je piquais la lettre parce que je crois qu’il y a une forme de brûlure, de coupure, de piqûre quand le désir en nous se fait vif.
Je travaille tout le temps avec des aiguilles, des épingles. Des traits du désir…
Une écriture du désir, à la fois évanescence et douleur.
En brodant, je crée comme un petit hamac qui me permet de ne pas être aspirée par le vide parce que depuis toujours j’ai ce sentiment de vide, d’abîme en moi. Un petit hamac opposé à ce mouvement de chute avec des mots pour dire non.
J’aime bien écrire, mais d’une certaine manière ça m’emprisonne.
Louise Bourgeois
Louise Bourgeois aussi.
Ce qui était important pour elle, c’était l’écriture.
C’était un milieu hyperbourgeois, une sauvagerie mais dans un cadre rassurant. Entre son mari, ses enfants, tout était compliqué. Et sa mère aussi en motif récurrent pendant toute sa vie, cette ambivalence entre haine et amour, cette araignée, mais bienfaisante.
C’est d’un courage inouï ! c’est magnifique et brutal aussi, il y a peu de gens qui osent cette brutalité.
Et ces questions de patriarcat restent. Si c’est en bonne voie sur le plan social (dans nos sociétés, on ne parle pas de partout dans le monde malheureusement), dans l’intime, les différences sont restées, les structures patriarcales sont intactes. Les couples souffrent… c’est effrayant.
En tant que femme artiste, j’ai vu que c’est quand même beaucoup plus dur que pour les hommes. J’étais la première femme à rentrer dans ma première galerie et j’ai vraiment vu la différence de traitement entre les artistes hommes et femmes.
Louise Bourgeois, c’est magnifique.
Et elle était magnifique cette exposition à Bâle, géniale !
[Louise Bourgeois x Jenny Holzer, The Violence of Handwriting Across a Page / Kunstmuseum Basel, 2022]
ne pas oublier l’émerveillement
C’est fabuleux l’art à côté de tout ce qui se passe dans le monde. C’est le vivant, comme la nature.
On oublie tout le temps cette magie de l’existence dans ces sociétés très matérialistes. On a perdu la joie de découvrir l’autre… la possibilité d’un lien autre qu’un lien intéressé.
Actuellement je développe des projets participatifs. Je rencontre des gens dans les musées, souvent ils me disent : personne n’écoute.
On souffre tous de cette solitude froide. Surtout ici je pense, on n’a plus cette curiosité de l’autre, l’autre est un objet comme un autre. On perd cette conscience que l’autre a une âme.
C’est la dimension du sacré, cette capacité à transcender la vie de tous les jours, de développer le vivant en soi qu’il faudrait conserver ! L’émerveillement aussi, c’est ça qui fait que la vie est vivante !
l’ennemi ?
la brutalité
C’est très spontanément et dans un rire que Véronique répond à la question de Picasso : L’art est une arme contre l’ennemi… Mais qui est l’ennemi ?
Art | Basel avec la galerie Stampa (Hall 2.1 / S17)
Moi j’adore l’ambiance, même dans la ville, il y a le parcours et maintenant à côté de la foire, il y a des petits coins où on peut prendre un café. Je suis là-bas tous les jours.
Cette année je présenterai à la galerie deux œuvres avec des floraisons (avant la foire je ne les montre à personne). Ils en choisiront une des deux. Il y aura une œuvre de chaque artiste de la galerie, une quinzaine je pense.
La pièce accrochée sur la cimaise ce jeudi 19 juin : Pétales en offrande (2024–2025)
et il y a une vie après Art | Basel
pour ma prochaine exposition chez Stampa, je travaille sur Éros & Thanatos.
| Unlimited 2025
En cette période trouble, le rouge sang de la vaste intervention de Katharina Grosse sur la Messeplatz (sol et façades) dresse un premier geste ample et une atmosphère stridente (l’an passé, Honoring Wheatfield – A Confrontation d’Agnes Denes accueillait le chaland avec son projet d’un écologisme apaisé).
Passé les portiques de contrôle, la grande installation de Marinella Senatore embarque le visiteur vers la nostalgie ludique d’une foire du trône même si son empathique message s’affiche en grand (I contain multitudes / We rise by lifting others*).
Cette quête de sens est souvent présente (Jaume Piensa…), surtout dans THE VOYAGE – A MARCH TO UTOPIA de l’Atelier Van Lieshout (Rotterdam) qui tranche d’une longue diagonale le hall d’Unlimited. Le dédale de leur proposition processionnelle, touffue et immersive, donne à voir les artefacts de tout ce qui est nécessaire (ou inutile : un incubateur pour bébés robots !) à la survie de l’humanité en transhumance vers un monde qu’elle espère meilleur. C’est à la fois angoissant voire brutal par l’expression ou le gigantisme de certains éléments (masques, cages, bœufs, véhicules, machines…) et touchant par ses micro-univers (petit zinc de proximité, droguerie, bonneterie…) et l’accumulation d’objets anciens évoquant par endroits un vide-greniers.
* Je contiens des multitudes / Nous grandissons en élevant les autres.
Si l’édition 2024 s’efforçait d’affirmer une production artistique bien ancrée, quelquefois engagée, dans un réel concret et tangible, en 2025, les propositions tentent d’ouvrir des perspectives alternatives à sa barbarie ou scandent par leur monumentalité même l’absurdité de celles si fragiles offertes par la technologie, ainsi cette exhibition récurrente d’imposants rochers presque bruts (Arcangelo Sassolino, Luiz Zerbini, Nadira Husain, Lee Ufan…) ou d’autres matériaux (Danse macabre de Nicola Turner, 2025).
Bien sûr certains s’adonnent toujours à un jeu facétieux avec la culture main stream (Yakoi Kusama, Cosima von Bonin…), quand d’autres s’engagent dans des logiques d’inventaires (Jef Geys, Faith Wilding…) en amont des tensions d’éradication… ou d’évanescence (Andrea Büttner).
La question qui s’incarne dans ce Hall 1 : Oh monde, où est ton utopie ?
Avec la sourde conscience que notre salut était un point minuscule séparant le besoin de s’entraider et l’envie de se détruire (Éric Fottorino / Marina A, 2018).
sculptures en estive

Le monde du vivant
2de Biennale d’art contemporain de Bischwiller
#EXPOSITION
Bischwiller, parcours urbain de juin à fin septembre 2025
commissariat Germain Roesz
guide de visite/catalogue franco-allemand, 20 p.
En cette période de désengagement des collectivités locales et des financeurs publics à l’endroit de la culture, il est nécessaire de saluer l’engagement de la ville de Bischwiller pour l’art contemporain.
La première Biennale avait accueilli 14 œuvres, il y en a 34 pour cette seconde édition de juin à septembre. Germain Roesz, le commissaire, a réuni douze artistes auxquels s’ajoutent les huit dont le travail est resté en place depuis 2023.
Toutes les générations sont représentées : des jeunes Yoshikazu Goulven Lemaître (prix Théophile-Schuler à St-Art 2024) avec deux pièces spectaculaires (une tortue sur l’étang de la retenue et un squelette de lézard géant accroché dans un arbre) ou Pierre-Louis Peny jusqu’aux sculpteurs consacrés que sont Robert Schad ou Armin Göhringer (pièces installées en 2023) ou encore Karl Manfred Rennertz…
Les services techniques de la commune ont amplement participé à la mise en place des œuvres (et grandement facilité la fabrication dans certains cas).
Toutes les techniques sont présentes (bois, bronze, pierre, tôle…), certaines plus innovantes comme la meute de loups en tiges métalliques phosphorescentes de Thomas Monin (toit du Centre culturel Claude-Vigée).
Les propositions sont abstraites ou figuratives et leur inspiration partagée est liée à la nature (beaucoup d’évocations animales). La plus troublante est « Unedo » de Gaëtan Gromer, musicien de formation : un arbre mort blanchi – avec cependant un vert et fragile surgeon d’arbousier – émettant des sons qui traduisent en temps réel le rythme de la déforestation mondiale…
Patrick Lang qui dirige l’atelier de sculpture des Arts décoratifs de Strasbourg depuis 1984, présente trois facétieuses pièces animalières près de la gare.
Un début de parcours qui passe par l’allée de Hornberg, la rue des écoles avant de rejoindre, par la rue Poincaré, la place de la mairie où trône trois bronzes impressionnants : Grosses Baumfenster de K. M. Rennertz, Lion & Lionne de Winfried Becker. Une dizaine de pièces en interaction directe avec le passant qu’il musarde ou fasse ses courses. Une proximité voulue par Jean-Lucien Netzer, maire de Bischwiller, car une grande partie de la population ne va pas dans les musées et encore moins dans les galeries d’art contemporain, il faut donc que les œuvres aillent à sa rencontre dans l’espace public !
La seconde partie de l’itinéraire jalonne la bucolique promenade de la coulée verte du Rotbaechel agréablement ombragée où se nichent les travaux de Nicolas Schneider, Sylvain Chartier, Bruno Feger, René Dantes…
Deux pièces sont un peu excentrées près du stade : Daniel Depoutot & François Cacheux.
Un joli but de promenade art et nature dans un cadre enchanteur voire d’excursion avec repas tiré du sac !
Une plaquette à la fois catalogue et guide de visite est disponible en version papier ou pdf. Le plan seul est également téléchargeable.
l’Histoire d’avant le bitume

Un passé incontournable.
Découvertes archéologiques de l’A355
#EXPOSITION
Galerie Heitz (palais Rohan, Strasbourg) du 13 juin 2025 au 21 juin 2026
commissaires Bertrand Béhague (DRAC GE) & Mathilde Villette, puis Quentin Richard (Musée Archéologique de Strasbourg)
en complément un catalogue exhaustif sur les fouilles 256 p., 35 €
10–13h & 14–18h, en continu le week-end, fermé le mardi
L’A355 est surtout connue au niveau local depuis 2012 par la mobilisation contre le grand contournement ouest (gco) avec une montée en tension en 2016–2017 notamment autour de la ZAD du Moulin évacuée manu militari en septembre 2018. Le changement de nom avec l’inauguration de décembre 2021 s’évertue de tourner cette page.
Mais une histoire bien plus ancienne s’était aussi invitée sur le chantier avec la campagne de fouilles préventives menée de septembre 2016 à août 2019. Cette exposition labellisée d’intérêt national par le ministère de la Culture en restitue les découvertes.
L’ampleur de l’emprise – 24 km pour 405 ha –, sa particularité – le tracé évite les villages – et par endroits sa profondeur – jusqu’à moins 11 m – déterminent l’envergure de la mission : 34 fouilles prescrites (quasiment tous les 500 m) assurées par six équipes d’une dizaine de personnes, soit le double des interventions effectuées habituellement sur une année en Alsace. Le nombre de contributeurs au catalogue en témoigne.
Cinq opérateurs en archéologie préventive (Inrap, Archéologie Alsace, ANTEA-Archéologie, Archeodonum et Éveha) sont intervenus sur 62,5 ha et l’ensemble des rapports représente 50 volumes.
L’horizon le plus ancien remonte à 190 000 ans avant J.-C. et la chronologie se prolonge par endroits jusqu’à la Première guerre mondiale. Sur le terrain la part prépondérante de formations lœssiques constitue un environnement de conservation favorable en particulier pour les périodes préhistoriques. D’ailleurs l’époque la plus représentée est le néolithique (26 sites) suivi de l’âge du bronze et de l’âge du fer où se développent le phénomène urbain et les échanges, notamment avec le monde méditerranéen.
La qualité et la nature des artefacts sont évidemment conditionnées par l’emprise du tracé et ce contexte. Les implantations anciennes correspondant peu ou prou aux villages actuels, c’est assez logiquement une forme de nomadisme et des implantations éphémères liées à l’activité, principalement agricole (fermes, silos…), mais également funéraires qui ont été mises à jour – aucune villa n’a été identifiée.
Les découvertes relèvent plutôt du mobilier d’usage lié à la cuisine, à l’habillement (des fibules, une plaque de ceinture du 1er âge du fer à Pfulgriesheim avec un fac-similé manipulable) ou à l’agriculture que des bijoux ou des parures spectaculaires.
Sur le site de Stutzheim-Offenheim, une figurine néolithique en terre cuite (h = 5,7 cm, interprétation discutée) a été retrouvée au milieu d’ossements d’animaux, de fragments de poterie et de silex, et à Breuschwickersheim, une émouvante figurine allaitante en céramique d’époque romaine signée Pistillus, ainsi qu’un vase à visage en céramique (IIIe–IVe siècle ap. J.-C.).
Quelques pièces de monnaies et des fers à cheval ont été relevés près de la voie romaine reliant Argentorate (Strasbourg) à Brocomagus (Brumath).
Par contre le dépouillement de l’important matériel collecté a permis d’élargir le corpus de connaissances sur les habitudes alimentaires (graines cultivées, ossements d’animaux consommés…), sociales (agapes, pratiques funéraires…) et l’usage du territoire avec un abandon des sites entre l’époque romaine et le haut Moyen Âge.
Les sépultures (350) révèlent aussi l’importance des parements chez les femmes avant le Ve siècle (attestant un statut social plus élevé ? une forme de matriarcat ?). Par la suite les dépouilles masculines seront à nouveau enterrées avec des attributs guerriers…
L’exposition donne des clefs pédagogiques avec dix dispositifs illustrant autant les techniques utilisées par les scientifiques (comme celle pour déterminer le sexe du défunt à partir des ossements) que le fonctionnement de certaines découvertes, notamment celle majeure du Qanât de Kolbsheim (Haut-Empire, IIe s. ap. J.-C.) : un ouvrage hydraulique, surtout attesté en Orient, constitué d’un alignement de puits (sur 88 m) destiné au captage par capillarité de l’eau de la nappe phréatique.
Condenser en 200 m2 trois ans de fouilles sur plus de 60 ha relevait de la gageure et le résultat est aussi lisible que cohérent. Cependant l’exposition est un peu le dessus de l’iceberg et pour avoir une vision complète du sens, des enseignements et de l’évolution des connaissances rendus possibles par tous les vestiges exhumés, il est bon de compléter la visite par la lecture du catalogue. Cette mise en perspective est l’objet de la première moitié de l’ouvrage, la seconde propose une notice pour chacun des 34 sites étudiés.
spectre diurne

Brundibár
de Hans Krása
#OPÉRA
représentation du mardi 27 mai au Théâtre municipal de Colmar (Opéra national du Rhin)
Brundibár est un opéra pour enfants écrit en 1938 par Hans Krása sur un livret d’Adolf Hoffmeister. Après de sombres aléas, la création officielle a lieu le 23 septembre 1943 dans le camp de concentration de Theresienstadt (Terezin).
La production signée Jeanne Candel (créée en 2016 à l’Opéra de Lyon) est portée par l’Opéra Studio dans une version pour piano (Annalisa Orlando) et accordéon (Pablo Devisme), la chef (Sandrine Abello) assurant quelques traits de percussions. Elle est interprétée en français par les enfants de la Maîtrise de l’Opéra national du Rhin et des classes à horaires aménagés musique.
Inspiré de contes de Grimm (Hänsel et Gretel, Les Musiciens de Brême), c’est une fable avec une morale positive : Face à l’injustice et l’adversité, l’union fait la force !
La création a été malmenée par l’annexion de la Tchécoslovaquie par les nazis (1939), puis la déportation du compositeur et de la troupe qui l’avait interprétée clandestinement dans un orphelinat juif de Prague en 1942 (les activités culturelles étaient interdites aux Juifs).
À Terezin, Krása l’a remaniée pour les instruments disponibles. L’œuvre était appréciée – elle inclut des chants populaires – et offrait un dérivatif bienfaisant notamment aux enfants participants. Elle a été jouée 55 fois dans un camp qui sera rafraîchi en 1944 (peinture, faux magasins, faux cafés, nombreux transferts vers Auschwitz afin de réduire la surpopulation) pour les besoins d’une vaste opération de propagande mise en scène pour la Croix Rouge et prolongée par un « documentaire » (Theresienstadt. Ein Dokumentarfilm aus dem Jüdischen Siedlungsgebiet). Quelques minutes de la production de 1943 y sont visibles… Par la suite, la plupart des acteurs forcés de cette mystification dont Krása sont transférés et assassinés à Auschwitz-Birkenau (automne 1944).
Difficile d’ignorer ce contexte même des décennies plus tard…
Au premier acte, le fond qui ferme la place du bourg représente une gueule d’enfer. Choix pertinent puisque, l’espace public est hostile tant aux Juifs à l’époque qu’aux deux enfants Pepícek et Aninka : en ce jour de marché, ils veulent chanter pour récolter quelques sous et acheter du lait à leur mère malade. Mais c’est le territoire de Brundibár, chanteur et joueur d’orgue de barbarie, qui fera tout pour les chasser avec, au début, le soutien du policier.
L’espièglerie s’invite cependant : les yeux et les dents du bas sont des enfants déguisés, celles du haut sont suspendues au bout d’une perche comme des lampions.
Brundibár est tenu par Michał Karski, baryton de l’Opéra Studio.
Le prologue imaginé par Jeanne Candel lui offre le quatrième Lied (Die zwei blauen Augen von meinem Schatz) du cycle Lieder eines fahrenden Gesellen de Gustav Mahler. Cet air nostalgique où l’amoureux délaissé se console sous l’enivrante beauté d’un tilleul adoucit un personnage plutôt noir par ailleurs (il serait inspiré d’Hitler).
À quelques pas, une fillette enterre ses larmes avant qu’une demi-douzaine de camarades ne la rejoigne pour raconter leurs cauchemars…
Des camelots viennent vanter leur marchandise, puis Brundibár entonne les Couplets du toréador (Carmen) enchaînant une dizaine de tubes d’opéra (de la Reine de la Nuit en passant par Casta Diva…) pour couvrir le chant des deux enfants.
Michał Karski endosse avec aisance tant vocalement que scéniquement ce rôle de caïd du quartier et s’en donne à cœur joie pour houspiller Pepícek et Aninka.
L’écriture est légère, mélodique, voulue simple pour être chantée par des enfants, mais se permet quelques fusées dissonantes. Les jeunes interprètes n’ont bien sûr pas l’assise des adultes, mais trouvent une belle assurance en duo, en ensemble et s’impliquent dans le jeu et le chant avec un généreux enthousiasme.
Au second acte, un clair de lune plein de poésie invite les mystérieuses créatures de la nuit : un chat en mobylette, un chien savant et un oiseau. Avec Pepícek et Aninka, ils complotent de mettre Brundibár hors d’état de nuire en rameutant tous les enfants du quartier. Brandissant toute une panoplie d’instruments en un tonitruant charivari, la joyeuse troupe aussi engagée que bon enfant chasse le malfaisant hors du marché.
Le chœur final embarque le public dans son rythme entraînant d’autant que les jeunes choristes envahissent la salle !
direction musicale Sandrine Abello
mise en scène Jeanne Candel (remontée par Jean Hostache)
décors Lisa Navarro
costumes Pauline Kieffer
lumières Vyara Stefanova
chorégraphie Isabelle Catalan
adaptation française Chantal Galiana
du sang… sans les larmes

Makbeth
d’après Shakespeare
#THÉÂTRE
représentation du jeudi 22 mai à La Filature, Mulhouse
en tournée jusqu’au 12 mars 2026 (autres dates en cours)
Compagnie associée à La Filature depuis une dizaine d’années, le Munstrum Théâtre de Louis Arene se produit pour la première fois dans la grande salle et se donne les moyens d’un spectacle total tout en sang et lumières pour en mettre plein la vue à son public.
Créée en février à Châteauvallon, leur version hollywoodienne de la tragédie privilégie l’action sur le texte qui bénéficie d’une nouvelle traduction raccourcie et avec une langue et des expressions trempées dans l’aujourd’hui.
explosions et mitraille
éclairs et fumée
beaucoup de fumée
tombant des cintres
éructée des coulisses
les sinistres productions de l’humain
courses et cris
de cour à jardin
de jardin à cour
des allers-retours sabres au clair
une guerre de positions fluctuantes
un relent de Chemin des Dames
une violence guerrière et forcenée
se devinent les coups les saignées
les élans cisaillés
les corps projetés et plantés
l’ivresse du sang et du meurtre
l’atavique sauvagerie ?
à peine une pause
avec le coassement des grenouilles
et la violence reprend de plus belle
un acharnement au carnage
Hollywood sous la pénombre
avec l’odeur et le goût du sang
avant les images écarlates
c’est long
trop sans doute
la lumière exerguera encore la violence
identifiera les victimes à occire
et magnifiera la couleur du sang
qui gicle sous les impacts répétés dans
les corps devenus palpitants fourreaux de sabres
le sang en bain
auquel les tripes arrachées
dispersées par poignées
se rajouteront vers la fin
la violence est spectacle
multicolore vibrionnant ludique
et joyeux
une complaisance festive
la violence illégitime
est administrée impitoyablement
pour s’emparer de la violence légitime
puis l’amplifier en surenchère
avec gourmandise et frénésie
une ivresse orgiaque barbare
et totalitaire
quelques ombres s’invitent
trop discrètes
le corps nu de Makbeth
livré aux goules humides et bitumineuses
du second colloque des sorcières
la dernière image
très shakespearienne
le bouffon trônant
sur sa tour d’arbitre de tennis
avec à ses pieds
le champ si fécond du carnage
que la forêt de Birnam ne cache même plus
La morte è il nulla.
È vecchia fola il Ciel! *
* La mort mène au néant. L’antique fable du Ciel !
selon l’adaptation de Boito pour l’Otello de Verdi (ex Credo de Jago)
La maîtrise de l’outil théâtre est incontestable et impressionnante. Les effets spéciaux sont efficaces. La remarquable géométrie des lumières articule avec une grande fluidité la succession des scènes, rythme le temps et la progression dramatique. Elle sait créer des sous-espaces de complot, saisir d’un spot un aparté comme un gros plan de cinéma. L’esthétique privilégie la symétrie (les triangles sont récurrents), une organisation du plateau axée, ordonnancée (assez mussolinienne comme la pratique Hollywood dans beaucoup de ses blockbusters) avec quelques tableaux envoûtants et racés.
Ces choix favorisent la prééminence de l’action sur le dialogue d’autant que la rumeur constante de la bande-son rend le texte souvent peu compréhensible. Les enjeux, les tenants et aboutissants s’en trouvent marginalisés au profit du déchaînement halluciné et mortifère.
Les (rares) moments poétiques, de suspension, sont musicaux – un chevalier en armure chantant du Nick Cave (mais plutôt hors dramaturgie), la cornemuse de l’enterrement… –, respectant la règle hollywoodienne du mountain & valley : ne pas étouffer le spectateur, avant de relancer la mécanique de la violence volontiers distanciée par l’humour, ici en jouant la mort à pile ou face…
Les huit comédiens portent des demi-masques agrandissant le nez et les yeux d’une exophtalmie hallucinée, certains ont des prothèses de ventre, les costumes sont au croisement de chitineux insectes et d’archaïques armures.
Tous s’accordent et défendent avec engagement le projet (seules certaines voix passent plus mal au travers du brouhaha permanent). S’en détache l’adipeux roi Duncan (Delphine Cottu), le bouffon (Erwan Darlet) et la Lady queer de Lionel Lingelser, mais c’est plutôt le fruit d’une imagerie fortement caractérisée que l’approfondissement d’une option dramaturgique exigeant une incarnation puissante (le Makbeth de Louis Arene se confond facilement avec le Banquo de François Praud visuellement proche). Des figures qui semblent issues de la bande dessinée ou du jeu vidéo et ne prédisposent guère à l’empathie…
La gestique peut (vaguement) évoquer les films de Kurosawa, mais là où le Japonais ritualise les rapports hiérarchiques et les confrontations de stratégie, le Munstrum ritualise l’administration facétieuse de la violence par ces marionnettes empêtrées dans leurs armes.
Pendant la représentation, des rires fusent régulièrement, mais ils sont éparpillés et ne gagnent jamais l’ensemble unanime de la salle…
La note d’intention déplore que sous le vernis de notre civilisation éclairée, la barbarie gronde (les drapeaux palestiniens dans le dos des comédiens lors des saluts en attestent la sincérité) et invoque la catharsis, un défoulement comparable au film d’horreur ou au thriller fantastique…
Mais transformer un être en jouet ne produit-il pas aussi la nécessaire déshumanisation pour le réduire en vermine à exterminer ?
Et cette esthétisation de la violence (du Mal) ne relève-t-elle pas de l’étourdissement festif pour en infuser la banalité et la familiarité afin que le spectateur soit mieux en capacité de l’endurer le moment venu ? Ne contribue-t-elle pas à la fabrique du consentement ?
Le sang a une couleur chaude. Et séduisante !
Et la guerre est un plaisir, le plus grand des plaisirs, sinon elle s’arrêterait tout de suite. Une fois qu’on y a goûté, c’est comme l’héroïne, on veut en reprendre. (Emmanuel Carrère / Limonov, 2012)
Le Makbeth du Munstrum Théâtre : un geste spectaculairement théâtral piégé par l’éloge de la pire addiction ?
avec Louis Arene, Lionel Lingelser, Delphine Cottu, Erwan Darlet,
Sophie Botte, Olivia Dalric, Anthony Martine, François Praud
conception, mise en scène, masques Louis Arene
traduction, adaptation Lucas Samain
scénographie Mathilde Coudière Kayadjanian, Adèle Hamelin, Valentin Paul, Louis Arene
lumière Jérémie Papin, Victor Arancio
musique & création sonore Jean Thévenin, Ludovic Enderlen
costumes Colombe Lauriot Prévost
production Munstrum Théâtre
fragile avenir…

On ne choisit pas ses fantômes
de Matthias Moritz
#THÉÂTRE
représentation du jeudi 15 mai à La Filature, Mulhouse
Après Hôtel Proust et son impitoyable charge contre le cynisme de nos dirigeants, Matthias Moritz se penche sur l’intime.
Reprenant la trame des Scènes de la vie conjugale d’Ingmar Bergman (1973) et de son remake américain inversé d’Hagai Levi (2021), il décortique « jusqu’à l’os » le couple, ses dysfonctionnements, ses impasses… C’est toujours une « comédie pessimiste » avec le public comme premier interlocuteur, mais la matière est plus personnelle et elle s’installe, résonne pour le public comme pour les deux comédiens, évacuant la facilité du discursif.
Le public entre sur le Boléro de Ravel, musique répétitive emblématique – nos rêves sont trop ennuyeux dira Débora –, le motif cependant est exotique et réserve une explosion finale teintée d’érotisme…
Rien n’est jamais simple !
Le contenu d’un grenier est suspendu dans les cintres : un frigo, une plante verte, des cartons, une chaise, une télé, tout ce qu’une vie à deux accumule.
Sur l’avant du plateau, une dizaine de micros, trois caméras…
Un régisseur (Arnaud Verley) est aux petits soins pour piloter ce dispositif.
Le couple entre, séparément, au ralenti : la vie c’est du cinéma… Ils refont leur entrée : tout est mise en scène !
Ils s’asseyent, se livrent de bon gré à ce tribunal médiatique : une confession comme dans les émissions de téléréalité. Et invasive : il y a Marianne & Johan (de Bergman), Mira & Jonathan (de Levi), mais aussi Débora Cherrière & Lucas Partensky (les noms des comédiens).
Quelques formules bien senties émergent dans ce prélude. Matthias Moritz a des positions fortes (dans Hôtel Proust, il ne s’en privait pas). Débora et Lucas les profèrent en coryphées.
En quittant ce « confessionnal », elle noue et pince ses cheveux : sa façon d’endosser le rôle de Mira, mais l’écume de Débora et Lucas débordera par moments (on ne « joue » pas complètement).
Le premier mouvement est une parade : défense et illustration du couple accompli. Et stable : dix ans de vie commune ! Une victoire qui déborde d’un an et demi des statistiques. Mais… la porosité à l’externe – leurs deux boulots – conditionne l’économie domestique, fissure souterrainement le dispositif conjugal. Trois vies : un sandwich où le couple est la couche du milieu. Soumise aux frictions, aux arrangements…
Finalement l’externalité fait exploser le couple. Elle est tombée amoureuse d’un collègue, veut refaire sa vie avec lui. Son départ dévoile la profondeur des failles, pointe L’art de tout balayer sous le tapis. Et là toute la poussière leur revient à la figure ! Il y a l’effet de surprise (pour lui) et la question : les mots auraient-ils évacué les maux ?
Autour d’eux tout se décroche, se déglingue, comme leur couple qui est devenu un produit comme les autres, avec son obsolescence programmée : le couple est une industrie très lucrative.
Le partage des biens est tendu. Maintenant il y a trop de mots !
Des mots sales (Christian Bobin), les mots du dehors qui contaminent l’intime, l’explosent !
S’il offre des moments poétiques ou d’humour (les dizaines de stylos qui tombent des cintres pour qu’ils signent le partage), le spectacle interroge surtout les lignes de blocages, de fractures.
Y a-t-il trop de mots ? Ou pas assez ? Et lesquels ?
Le couple serait-il un rituel animiste travesti/perverti par le dialogue ?
La pièce ne cherche pas à donner de réponse. Et si rien n’est résolu, l’important, quand même, c’est ce qui se joue entre deux êtres.
Alors ? Esquisser un retour au tribal pour inventer une autre alchimie, un rituel vodou pour purger l’impur, les fantômes et leurs impostures ? Le tableau final avec un bout de nature (forcément climatisé) et un rayon de lumière qui irradient de la fenêtre du fond, suggère qu’un avenir semble malgré tout possible !
avec Débora Cherrière, Lucas Partensky
mise en scène & adaptation Mathias Moritz
scénographie & régie plateau Arnaud Verley
lumière Fanny Perreau
son Nicolas Lutz
ancrer et s’ancrer

@La Filature | saison 25 26
#THÉÂTRE, DANSE, MUSIQUE
La Filature (Mulhouse)
51 spectacles et 5 expositions du 1 octobre 2025 au 11 juin 2026
abonnement dès le 14.06, ouverture de la vente à l’unité le 1.07
La saison qui s’achève a été la « première année sereine » de Benoît André, directeur de la Filature (il est arrivé en janvier 2020…). Sa politique d’élargissement des publics et des offres porte doucement ses fruits.
Et de plus en plus, les spectateurs s’attardent avant et/ou après les représentations. En décembre l’ouverture du restaurant Audace saura amplifier cette dynamique. Intégré au bâtiment, il pourra fonctionner de façon autonome, disposera d’une salle de 105 couverts, d’une terrasse et proposera des prix raisonnables pour tous. Il s’adaptera bien sûr à la programmation (thèmes, horaires).
Tout cela est possible grâce au soutien de la Ville qui veut faire vivre cet équipement exceptionnel : une synergie d’utilisateurs bénéficiant du plus grand plateau de France après l’Opéra Bastille.
Nathalie Motte, Adjointe au Maire de Mulhouse déléguée à la Culture, était présente pour affirmer l’engagement de la Ville qui subventionne une partie des travaux du restaurant (à hauteur de 800 000 € comme propriétaire des lieux, le groupe BK apportant une somme légèrement supérieure). Par ailleurs après 30 ans, des travaux de rénovation et de mise aux normes du parc scénique (38 km de câbles !) sont nécessaires. Ils s’étaleront de septembre prochain à 2027 pour un montant de 1,5 million d’euros. La Ville y contribue et a en outre voté une aide supplémentaire sur 3 ans pour soutenir l’action artistique (3 x 54 000 €) : « La culture est premier budget de la Ville de Mulhouse ! »
Ces aides sont bienvenues dans un contexte tendu par ailleurs (gel des subventions voire baisse dans certaines régions). Ces restrictions touchent d’abord le dernier maillon, le plus fragile de la chaîne : les compagnies. Aussi un choix fort pour la programmation a été de soutenir les compagnies régionales souvent par des coproductions.
Ainsi le portrait de la saison est consacré à l’éclectique artiste strasbourgeoise Léopoldine HH : actrice, musicienne… Mais il faudra patienter jusqu’au printemps pour profiter de ses trois soirées : 8 soirs par semaine (15.03), Woyzeck ou la vocation de Büchner (8 & 9.04, mise en scène Tünde Deak) et La Folie Élisa (20 & 21.05, création).
Mais dès le 7 octobre, les Scènes d’Automne en Alsace mettront les troupes locales à l’honneur. Laure Werkmann bénéficie du focus 2025 avec Renaître (10 & 11.10) et sa création L’amour après (7 & 8.10). Thierry Froger et la Cie Roland furieux se sont inspirés d’un projet commandé à Godard avant le bicentenaire de 1789 (et avorté) pour Sauve qui peut (la révolution) (11 & 12.10).
Trois autres propositions sont programmées chez les partenaires.
Et six autres compagnies de la Région sont invitées lors de la saison.
Louis Arene revient avec la Comédie Française et Le Mariage forcé de Molière (6–8.11). Son Munstrum Théâtre cède la place à Romain Gneouchev issu du TNS qui entame sa complicité avec Une chose vraie (10 & 13.03) écrite pour une comédienne atteinte d’une maladie neurodégénérative précoce.
Catherine Verlaguet & Olivier Letellier proposeront Mon petit cœur imbécile (6.05) et Sylvain Groud complice depuis 2025 proposera Let’s Move ! (3.06) spectacle chorégraphique inspiré du répertoire de la comédie musicale. Conçu pour une centaine de danseurs bénévoles, c’est l’un des quatre évènements participatifs* avec Skatepark (30 & 31.05), bodies in urban spaces (30 & 31.05).
Et surtout to like or not (3–7.02) : un projet transmédia d’Émilie Anna Maillet sur l’ère numérique et l’addiction aux réseaux sociaux, le portrait d’une jeunesse immergée dans l’interactivité… et le mensonge des avatars, des fake news…
* appel à participants, respectivement : 100 danseurs, des skaters de 18 à 25 ans, des performeurs, des jeunes de 16 à 25 ans motivés par le théâtre
En mars, la Quinzaine de la Danse invitera cinq chorégraphes.
quatre saisons en mouvement (10.03) chorégraphient les musiciens des Bruges Strings (musique de Vivaldi), Thomas Lebrun nous immerge Sous les fleurs (11–13.03) dans l’univers du 3e genre chez les Zapothèques imprégné visuellement par Frida Kahlo, Catherine Gaudet nous plonge dans la transe d’ODE, Emmanuel Eggermont nous livre son subtil et émouvant hommage à Raimund Hoghe avec About Love and Death (17 & 18.03) avant les Imminentes (21.03 à Saint-Louis) de Jann Gallois.
En clôture de saison, une restitution hommage aux Ballets Russes (10 & 11.06) sera coproduite avec le Ballet du Rhin.
Le théâtre de texte n’est pas oublié avec La Maison de Bernarda Alba (4–6.03, création) de Federico García Lorca mis en scène par Thibaud Croisy et L’Hôtel du Libre-Échange (11 & 12.03) de Feydeau par Stanislas Nordey.
Christoph Marthaler revient avec Le sommet (20 & 21.03) entre alpinisme et « Davos »…
L’offre est pléthorique avec aussi sept concerts dont le coup de cœur de l’équipe : Dominique Fils-Aimé (8.04) soutenue par la Délégation générale du Québec à Paris (comme quatre autres spectacles), deux cinés concerts et un spectacle de cirque guinéen pour la fin d’année Yé ! (L’Eau !) (3–6.12) où l’énergie, l’humour, la légèreté du Circus Baobab s’emparent aussi des questions environnementales.
Sans oublier les 5es Nuits de l’étrange (30 & 31.10) et cinq expositions à la galerie dont La Régionale 26 (nov-déc) et la 7e Biennale de la Photographie de Mulhouse (juin-juil).
Pour les habitués, les Soirées Sunset (~500 personnes y participent), le club sandwich sont reconduits.
du fabuleux animal & musical

@Comédie de Colmar | saison 25 26
#THÉÂTRE, MUSIQUE & DANSE
Comédie de Colmar
26 spectacles pour 77 levers de rideau du 11 septembre 2025 au 13 juin 2026
abonnements à partir du vendredi 14 juin et billetterie du 20 août
Nouvelle saison « idéale » selon le mot de Matthieu Cruciani, c’est-à-dire élaborée conformément aux envies de l’équipe, avec 26 spectacles (4 de plus) et les synergies habituelles : les six artistes associés, Scènes d’Automne en Alsace, la Jeune troupe avec Reims et, en novembre, la danse avec le Ballet de l’Opéra national du Rhin de Bruno Bouché.
Ouverture de saison avec Charlotte Planchou (11.09), une voix jazz formée au lyrique et fascinée par les sons anciens en amont du Festival de Jazz de Colmar (18–28.09) suivie de Zusammen (2–6.10), le cirque équestre de la Compagnie Equinote mis en scène par Émilie Capliez : une première pierre au rapport entre animal et humain, un des questionnements de la saison.
Au printemps, après Des femmes qui nagent et ses prémices vues par Jules Verne l’an passé, Émilie poursuivra Une histoire de cinéma (3–6.03) avec quelques figures des débuts, Alice Guy et Georges Méliès, très influencées par le music-hall.
En fin de saison, Raphaëlle Rousseau convoquera l’actrice Delphine Seyrig (1932–1990) pour une Discussion avec DS (28 & 29.05).
Laure Werkmann et sa tétralogie seront l’axe des Scènes d’Automne en Alsace 2025. Chacun des quatre opus trace l’itinéraire d’une femme qui se reconstruit. Dans Croire aux fauves (14 & 15.10), c’est celui de Nastassja Martin (anthropologue et militante très investie dans la défense des glaciers) laissée pour morte par un ours.
En mai, S’arracher (5–7.05, mais Par les villages dès le 31.10) croise le road trip d’un jeune qui vient de perdre son père et d’une biche traquée prolongeant cette tension entre animalité et humanité.
Et ce lien reste-t-il possible dans Le sanctuaire (4.02) préservé d’un monde post-apocalyptique ?
En contrepoint le festif sera de rigueur avec une proposition de Pierre Maillet proche du cabaret : Edith Beale au Reno Sweeney (5–8.11), le poétique Jérémy Fisher (26–28.11) mis en scène par Thomas Ress et trois spectacles s’amusant à muer le drame en humour jubilatoire : noir avec Dolorosa (4 & 5.12), onirique avec Vertiges (11 & 12.12) et dans l’autodérision avec Il tango delle capinere (18 & 19.12).
Les classiques ne sont pas oubliés avec Les femmes savantes (5–7.02), L’Hôtel du Libre-Échange (11 & 12.02) vu par Stanislas Nordey, Woyzeck (31.03, 1 & 2.04), mais aussi Les chroniques (29 & 30.01) et Hurlevent (17 & 18.03) d’après respectivement Zola et Emily Brontë.
Entre théâtre documentaire et autobiographie, Elles avant nous (12 & 13.03) portent la parole de trois femmes mahoraises et 24 place Beaumarchais (8 & 9.04) celle de Brahim Koutari qui a grandi dans un quartier et se produit aujourd’hui sur les plateaux de théâtre et de cinéma. Ensuite Marie Fortuit rendra hommage au matrimoine d’Anne Sylvestre pour La Vie en vrai (29 & 30.04).
Touche (7–12.02) sera le spectacle pour les tout-petits (18 mois–cinq ans), qu’on peut enchaîner avec les marionnettes de Retors Paniques (21–22.05) après le confinement ludique des Fusées (13–16.01) de Jeanne Candel dont l’OnR vient de présenter Brundibár.
Dès l’automne, la Comédie poursuit sa collaboration avec Bruno Bouché et le Ballet de l’Opéra national du Rhin ajoutant la danse à son offre en accueillant la proposition « chromato-chorégraphique » All Over Nymphéas d’Emmanuel Eggermont (13 & 14/11) en amont de la Quinzaine de la Danse sur le territoire mulhousien (en mars).
Les actions vers les publics sont bien sûr au rendez-vous avec le concert de Jean-Christophe Folly (21.11) lors du Festival du livre, la tournée Par les villages, L’Heure lyrique (12–13.06), l’ouverture aux amateurs avec Encrage #6 (25 & 26.06), les Courts-circuits…
regarder au lieu de voir

@Espace 110 | saison 25 26
#THÉÂTRE, DANSE, MUSIQUE
Espace 110, Centre Culturel Illzach, Scène conventionnée d’intérêt national « art et création »
abonnements & billetterie dès le 27/05
Selon un rituel bien installé, Thomas Ress a animé une présentation vitaminée de la prochaine saison avec son équipe et de nombreux artistes, notamment les membres des huit compagnies accueillies en résidence en 2025–26. Il met l’accent sur une offre transversale où les spectacles nourrissent et enrichissent la très large palette d’activités (140 offres dans tous les domaines).
Une programmation qui invite à « regarder au lieu de voir », à « savourer au lieu de consommer » et donne du sens à une communauté de vie et d’altérité sur le territoire de la commune et un peu au-delà (de Colmar à Saint-Louis avec les Scènes d’Automne en Alsace).
En ouverture de saison, la Compagnie Hélios dirigée par le président Jean-Pierre Verdheillan fêtera ses 30 ans avec 3 comédies à la française (Molière, Guitry, Feydeau, les 12, 13, 18, 19, 20/09)
La blessure est l’endroit où la lumière entre en nous, Saye Sirvani cite Djalâl Al-Dîn Rûmî pour évoquer La Perle (4 & 5/11) qui conclura sa résidence d’artiste dans la maison (entamée avec le beau L’ivresse des profondeurs). Certainement un des moments forts de ce premier trimestre axé sur le corps sportif avec deux spectacles chorégraphiques Goal (26/09) et Go (3/10), puis le parcours de femme de la tenniswoman Marion Bartoli : Renaître (10 & 11/10).
Les 14 & 15 novembre, Bédéciné fêtera ses quarante ans encadrés par deux propositions : Micheline (12/11) et, d’après l’œuvre de Tomi Ungerer, Le Nuage bleu (19/11).
Une soirée orientale, Ishtar Connection (29/11) avec Fawzi Al-Aiedy, chant et oud, ouvrira la période des fêtes où L’inouïe nuit de Moune (5/12, gratuit) se déroulera sous une yourte avant que Santiago Moreno l’homme-orchestre de Soledad (12/12) ne conclue l’année.
Des femmes harassées mais joyeuses s’inviteront en janvier, avec l’humour de Barmanes (16/01), Quand j’étais petite je voterais (24/01) et Silence Vacarme (30/01), ces deux derniers déjà présentés à la Comédie de Colmar.
Ensuite La ferme des animals (6/02) d’après Orwell questionnera le pouvoir et Le Sanctuaire (13/02) les marges du libre arbitre face au mensonge institutionnalisé.
La Quinzaine de la danse (6–21/03) proposera à nouveau une offre ambitieuse sur le grand plateau de La Filature avec le Ballet du Rhin comme 3e larron. En écho l’Espace 110 accueillera l’esprit argentin de Como una baguala oscura (10/03) et clubbing de Guest/Flux (20/03), ainsi que le dialogue percussif des corps avec le piano de Mikro (14/03).
L’imaginaire retrouvera Le chapelier fou (27/03) en compagnie d’Alice au pays des merveilles et le Pinocchio de Mentez-moi (11/04).
Enfin Pas touche/L’Archipel (7/05) accueillera l’été : en extérieur aux Jardins du Temps avec un repas végétarien entre les deux spectacles.
miroir sans tain

@Opéra national du Rhin, saison ’25 ’26
#OPÉRA & DANSE
Opéra national du Rhin (Strasbourg), La Filature (Mulhouse), Comédie de Colmar & Théâtre Municipal (Colmar)
ouverture des abonnements le 15/05 pour Strasbourg, le 22/05 pour Mulhouse & Colmar
billetterie à l’unité à partir du 2/09
En compagnie de Bruno Bouché, directeur du ballet, Alain Perroux, directeur général, a présenté sa dernière saison à l’OnR (il prendra la direction du Grand Théâtre de Genève en juillet 2026) avec un fil rouge inspiré par Shakespeare : Le monde est un théâtre.
Il en a profité pour préciser les choix et le calendrier de la rénovation du théâtre de la place Broglie fruit d’une réflexion solidement documentée avec les partenaires du projet.
la saison 25-26
Entre illusion et désillusion, Il Trionfo del Tempo e del Disinganno, premier oratorio de Hændel, peindra de couleurs mélancoliques l’ouverture de la saison (version de concert, uniquement à Strasbourg le 14/09).
Suivra une production de l’Otello de Verdi (29/10–18/11). Speranza Scappucci, une élève de Riccardo Muti, dirigera cet opéra torrentiel dans une version où le final du troisième acte est plus axé sur Jago, personnage central de la pièce, qui, pour conquérir le pouvoir, produit des fake news (comme on dirait aujourd’hui) : chez Shakespeare, on trouvait déjà tout ce qui est actuel comme l’écrivait Karl Kraus en 1933 ! Coproduit avec l’opéra de Nancy, le renfort de ses chœurs promet une impressionnante tempête initiale !
Pour les festivités de fin d’année, la reprise d’Hansel et Gretel d’Engelbert Humperdinck (7/12–11/01), présenté en streaming en 2020, ne dépaysera pas le public (à partir de 8 ans) puisque, dans sa mise en scène, Pierre-Emmanuel Rousseau remplace le pain d’épice par le spectacle forain.
Deux raretés ouvriront l’année 2026.
En création française, Le Miracle d’Héliane d’Erich Wolfgang Korngold (21/01–1/02, seulement à Strasbourg) bénéficie de l’orchestration rutilante d’un compositeur qui, ayant fait les beaux jours d’Hollywood (deux oscars), dépeint une société dystopique.
En mars, le metteur en scène Olivier Py fera renaître Le Roi d’Ys d’Édouard Lalo (11–29/03), un opéra populaire jusqu’à la fin des années cinquante, tombé en désuétude depuis…
Le second classique de la saison, Les Noces de Figaro (28/04–31/05), sera confié à une jeune distribution dont quelques anciens de l’Opéra Studio.
Ce dernier proposera une nouvelle production de chambre : Les Mamelles de Tirésias de Francis Poulenc (8–27/03) sur un livret loufoque et surréaliste d’Apollinaire. Proposée dans l’adaptation pour deux pianos de Britten, elle voyagera avec l’Opéra Volant en 2026.
Les jeunes chanteurs reprendront dès novembre dans la production créée en 2024 Les Fantasticks (4/11–5/12), grand classique de la comédie musicale.
Et c’est avec ce goût assumé pour Broadway, qu’Alain Perroux conclura son mandat : Gypsy de Jule Styne, paroles de Stephen Sondheim (7–23/06), mis en scène par Laurent Pelly avec Natalie Dessay et Neïma Naouri [en remplacement de Follies de Stephen Sondheim suite au retrait d’un coproducteur, mis à jour du 23.10.2025].
Côté danse, Bruno Bouché bénéficie d’une ample programmation et y affirme son attachement à la peinture.
La proposition « chromato-chorégraphique » All Over Nymphéas d’Emmanuel Eggermon (13/11–12/05) permet une première collaboration avec Pôle Sud et sera présentée lors de la Quinzaine de la Danse (Mulhouse).
Caravage (25/03–1/04), la 6e création de Bruno Bouché à l’OnR, sera dansé par le Ballet du Théâtre de Chemnitz (ville jumelée avec Mulhouse) avec l’envie de transcrire par le geste et le corps la puissance et la sensualité qui émanent des toiles tourmentées de l’Italien. Les musiques seront, pour la plupart, d’époque (Monterverdi…).
Et dès septembre…
En regard (18–29/09) mettra la tradition créole de Léo Lérus avec une sensibilité plutôt intimiste en écho avec l’impressionnante énergie collective de Sharon Eyal (cf. Love Cycle à La Filature en 2021).
Bryan Arias créera Hamlet (30/01–13/02) en insistant sur le rôle des femmes dans cette tragédie tendue par des musiques de Sibelius.
Pénalisée par les restrictions lors de sa création, Danser Mozart au XXIe siècle (Rubén Julliard / Marwik Schmitt) sera repris en mai (21–20/05).
Enfin une coréalisation avec La Filature promet un final de saison spectaculaire (11–27/06) : Tero Saarinen, Dominique Brun et François Chaignaud poseront un nouveau regard sur les chorégraphies de la compagnie des Ballets russes de Diaghilev qui a bouleversé la danse au début du XXe siècle.
Sans oublier les récitals : Christian Immler & Julie Depardieu, Marina Viotti, Sabine Devieilhe, Pene Pati, Huw Montague Rendall.
Ainsi que la participation aux Festival Musica (19/09–5/10) et Arsmondo consacré aux Îles (12–22/03) ainsi qu’à la Quinzaine de la Danse (6–22/03) sur le territoire mulhousien.
le projet de rénovation, horizon 2033…
Le bâtiment de la place Broglie est en délicatesse avec les normes depuis 1997, aussi cette rénovation figurait en bonne place dans le programme de l’équipe municipale actuelle.
Des expertises patrimoniales, techniques, financières approfondies avec des préfigurations ont permis d’éclairer la prise de décisions.
Un premier arbitrage a écarté la solution la plus onéreuse : une nouvelle construction sur un autre site. Par contre, plutôt qu’une mise aux normes plus ou moins ambitieuse, les partenaires institutionnels et en concertation avec l’opposition municipale ont choisi un remaniement en profondeur pour un confort optimal du public : visibilité, acoustique & accueil. Alain Perroux insiste sur ces aspects assez déficients actuellement légitimant le passage d’une jauge de 1 100 places à 940.
Pour le public, les saisons se dérouleront sans changement notable jusqu’à celle de 2027–28 incluse, ces trois années permettront à la fois d’adapter le Palais des fêtes pour l’accueil d’une grande partie des spectacles et de mener, jusqu’en février 2027, un « dialogue compétitif » qui préserve une maîtrise plus fine qu’un simple concours d’architecture. Suivront le chantier (avec notamment un rehaussement de cinq mètres du toit actuel) et cinq saisons hors-les-murs avec une réouverture programmée à l’automne 2033.
Et pour mémoire :
Chrysoline Dupont succèdera le 1er juillet 2026 à Alain Perroux, comme directrice générale de l’Opéra national du Rhin (communiqué de presse du 5.07.2024).
de l’autre côté du miroir

Mémoires Croisées
Raymond E. Waydelich
#EXPOSITION
Drusenheim, Espace d’Art PASO du 30 avril au 22 mai 2025
commissaire Germain Roesz, catalogue 44 p.
L’exposition, tout comme le catalogue, a été élaborée en étroite collaboration avec l’artiste puis repoussé en raison de ses problèmes de santé : Raymond tenait à être présent à l’accrochage, au vernissage… Suite à sa disparition en août 2024, elle s’est transformée en hommage au « marchand de bonheur ».
La Fondation Fernet-Branca consacre également une importante exposition à Raymond E. Waydelich (avec Christophe Hohler) jusqu’au 31 août 2025 : anonymous-famous. Une grande salle à l’étage est consacrée à ses boîtes reliquaires dont certaines n’ont jamais été exposées.
Un texte sensible et juste de Jean Christian ouvre l’exposition vers quatre lithographies rares prêtées par Pierre Gangloff (des Pattern Painting de 1973) et une boîte reliquaire datée de 1977 : une merlette (sans doute) « crucifiée » de dos et coiffée d’un haut bonnet conique fabriqué à partir d’une page imprimée, le bec dépasse sur la gauche.
Cette tête becquée coiffée d’un capirote semble une préfiguration miniature de celle de L’homme de Frédehof (Venise, 1978) dont le corps par contre est humain.
Ici comme dans l’installation vénitienne, le capirote rappelle ceux portés par les pénitents en Espagne (cf. Goya) et plus tard les membres du Ku Klux Klan – l’indice d’une meute incontrôlable susceptible de coups de folie collective. Le long bec de Frédehof évoque ceux utilisés par les médecins, remplis d’aromates, notamment lors des épidémies de peste du XIVe au XVIIe siècle (Doctor Schnabel). L’environnement de l’installation vénitienne où trône le personnage est celui d’après une catastrophe. Les choix de Raymond pour le traitement du protagoniste semblent suggérer qu’il est à la fois le (co)responsable et la victime de ce désastre.
Pour mémoire, en ces années-là, un conflit nucléaire restait une éventualité tangible (crise des euromissiles en 1977) et des alertes aussi claires qu’énergiques pointaient les risques liés tant à la pollution qu’aux ressources limitées de la planète (Le Printemps silencieux de Rachel Carson date de 1962, le rapport Meadows de 1972, etc.). Et la catastrophe hante en prérequis son projet Mutarotnegra (1995)…
Le dispositif a été démantelé après la Biennale, mais l’inspiration mémorielle et les questions restent palpables dans les boîtes reliquaire qui sont des installations domestiques, miniatures, « portables » aussi comme La Boîte-en-valise (1949) de Marcel Duchamp que Raymond admirait : Il cassait la baraque (interview de mai 2021). Sauf que lui en profite pour déployer l’univers de Lydia Jacob : celui de la génération de ses grands-parents, celui de gens modestes qui vivaient chichement et dont l’esprit de vie survivrait jusqu’aux années cinquante avant d’être balayé par l’essor de la société de consommation. Les rares objets que possédait cette génération (et qui duraient une vie entière voire plusieurs) seront peu à peu mis au rebut, jetés.
Un univers disparaît et Raymond, archéologue sensible et averti, en récupère des fragments devenus obsolètes ou désactivés par le progrès. Il les mue en œuvre, il les relie, les réordonne par la poésie et l’imagination en un monde fictif plus convaincant que le (dit) réel : une nouvelle vie, un nouveau sens (quelquefois du non-sens) esquissent des histoires souvent touchantes, quelquefois drôles. Le bonheur qu’il offrait naissait là, au-delà du parfum et de la densité du souvenir.
Pages illustrées, carte de géographie (ou à jouer) dressent un itinéraire à d’anciennes photos noir et blanc très posées, à des camées, des cadrans de montre derrière un bout de grillage de cage à poule rappelant l’ancrage dans la ruralité. Il y a des pinceaux, des couverts, des microsillons, des flotteurs de canne à pêche ou cette lame de scie à bûches ringardisée par l’abattage des tronçonneuses, mais anoblie par le geste du peintre.
Et s’il était très attaché au terroir, cette coloration reste discrète, beaucoup de pièces pourraient figurer à l’autre bout de la planète dans Le Musée du silence (2000) ou à côté des spécimens du laboratoire de L’Annuaire (1994), romans de la Japonaise Yoko Ogawa.
Ce goût du ludique n’évacue pas la dimension critique.
L’omniprésence de la numérotation, de ficelles et de sceaux, de tampons, de grillages donne classe et distinction à la logique d’inventaire et à l’obsessionnel administratif de tout contrôler (et ne rien maîtriser : les flèches pour orienter dans le désordre ambiant remplacent peu à peu les chiffres…).
Un merle brandissant du bec un transistor dans un environnement de pièces électroniques dénonce sans avoir l’air d’y toucher l’obsolescence extraordinairement rapide et la toxicité des déchets technologiques.
Ou cet acharnement de hache, scie, tarière à martyriser les livres (il y en a plusieurs sur un parterre voisinant avec des masques Thonet Afrika).
La récurrence des oiseaux naturalisés, de leurs ailes et plumes (et ces jeux de mots : se faire couper les ailes, y laisser des plumes ?) n’est guère étonnante : contrairement aux humains, ces animaux savent prendre de la hauteur, voir les choses que nous, le nez dans le guidon, ne voyons plus. Et que l’artiste sait aviver sous nos yeux !
La découverte en 1984 des silhouettes noires en Crète puis à Chypre (un petit truc qui déclenche…) lui ouvre d’autres perspectives : le trait vif et énergique du dessin propice au gisement imaginatif d’un humour cinglant. Naîtront les séries Kreta, Namibia et ce bestiaire qu’il décline en dessin et jusqu’aux dernières eaux-fortes, mais aussi avec les sculptures en tôle découpée.
Au centre de l’exposition, ce chat au regard avide vers la souris à ses pieds et souligné par un sourire carnassier tout en dents nous raconte – avec un clin d’œil à Tex Avery – l’humaine condition aussi bien que ces vers de Friedrich Schiller (Das Lied von der Glocke / Le chant de la cloche, 1800) :
| Gefährlich ist’s den Leu zu wecken, Und grimmig ist des Tigers Zahn, Jedoch der schrecklichste der Schrecken Das ist der Mensch in seinem Wahn. | Réveiller le lion est périlleux, Et redoutable est la dent du tigre. Mais la plus terrible des terreurs, C’est l’homme dans sa folie. |
En août 2024, un article rendait hommage à Raymond E. Waydelich et détaillait son itinéraire et la singularité de son travail.
Plus récemment, en avril 2025, est parue dans L’imaginaire artistique d’un Musée Zoologique, Une vie rêvée qui évoque ses installations en dialogue avec la faune naturalisée du Musée Zoologique de Strasbourg (1981).
images de l’hédonisme

Garden–Party
fleurs et jardins dans la Collection Würth
#EXPOSITION
Erstein, Musée Würth du 27 avril 2025 au 4 janvier 2026
catalogue en allemand (avec livret en français) 208 p., 30 €
En puisant dans son fond de quelque 20 000 pièces, la Fondation Würth élabore des expositions thématiques ou monographiques qui voyagent ensuite dans ses douze autres musées en Europe.
Si Art Brut (2023) était une initiative du musée d’Erstein, Garden-Party est la déclinaison de : Rosen rot Gras grün Quitten gelb, Les secrets des plantes dans la Collection Würth présentée à la Kunsthalle Würth, Schwäbish Hall en 2023. Entre fascination et exploration, une quarantaine d’artistes tentent de nous dévoiler leur perception des mystères du végétal…
La délectation analytique ouvre l’exposition avec les radioscopies d’Azuma Makoto (X-ray Flowers, 2021) qui voisinent avec l’accumulation taxinomique d’herman van vries (les 123 cadres de From the laguna of Venice, a journal, 2014) et la subtile précision digne de planches botaniques des Tulipes (1983 & 2001) de Jan Peter Tripp et des Orchidées (1985) de Paul Wunderlich. Pour Pflanzturmkonstrukt (2010), Gunther Damisch réélabore habilement le réel avec un assemblage architecturé d’éléments végétaux… coulé en bronze.
L’hédonisme capiteux de Marc Quinn prend ensuite largement ses aises et face à la luxuriance de ses grands formats, personne ne pourra ignorer que la fleur est un organe sexuel ! Ses roses sont l’alibi ludique pour érotiser la pinup dont l’oreiller est un quartier de viande… (The Living and the Dead, 2012) De même ses trois sculptures, des têtes mangées par le végétal, évoquent plus un accouplement que la dissolution du corps qui retourne à la poussière.
Dans l’hommage à Monet qui conclue le rez-de-chaussée, Alex Katz préserve surtout le motif des nymphéas avec une grâce aérienne quand il privilégie les tons lumineux (Boutons d’or, 2009, sur la mezzanine), mais avec une netteté stricte quand il impose le fond noir (Hommage to Monet 6, 2009). Sonia Streng accède à la complexité de l’impressionniste en ouvrant de chatoyantes épaisseurs de sous-bois entre ses hautes herbes (Wiesen und Feldbilder Nr.1, 2004).
À l’étage un premier cabinet accueille des pièces plus anciennes issues de la sphère germanique qui travaillait à un « après impressionnisme » tout en se méfiant de l’influence parisienne… Ils traitent pourtant les mêmes sujets – des jardins quelquefois très fréquentés, des parterres de fleurs ou de simples bouquets –, mais d’un geste qui donne envie de s’attarder : la subtilité de la touche, la juxtaposition fine et vive des coups du pinceau, du couteau – Max Liebermann, Ernst Ludwig Kirchner, Oskar Kokoschka – ou d’aplats plus francs et nets pour trouver la résonance juste – Gabrielle Münter qu’on retrouvera dans le second cabinet (Stillleben mit Holzente, vers 1930) à côté de l’exubérant Lovis Corinth. Dommage que les Erick Nolde, Franz Marc qui figuraient dans la première édition en Allemagne (cf. catalogue) soient absents (de même que les Hockney).
Le parcours suit la chronologie et le figuratif laisse la place à un jeu s’appropriant cet inépuisable gisement de formes et de couleurs. La ludique géométrie de Johannes Itten décline les quatre saisons (1963), l’ocre lumineux du Mittelstrom (2004) de Gunther Damisch est particulièrement mis en valeur dans la perspective sur une paroi noire…
Les acquisitions plus récentes reviennent vers des éléments plus familiers : Nicole Bianchet travaille le support au cutter produisant scarification et échardes avec des saillies de tiges et de fanes apaisées de peinture aux tons sourds suggérant un univers plus rugueux que bucolique (Tell tale & Blaue Blume riecht man nicht, 2009). Presque l’inverse du jaillissement de Saeko Takagi (Twilight Picnic – Purple, 2017) où l’exubérance multicolore emplit la toile du joyeux débordement d’une nature inventive et proliférante.
Le second cabinet accueille des « classiques » plus tardifs : Jean Fautrier, Richard Mortensen, Günter Grass, Victor Bauer, Bernard Buffet…
La matière champêtre très figurative de L’herbier démesuré créé par Garance Coppens (étudiante en didactique visuelle à la HEAR) raccompagne le visiteur qui peut prolonger la Garden-Party en musardant au gré des quatre saisons (l’exposition dure jusqu’en janvier) dans l’écrin de verdure de cinq hectares au sud du musée.
éruptive liberté

Medardo Rosso
L’invention de la sculpture moderne
#EXPOSITION
Kunstmuseum Basel | Neubau du 29 mars au 10 août 2025
commissaires Heike Eipeldauer (mumok, Wien) & Elena Filipovic (Kunstmuseum Basel)
catalogue très exhaustif sur le peintre en allemand ou en anglais, 500 p., 59 CHF
la terre palpite
enfante un visage
un éveil
en surprise en immédiateté
en sourire souvent
quelquefois ils éclosent par paire
mère et enfant
en émouvante promiscuité
le regard mémoire capte
la main trace et pétrit
geste éruptif
capturant l’apparition
en fougueuse invention d’un gisement de matière
en sensible empathie d’un être miroir
frémissant et offert
la cire sur le plâtre
si souvent
avec le soyeux de la peau
et une chaleur sensible
que n’a pas le marbre
beaucoup d’enfants
Ecce Puer
joyeux pied de nez de l’anarchiste
à l’Ecce Homo
des mères
et des prostituées
des malades aussi
et des petites mains
concierge bookmaker sacristain
des épiphanies
en lave ascensionnelle
défiant le temps
et l’équilibre
un organique jaillissement
sédimenté en corps
entier ou pas
en oblique ou soutenu
toujours en fragilité
car le monde est fragile
s’y tenir droit relève de l’exploit
que le rire sanctifie d’un éclat
D’origine italienne, Medardo Rosso (1858–1928) qui a vécu une trentaine d’années à Paris, est un important défricheur rarement montré et peu documenté. Cette monographie, déjà présentée au mumok à Vienne (18.10.2024–23.02.2025), répare cette injustice et permet de découvrir en majesté ce passeur entre l’impressionnisme et la modernité.
Lire en ligne l’article paru en juillet dans le trimestriel Novo n° 77 (p. 72 & 73).
#Autre contribution à cette postérité aussi méritée que nécessaire, l’important catalogue (500 p., 450 ill., 59 CHF) édité pour l’occasion sous la direction d’Heike Eipeldauer : la publication la plus complète à ce jour consacrée à Medardo Rosso.
#L’ART-Kuratorenpreis 2024 a été attribué le 10.04.2025 par le jury du magazine « art DAS KUNSTMAGAZIN » à Heike Eipeldauer pour cette exposition (récompense la plus prestigieuse pour un commissariat d’exposition de l’espace germanophone).
Depuis 1928, le Museo Medardo Rosso ouvert par son fils Francesco à Barzio (Italie) est dédié à l’artiste.
Ayant prêté beaucoup de ses pièces pour cette exposition, il est fermé jusqu’en septembre 2025.
la vie en [très] grand

anonymous-famous
Christophe Hohler & Raymond Émile Waydelich
#EXPOSITION
Saint-Louis, Fondation Fernet-Branca du 5 avril au 21 septembre 2025
commissariat Ute Dahmen
• catalogue trilingue (français, allemand & anglais) consacré aux travaux exposés par Christophe Hohler, 184 p., 25 €
• catalogue bilingue (français & allemand) édité pour la rétrospective des 80 ans de Raymond E. Waydelich à Offenbourg (D) en 2017, 192 p., 35 €
Après une longue fermeture pour travaux, la Fondation Fernet-Branca avait retrouvé son niveau d’excellence avec l’exposition monographique L’ŒUVRE MESSAGIER (2024). Ce printemps elle confronte la vision de deux artistes importants ancrés dans le territoire rhénan et qui ont toujours été attentifs aux petites gens, aux anonymes : de leur réinterprétation de L’Angélus (J-F Millet, 1857–59) à Lydia Jacob, alter ego de Raymond E. Waydelich, ou à cette foule d’Hommes qui avancent (ou pas) de Christophe Hohler.
En écho à la société dans laquelle il vit, un artiste peut faire comme Shakespeare (ou Goya), montrer les violences, les meurtres, toute la barbarie qu’elle est capable de mettre en œuvre ou alors, comme le théâtre classique, évacuer chastement toutes les horreurs en coulisses et n’afficher qu’un présomptueux vernis de civilisation.
Christophe Hohler serait plutôt du côté de Shakespeare, sauf qu’en face, la société se revendique policée et suture consciencieusement par les discours le vernis qui craque de partout : si la violence n’est plus administrée aussi ostensiblement qu’il y a deux ou quatre siècles, elle a été externalisée, a élargi son périmètre et déployé des routines plus souterraines (tout aussi destructrices si ce n’est plus).
la vie est tellement violente, tellement plus violente que tout ce que je peux faire ! On est tout le temps assailli par la violence, et aujourd’hui, avec ces millions d’images qui viennent de partout, la violence est partout et permanente. Vraiment, je ne parviens pas à penser que mes toiles sont violentes.
Une réflexion que Francis Bacon livrait en 1992 à Michel Archimbaud… il y a plus de trente ans et aujourd’hui les millions d’images sont devenues des milliards !
transhumance
Et Christophe Hohler peint…
des hommes, quelques femmes quand même.
Seuls, à deux, en troupe. De face, de profil, souvent en marche, sinon debout ou assis, rarement en activité (il y a bien quelques musiciens, quelques pêcheurs…). Beaucoup sont peints en pied.
Par dizaines, ils hantent les cimaises : tout un peuple.
Et l’artiste creuse les expressions d’un geste nerveux et intense, il jette une ligne rapide, aérienne et torturée ou surligne, fourgonne une tête, une bouche autour d’un cri muet, charge jusqu’au presque noir hors duquel éclate quelquefois le blanc d’un œil qui interpelle le regardeur.
Les postures sont fatiguées accablées, les bras tentent de s’en extraire, d’aller au-delà de la carcasse, de trouver une amplitude qui en impose et par là révèle l’aura, la projette en reconquête de l’espace vital et mental qu’a confisqué cette violence travestie.
Une aura individuelle ou collective.
Elle se matérialise par ces éclaboussures – ce dripping –, cette matière vibrante grandissant les silhouettes : une révolte contenue qui déborde et s’insurge contre la violence subie, tente de s’en débarrasser comme un chien trempé qui s’ébroue ou un Prométhée qui secouerait des chaînes invisibles. Et sur les grands formats, coincés entre le ciel et la terre, réduits à cette ligne en stabulation masquant l’horizon, celle de détenus qui se débattent contre le fatum. (Affluence, 2019)
La vigueur du trait est expressive et… anonyme. Ses êtres sont présents avec densité mais peu identifiables (certains ont une barbe, un cigare…), on distingue un col un sac à dos, mais on ne pense pas aux vêtements – on dirait : ils ne sont pas nus ou alors habillés de peinture – et les quelques indices vestimentaires n’indiquent aucune époque, aucune géographie.
Par contre l’âme de chaque individualité est là : à nue, cinglée sur la toile, débordant de son aura !
Une aura en bataille où les éclats polychromes sont l’indice du combat contre l’adversaire invisible, où l’immobilité tendue du noir et blanc est bafouée par la couleur en taches mordantes comme une malédiction.
La plupart sont en déplacement, de nombreux titres l’indiquent : marcheurs voyageurs pèlerins ou traversée en fuite en marche… Une humanité de corps outragés égarés dans un espace linceul, mais toujours en quête avec quelquefois ces regards levés (Il se passe quelque chose dans le ciel, 2 toiles 2024 & 2025).
L’envie de ménager un modeste espoir ?
La présence oppressante d’un fond rouge, vert malachite ou nuit le ravale crûment.
Et quand un accessoire s’affiche, c’est une kalachnikov aux mains d’un gamin en miroir de son ballon de foot (Jeux d’enfants, 2007)…
Même les poissons ont leur pendant sans chair et tout en arêtes… (Poisson, 2 toiles de 2019)
Et le miroir s’invite en arbitre de ses Danses macabres (2018–2019). Loin des hétéroclites farandoles médiévales, c’est le face-à-face d’Hamlet avec le crâne de Yorick – celui de la tirade To be or not to be* – qui orchestre l’affrontement du rouge et du noir. De la nuit et du sang. Le rouge translucide du sang mêlé de sueur.
Mais tout n’est pas noir chez Christophe Hohler : profitant de l’ampleur du lieu, il voulait montrer une autre palette. Dès la deuxième salle, des vues de forêts, des sous-bois sombres certes mais enluminés de discrètes flaques dorées ; dans l’aile ouest, des fleurs et des violettes en petits formats très pop art dans la vivacité colorée et l’agencement en séries ; des musiciens dans l’espace au sud ; Les oliviers près de Cargèse, la cathédrale de Strasbourg à l’étage…
Et il y a des gestes d’affection : Assistance (2 toiles de 2022), 2 hommes en conversation (2022), L’étreinte (2023) et dans L’Angélus (triptyque, 2024), le couple de paysans ne prie pas comme chez Millet, mais s’étreint intensément : ils ont compris que le partenaire en chair et en os, hic et nunc, était le seul soutien possible et qu’il ne fallait rien attendre d’une entité qu’elle soit déique, étatique…
Si ses sculptures (terre cuite – vernissée en général – ou fonte) reprennent les mêmes thèmes, elles sont plus torturées que sa peinture. L’énergie du geste tourmente la matière au lieu de se prolonger en fusées et en tourbillons comme sur la toile. L’engobe est blanc, céladon, vert-de-gris… mais rouge pour la peau ! à moins que l’or (ou le rouille du métal brut pour les grands formats) ne prenne la main.
Dans Das Narrenschiff (2019), les fous ne sont pas typés et individualisés comme chez Bosch, mais, tout en cris et en agressive gesticulation avec des attributs de fétiches vodous, ils semblent emportés dans une folie collective dont l’issue est certaine : ils mènent l’embarcation vers le naufrage (sujet de 3 autres pièces… 2018 & 2023).
anonymous…
et ces anonymes marchent
car le monde est f(l)ou
et ils luttent pour ne pas devenir fous !
mais s’ils accèdent à la célébrité
ils le deviennent
famous…
* Être ou ne pas être : forme active (masculine ?) de la Melancholia ?
En peinture, la question mérite d’être réfléchie…
archéo-fiction
L’approche de Raymond E. Waydelich (qui se revendiquait « marchand de bonheur ») semble plus joyeuse et offrir un contrepoint facétieux au tragique du Sundgauvien, mais le caractère carnassier de ses créatures est bien présent et s’il s’en moque, c’est pour ne surtout pas le dénier.
Dans ses Angélus (deux canevas dénichés dans un grenier et amendés), la sérénité champêtre est compromise par les artefacts technologiques : avion dans le ciel, moto.
L’association des deux artistes est harmonieuse et quelquefois piquante. L’invitation leur avait été lancée pour 2023, mais, voisin et familier du lieu (de l’étendue de ses cimaises notamment), Christophe Hohler avait demandé du temps et ce report au printemps 2025. Entretemps Raymond est parti… et l’accrochage se transforme en hommage. La commissaire Ute Dahmen (qui connaît bien son travail) a sélectionné les pièces avec les proches de l’artiste.
La grande salle de l’étage (côté nord) présente beaucoup de boîtes reliquaires pour lesquelles Raymond avait une tendresse particulière – certaines n’ont jamais été exposées. Elles sont liées à Lydia Jacob (son arbre généalogique est présent à l’entrée), préservent en miniature l’esprit de L’homme de Frédehof (Venise, 1978) et déroulent cette fabrique d’archives fictives, mais touchantes et justes : elles sont nourries d’objets quotidiens liés à des souvenirs d’enfance, de voyage, à des habitudes, un savoir-faire, des objets familiers et poétiques mais souvent disparus ou voués à l’oubli.
Ses autres travaux sont accrochés en dialogue avec ceux de son collègue et ami : quelques Memories painting (en bas), des collages, des dessins, des gravures… mais peu de sculptures.
Une exposition dense, riche, avec des grands formats, aussi impressionnante par la quantité des pièces que par la qualité des deux artistes.
L’Espace d’Art PASO à Drusenheim (67) consacre également une exposition à Raymond E. Waydelich du 30 avril au 22 mai 2025 : Mémoires Croisées, (l’analyse sur les boîtes reliquaire y est plus approfondie).
En août 2024, un article rendait hommage à Raymond E. Waydelich et détaillait son itinéraire et la singularité de son travail.
Tout récemment, en avril 2025, est parue dans L’imaginaire artistique d’un Musée Zoologique, Une vie rêvée qui évoque ses installations en dialogue avec la faune naturalisée du Musée Zoologique de Strasbourg (1981).
L’imaginaire artistique d’un Musée Zoologique

Un bestiaire strasbourgeois contemporain
textes de Paul Ardenne, Daniel Payot, Germain Rœsz, Luc Maechel
#LIVRE
chez Association des Presses Universitaires de Strasbourg, avril 2025 (Collection Essais : 144 p., 186 ill., 40 €)
#EXPOSITION
Strasbourg, galerie Chantal Bamberger du 17 au 31 mai 2025
Après une très importante compagne de travaux, le Musée Zoologique de Strasbourg rouvrira ses portes à l’automne 2025. L’Association des Amis du Musée a profité de cette longue pause pour revisiter l’histoire du lieu en élaborant cet ouvrage. Il met l’accent sur l’une des singularités de ses expositions temporaires : proposer à des artistes contemporains de mettre en écho leur travail avec les collections. Les textes et les images font revire ces belles rencontres entre art et science.
texte du 4e de couverture
Le Musée Zoologique de Strasbourg n’est pas seulement une collection d’histoire naturelle exceptionnelle, c’est un lieu hors du commun et hors du temps, le vestige d’une épopée scientiste visant à restituer et classer la totalité du monde animal. Leurs spectres naturalisés y forment une réserve figée et silencieuse, tout à la fois étrange et familière.
De vitrines en dioramas, le public y est convié au spectacle du savoir, mais c’est bien davantage une invitation au voyage et à l’imaginaire qui nous est faite ici.
Nombre d’artistes ont répondu, de manière très diverse, à cette sollicitation implicite. Ils ont souvent fait du musée un lieu d’études « d’après nature » mais ils y ont surtout cherché les motifs et les mobiles susceptibles de nourrir ou d’élargir leurs champs de recherche. Ils y ont aussi trouvé l’occasion de revisiter des thèmes anciens (natures mortes, cabinets de curiosités, trompe-l’œil, chimères, métamorphoses…), ou d’en imaginer de nouveaux dans toutes les disciplines (photographie, peinture, dessin, sculpture, infographie, installations…), et dans les espaces les plus divers, y compris les lieux mêmes du musée.
Cet ouvrage, initié par l’Association des Amis du Musée Zoologique de Strasbourg, témoigne de ce renouvellement radical de l’art animalier depuis une quarantaine d’années. 32 artistes y déploient un bestiaire inédit inspiré par le génie d’un même lieu.
Les artistes ayant exposé au Musée Zoologique et dont le travail est présenté dans le livre ont exposé certaines de leurs pièces à la Galerie Chantal Bamberger du 17 au 31 mai 2025.
l’appel du large

Jérémy Fisher
de Mohamed Rouabhi
#THÉÂTRE
représentation du jeudi 3 avril à l’Espace 110 (Illzach)
en tournée à partir de septembre 2025
Pour leur création 2025, Thomas Ress, directeur de la maison, et sa Compagnie des Rives de l’Ill s’offrent un dispositif bi frontal immersif construit expressément pour l’occasion.
La pièce est un conte, recommandé à partir de 12 ans pour 1h15, mais adapté à un public un peu plus jeune s’il n’est pas trop impressionnable (par le masque du médecin et les effets lumineux du cauchemar).
Le public est invité à prendre place sous une grande tente évoquant un bateau renversé avec une ouverture sommitale en forme de poisson : un orifice permettant à l’âme de s’échapper chez les animistes. Discrètement le sacral s’invite…
Des « projections » activent la toile écrue de cette nef – la noyade de Foster (récit de Tom), l’échographie de Jodie, l’irruption du cauchemar, le final… Un dispositif scénique acteur à part entière du spectacle.
Cette mise en vibration immersive de l’espace entre ténèbres et lumière avec ombres chinoises, effets kaléidoscopiques, faisceaux traqueurs… est le fruit d’un subtil jeu de manipulations assurées à vue par les comédiens et la régie.
Ludmila Gander l’amplifie d’une bande-son délicatement élaborée : bruissements, bourdonnements, bouillonnements, battements de cœur, glougloutements, etc.
La pièce se veut une ode au droit à la différence et met en scène une parentalité attentive et intelligente en cohérence avec la profondeur des sentiments et acceptant, accompagnant l’émancipation de leur fils qui veut/doit quitter le nid pour un autre destin : aquatique.
Jérémy (Nicolas Phongpheth) porte le récit en étant à la fois le narrateur et en jeu. Son autre destin s’invite par le biais d’une alter ego danseuse (Virginia Danh) – travail au sol à fleur du praticable jusqu’à leur conjonction finale.
Laure Werckmann et Fred Cacheux donnent une certaine épaisseur humaine à Jodie et Tom, les parents de Jérémy, des personnages peu complexes et sans beaucoup d’interactions. La confrontation au monde est croquée par deux figures de grotesques : le médecin avec son masque bec d’oiseau médiéval et sa perche échographique (Philippe Cousin), puis le commis voyageur en aquarium (Jean-Pierre Verdeilhan), farfadet particulièrement envahissant (Comment s’en débarrasser ?). Accessoirement Jérémy évoque la proposition du directeur de la piscine qui veut le transformer en attraction de cirque.
Ces scènes plutôt humoristiques suggèrent (discrètement) la tentative de la science de régenter les vies et celle du marché de tout transformer en espèces sonnantes et trébuchantes.
Pas sûr par contre que Mulder et Scully parleront aux plus jeunes… (scène du cauchemar)
Le texte de Mohamed Rouabhi est linéaire et lisse. Sa langue est simple mais sans la subtilité allusive d’un Mæterlinck qui savait ouvrir de déchirants abîmes sur le sens de la Vie et les impasses de la destinée (Pelléas et Mélisande est aussi une histoire d’altérité…).
En embarquant le spectateur dans cette nef chaleureuse rendue envoûtante par des techniques traditionnelles au théâtre et qui savent vivifier un autre monde, Thomas Ress et son équipe donnent un charme inventif et poétique, drôle par moments, à cette fable et à son message de bienveillance.
Mais comme l’écrivait Adam Smith : Ce n’est pas de la bienveillance du boucher, du marchand de bière et du boulanger que nous attendons notre dîner, mais bien du soin qu’ils apportent à leurs intérêts. Nous ne nous adressons jamais à leur humanité, mais à leur égoïsme.
avec Nicolas Phongpheth, Laure Werckmann, Fred Cacheux,
Jean-Pierre Verdeilhan, Philippe Cousin, Virginia Danh
mise en scène Thomas Ress
scénographie Antonin Bouvret
création musicale Ludmila Gander
dunkle Sehnsucht*
* sombre nostalgie/désir (terme très utilisé par les Romantiques allemands)

Le Misanthrope
de Molière
#THÉÂTRE
représentation du vendredi 28 mars à la Comédie de Colmar
Simon Delétang a une histoire complexe avec Le Misanthrope. La première scène avec Célimène (AII, s1) lui a ouvert les portes de l’ENSATT, mais ensuite des rendez-vous manqués ont contrarié son envie de le jouer, de le monter jusqu’à cette production. Un temps long pour mûrir la pièce et son personnage emblématique : un « Héros romantique absolutiste », « le plus beau personnage du théâtre français » « en avance sur son temps ».
Des convictions qui innervent fortement son spectacle créé au Théâtre de Lorient – CDN en octobre 2024.
un parfum d’écurie
deux arrière-train de chevaux
et de la paille sous un portique à jardin
une porte basse dans le mur du fond
avec un escalier
une montée vers le SILENCE
c’est écrit en grande lettres capitales au-dessus
et deux bancs
un lieu où on passe où on vaque
avec énergie et vitalité
une chorégraphie enlevée
comme souvent chez Delétang
et on y parle
beaucoup
presque une arène de disputatio
où l’alexandrin semble une évidence
pour déployer les dogmes
et il en faut plusieurs pour qu’ils s’affrontent
que le « en société » vaille la peine
l’inverse du SILENCE placardé
un lieu d’intrigue et d’influence
de trahison aussi
bien plus dangereux qu’un café du commerce
avec l’hypocrisie en règle d’or
la polémique sur le sonnet d’Oronte (Gaël Baron) le confirme d’emblée
sauf que l’exigeante posture qu’Alceste défend est intenable
face à Célimène notamment
surtout
l’intimité s’accommode mal des dogmes
qui évacuent les sentiments voire l’humain
au fond tout cela n’est qu’un jeu
de vanités
et Célimène le sait et s’en amuse
ces WC qu’elle offre en sièges à ses invités
les piques qu’elle distille avec délectation
et tous savourent la grâce de sa férocité
sauf Alceste
Si l’argumentation patiente et raisonnable de Philinte (Julien Chavrial) qui prône le sincèrement hypocrite (ou l’hypocritement sincère) ne convainc guère Alceste, Célimène, plus pratique, jongle avec une habile mise à distance. Le « Demeurez » (AII, s3) qu’elle lance à son amant, Thibault Vinçon à la fois charmant et ébouriffant, vise à lui dévoiler le spectacle du jeu de dupes que sont les mœurs (et sa manière à elle d’en jouer) : un édifiant teaser plutôt qu’un discours abscons.
Sur ces bases, Leïla Muse compose une Célimène d’une nature saine et lucide (une forme de sincérité qui touche Alceste – malgré les compromis) et elle lui fait voir (comme avec des lunettes déformantes) tous ces gens tels qu’ils sont fondamentalement : des bouffons bouffis d’eux-mêmes. Ainsi des WC à la perruque de Clitandre (Yanis Skouta) en passant par les tics de petits marquis et le spectaculaire numéro de venimosité de l’Arsinoé de Déborah Marique. Une radioscopie qui suggère par l’exemple qu’il n’y pourra rien changer !
Dire du mal des autres est encore la plus grande récréation que l’homme social ait trouvée. (Edmond de Goncourt)
La musique appuie les traits grinçants de cette cour ou amplifie les moments de poésie, il y en a (ce rebec rudimentaire jouée par Fabrice Lebert en écho à Célimène).
Tous en rient y compris le public. Mais pas Alceste qui reste hermétique à la démonstration.
Or Célimène est encore jeune, elle veut prendre le risque de vivre pour quelques moments miraculeux (et garder espoir ?), aussi elle rejette la lente extinction sous l’ascèse rigide (et exclusive) que veut lui imposer l’intransigeant Alceste.
Absolutiste jusqu’au bout, il s’en va, monte vers le SILENCE.
La cloison tombe et ouvre l’espace : le Misanthrope est devenu Le Voyageur contemplant une mer de nuages de Caspar David Friedrich (1818). Une icône du romantisme.
Pendant quelques secondes, Alceste regarde le monde de haut, s’imagine le dominer peut-être… Mais la vraie vie n’est pas une toile de maître, la brume enfle et l’avale.
Le verbe… pour en faire quoi ?
Une tragédie de la conversation suggérait Vitez.
avec Thibault Vinçon, Leïla Muse, Julien Chavrial, Gaël Baron, Déborah Marique, Yanis Skouta, Romain Gillot, Pauline Moulène, Fabrice Lebert
mise en scène et scénographie Simon Delétang
lumière Mathilde Chamoux
costumes Charlotte Gillard
son Nicolas Lespagnol-Rizzi
lumière noire

Phèdre
de Jean Racine
#THÉÂTRE
représentation du mercredi 26 mars à La Filature, Mulhouse
Pour sa production de 2024, Matthieu Cruciani avait privilégié un décor très construit et baigné de soleil : une salle d’apparat s’ouvrant sur une terrasse avec vue sur la mer. Pour sa création 2025 (début février Le Cratère–Alès), Anne-Laure Liégeois fait à l’inverse le choix d’une version dépouillée : un plateau quasi nu dévoré par la pénombre. Les costumes contemporains, noirs et anthracites, amplifient cette froide austérité.
Deux manières de décortiquer les jeux de pouvoir et comment l’humain s’y fracasse !
trois canapés affrontés
un vaste tatami les sépare
trois clans enfermés
dans un des carceri de Piranesi dont on aurait évacué les structures labyrinthiques pour ne conserver que la lumière noire
des corps affalés livrés
à peine des corps
la viande disparaîtra très vite
les jambes de Phèdre sous le pantalon
le corps dans les jeux de pouvoir ne peut être qu’une loque
ou une arme (comme cette lame qui passe de main en main)
l’affirmation du pouvoir surgit de l’ombre
et y retourne
le temps de méditer le (sale) coup d’après
Thésée lui arrive de la salle
(il vient d’échapper aux ombres de la mort)
comme l’annonce de Panope juste avant
D’entrée Anne-Laure Liégeois déporte le dialogue d’exposition en salle (un peu moins audible du coup), un tunnel qu’assure Ulysse Dutilloy-Liégeois sans vraiment en résoudre le statut. Sur le plateau par contre, il sait donner consistance à son Hyppolite dépassé et trop tendre pour ces venimeux jeux stratégiques où il joue plutôt perdant. Théramène (David Migeot) saura l’anoblir avec un récit de sa mort enlevé mais plus hagiographique qu’ému – un joli rôle… épique par procuration.
Aricie est la plus lucide et parvient à esquisser un (minuscule) chemin. La blondeur de Liora Jaccottet détonne dans cet aréopage de sombres silhouettes et elle porte avec netteté cette détermination laissant peu d’espace aux conseils d’Ismène (Ema Haznadar).
Personnage calculateur, l’Œnone de Laure Wolf se démène, déverse son argumentaire nourri de logique dynastique, de tactiques manœuvrières… mais ne parvient qu’à lever les inhibitions de Phèdre catalysant la tragédie. Sa scansion des alexandrins (indice mécanique d’une rationalité désemparée ?) se heurte à l’engagement ordalique de la fille de Minos.
La lumière noire crucifie et la Phèdre d’Anna Mouglalis le sait, le vit.
Elle croule sous le poids de son corps, avance chancelante, désarticulée. Sa sombre voix d’alto fourrage sa blessure, musique rauque et ardente, fêlée sur la fin : un lamento avec des feulements et des insurrections où l’incarnation transcende la métrique des vers. Sa viande mourra au milieu de l’autel plateau. La veste tombe découvrant bras et épaules nus, livrant une carcasse démissionnée, un chiffon de chair : le seul corps en jeu, la seule qui avait osé toucher les autres. Et la terre…
Le Thésée d’Olivier Dutilloy est blanchi sous le harnais, un sexagénaire pétri d’une colère autoritaire, active ou rentrée, dont il cisèle les pulsations dictées par une intransigeance qui finit par le terrasser.
Le pouvoir décidément est bien ingrat.
La lecture d’Anne-Laure Liégeois est sobre, concentrée sur le texte, avec des manteaux qu’on enlève pour avoir l’impression d’alléger sa charge et des face-à-face comme deux aimants qui se repoussent au lieu de s’attirer.
Sur la grande (et haute) scène de La Filature, la folie du pouvoir déploie ses effluves délétères, mais cet écrin vaste et dru la confronte aussi au vertige de sa vacuité.
mise en scène, scénographie Anne-Laure Liégeois
avec Anna Mouglalis, Ulysse Dutilloy-Liégeois, Olivier Dutilloy, Liora Jaccottet, Laure Wolf, David Migeot, Anne-Laure Liégeois, Ema Haznadar
création lumière Guillaume Tesson
costumes Séverine Thiebault
transcender la transe

Naharin’s Virus
d’Ohad Naharin · The Batsheva Ensemble
#DANSE
représentation du jeudi 20 mars à La Filature, Mulhouse
Le spectacle a été créé en mars 2001. Ohad Naharin et The Batsheva Ensemble l’ont recréé en 2014 et il est au répertoire de la compagnie depuis. Sa proposition est atypique : Cette pièce est un prologue. […] Ce que vous allez voir n’est pas une pièce. Ce soir on ne joue pas. […] on joue avec vous.
Le chorégraphe et les interprètes endossent avec force (et à leur manière) le projet de Peter Handke (Outrage au public) en installant une tension entre le plateau et ses danseurs, les mots dits ou écrits et le public en interface interpellée sur ses préjugés, ses habitudes, son statut…
lumière sur le plateau
s’y tortille une croix
mannequin simili-danseur
des boudins torturés par le vent sur une plage
déserte
le public s’installe en face
un confortable balcon
pour assister à la tempête ?
musique arabe clinquante et enlevée
la nuit tombe
souffle et sifflement du vent
torture du vide, de l’absence
du fond noir et mat
un corps phagocyté affleure
il s’y débat s’y frotte s’y contorsionne
accrochée à une craie
la danseuse trace une ligne blanche
un fil de lien
elle suit le contour de son bras
de sa souffrance
se hisse de cour vers jardin
lentement
elle réussit le mot VOUS
elle ne lâche pas la ligne blanche sur le tableau noir
dressé sur son extrémité à jardin
un coryphée
immobile en costume cravate
en mirador d’une cour de prison
il dit les mots de Peter Handke
ceci n’est pas un spectacle…
au compte-goutte les danseurs entrent
forment des couples des trios
le coryphée aussi les rejoint
il quitte son costume de mannequin acéphale
ils sont six quatorze dix-sept
ils écrivent
geste au sol et sur le mur
au fond tambourinement perlé des craies contre
ils écrivent le mot NOUS blanc sur noir
bientôt en anagramme PALESTINIA
de grandes lettrines sur toute la largeur du plateau
ils écrivent et affrontent le public
des détenus qui se débattent
en contention entre les mots et les spectateurs
intense présence des corps tout en largeur
alignés à face avec énergie et puissance
un second rang en quinconce
déplacements latéraux et gestes mimétiques
en raccourci d’un meneur
des cris des interjections des coups sur le sol
de pieds de mains
certains sautent se suspendent au fond
tournent le dos au public
Et toujours le texte de Handke…
Le plateau avec ses danseurs est un espace en énergique dialogue frontal avec les mots (écrits ou parlés) et le public interpellé en permanence et très directement par le coryphée (mais sans interactivité concrète). D’une scène à l’autre, d’une musique à l’autre, des mouvements, des attitudes, des gestes reviennent, prennent une autre couleur, portent une autre émotion (ainsi avec l’adagio de Barber). Et le dispositif est d’une belle et simple unité : un sol blanc cassé, des parois noires dont se détachent en contraste, comme des troncs de statues antiques, les danseurs avec leurs justaucorps chair (jusqu’au bout des ongles) dressés sur des collants noirs.
Vers la fin, obsessionnelle, maniaque, une danseuse trace un cercle autour du A – un Peace & Love runique –, celui d’anarchie, d’amour ?
À l’autre bout, une autre perchée et penchée frotte une tache rouge qui grandit, grandit.
Le noir et blanc des mots avec le rouge du sang.
Dans son texte, Handke questionne les mots.
Mais de quel côté sont les mots ?
La pièce est dense, forte, intrigante aussi : un morceau d’enfer qui brûle dans l’absence de tout parce que seules les frustrations du corps et les images obsédantes du rêve l’alimentent. (Pascal Quignard / L’amour la mer, 2022)
avec le Batsheva Ensemble, division junior de la Batsheva Dance Company
chorégraphie & scénographie Ohad Naharin
création musicale Karni Postel avec des musiques additionnelles
costumes Rakefet Levi
lumière Avi Yona Bueno « Bambi »
paix profonde

Planètes
de Jérôme Brabant
#DANSE
représentation du samedi 15 mars 2025 à l’Espace 110 (Illzach)
Créée en mai 2024 au Manège, scène nationale-Reims, Planètes est la première pièce de groupe de cette envergure dans le parcours de Jérôme Brabant. C’est aussi l’une des premières fois où il ne danse pas dans sa création. La chorégraphie est conçue pour être en totale symbiose avec la musique originale du duo Philip | Schneider, compositrices et chanteuses danoises.
premiers gestes dans le silence
intrusion timide
une femme seule
Ève cosmique en contre-jour
ses paumes tranchantes aux reflets argentés
forent l’espace
tracent le chemin
tirent le corps
en sourdine la combustion
grandit
mûrit une voix céleste
une syllabe unique et scandée
tendue et têtue
les mains impulsent la giration
emballent la gravitation
qui décroche les autres danseurs des flancs à cour à jardin
ils créent rejoignent le manège orbital
leurs mains leurs bras se tendent
cherchent l’espace
et le colonisent
bâtissent le non-vide
désamorcent le néant
les corps activent le spectre
de l’infrarouge à l’ultraviolet
avec leur académique moiré
corps et matière saisis dans des faisceaux rouge jaune vert
le vertige pendulaire des rondes ordonne l’espace
balise le temps
avec les ombres mouvantes en cadran stellaire
la modulation extatique s’amplifie en duo
le mezzo s’entrelace au soprano
les danseurs s’invitent en ison
en écho des bourdons vibratoires
trépidations ferroviaires
tourmente venteuse
grondement intergalactique
combustion (à nouveau)
les révolutions successives
disparition réapparition
se résolvent quelquefois en figure collective
ascensionnelle
comme émergeant de la magie des voix
témoins et satellites du sidéral brassage
des montées en éruption hypnotique
où le geste n’est pas en rythme avec la musique
mais semble naître de la transe sonore
s’épanouir en géante rouge
avant sa dissolution en naine blanche en trou noir
La chorégraphie de Planètes est (forcément) répétitive, obsessionnelle. La geste galactique portée par les danseurs se distribue d’un corps à l’autre, les coalise ou pas. L’entrecroisement centrifuge mené par les mains, des mains toujours actives et quêteuses, crée et cherche du sens…
Jérôme Brabant trouve des poses d’arabesques, de statuaire antique (discobole, guerrier couché…), de divinités égyptiennes, leur impulse une dynamique qui ici peut prendre son essor, aller au bout de l’élan… avant de se dissoudre.
La ductilité liquide de son travail inscrit dans notre mémoire le corps astral de ses danseuses et danseurs tels d’universels hiéroglyphes issus du temps, de l’espace : indices fragiles et mouvants de notre atavique tentative d’appréhender l’orientation de l’homme en lui-même et dans le cosmos, à partir du mythe et de la peur (Aby Warburg).
avec Alexandra Damasse, Valentin Mériot, Yves Mwamba, Emma Noël, Manuele Robert, Nina Vallon, Lucie Vaugeois
musique & chant Joséphine Philip, Hannah Schneider
conception & chorégraphie Jérôme Brabant
scénographie Jérôme Brabant, Françoise Michel
lumière Françoise Michel
un mantra du Care

Robot, l’amour éternel
de & avec Kaori Ito
#DANSE
représentation du 11 mars 2025 à l’Espace 110 (Illzach)
Kaori Ito a été nommée à la direction du TJP, Centre Dramatique National de Strasbourg Grand-Est au 1er janvier 2023. Danseuse depuis plus de vingt ans (pour Decouflé, Preljocaj, Platel, Cherkaoui & Thierrée entre autres), elle a fondé Himé sa propre compagnie en 2015 et entamé une trilogie autobiographique dont Robot est le dernier volet. Depuis sa création en 2018, la chorégraphe reprend régulièrement le spectacle en tournée.
le piano saupoudre un ostinato teinté de romantisme
paix irénique de la nuit
avec le tourbillon cristallin des notes
la lumière éclôt délicatement
caresse une membrane
dorée comme le sable, elle pulse
l’ombre se joue du chatoiement
sculpte cette étendue palpitante
tandis que le tissu glisse vers le fond
dans le gouffre
la lumière sédimente une vaste surface minérale
percée d’orifices carrés anguleux
comme les tombes ouvertes par la parousie de Fra Angelico*
de l’une émerge un pied
prudent expressif
il se retire
plus loin pointe une tête un tronc
la moitié du visage est masqué
demi-masque couleur chair et plastique
le corps s’extirpe
essaye sa mécanique
ses mouvements sont un peu heurtés
il arpente l’estrade
quelques prothèses en plastique traînent
il en ramasse une
teste ce fragment d’exosquelette
un expédient pour prévenir la désarticulation
et assurer le fonctionnement au long cours
puis
impératif de robot au réveil
il attrape son smartphone
l’éclat de l’écran tétanise le visage
glaçante impérieuse
une voix synthétique égrène les injonctions
voix d’aéroport
voix lisant les items d’un agenda
dense débridé harassant
a rat race
une vie mécanique
le corps s’y conforme
joue cette vie-là
voix attendue aussi
le corps la bouche miment l’énonciation de consignes
jeu de rivalité avec la machine
rébellion minuscule
par l’humour souvent
en dépit de la contrainte
la personne la femme Kaori existe
Robot, l’amour éternel ne met pas en chorégraphie une danse de robot. La danse est le moyen de paramétrer le corps en mécanique destinée à abattre un emploi du temps. Une vie normale. Ou presque.
Le métro boulot dodo devient pour la danseuse en tournée à l’international avion boulot et pas dodo.
Et le Campo Santo de Fra Angelico se mue en radeau de la méduse où la naufragée trace un itinéraire où ni le corps, ni l’esprit ne trouvent le repos.
Abattage…
Alors la pulsion de mort pour rompre l’abrutissement ?
Les mots le disent, évoquent aussi ces petites morts : les pointillés lumineux d’une vie normale. Mais qui peinent à devenir une ligne de Vie…
Thanatos
Éros
La maternité précipite la rupture de cette logique, la commotion très concrète de l’accouchement surtout. Quoique : Je t’ai donné la vie. Je t’ai donné la mort.
Mais un fil de vie se dessine.
La voix synthétique et anonyme devient celle de Kaori enregistrée, puis sa voix devient réelle. Et elle interpelle le public.
Le doute demeure, sous l’ombre de la mort ?
Nouée en linceul, la membrane textile du début affleure à nouveau, traverse le plateau d’une tombe à l’autre. Kaori en galérienne l’active doucement, très doucement. En mode mineur au rythme lancinant du O Solitude de Purcell.
Éloge de la lenteur. Éloge de la paresse ?
Le repos enfin ? La mort joyeuse avec les derniers selfies couchée dans la tombe (pas de jugement dernier pour les robots !)
Noir morendo.
Et en conjuration : La danse est un mantra pour réparer les vivants (Kaori Ito).
Il convient de saluer le travail de Yann Ledebt qui, de sous le plateau, assure beaucoup de manipulations et la régie du spectacle.
* Le Jugement dernier conservé au musée national du couvent San Marco de Florence (tempera et or sur bois, 105 × 210 cm, 1431 – 1435)
avec Kaori Ito
manipulations et régie Yann Ledebt
texte, mise en scène & chorégraphie Kaori Ito
décor Pierre Dequivre, Delphine Houdas & Cyril Turpin
direction technique & création lumière Arno Veyrat
Angelus novus, speriamo

EXIT ABOVE d’après la tempête
d’Anne Teresa De Keersmaeker, Meskerem Mees, Jean-Marie Aerts, Carlos Garbin · Rosas
#DANSE
représentation du mercredi 5 mars à La Filature, Mulhouse
Avec son hypnotique immersion dans le blues, le spectacle d’Anne Teresa De Keersmaeker, Meskerem Mees, Jean-Marie Aerts, Carlos Garbin · Rosas créé à Bruxelles en 2023 inaugure la Quinzaine de la Danse à La Filature. C’est la première proposition d’une programmation particulièrement relevée cette année avec, entre autres, une soirée William Forsythe et The Batsheva Ensemble pour ne citer que les plus connus…
un danseur vient jusqu’en bord de scène
battements de mains
adressés
à la technique
au public
léger flou
voulu
avant le chaos
celui d’Angelus novus
Walter Benjamin pour les mots*
Meskerem Mees pour les dire
… du paradis souffle une tempête qui s’est prise dans ses ailes, si violemment que l’ange ne peut plus les refermer. Cette tempête le pousse irrésistiblement vers l’avenir auquel il tourne le dos, tandis que devant lui les ruines s’accumulent dressées jusqu’au ciel. Cette tempête est ce que nous appelons le progrès.
en sourdine un bruissement d’eau
contaminé par la mécanique
le danseur est toujours seul
les mouvements de ses bras travaillent le doute
au fond un voile écru monte vers les cintres
masque l’écran noir où s’écrivaient les mots de Benjamin
la machine à vent enfle le voile
houle textile
ample soyeuse avec des reflets argentés
scintillant vertige du déchaînement
ivresse dionysiaque
le son de la tempête enfle
souffle liquide et fabriqué
la mécanique de la machine à tempêtes
engloutit le danseur
vacarme du progrès ?
silence brutal
la fine toile tombe
black cube
la foule après la houle
avec le blues
le chant de Meskerem Mees
la guitare de Carlos Garbin
en sourdine souvent
le chaos se berce de sonorités mélancoliques
l’ardent désir du chaos est devenu nostalgie. Et il en sera ainsi jusqu’à ce qu’un vent terrible précipite dans l’oubli la majorité de l’humanité. Les survivants frissonneront au milieu du chaos. (D. H. Lawrence / Le Chaos en poésie, 1928)
un chaos insensible
et nomade
de la tempête de Benjamin
remontée vers celle de Shakespeare
à l’errance sur l’île du naufrage
la marche
et la quête
Dans le blues, les gens frappent des mains, tapent sur leurs cuisses, sur leurs jeans : c’est une participation à la fois individuelle et collective. (Anne Teresa De Keersmaeker)
Créer du collectif. Grâce au blues !
La chorégraphe dirige et fixe les élans, les précipite, les détourne aussi.
Irrépressibles pulsions vers l’après : trouver son lieu, trouver son âme.
Les bras prolongent les corps qui cherchent d’autres corps.
Et se trouvent quelquefois. Lien fugace, ineffable.
Des gestes de construction, en équilibre pour lutter contre le déséquilibre. Ensemble.
Ils sont jeunes, aiment la fête, en abusent quelquefois…
Les treize interprètes de Rosas – des grands, des petits, des peaux blanches ou noires, des hommes en jupes… – occupent tout le plateau : par ronde, par vague – fond/face, cour/jardin. Ils marchent, elles marchent.
Parfois Anne Teresa De Keersmaeker fige les postures : images gelées en photos souvenirs. Elle juxtapose les rythmes : des déplacements, des mouvements calés sur la musique et, en diffraction, certains courent, d’autres traînent, s’immobilisent.
Rien de classique, à peine trois porters, mais des jeux à terre, quelques acrobaties hip hop : trouver l’ancrage.
Une virtuosité contrapuntique. La houle humaine en intelligibilité. Il faudrait un troisième œil pour tout saisir, tout enregistrer…
Le tango est une pensée triste qui se danse disait Enrique Santos Discèpolo. Le blues de Meskerem Mees n’en est pas loin avec sa mélancolie, mais Anne Teresa De Keersmaeker sait briser cet envoûtement, planter des silences tendus, faire éclater des moments jubilatoires et enlevés, rendre complices ses anges.
Pour nous en sortir par le haut !
avec Abigail Aleksander, Jean Pierre Buré, Niklas Capel, Lav Crnčević, José Paulo dos Santos, Nathan Felix-Rivot, Carlos Garbin, Nina Godderis, Robson Ledesma, Meskerem Mees, Mariana Miranda, Ariadna Navarrete Valverde, Margarida Ramalhete
composition musicale Meskerem Mees, Jean-Marie Aerts, Carlos Garbin
paroles Meskerem Mees, Wannes Gyselinck
scénographie Michel François, lumière Max Adams, costumes Aouatif Boulaich
parfums d’enfance

Le Château des Carpathes
d’Émilie Capliez d’après Jules Verne
#THÉÂTRE
représentation du vendredi 28 février à la Comédie de Colmar
Dans la continuité de Little Nemo (2022), Émilie Capliez adapte Jules Verne avec l’envie de partager cet âge d’or du livre de jeunesse illustré (elle se réfère explicitement à l’édition Hetzel de 1892), d’autant plus qu’en s’appropriant les découvertes scientifiques, l’écrivain défriche le terrain au roman d’aventures, mais aussi policier, gothique, fantastique…
Respectant l’exigence pédagogique revendiquée par le Magasin d’éducation et de récréation où le roman a été publié en feuilleton, l’auteur contextualise précisément les lieux de l’action et, à la fin, fournit d’amples explications sur les inventions d’Orfanik l’âme damnée (et technique) du baron de Gortz.
La structure narrative du conte adoptée pour transposer le récit à la scène, s’en accommode et Fatou Malsert en narratrice s’en empare avec malice et énergie (elle incarne aussi une aubergiste pleine de bon sens).
Malgré tout le texte de la pièce aurait pu s’alléger encore plus : un siècle de cinéma s’est chargé d’établir la (mauvaise) réputation des Carpathes – et la première scène avec un plateau inondé de fumerolles l’expose très bien visuellement –, quant aux détails des technologies employées (nouvelles à l’époque), si le lecteur du livre peut s’en délecter, sur scène ils se dissolvent…
L’autre gageure de la transposition était d’offrir un espace aux nombreux lieux du roman : ceux du village, du château sans compter les maisons d’opéra des flash-back. La scénographie d’Alban Ho Van s’en acquitte avec fluidité : la plupart des éléments descendent des cintres et deux grands écrans verticaux mobiles racontent les montées au château. La Stilla se permet même un jeu sur l’avant/arrière du rideau d’avant-scène jouant la plasticité de l’espace.
Le nœud de l‘intrigue est la volonté concurrente du jeune comte de Télek et du baron de Gortz de s’approprier la Stilla une talentueuse cantatrice napolitaine, le premier par le mariage, le second par tous les moyens possibles… aussi ce dernier la traque de représentations en représentations – limite harcèlement –, à tel point que la jeune femme meurt en scène…
C’est là, avec la mise en musique par la compositrice de jazz Airelle Besson, que le spectacle est le plus réussi. Un trio – trompette (Oscar Viret), violoncelle (Adèle Viret) et piano (Julien Lallier) – accompagne les changements du décor, le passage du temps avec parfois des parfums de blues, de tango… À l’occasion, le trompettiste s’invite en confident, distillant sa plainte en écho aux tourments de l’un ou l’autre personnage. Emma Liégeois en Stilla s’affirme aussi chanteuse : en contraste à la rigoureuse netteté du piano, ses modulations expriment l’extatique déchirure de son être et fascinent autant les deux soupirants que le public du San Carlo.
Dans un autre registre, elle incarne une villageoise pleine d’allant.
D’une scène, d’un lieu à l’autre, les trois comédiens et les deux comédiennes endossent les nombreux rôles, rejoints au besoin par les trois musiciens.
Acteur expérimenté, Jean-Baptiste Verquin sait moduler son boitement selon qu’il joue le maire, le baron ou le colporteur. François Charron et Rayan Ouertani, membres de la jeune troupe, alternent vanité et couardise – propices à quelques traits d’humour – au gré des changements de costumes et de postiches.
Si la technologie qui s’amorce en 1892, est devenue invasive un siècle plus tard au point de remplacer progressivement l’humain, le conte tel que le monte Émilie Capliez ne s’ouvre pas vers ces abîmes… Mais toute la troupe prend visiblement plaisir à cette histoire qui se déplie comme un livre d’images.
lumière Kelig Le Bars
vidéo Pierre Martin Oriol
costumes Pauline Kieffer
extravagance & distinction

La Clef des songes
Chefs-d’œuvre surréalistes de la Collection Hersaint
#EXPOSITION
Riehen (Bâle), Fondation Beyeler du 6 février au 4 mai 2025
commissariat Raphaël Bouvier
catalogue bilingue allemand & français, 144 p., 58 CHF, 44 €
Parallèlement à l’exposition « Lumières du Nord », la Fondation ouvre ses cimaises à la Collection Hersaint avec une cinquantaine de tableaux.
Initiée dès 1921 avec Cage et oiseau (1920) de Max Ernst, Claude Hersaint (1904–1993) l’enrichit principalement d’œuvres liées au surréalisme. Proche d’Ernst et Hildy Beyeler, les choix du couple Hersaint divergent de ceux des galeristes bâlois, mais finalement le fond constitué par ces derniers les complète harmonieusement par amplification – Picasso, Miro – ou confrontation – Louise Bourgeois, Giacometti.
Après la sérénité fauve des forêts boréales canadiennes (Lumières du Nord, salle 9), il est possible d’accéder directement à la troisième salle de l’exposition. Le passage vers la sauvagerie du Picasso qui triture les physionomies (c’est après Les Demoiselles d’Avignon) paraîtra un peu rude. Mais seule La femme au chat (1937) est issue de la Collection, la Fondation complétant avec ses propres acquisitions. Ce portrait est celui de Paul Éluard déguisé en femme, une forme d’outrance ludique revendiquée par le Catalan.
Sinon les autres toiles accrochées – de Magritte à Dubuffet selon le parcours proposé – sont d’une grande délicatesse et s’accordent à l’exigence mentionnée par sa fille Évangéline : élégance et discrétion. Il est vrai que les œuvres s’invitaient en proximité quotidienne comme l’attestent les photos de leurs intérieurs, ce qui conditionnait forcément les choix.
Max Ernst est le plus représenté avec un panorama sur presque quarante ans de sa carrière (1920 à 1957) : L’Ange du foyer (Le Triomphe du surréalisme, 1937), d’une énergie sauvage mais finement élaboré – cf. les plumes comme les drapés – rejoignant l’exigeante précision du seul Dali présent (Le Jeu lugubre, 1929), les Noces chimiques (1948) plus mécaniques et articulées, ses jeux de formes et de couleurs (Une nuit d’amour, Loplop, Évangéline…) et surtout ses luxuriants et intrigants paysages dont les organiques et ascensionnelles proliférations rhizomateuses abritent dans leur ombre des yeux, des griffes, des créatures fantastiques [salle 4].
La ville entière (1936/37), pièce préférée du collectionneur est là. D’un avant-plan végétal touffu surgit une ville repliée derrière ses remparts : un îlot défiant et menacé…
Non loin, Le lion, ayant faim, se jette sur l’antilope (1898/1905, Fondation Beyeler) d’Henri Rousseau suggère le passage à l’acte…
Cet entre-aperçu latent et mystérieux – une vie sous la vie – est peut-être le fil conducteur des acquisitions.
D’ailleurs le collectionneur n’émerge que partiellement de l’ombre dans le portrait qu’en peint Balthus autre artiste très présent. La lascivité de ses trois nymphettes est interpellée par le trait nerveux, jaillissant d’Alberto Giacometti et l’aérienne chorégraphie de ses sculptures menant vers le prêt permanent des Hersaint à la Fondation : le monumental Passage du Commerce-Saint-André (1952–1954) dressé en majesté face aux baies nord et qui figurait dans l’exposition monographique de 2018.
La salle 8 rend hommage aux femmes très actives dans le mouvement surréaliste : trois Dorothea Tanning et son univers kafkaïen dont la Valse bleue (1954) et le Prométhée enchaîné (1953) par des barbelés de Toyen mis en regard avec deux pièces de Louise Bourgeois.
En tout 23 peintres sont exposés, notamment trois René Magritte dont La Clef des songes (1930) et autant de facétieuses compositions anthropomorphes de Victor Brauner.
Le fond Beyeler complète abondamment l’unique Joan Miró (Femme, 1934) ou Jean Dubuffet présent avec son délicat Personnage en ailes de papillons (1953) et L’homme de marbre (1955) dont le sourire enjoué clôture la présentation.
Banquier de profession, Claude Hersaint fréquentait volontiers les artistes, les galeries et les salons (celui de Marie-Laure et Charles de Noailles entre autres), mais restait à distance des coteries. Sa fille cite volontiers sa sentence : Quand les peintres se rencontrent, ils parlent d’Argent. Quand les banquiers se rencontrent, ils parlent de peinture.
Une lucidité qui serait le secret de sa distinction ?
Le catalogue est alphabétique (par peintres) et ne restitue que les pièces issues de la Collection Hersaint. Il inclut une interview par le commissaire d‘Évangéline Hersaint, fille des collectionneurs.
L’exposition est montée en étroite collaboration avec elle.
l’envers du décor

en retrait à droite l’Ange de l’Annonciation (école Hans Baldung Grien)
Verso Histoires d’envers
#EXPOSITION
Kunstmuseum Basel | Neubau du 1 février 2025 au 4 janvier 2026,
commissaire : Bodo Brinkmann
La directrice du Kunstmuseum Basel, Elena Filipovic a permis à Bodo Brinkmann, conservateur Maîtres anciens, XVe–XVIIIe siècle, de mener à bien un projet qui lui tenait à cœur depuis longtemps : faire découvrir la face cachée d’œuvres appartenant aux collections du musée. Dans trois salles du Neubau, il a chorégraphié un dispositif permettant d’admirer 36 pièces datées du XIVe au XVIIIe siècle sous toutes les coutures : recto et Verso.
Après cette dernière exposition, il élaborera encore avec Anita Haldemann la nouvelle présentation des collections d’art ancien du Hauptbau où certains agencements réalisés pour Verso pourront trouver leur place.
Un musée décontextualise les pièces qu’il présente et d’autant plus quand elles sont anciennes induisant quelquefois une vue parcellaire. La partie occultée peut cependant avoir un rôle significatif dans l’usage de l’objet, éclairer son histoire ou celle du sujet portraituré…
Dans ce jeu d’avers et de revers, les retables dont les séquences de voilement dévoilement rythmaient le calendrier liturgique sont les plus spectaculaires. Peindre les deux faces des panneaux latéraux était nécessaire pour préserver la qualité de la dévotion et la faire vivre en fonction des circonstances : valoriser des saints particuliers, mettre en scène des sculptures dans un ensemble signifiant et aussi permettre aux donateurs de figurer par leur image dans l’espace sacré.
Quand un panneau est périphérique, la vénération veille à l’anoblir : un fond souvent incarnat avec des initiales (IM pour Iesus Maria, MRA pour Maria) ou un motif imitant la pierre, matériau noble utilisé pour les autels, ou le brocart.
La présence d’armoiries ou d’un monogramme permet d’identifier le propriétaire du tableau ou le sujet du recto dans le cas d’un portrait.
Des appropriations plus tardives s’opèrent aussi. Suite à un changement d’usage, l’autre face est peinte (volets d’un orgue) ou alors quelques décennies plus tard un artiste réutilise comme support une ancienne plaque de cuivre gravée tel Pieter Snyers pour sa délicate Nature morte avec des tiges de primevères et des légumes (1752) : l’ancien verso devient le recto…
Des inscriptions sont quelquefois ajoutées postérieurement, en général pour préserver un historique… ou ce cas interpellant : le revers du portrait en gentilhomme de Johann von Brügge (vers 1544). Trois ans après sa mort en 1556, les autorités bâloises découvrent que sous ce faux nom prospérait David Joris recherché comme hérétique et chef de secte anabaptiste. Condamné à titre posthume comme « archi-hérétique », sa dépouille est exhumée, brûlée avec ses écrits et un placard est apposé au dos de son effigie avec la sentence en latin et en allemand.
Parfois le revers s’efforce d’imposer une image édifiante : une prostituée aguichée par un squelette (une métaphore des maladies vénériennes) traitée presque en miroir au verso de l’effusion érotique de Bethsabée au bain (Niklaus Manuel dit Deutsch, 1517)……
Enfin, de par son statut, l’enseigne est traitée sur les deux faces, mais celle des frères Holbein relève sans doute d’un hommage à leur professeur, Oswald Geisshüsler, dit Myconius, lorsqu’il quitte Bâle en 1516.
Cet accrochage bâlois montre de la très belle peinture et permet de découvrir autrement Baldung Grien, Cranach, Holbein, Snyers, Stimmer, Witz… pour ne citer que les plus connus.
Le dispositif est un doux labyrinthe où le regard croise celui des visages peints et participe à ces échanges d’une toile à l’autre où les personnages observent la scène voisine, où les animaux sont souriants, les tissus voluptueux, les chevelures ciselées de reflets dorés, où les expressions sont chargées d’empathie et portées par cette ineffable chorégraphie des mains vecteurs d’une sérénité qui plonge le visiteur dans une paix presque surnaturelle (Siri Hustvedt).
Et puis ces versos rendent perceptible l’émouvant passage du temps – un sourire surgissant d’un vêtement écaillé, un corps tronqué par une reprise, l’évanescente empreinte d’une scène presque fondue dans le support –, d’autant plus que cette fragilité de la trace est affrontée à l’éclat triomphant du recto avec le bleu, le vermillon des costumes et le rose onctueux des chairs !
rendre dicible

1972
de Fred Cacheux, Nils Öhlund
#THÉÂTRE
représentation du vendredi 31 janvier à l’Espace 110 (Illzach)
Dans le programme, la présentation de la pièce évoque le rapport Meadows, l’âge des comédiens, les problèmes liés au climat (Un écran soutient les démonstrations…) laissant imaginer une production sérieuse voire aride.
Le spectacle est tout l’inverse (le rapport ne sera évoqué qu’au bout d’une heure) et s’il part dans tous les sens, c’est pour nous interpeller certes, mais aussi rire, rire de nous-mêmes (et plutôt beaucoup) et toujours revenir à Nous, Nous tous acteurs de 1972 et de notre destin commun.
un grand écran vertical à jardin
un compte à rebours
une chaise bistrot déplacée
abandonnée déplacée à nouveau
Francis (tout le monde s’appelle Francis)
Francis monte descend du plateau
remonte rejoint la coulisse
revient dubitatif
du temps de flottement
une mise en place brouillonne
volontairement
la salle reste allumée
dans le silence
hésitations encore
Francis se dédouble
même sweat outremer
même jeans rouille
même moustache
Ils se parlent
en anglais
se négocient la chaise
symbole de notre terre limitée ?
glissent vers le franglais
le chaos linguistique de Babel ?
la langue de bois s’intensifie
avec la bascule vers le français
et puis la conscience
peut-on profiter du fruit de son crime ?
Francis rameute Caïn
et surtout Claudius (Hamlet)
il lance sa tirade du IIe acte (scène 5)
leurs propres souvenirs remontent
et les Francis s’emballent
s’envolent sur l’ivresse des possibles
consuméristes !
Très vite les Francis (Fred Cacheux, Nils Öhlund) impliquent le public, l’embarquent sur le plateau, se jouent des codes de la re/présentation, installent une tension entre la salle vidée et la scène où stabule maintenant le public : ils instaurent un débat mouvant.
Ils l’interpellent depuis la salle
avec d’autres questionnements
aiguisés de quelques sentences
nous ne savons pas maîtriser le présent
nous manque le sens de l’orientation
la croyance passe pour de la connaissance …
Le rapport Meadows s’invite tard.
C’est une douche froide en pleine euphorie consumériste adossée à une frénétique exploitation des ressources.
Les jeunes ingénieurs du MIT ont brassé beaucoup de papier (il n’y avait pas encore d’informatique). Ils étaient prêts à s’engager comme beaucoup de jeunes aujourd’hui.
Mais ailleurs…
chacun veut la plus grosse part du gâteau (ce qu’il en reste) !
D’autres statistiques, d’autres discours le balayent sous le tapis :
le vent des mots, des mots sales le plus souvent
et de modestes sparadraps sur l’hémorragie …
Jusqu’à présent, rien n’indique qu’ils se soient trompés.
Et s’il n’était pas trop tard ?
Les Francis font le rapprochement avec la fresque d’Ambrogio Lorenzetti au Palazzo Pubblico de Sienne : Allégorie et effets du Bon et du Mauvais Gouvernement.
Ils suggèrent l’atavisme du comportement collectivement mortifère (cf. les cinq besoins fondamentaux) …
Les deux Francis nous offrent pendant 90 min, un bouillonnement partagé avec feu et conviction, un pas de deux original qui réussit l’implication du public (si souvent ratée), une stimulante prise en main de l’objet théâtre qu’ils « révolutionnent » (au sens littéral : mettre à l’envers) avec l’envie et l’espoir de pareillement et joyeusement « révolutionner » le système par le bas (du coup le remettre à l’endroit !). Ils expérimentent ce tissage du lien personnel et individuel à l’Autre générant du Nous ensemble sans lequel rien n’est possible.
Et ils le prolongent en dehors de la salle avant, après par des rencontres, des animations…
En 2025, on sait encore plus qu’en 1972…
pourtant plane la résurgence phénoménalement délirante d’un monde où le « tout est monnayable » se réarme en dogme absolu !
Une mise en spectacle médiatique des prolégomènes de l’apocalypse ?
Les deux Francis et Nous, autres Francis, voulons croire que non…
mise en scène & jeu Fred Cacheux, Nils Öhlund
création et régie technique Pierre Mallaisé
production Facteurs Communs
commentaire Fred C du 9 février 2025 à 18:41
Un très grand merci pour ce texte à propos de 1972. Notre objet est de rendre dicible. L’expression dont vous faites le titre d’un article démultiplie le geste. Rendre dicible au carré. Et vous donnez sens et juste mesure à notre proposition. De Francis à Francis, salut !
l’art et la matière
Ressources humaines
Michel Cornu & Robert Schad
#EXPOSITION
Strasbourg, Galerie Radial Art Contemporain du 7 février au 22 mars 2025
Avec comme titre un joli pied de nez au langage technocratique, deux artistes dont l’engagement physique pour créer leurs œuvres est impressionnant, partagent une exposition à la Galerie Radial à Strasbourg du 7 février au 22 mars.
Michel Cornu comme Robert Schad ont préparé des pièces expressément pour l’occasion et art karlsruhe qui se tiendra fin février. Le galeriste qui leur a fait confiance, Frédéric Croizer découvrira leurs créations lors de l’accrochage 🙂
Le travail de Michel Cornu ressemblera certainement à ce qu’il pratique depuis quelques temps déjà : des abstractions vibrantes, souvent des grands formats, sur papier.
Gravures sur cuivre et sur bois, encres sur papier Japon et grands dessins
travaillés dans la profondeur de la matière
posée imposée déposée surexposée…
comme un sous-bois saisi lors d’une fulgurante éclaircie
où seul un intense travail d’approche permet d’en exprimer le mystère
ou d’accéder à d’astronomiques confins ?
J’avais évoqué son travail lors d’une précédente exposition à la galerie Murmure (automne 2023) et j’ai eu la chance de le filmer en énergie durant l’été 2021 dans son atelier et celui de l’ami taille-doucier Rémy Bucciali.
Robert Schad débite et soude l’acier : des modules industriels standards (tubes et poutrelles de différentes sections).
Il avait exposé son travail dans une dizaine de sites patrimoniaux en Bourgogne, le parcours de sculptures Dix par Dix d’octobre 2021 à septembre 2023 : des envolements dont l’aérienne chorégraphie défie la pesanteur du matériau et fait oublier la lourde logistique industrielle nécessaire à leur fabrication.
D’altières horographies semblant effilées par le souffle du vent
dressant fièrement leur arachnéenne fragilité face aux tourmentes !
Je l’ai filmé fin 2022 lors d’une résidence de gravure chez Rémy Bucciali : un exercice plus léger, fruit également de l’agencement ludique de modules identiques. L’atelier s’est ensuite chargé de préparer, mordre puis imprimer les plaques.
quand le paysage sculpte la peinture

Nordlicher
von Edvard Munch bis Hilma af Klint
#EXPOSITION
Riehen (Bâle), Fondation Beyeler du 26 janvier au 25 mai 2025
commissariat : Ulf Küster, assisté d’Helga Christoffersen
beau catalogue en anglais ou en allemand, 240 p., 62,50 CHF, 58 €
« Lumières du Nord » est le 6e opus d’une programmation consacrée au paysage initiée avec Monet en 2002. L’exposition en présente 74 peints au-delà du 60e parallèle nord par treize artistes de 1888 à 1937. Huit Scandinaves, quatre Canadiens et un Russe (le contexte géopolitique actuel justifie en partie ce dernier choix).
L’exposition est coréalisée avec le Buffalo AKG Art Museum (Buffalo, New York) qui l’accueillera du 1er août 2025 au 12 janvier 2026.
Le catalogue inclut un cahier de photos : un réel mythifié par le noir et blanc, émouvant écho aux vues des peintres alternant un fantomatique cérusé et l’exaltation fauviste. Anna Boberg y figure en pied avec son équipement pour peindre sur le motif dans ces conditions polaires !
Regroupée par peintres, la présentation dresse une arche chronologiquement cohérente qui va des Scandinaves avec en point d’orgue le plus connu Edvard Munch [salle 6] pour s’achever par les Canadiens. Les premiers (six sur les huit) ont séjourné à Paris, Berlin, Munich… et côtoyé les œuvres et les acteurs de leurs foisonnants courants artistiques. De retour au pays, ils ambitionnent de développer un art singulier, quelquefois préoccupés par l’identité nationale fortement présente à l’époque (séparation des royaumes de Suède et de Norvège en 1905, indépendance de la Finlande en 1917…).
Un âge d’or s’ouvre, il aboutira à la grande exposition « Contemporary Scandinavian Art » à Buffalo (USA) en 1913. Leurs toiles inspireront leurs collègues canadiens qui la visitent et dont l’environnement (principalement l’Ontario) a des caractéristiques voisines conduisant à la création en 1920 du Groupe des Sept (The Group of Seven).
Constituée majoritairement de conifères, la forêt boréale (aussi connu sous le nom de toundra ou taïga) est parcourue par un vaste réseau lacustre.
Le grand fusain d’Ivan Chichkine (Wind Fallen Trees, 1888) dévoile le chaos de cette forêt primaire, la plus grande de la planète, et s’immisce dans sa mystérieuse profondeur.
Ses collègues privilégient des futaies moins denses et leurs arbres cisaillent la toile d’une cinglante présence suscitant la vibration de l’air pur mais glacial. Les troncs souvent à contre-jour comme les barreaux d’une cage – avec parfois l’inquiétante gesticulation des branches évoquant Caspar David Friedrich – aiguisent l’irruption saisissante ou discrètement mordorée de la lumière anoblissant le territoire en épiphanie. Les habitants sont rares sinon à l’état de trace : une échelle, la lumière à une fenêtre, des pas dans la neige…
Akseli Gallen-Kallela s’attarde sur la profondeur du temps : ces couches de neige accumulées (The Lair of the Lynx (Lokulan), 1908). Par le blanc, il suggère la fusion entre l’air et l’eau – neige ou glace –, la verticalité terre ciel avec des arbres qui sortent du cadre en haut comme en bas. Il métamorphose sa cascade en matière symphonique dont le motif, l’explosion liquide, affronte la luxuriante polyphonie des roches ; le cadre Jugendstil et les quatre cordes dorées attendrissent la rudesse du paysage et le froid que projettent les éclaboussures (Mäntykoski Waterfall, 1892-94). Ses vues aériennes sont plus apaisées et souvent ivres de soleil (Lanscape by Ruovesi, 1898).
Comme la Vue depuis Pyynikki Ridge (1900) d’Helmi Biese dont le geste sait transmettre les fougueuses tourmentes à la pâte picturale quand le blizzard se lève : une violence aussi intense qu’obstinée qui accable branches et roches (Coastal Landscape, 1904).
Les influences sont sensibles.
Le pointillisme donne une densité obsédante aux tempêtes de neige d’Anna Boberg qui étouffent l’horizon en contraste avec l’avant-plan liquide traité en larges lignes horizontales (Mountains. Study from North Norway). Quand l’été met à nu le territoire, elle burine en une composition quasi abstraite la gigantesque broyeuse de roches et de glace où l’homme n’a pas sa place (Glacial Lake). Elle s’autorise aussi le spectaculaire des aurores boréales (deux toiles avec une troisième du Canadien Tom Thomson).
Harald Sohlberg accroche la lumière avec un élément toujours mis à distance : maison, horizon au crépuscule, cimes enneigées… Elle apparaît comme une conquête sur la nuit boréale et quelquefois s’immisce rasante jusqu’à l’avant-plan.
Alors qu’Hilma af Klint dont Sunrise (1907) évoque Turner, en saisit la lointaine et ténébreuse incandescence (Serenity of the Evening, 1907).
Chez Gustaf Fjæstad, le pointillisme sculpte la luminosité des amas de neige, il sacrifie les cimes au détriment des étendues gelées : le peintre comme le promeneur regarde où il met les pieds ! Sans négliger la poésie des rides liquides suscitées par la caresse du vent (Winter Evening by a River, 1907).
Prince Eugen (qui appartient à la famille régnante suédoise) montre un pays plus luxuriant, presque hédoniste. Il en capte cependant la dimension transcendantale avec ses arbres qui sortent du cadre, ses vues d’oiseaux plantant l’ampleur du territoire (Orlängen Lake, Balingsta, 1891).
L’humanité industrieuse, condamnée au ralenti en hiver, brutale en été, hante les toiles d’Edvard Munch : ces saignées de bûcherons avec les arbres abattus rendues par de larges aplats rageux aux couleurs sourdes (The Yellow Log, 1912). Ailleurs ses enfants semblent en admiration touristique… (Children in the Forest, 1901-02)
En Colombie-Britannique, Emily Carr privilégie la perception glacée d’un environnement rude, sombre, peu accueillant (In the Forest, 1935). Elle le malmène de frissons, de distorsions ou amplifie la tension abstraite : le jeu ambigu entre le couvert et le découvert installe un espace en occlusion malgré la vivacité du chromatisme et l’énergie du mouvement (Abstract Tree Forms, 1931-32).
Lawren S. Harris est plus enjoué et délivre la quintessence du paysage mis en spectacle, surrection contre nuées, affrontement terre lumière : les images du « chaosmos* » mis en compréhension par l’articulation des volumes (Lac Superior, 1923). Certains rapprochent son travail du Danois Munch, mais il est plus acéré dans le jeu des ombres et du soleil sur les matières (Beaver Pond, 1921). Dans ses petits formats, il infuse une patte et une chaleur fauviste à ces confins arctiques (Montreal River, 1920 ou Mitchell Lake, 1918-21).
Il partage cette flamboyante netteté avec J. E. H. MacDonald – plus nerveux et plus attentif à l’échelonnement des plans (A Lakeshore, Algoma, 1921) – et Tom Thomson dont la flamboyante ivresse est réprimée par les silhouettes spectrales des arbres (Fire-Swept Hills, 1915).
Les tons sont séduisants, certains proches de la marqueterie (Tom Thomson : Tamaracks, 1915) et, en dépit de leur petite taille (21,5 x 26,5 cm en général), leurs toiles déploient une exubérance non dénuée de mysticisme. Elles sont présentées à fleur du bois dans les colonnes en planches cérusées dressées dans la dernière salle [9] : une scénographie épurant cet univers arctique, métaphore fantomatique des vers de Baudelaire (Correspondances).
La Nature est un temple où de vivants piliers
Laissent parfois sortir de confuses paroles ;
[…]
Vaste comme la nuit et comme la clarté,
Les parfums, les couleurs et les sons se répondent.
* selon le mot d’Asger Jorn (1953)
Boreal Dreams
Quelques peintures le montrent (Munch) et déjà en 1930, Emily Carr se plaint du déboisement radical pratiqué par l’industrie forestière. Mais toutes ces œuvres préservent le souvenir de sites iridescents et envoûtants dont la magnificence est perceptible même quand le froid les sédimente. Peut-être est-ce un des destins du musée : préserver les images (les traces, les artefacts ?) d’une nature épargnée par les activités humaines, celle d’avant les catastrophes…
Boreal Dreams de Jakob Kudsk Steensen commandé par la Fondation pour cette exposition s’empare de cette problématique et tente de visualiser l’impact du réchauffement climatique sur les forêts boréales : une vidéo visible depuis les baies sud sur un grand écran LED (avec le son en libre accès wifi par QRC).
La bonne volonté est indiscutable et les images séduisantes (assez répétitives cependant), mais l’ambition n’est compréhensible qu’à la lecture du livret de visite (gratuit). Et pour prendre pleinement la mesure du projet, il est nécessaire de se plonger dans le catalogue ou d’aller sur le site web…
Installée dans le parc (côté entrée du musée), la projection est librement accessible aux heures d’ouverture de la Fondation.
regard sur le regard

Robert Cahen De la trame au drame
de Jean-Paul Fargier
#LIVRE
chez Médiapop Éditions, janvier 2025, (175 p., 17 €)
Critique depuis 1968 aussi bien aux Cahiers du cinéma ou Art Press qu’au Monde ou à Libération, l’auteur Jean-Paul Fargier, particulièrement attentif au cinéma militant et expérimental, a souvent écrit sur le travail de Robert Cahen.
S’il avait déjà réuni ses chroniques et ses réflexions sur d’autres pionniers de la vidéo notamment Nam June Paik (1989), Bill Viola (2014), il ne l’avait pas fait pour le vidéaste mulhousien et il tenait à compléter son travail d’historien. C’est chose faite avec ce « journal de voyage » allant de 1973 (L’invitation au voyage) à 2023 (Arabia Felix).
L’auteur fait le choix de conserver ses textes tels quels – et quelques coups de griffe égratignent ici ou là –, cependant il a revisionné tous les films et rédigé à chaque fois une introduction qui contextualise la chronique (ou l’interview) et quelquefois la nuance. Cette démarche d’une grande sincérité préserve la fraîcheur et la saveur d’une autre époque : une ère bien plus liée au matériel (hardware) avec souvent la description des drôles de machines (les « joujous ») et aussi le plaisir de la découverte ou l’étonnement devant certaines réalisations.
Le récit de ces (presque) origines est émouvant – on parlait de bandes – et fait vivre ce milieu dont les membres finalement peu nombreux se croisent, collaborent, se perdent de vue puis se retrouvent notamment lors de festivals où d’autres perspectives s’inventent quelquefois. Comme Robert, une partie vient de la musique, entre autres Nam June Paik (1932–2006) considéré comme l’inventeur de l’art vidéo (à Wuppertal en 1963 « au sein du mouvement Fluxus »).
Les œuvres (mais toutes n’y figurent pas) servent un fil conducteur chronologique où par petites touches d’hier ou d’aujourd’hui, il révèle un artiste appartenant à une génération qui savait prendre le temps et pour laquelle l’exigence avait un sens. À plusieurs reprises, il le qualifie de Maître ès ralentis (ils ne sont jamais gratuits, il insiste à chaque fois) qui recourt aux effets pour trouver « la forme fine qui sied à son sujet ». Le parfum de nouveauté est d’autant plus éloquent qu’il remet l’histoire dans l’ordre : ces dernières années, les logiciels (software) ont pris la main et assurent facilement et spectaculairement des effets comparables voire plus complexes qu’à cette époque de défricheurs.
Visiblement il a une tendresse particulière pour les pièces où le cinéaste s’assure au son de la complicité de grands anciens (Bach pour Sanaa) ou contemporains : Messiaen (Dernier Adieu), Boulez (Répons & Le Maître du Temps) ou Michel Chion, son ami depuis le GRM*.
En cinquante ans de carrière, Robert Cahen a beaucoup voyagé avec sa caméra, sur les cinq continents, mais aussi dans les genres, souvent en proximité d’autres artistes (danseurs, musiciens…) et il serait dommage de le réduire à ses ralentis. Certes ils permettent de diffracter le temps, de faire palpiter les « Flux et reflux du monde », mais, tentant de « découvrir du sens derrière du caché », il cultive ce goût pour le regard caméra, qui se métamorphose en beau regard public (normalement proscrit par le cinéma officiel), celui des rencontres furtives avec les « Fantômes d’une existence entr’aperçue. Embryons de fiction restée en devenir. » Il imprime dans nos regards ce « figuratif défiguré », ce temps qui dure longtemps – une aspiration à (re)trouver l’éternité ? –, mais aussi s’effiloche en destin furtif, non résolu (encore une transgression des règles de la fiction dominante) comme finalement la vie… avant sa chute imperceptible dans l’absence.
En cours d’ouvrage, Jean-Paul Fargier s’interroge : Où va la vidéo ? Dans tous les sens. Mais lequel est le bon ? Avec ce livre d’amitié, il montre que Robert Cahen ouvre un chemin : exigeant et attentif au souffle du monde !
Si la lecture du livre donne envie de (re)voir les films de l’artiste, Entrevoir, un DVD édité chez RE-VOIR regroupe 14 vidéos de 1973 à 2021.
* Groupe de Recherches Musicales au sein de l’ORTF, puis de l’INA
être improbable

Polywere
de Catherine Monin
#THÉÂTRE
représentation du samedi 18 janvier à l’Espace 110 (Illzach)
L’Espace 110 entame l’année 2025 avec une réflexion sur « Nos empreintes terrestres », proposition ô combien nécessaire (et prémonitoire ?).
En début de cycle, le spectacle Polywere met à jour un premier artefact. Suivront deux week-ends d’ateliers ponctués par Des larmes d’eau douces et 1972 (respectivement les 24 et 31 janvier).
Issu de la nuit à laquelle il retournera, Hugues De La Salle incarne un Emmanuel, grand échalas adolescent, fort convaincant. Il nous raconte d’abord ce souvenir d’enfance, ce traumatisme de chasse qui fait basculer son destin. Si au début, le gamin est plutôt enthousiaste par cette complicité sauvage avec les adultes (mâles !), le sang, la mort, l’objet cadavre amènent la prise en conscience de ces êtres qui sont tués, se mangent entre eux et surtout la nature du plus vorace de tous : l’homme. Ce bouleversement suscite une empathie si fascinée et intense avec les victimes qu’il se glisse dans leur peau – de la thérianthropie comme l’explique la psychiatre (Cécile Arthus) à ses parents (Stéphanie Schwartzbrod & Philippe Lardaud). Ceux-ci complètent le fil narratif de cette métamorphose qui contrarie leur envie de normalité, livrant finalement leur fils à la psychiatrie seule habilitée à circonscrire le périmètre de l’irrationnel.
S’évadant de l’hôpital pour échapper autant à l’enfermement matériel qu’à la camisole chimique destinée à l’intégrer, Emmanuel se réfugie en forêt et rencontre ses « congénères ».
Le dispositif scénique, épuré et envoûtant, accompagne cette quête initiatique : un cylindre piédestal (au début) dont la géométrie se fragmente en éléments praticables, des fumées rasantes évoquant l’humus palpitant des sous-bois, des halos suggérant ces saignées de soleil entre les frondaisons, de sveltes fûts en contrejour zébrant le fond…
Le texte de Catherine Monin sait trouver le rythme haletant (toujours bien tenu par le comédien), la matière vocale de cette créature transmuée, mais aussi glisser quelques formules pertinentes et inventer de belles métaphores poétiques.
Sans naïveté, Polywere institue une parenthèse à notre condition aliénée avec l’hédonisme d’un Waldweben (mais sans le triomphalisme wagnérien) grâce à ses mots, ses images et nous permet d’accéder au bruissement de cette autre nuit… une ouverture plus qu’un destin : J’arrive pas à suivre les flèches alors qu’il n’y a pas de sens…
avec Hugues De La Salle, Stéphanie Schwartzbrod, Philippe Lardaud, Cécile Arthus
texte Catherine Monin
mise en scène Cécile Arthus
scénographie Laurence Villerot
lumières Maëlle Payonne
sons Antoine Reibre
production et contact compagnie Oblique
en quête du paradis perdu

Goliath, Germaine et moi
de Gwladys Morinière (2024)
#CINÉMA
documentaire tourné entre 2005 & 2023, sorti en salle en octobre 2024 (France, 90 min)
=> dates des projections en présence de la réalisatrice
Après une vie de commerçante prospère et le décès de son mari, Germaine entame une retraite engagée et militante. La réalisatrice la rencontre lors d’une « Caravane pour la Palestine » en 2005 et la filme pour la première fois : elle a 76 ans.
Elle la retrouve quelques années plus tard dans les manifestations contre le Grand Contournement Ouest de Strasbourg et décide de nouer leur amitié en lui consacrant un documentaire. Hasard de l’Histoire, les Gilets Jaunes, une pandémie et le confinement s’invitent comme nouveaux terreaux de luttes. De répression et de doutes aussi…
Des images édéniques ouvrent le film : un faon s’invite au pique-nique de la famille. Germaine le biberonne, ses enfants le caressent. La patine du Super 8 renforce l’aspect bucolique de Kœnigshoffen, ce quartier de Strasbourg verdoyant dans les années-cinquante aujourd’hui bétonné.
Entretemps elle s’est retirée plus loin, à Kolbsheim. Là aussi la forêt voisine doit être rasée au profit du GCO : un serpent de mer vieux de plus de trente ans qui se concrétise en pleine crise climatique. Les opposants regroupés en collectif organisent la résistance et multiplient les recours. Germaine participe aux manifestations sur place, à Strasbourg, aux célébrations festives et cultuelles (enterrement symbolique d’un arbre), aux réunions, aux rassemblements devant le tribunal… et à la dénonciation des services de l’État en délicatesse avec le droit et l’exemplarité.
Le 10 septembre 2018, pour ouvrir la voie aux tronçonneuses et aux bulldozers de Vinci, la police intervient. La nonagénaire est gazée sans ménagement tout comme les élus (les députés José Bové & Martine Wonner, le maire de Kolbsheim Dany Karcher). Des photos en stock-shot montrent l’intervention et en atténuent la brutalité…
Avec le mouvement des Gilets Jaunes, puis l’opposition aux contraintes liées à la pandémie, une agrégation des manifestations s’opère à défaut d’une convergence des luttes.
Germaine est omniprésente, s’incarne en passionaria entourée avec respect et enthousiasme. Son verbe est haut, sa cour est pressante et admirative. Elle est une figure fédératrice, un personnage inspirant plutôt qu’un tribun. Cependant face à la maréchaussée surarmée, elle dénonce « les requins de la finance » comme la « destruction de notre belle nature ». En face les expressions sont gênées : l’âge de l’égérie sans doute, peut-être aussi de sentir qu’ils sont le bras armé d’une société fatiguée et fracturée qui tente de préserver ses lambeaux en imposant un « Absurdistan autoritaire » (Die Zeit, 12.11.2020).
Assise dans son séjour, l’œil malicieux, elle montre et lit les slogans griffonnés sur les enveloppes de ses courriers, commente la politique, le népotisme, le « théâtre » du pouvoir, invoque la profondeur dans le temps des luttes : les petits commerces de sa jeunesse sinistrés par une administration tatillonne et favorable aux supermarchés. Elle accueille aussi des réunions et plaisante sur les risques judiciaires !
En écho, des animations – blanc sur fond noir – rythment le film et la voix de la réalisatrice suggère les enjeux, articule le passage du temps et des luttes. Le personnage métaphorique de Goliath lui permet d’installer une entité qui incarne aussi bien Vinci qu’un système protéiforme qui profite des working poor, des mesures sanitaires et parvient à prolonger ce temps de tous les possibles (à son bénéfice) grâce à la puissance publique.
Le glissement de la septuagénaire rayonnante de vitalité dansant avec les Gazaouies en 2005 vers la vieille dame recroquevillée dans un fauteuil roulant poussé par son amie Malika illustre la marche du destin et esquisse une métaphore.
Le corps comme le militantisme atteignent leurs limites…
Vers la fin, la réalisatrice se filme jardinant dans sa ferme vosgienne acquise depuis peu : sans doute qu’elle aussi pourra recueillir un faon égaré, mais Le cri de détresse d’un seul gouverné ne vient pas à bout du tambour (Ahmadou Kourouma / En attendant le vote des bêtes sauvages, 1998).
images, son Gwladys Morinière, Laurent Marboeuf, Hervé Roesch
montage Gwladys Morinière, Agata Bielecka, Andrea Pica
production & diffusion (avec les dates de projection) L’Humaine prod
contact lhumaineprod@yahoo.com