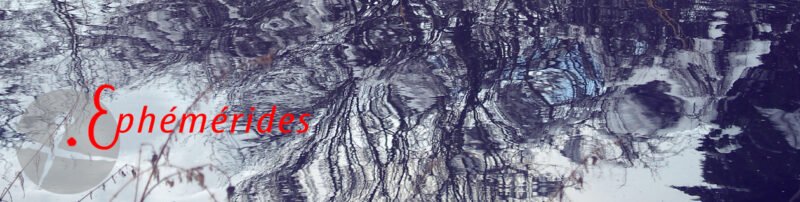un regard et des choix – forcément subjectifs – sur l’offre culturelle 2025…
#LIVRES : La mémoire des murs (F. Saur/L. Maechel), L’imaginaire artistique d’un Musée Zoologique (P. Ardenne, D. Payot, G. Rœsz, L. Maechel), Robert Cahen De la trame au drame (J.-P. Fargier)
#CINÉMA : Goliath, Germaine et moi (G. Morinière)
#EXPOSITIONS :
| Fondation Beyeler (Riehen/Bâle) : Vija Celmins / La Clef des songes / Lumières du Nord
| Kunstmuseum Basel | Neubau : Medardo Rosso L’invention de la sculpture moderne / Verso
| anonymous-famous, C. Hohler & R.E. Waydelich (Fondation Fernet-Branca, Saint-Louis), Véronique Arnold à Art | Basel, Le monde du vivant – 2de Biennale d’art contemporain (Bischwiller), Garden–Party (Musée Würth, Erstein), Mémoires Croisées – R.E. Waydelich (Espace d’Art PASO, Drusenheim), Un passé incontournable (Galerie Heitz, palais Rohan, Strasbourg), Ressources humaines (Galerie Radial, Strasbourg)
#SPECTACLES VIVANTS :
Brundibár (H. Krása/S. Abello, J. Candel), Makbeth (Shakespeare/Munstrum Théâtre), On ne choisit pas ses fantômes (M. Moritz), Jérémy Fisher (M. Rouabhi/T. Ress), Le Misanthrope (Molière/S. Delétang), Phèdre (Racine/A-L Liégeois), Naharin’s Virus (O. Naharin, The Batsheva Ensemble), Planètes (J. Brabant), Robot, l’amour éternel (K. Ito), EXIT ABOVE d’après la tempête (A.T. De Keersmaeker, Rosas), Le Château des Carpathes (J. Verne/E. Capliez), 1972 (F. Cacheux, N. Öhlund), Polywere (C. Monin, C. Arthus)
@SAISONS 2024-25 : Sweeney Todd (OnR/ Filature 5 & 6.07)
@SAISONS 2025-26 : Opéra national du Rhin • La Filature (Mulhouse) • Espace 110 (Illzach) • Comédie de Colmar
@avant-papier sur présentation de presse et documents remis
Sur la page d’accueil, des informations actualisées sur les évènements encore accessibles.
εphεmεrides 2024 • 2023 • 2022 • 2021 • 2020 • 2019 • 2018 • avant
Qui n’est pas assoiffé d’art est proche de sa dégénérescence.
Egon Schiele
l’éloquence du silence

#EXPOSITION
Riehen (Bâle), Fondation Beyeler du 15 juin au 20 septembre 2025
commissariat Theodora Vischer et James Lingwood
catalogue en anglais ou en allemand, 208 p., 62,50 CHF, 58 €
tous les jours de 10h à 18h, jusqu’à 20h le mercredi
Avec Vija Celmins, et après Wayne Thiebaud en 2023, la Fondation Beyeler nous offre une autre belle découverte venue d’outre-Atlantique. Une ample rétrospective pleine de douceur et de sérénité !
Née à Riga en 1938, elle suit ses parents qui fuient l’avancée russe et migrent vers les États Unis en 1948 où la jeune femme fait ses études d’art. Indianapolis, Los Angeles, le Nouveau-Mexique, New York puis Long Island où elle vit et travaille encore aujourd’hui. Près de l’océan !
Durant sa carrière, elle n’a réalisé qu’environ 220 peintures, dessins et sculptures. L’exposition n’en réunit pas moins de 90 allant des années soixante à 2024 et a été organisée en étroite collaboration avec l’artiste.
des objets quotidiens
d’abord
deux lampes (Lamp. #1, 1964)
comme les yeux du fond braqués sur l’observateur
une plaque de cuisson (Hot Plate, 1964)
sa fiche et son fil tendus comme un manche vers la main du spectateur
le feu sourd d’un calorifère tenu à distance par la grille (Heater, 1964)
pas de flamme mais une couleur dense surgi du fond
d’un enfer épais situé bien au-delà de la toile
et sans la pliure entre l’horizontale du sol et la verticale de la paroi
en abstraction
le prosaïque n’intéresse pas Vija Celmins
elle fuit le trivial, l’engouement pour le sériel
cet univers matérialiste et proliférant que font claquer Warhol, Lichtenstein et tant d’autres
hyperréaliste ?
quand elle peint une lettre, elle falsifie les timbres (Letter, 1968)
et le plus souvent elle peint l’impossible
des bombardiers en plein vol
un champignon atomique
un incendie
le sol lunaire
un mouvant, un inaccessible dont la photo peut saisir l’instantané
pas la peinture de chevalet
entre distance et intimité, quelque part mon œuvre ment *
pourtant elle gèle pour l’éternité ces dynamiques phénoménales
et si elle travaille d’après photographies
la matérialité de la toile reste vibrante
comme les couches, nombreuses
et les passages au flou pour sortir du motif, accéder au blanc du support
progressivement les artefacts disparaissent
l’humain ne compte pas / plus
ou si elle le peint, il brûle : Burning Man (1968)
et ses machines sont des engins de mort
l’écume de sa microscopique mise en spectacle
or Vija Celmins traque l’essentiel
et l’homme dans la Création compte pour si peu
elle peint ses premiers ciels dès la fin des années soixante
des nuages
et aussi la houleuse surface de l’océan
suivront les confins galactiques
des sols enneigés
des toiles d’araignées
la surface de coquillages
la résille craquelée de céramiques
et récemment ces aériennes chorégraphies de flocons de neige
son hyperréalisme n’est qu’un (ardent) prétexte
il ordonnance la possibilité de l’espace dans les deux dimensions du support
le traitement du sujet articule le rapport au sujet du spectateur
le minutieux rendu mobilise son regard et l’emmène ailleurs
vers une abstraction spatiale
et une olympienne éternité
en général la peinture organise la profondeur en plans successifs, échelonnés de l’avant-plan vers l’horizon
une illusion élaborée souvent avec gourmandise
Vija Celmins commence en amont
elle installe l’accrétion (la distance-attraction) entre le spectateur et le plan du support avant de le subjuguer vers son au-delà
le motif et le frémissement lumineux médiatisent cet accès à la profondeur
aspire le corps du regardeur comme le ferait un trou noir
mais pour élargir ses perspectives
et, par cette dissémination, l’embarquer vers une vaste concentration
cette tension est présente dès ses débuts
ces phares « surexposés » braqués vers le public (Truck, 1966)
ces forteresses volantes en suspension
cette amorce de tableau de bord (Porsche, 1966–67)
ces terrains désertiques sans repère sans ciel qui sont la continuité du parquet qu’il foule dans le musée
jusqu’à la neige avec la si fine bande de sol (qui pourrait être une couche de nuages)
l’espace vient vers le spectateur et installe son corps en vecteur actif qui se déploie dans cette étendue dense épaisse et qui transperce la toile au-delà des confins représentés
une totalité où le geste de l’artiste bien présent organise la fascination qui hypnotise le regard
le temps est suspendu
ouvre un voyage dans le futur antérieur
une pure expérience du regard qui fait que sa matière est narrative *
avec ce jeu de trituration de la profondeur
la slow painter – comme elle se définit elle-même – peint l’insondable éternel
ce temps qui ne s’arrête jamais
sauf brièvement dans les représentations de Vija Celmins
* les citations sont extraites d’un entretien avec l’artiste en février 2025 (cf. catalogue)
There is only one thing I fear in life, my friend: One day, the black will swallow the red. *
* une réplique attribuée à Rothko par John Logan dans sa pièce de théâtre Red (2009) :
« Il n’y a qu’une seule chose que je crains dans la vie, mon ami : un jour, le noir avalera le rouge. »
En prolongement de cette exposition monographique, la Fondation présente une partie de sa collection de peintures avec de très belles pièces de Jean-Michel Basquiat, Mark Bradford, Marlene Dumas (une salle avec leur dernière acquisition : The Devil May Care, 2024), Wade Guyton, Pablo Picasso, Gerhard Richter, Mark Rothko (une salle), Wilhelm Sasnal, Wolfgang Tillmans et Andy Warhol.
Cet accrochage d’été jusqu’au 31 août mérite le détour !
Fondation Beyeler du 25 mai au 31 août 2025
commissariat Theodora Vischer
tous les jours de 10h à 18h, jusqu’à 20h le mercredi
suturer le nid de flammes

#SALON
Art | Basel
direction : Maike Cruse
du 18 au 22 juin 2025 (journées vip les 16, 17 & 18, tout public à partir du 19)
Messeplatz 10 • 4005 Bâle (CH)
Pendant quelques jours Art|Basel s’invite à la Messe de Bâle et déborde généreusement dans la ville. Les institutions dédiées toute l’année à la culture, notamment à l’art contemporain, font écho à l’évènement pour proposer une semaine festive autour des arts visuels.
L’habitué retrouvera Unlimited, vaste espace muséal scénographié par le commissaire Giovanni Carmine en lien avec les galeries présentes. Dans le hall voisin, plus de 4 000 artistes des cinq continents sont présentés par les 200 exposants de Galleries.
Parmi elles, la galerie bâloise Stampa (Hall 2.1 / S17) montre depuis une demi-douzaine d’années le travail de Véronique Arnold : une des rares artistes régionales à bénéficier de cette visibilité.
| Véronique Arnold avant Art|Basel
Habituellement le peintre caresse la toile du pinceau.
Véronique Arnold, elle, la pique, la transperce.
Non pas pour la blesser mais pour suturer !
Un geste thaumaturgique pour dénouer des nœuds.
Elle est sensible à l’ambivalence.
Le vêtement, le drap protègent, mais peuvent aussi être râpeux s’ils sont en lin.
Et surtout le tissu est mémoire.
Mémoire de pratiques ancestrales (quelquefois disparues) où le corps, les mains s’impliquent comme le tissage et la teinture des kelsch.
Mémoire du vêtement qui perpétue la présence de celui ou celle qui l’a porté.
Elle choisit ses tissus, ses matières, ses tuniques, ses kimonos avec beaucoup de soin et les brode de figures, de motifs, de mots. Ceux délicats de poètes, de philosophes (comme Rûmî, Mandelstam, Rilke, Nietzsche) ou ceux émus, intimes de personnes qu’elle a rencontrées et écoutées lors de projets, de résidences, voire dans un café.
Ses broderies amplifient le cri silencieux des corps absents.
Le fil qu’elle utilise a souvent la couleur du sang comme chez Louise Bourgeois dont elle admire l’audace et la manière de montrer la cruauté par les mots, la répétition et la couture.
Certaines pièces rappellent la diaphane souffrance des Disremembered (2014–15 & 2020–21) de Doris Salcedo et, comme la Colombienne, elle expérimente la création partagée et collective.
Un art où les traces transcrites ouvrent à la mémoire concrète du monde.
Un art qu’elle souhaite : habité.
En amont de la foire bâloise, voici les mots de l’artiste recueillis lors d’un échange sensible dans son atelier (22.05) :
les kelsch
Enfant, j’ai vécu dans une famille alsacienne. Il y a encore dans le grenier chez ma mère des tissus qui ont été teints au pastel bleu*. En hiver après les travaux des champs, on faisait des kelsch – on avait le temps… – et donc il y avait plein de tuniques en lin, des draps en lin… Quand j’étais petite, j’ai dormi dans des draps en lin : il y a à la fois le côté très frais en été, mais aussi très rugueux.
Pour une série (broderie sur lin, 2020), j’avais travaillé avec des femmes et je leur avais demandé de me parler de leurs désirs, de ce qu’elles avaient vécu, des sites de rencontres aussi. J’avais transcrit ça sur ces peaux rêches parce que c’était souvent des témoignages un peu durs avec des notions d’abandon, de tristesse, de solitude ou de joie, tout un répertoire d’émotions.
J’aime bien impliquer des gens dans mon travail. Je pense qu’un artiste est une membrane sensible au contact du monde…
Seul on ne perçoit pas grand-chose… Le retrait [dans l’atelier] est juste là pour transcrire.
* On faisait des teintures en rouge et en bleu, en Alsace c’était avec deux plantes : la garance et le pastel ; et c’est fascinant qu’à partir d’une plante, on ait des couleurs tellement vives.
les frivolités
Dans ma famille, on ne parlait pas beaucoup. Le seul moment où quelqu’un m’écoutait, c’était quand j’étais chez ma grand-mère maternelle. Sur un petit banc au vert, elle faisait des frivolités – des formes de broderie qu’elle avait apprise d’une sœur au couvent : que des petits ronds les uns après les autres. Elle faisait des petits ronds à longueur de journée et elle me disait : raconte-moi quelque chose, qu’est-ce que tu as fait, qu’est-ce que tu as découvert… pour moi cette forme de broderie c’est aussi raconter, il y a narration.
Un jour, je lui ai dit : j’aimerais tellement apprendre les frivolités. Elle m’a dit : tu as autre chose à faire dans la vie ! Ça m’a tellement frustré ! Je pense que ça a été ça [le déclencheur]… Et puis les femmes dans ma famille faisaient aussi des vêtements, ma mère m’amenait chez la couturière du village pour les fêtes… des choses comme ça.
La création ou l’écriture, c’est un trésor inouï, inépuisable aussi.
Quand j’étais enfant, je ne comprenais pas du tout le monde qui m’entourait. J’ai ce souvenir très précis. Je ne comprenais pas le fonctionnement de ma famille, je ne comprenais pas pourquoi il fallait aller à l’école… je me disais : bon je vais faire semblant mais ce n’est pas moi !
Là je peux être moi-même : la création, c’est un privilège inouï !
le Japon et les kimonos
Il y a une quinzaine d’années, j’étais allé au Japon grâce à Christine Ferber qui m’avait invitée deux années de suite au salon du chocolat à Tokyo. La découverte du Japon a été pour moi immense. Immense ! J’avais tout le temps ce sentiment d’une très grande poésie, partout, dans les corps, dans les œuvres d’art, dans les vêtements, dans les céramiques…
Et pour les Japonais la nature est peuplée d’esprits.
Au jardin des mousses Kokedera à Kyoto, j’ai vraiment senti un esprit. J’en ai parlé à mon amie japonaise qui est maître de cérémonie du thé. Elle m’a dit : mais oui, je l’ai senti en même temps que toi…
Il y a une coexistence entre les fantômes du passé, les ancêtres, les esprits et les humains, il n’y a pas de séparation franche entre les états de l’être. Pour moi prendre un kimono, c’est parler de cette fluidité-là de l’être. Il n’y a rien de séparé, on est constitué des mêmes éléments que… cette théière.
J’avais une exposition là-dessus : We are the universe (Nous sommes l’univers).
J’ai mis mon corps là-dedans pour essayer de sentir un peu le cosmos. C’était une idée de vertige métaphysique : sous le ciel étoilé, dans cet univers, comment c’est possible d’être vivant ?
Il y a un élan de vie, un désir de vie dans chaque chose, dans chaque être.
C’est ça qui est fascinant quand je présente un vêtement, il y a quelque chose de peuplé, de fantomatique aussi.
Le kimono blanc avec les broderies roses [EROS : écritures inconscientes illisibles, 2024], c’est une soie floquée semi-transparente où j’ai écrit en écriture miroir et en écriture positive. À chaque fois que j’écrivais une lettre, je piquais la lettre parce que je crois qu’il y a une forme de brûlure, de coupure, de piqûre quand le désir en nous se fait vif.
Je travaille tout le temps avec des aiguilles, des épingles. Des traits du désir…
Une écriture du désir, à la fois évanescence et douleur.
En brodant, je crée comme un petit hamac qui me permet de ne pas être aspirée par le vide parce que depuis toujours j’ai ce sentiment de vide, d’abîme en moi. Un petit hamac opposé à ce mouvement de chute avec des mots pour dire non.
J’aime bien écrire, mais d’une certaine manière ça m’emprisonne.
Louise Bourgeois
Louise Bourgeois aussi.
Ce qui était important pour elle, c’était l’écriture.
C’était un milieu hyperbourgeois, une sauvagerie mais dans un cadre rassurant. Entre son mari, ses enfants, tout était compliqué. Et sa mère aussi en motif récurrent pendant toute sa vie, cette ambivalence entre haine et amour, cette araignée, mais bienfaisante.
C’est d’un courage inouï ! c’est magnifique et brutal aussi, il y a peu de gens qui osent cette brutalité.
Et ces questions de patriarcat restent. Si c’est en bonne voie sur le plan social (dans nos sociétés, on ne parle pas de partout dans le monde malheureusement), dans l’intime, les différences sont restées, les structures patriarcales sont intactes. Les couples souffrent… c’est effrayant.
En tant que femme artiste, j’ai vu que c’est quand même beaucoup plus dur que pour les hommes. J’étais la première femme à rentrer dans ma première galerie et j’ai vraiment vu la différence de traitement entre les artistes hommes et femmes.
Louise Bourgeois, c’est magnifique.
Et elle était magnifique cette exposition à Bâle, géniale !
[Louise Bourgeois x Jenny Holzer, The Violence of Handwriting Across a Page / Kunstmuseum Basel, 2022]
ne pas oublier l’émerveillement
C’est fabuleux l’art à côté de tout ce qui se passe dans le monde. C’est le vivant, comme la nature.
On oublie tout le temps cette magie de l’existence dans ces sociétés très matérialistes. On a perdu la joie de découvrir l’autre… la possibilité d’un lien autre qu’un lien intéressé.
Actuellement je développe des projets participatifs. Je rencontre des gens dans les musées, souvent ils me disent : personne n’écoute.
On souffre tous de cette solitude froide. Surtout ici je pense, on n’a plus cette curiosité de l’autre, l’autre est un objet comme un autre. On perd cette conscience que l’autre a une âme.
C’est la dimension du sacré, cette capacité à transcender la vie de tous les jours, de développer le vivant en soi qu’il faudrait conserver ! L’émerveillement aussi, c’est ça qui fait que la vie est vivante !
l’ennemi ?
la brutalité
C’est très spontanément et dans un rire que Véronique répond à la question de Picasso : L’art est une arme contre l’ennemi… Mais qui est l’ennemi ?
Art | Basel avec la galerie Stampa (Hall 2.1 / S17)
Moi j’adore l’ambiance, même dans la ville, il y a le parcours et maintenant à côté de la foire, il y a des petits coins où on peut prendre un café. Je suis là-bas tous les jours.
Cette année je présenterai à la galerie deux œuvres avec des floraisons (avant la foire je ne les montre à personne). Ils en choisiront une des deux. Il y aura une œuvre de chaque artiste de la galerie, une quinzaine je pense.
La pièce accrochée sur la cimaise ce jeudi 19 juin : Pétales en offrande (2024–2025)
et il y a une vie après Art | Basel
pour ma prochaine exposition chez Stampa, je travaille sur Éros & Thanatos.
| Unlimited 2025
En cette période trouble, le rouge sang de la vaste intervention de Katharina Grosse sur la Messeplatz (sol et façades) dresse un premier geste ample et une atmosphère stridente (l’an passé, Honoring Wheatfield – A Confrontation d’Agnes Denes accueillait le chaland avec son projet d’un écologisme apaisé).
Passé les portiques de contrôle, la grande installation de Marinella Senatore embarque le visiteur vers la nostalgie ludique d’une foire du trône même si son empathique message s’affiche en grand (I contain multitudes / We rise by lifting others*).
Cette quête de sens est souvent présente (Jaume Piensa…), surtout dans THE VOYAGE – A MARCH TO UTOPIA de l’Atelier Van Lieshout (Rotterdam) qui tranche d’une longue diagonale le hall d’Unlimited. Le dédale de leur proposition processionnelle, touffue et immersive, donne à voir les artefacts de tout ce qui est nécessaire (ou inutile : un incubateur pour bébés robots !) à la survie de l’humanité en transhumance vers un monde qu’elle espère meilleur. C’est à la fois angoissant voire brutal par l’expression ou le gigantisme de certains éléments (masques, cages, bœufs, véhicules, machines…) et touchant par ses micro-univers (petit zinc de proximité, droguerie, bonneterie…) et l’accumulation d’objets anciens évoquant par endroits un vide-greniers.
* Je contiens des multitudes / Nous grandissons en élevant les autres.
Si l’édition 2024 s’efforçait d’affirmer une production artistique bien ancrée, quelquefois engagée, dans un réel concret et tangible, en 2025, les propositions tentent d’ouvrir des perspectives alternatives à sa barbarie ou scandent par leur monumentalité même l’absurdité de celles si fragiles offertes par la technologie, ainsi cette exhibition récurrente d’imposants rochers presque bruts (Arcangelo Sassolino, Luiz Zerbini, Nadira Husain, Lee Ufan…) ou d’autres matériaux (Danse macabre de Nicola Turner, 2025).
Bien sûr certains s’adonnent toujours à un jeu facétieux avec la culture main stream (Yakoi Kusama, Cosima von Bonin…), quand d’autres s’engagent dans des logiques d’inventaires (Jef Geys, Faith Wilding…) en amont des tensions d’éradication… ou d’évanescence (Andrea Büttner).
La question qui s’incarne dans ce Hall 1 : Oh monde, où est ton utopie ?
Avec la sourde conscience que notre salut était un point minuscule séparant le besoin de s’entraider et l’envie de se détruire (Éric Fottorino / Marina A, 2018).
sculptures en estive

Le monde du vivant
2de Biennale d’art contemporain de Bischwiller
#EXPOSITION
Bischwiller, parcours urbain de juin à fin septembre 2025
commissariat Germain Roesz
guide de visite/catalogue franco-allemand, 20 p.
parcours en accès libre
En cette période de désengagement des collectivités locales et des financeurs publics à l’endroit de la culture, il est nécessaire de saluer l’engagement de la ville de Bischwiller pour l’art contemporain.
La première Biennale avait accueilli 14 œuvres, il y en a 34 pour cette seconde édition de juin à septembre. Germain Roesz, le commissaire, a réuni douze artistes auxquels s’ajoutent les huit dont le travail est resté en place depuis 2023.
Toutes les générations sont représentées : des jeunes Yoshikazu Goulven Lemaître (prix Théophile-Schuller à St-Art 2024) avec deux pièces spectaculaires (une tortue sur l’étang de la retenue et un squelette de lézard géant accroché dans un arbre) ou Pierre-Louis Peny jusqu’aux sculpteurs consacrés que sont Robert Schad ou Armin Göhringer (pièces installées en 2023) ou encore Karl Manfred Rennertz…
Les services techniques de la commune ont amplement participé à la mise en place des œuvres (et grandement facilité la fabrication dans certains cas).
Toutes les techniques sont présentes (bois, bronze, pierre, tôle…), certaines plus innovantes comme la meute de loups en tiges métalliques phosphorescentes de Thomas Monin (toit du Centre culturel Claude-Vigée).
Les propositions sont abstraites ou figuratives et leur inspiration partagée est liée à la nature (beaucoup d’évocations animales). La plus troublante est « Unedo » de Gaëtan Gromer, musicien de formation : un arbre mort blanchi – avec cependant un vert et fragile surgeon d’arbousier – émettant des sons qui traduisent en temps réel le rythme de la déforestation mondiale…
Patrick Lang qui dirige l’atelier de sculpture des Arts décoratifs de Strasbourg depuis 1984, présente trois facétieuses pièces animalières près de la gare.
Un début de parcours qui passe par l’allée de Hornberg, la rue des écoles avant de rejoindre, par la rue Poincaré, la place de la mairie où trône trois bronzes impressionnants : Grosses Baumfenster de K. M. Rennertz, Lion & Lionne de Winfried Becker. Une dizaine de pièces en interaction directe avec le passant qu’il musarde ou fasse ses courses. Une proximité voulue par Jean-Lucien Netzer, maire de Bischwiller, car une grande partie de la population ne va pas dans les musées et encore moins dans les galeries d’art contemporain, il faut donc que les œuvres aillent à sa rencontre dans l’espace public !
La seconde partie de l’itinéraire jalonne la bucolique promenade de la coulée verte du Rotbaechel agréablement ombragée où se nichent les travaux de Nicolas Schneider, Sylvain Chartier, Bruno Feger, René Dantes…
Deux pièces sont un peu excentrées près du stade : Daniel Depoutot & François Cacheux.
Un joli but de promenade art et nature dans un cadre enchanteur voire d’excursion avec repas tiré du sac !
Une plaquette à la fois catalogue et guide de visite est disponible en version papier ou pdf. Le plan seul est également téléchargeable.
l’Histoire d’avant le bitume

Un passé incontournable.
Découvertes archéologiques de l’A355
#EXPOSITION
Galerie Heitz (palais Rohan, Strasbourg) du 13 juin 2025 au 21 juin 2026
commissaires Bertrand Béhague (DRAC GE) & Mathilde Villette, puis Quentin Richard (Musée Archéologique de Strasbourg)
en complément un catalogue exhaustif sur les fouilles 256 p., 35 €
10–13h & 14–18h, en continu le week-end, fermé le mardi
L’A355 est surtout connue au niveau local depuis 2012 par la mobilisation contre le grand contournement ouest (gco) avec une montée en tension en 2016–2017 notamment autour de la ZAD du Moulin évacuée manu militari en septembre 2018. Le changement de nom avec l’inauguration de décembre 2021 s’évertue de tourner cette page.
Mais une histoire bien plus ancienne s’était aussi invitée sur le chantier avec la campagne de fouilles préventives menée de septembre 2016 à août 2019. Cette exposition labellisée d’intérêt national par le ministère de la Culture en restitue les découvertes.
L’ampleur de l’emprise – 24 km pour 405 ha –, sa particularité – le tracé évite les villages – et par endroits sa profondeur – jusqu’à moins 11 m – déterminent l’envergure de la mission : 34 fouilles prescrites (quasiment tous les 500 m) assurées par six équipes d’une dizaine de personnes, soit le double des interventions effectuées habituellement sur une année en Alsace. Le nombre de contributeurs au catalogue en témoigne.
Cinq opérateurs en archéologie préventive (Inrap, Archéologie Alsace, ANTEA-Archéologie, Archeodonum et Éveha) sont intervenus sur 62,5 ha et l’ensemble des rapports représente 50 volumes.
L’horizon le plus ancien remonte à 190 000 ans avant J.-C. et la chronologie se prolonge par endroits jusqu’à la Première guerre mondiale. Sur le terrain la part prépondérante de formations lœssiques constitue un environnement de conservation favorable en particulier pour les périodes préhistoriques. D’ailleurs l’époque la plus représentée est le néolithique (26 sites) suivi de l’âge du bronze et de l’âge du fer où se développent le phénomène urbain et les échanges, notamment avec le monde méditerranéen.
La qualité et la nature des artefacts sont évidemment conditionnées par l’emprise du tracé et ce contexte. Les implantations anciennes correspondant peu ou prou aux villages actuels, c’est assez logiquement une forme de nomadisme et des implantations éphémères liées à l’activité, principalement agricole (fermes, silos…), mais également funéraires qui ont été mises à jour – aucune villa n’a été identifiée.
Les découvertes relèvent plutôt du mobilier d’usage lié à la cuisine, à l’habillement (des fibules, une plaque de ceinture du 1er âge du fer à Pfulgriesheim avec un fac-similé manipulable) ou à l’agriculture que des bijoux ou des parures spectaculaires.
Sur le site de Stutzheim-Offenheim, une figurine néolithique en terre cuite (h = 5,7 cm, interprétation discutée) a été retrouvée au milieu d’ossements d’animaux, de fragments de poterie et de silex, et à Breuschwickersheim, une émouvante figurine allaitante en céramique d’époque romaine signée Pistillus, ainsi qu’un vase à visage en céramique (IIIe–IVe siècle ap. J.-C.).
Quelques pièces de monnaies et des fers à cheval ont été relevés près de la voie romaine reliant Argentorate (Strasbourg) à Brocomagus (Brumath).
Par contre le dépouillement de l’important matériel collecté a permis d’élargir le corpus de connaissances sur les habitudes alimentaires (graines cultivées, ossements d’animaux consommés…), sociales (agapes, pratiques funéraires…) et l’usage du territoire avec un abandon des sites entre l’époque romaine et le haut Moyen Âge.
Les sépultures (350) révèlent aussi l’importance des parements chez les femmes avant le Ve siècle (attestant un statut social plus élevé ? une forme de matriarcat ?). Par la suite les dépouilles masculines seront à nouveau enterrées avec des attributs guerriers…
L’exposition donne des clefs pédagogiques avec dix dispositifs illustrant autant les techniques utilisées par les scientifiques (comme celle pour déterminer le sexe du défunt à partir des ossements) que le fonctionnement de certaines découvertes, notamment celle majeure du Qanât de Kolbsheim (Haut-Empire, IIe s. ap. J.-C.) : un ouvrage hydraulique, surtout attesté en Orient, constitué d’un alignement de puits (sur 88 m) destiné au captage par capillarité de l’eau de la nappe phréatique.
Condenser en 200 m2 trois ans de fouilles sur plus de 60 ha relevait de la gageure et le résultat est aussi lisible que cohérent. Cependant l’exposition est un peu le dessus de l’iceberg et pour avoir une vision complète du sens, des enseignements et de l’évolution des connaissances rendus possibles par tous les vestiges exhumés, il est bon de compléter la visite par la lecture du catalogue. Cette mise en perspective est l’objet de la première moitié de l’ouvrage, la seconde propose une notice pour chacun des 34 sites étudiés.
spectre diurne

Brundibár
de Hans Krása
#OPÉRA
représentation du mardi 27 mai au Théâtre municipal de Colmar (Opéra national du Rhin)
Brundibár est un opéra pour enfants écrit en 1938 par Hans Krása sur un livret d’Adolf Hoffmeister. Après de sombres aléas, la création officielle a lieu le 23 septembre 1943 dans le camp de concentration de Theresienstadt (Terezin).
La production signée Jeanne Candel (créée en 2016 à l’Opéra de Lyon) est portée par l’Opéra Studio dans une version pour piano (Annalisa Orlando) et accordéon (Pablo Devisme), la chef (Sandrine Abello) assurant quelques traits de percussions. Elle est interprétée en français par les enfants de la Maîtrise de l’Opéra national du Rhin et des classes à horaires aménagés musique.
Inspiré de contes de Grimm (Hänsel et Gretel, Les Musiciens de Brême), c’est une fable avec une morale positive : Face à l’injustice et l’adversité, l’union fait la force !
La création a été malmenée par l’annexion de la Tchécoslovaquie par les nazis (1939), puis la déportation du compositeur et de la troupe qui l’avait interprétée clandestinement dans un orphelinat juif de Prague en 1942 (les activités culturelles étaient interdites aux Juifs).
À Terezin, Krása l’a remaniée pour les instruments disponibles. L’œuvre était appréciée – elle inclut des chants populaires – et offrait un dérivatif bienfaisant notamment aux enfants participants. Elle a été jouée 55 fois dans un camp qui sera rafraîchi en 1944 (peinture, faux magasins, faux cafés, nombreux transferts vers Auschwitz afin de réduire la surpopulation) pour les besoins d’une vaste opération de propagande mise en scène pour la Croix Rouge et prolongée par un « documentaire » (Theresienstadt. Ein Dokumentarfilm aus dem Jüdischen Siedlungsgebiet). Quelques minutes de la production de 1943 y sont visibles… Par la suite, la plupart des acteurs forcés de cette mystification dont Krása sont transférés et assassinés à Auschwitz-Birkenau (automne 1944).
Difficile d’ignorer ce contexte même des décennies plus tard…
Au premier acte, le fond qui ferme la place du bourg représente une gueule d’enfer. Choix pertinent puisque, l’espace public est hostile tant aux Juifs à l’époque qu’aux deux enfants Pepícek et Aninka : en ce jour de marché, ils veulent chanter pour récolter quelques sous et acheter du lait à leur mère malade. Mais c’est le territoire de Brundibár, chanteur et joueur d’orgue de barbarie, qui fera tout pour les chasser avec, au début, le soutien du policier.
L’espièglerie s’invite cependant : les yeux et les dents du bas sont des enfants déguisés, celles du haut sont suspendues au bout d’une perche comme des lampions.
Brundibár est tenu par Michał Karski, baryton de l’Opéra Studio.
Le prologue imaginé par Jeanne Candel lui offre le quatrième Lied (Die zwei blauen Augen von meinem Schatz) du cycle Lieder eines fahrenden Gesellen de Gustav Mahler. Cet air nostalgique où l’amoureux délaissé se console sous l’enivrante beauté d’un tilleul adoucit un personnage plutôt noir par ailleurs (il serait inspiré d’Hitler).
À quelques pas, une fillette enterre ses larmes avant qu’une demi-douzaine de camarades ne la rejoigne pour raconter leurs cauchemars…
Des camelots viennent vanter leur marchandise, puis Brundibár entonne les Couplets du toréador (Carmen) enchaînant une dizaine de tubes d’opéra (de la Reine de la Nuit en passant par Casta Diva…) pour couvrir le chant des deux enfants.
Michał Karski endosse avec aisance tant vocalement que scéniquement ce rôle de caïd du quartier et s’en donne à cœur joie pour houspiller Pepícek et Aninka.
L’écriture est légère, mélodique, voulue simple pour être chantée par des enfants, mais se permet quelques fusées dissonantes. Les jeunes interprètes n’ont bien sûr pas l’assise des adultes, mais trouvent une belle assurance en duo, en ensemble et s’impliquent dans le jeu et le chant avec un généreux enthousiasme.
Au second acte, un clair de lune plein de poésie invite les mystérieuses créatures de la nuit : un chat en mobylette, un chien savant et un oiseau. Avec Pepícek et Aninka, ils complotent de mettre Brundibár hors d’état de nuire en rameutant tous les enfants du quartier. Brandissant toute une panoplie d’instruments en un tonitruant charivari, la joyeuse troupe aussi engagée que bon enfant chasse le malfaisant hors du marché.
Le chœur final embarque le public dans son rythme entraînant d’autant que les jeunes choristes envahissent la salle !
direction musicale Sandrine Abello
mise en scène Jeanne Candel (remontée par Jean Hostache)
décors Lisa Navarro
costumes Pauline Kieffer
lumières Vyara Stefanova
chorégraphie Isabelle Catalan
adaptation française Chantal Galiana
du sang… sans les larmes

Makbeth
d’après Shakespeare
#THÉÂTRE
représentation du jeudi 22 mai à La Filature, Mulhouse
en tournée jusqu’au 12 mars 2026 (autres dates en cours)
Compagnie associée à La Filature depuis une dizaine d’années, le Munstrum Théâtre de Louis Arene se produit pour la première fois dans la grande salle et se donne les moyens d’un spectacle total tout en sang et lumières pour en mettre plein la vue à son public.
Créée en février à Châteauvallon, leur version hollywoodienne de la tragédie privilégie l’action sur le texte qui bénéficie d’une nouvelle traduction raccourcie et avec une langue et des expressions trempées dans l’aujourd’hui.
explosions et mitraille
éclairs et fumée
beaucoup de fumée
tombant des cintres
éructée des coulisses
les sinistres productions de l’humain
courses et cris
de cour à jardin
de jardin à cour
des allers-retours sabres au clair
une guerre de positions fluctuantes
un relent de Chemin des Dames
une violence guerrière et forcenée
se devinent les coups les saignées
les élans cisaillés
les corps projetés et plantés
l’ivresse du sang et du meurtre
l’atavique sauvagerie ?
à peine une pause
avec le coassement des grenouilles
et la violence reprend de plus belle
un acharnement au carnage
Hollywood sous la pénombre
avec l’odeur et le goût du sang
avant les images écarlates
c’est long
trop sans doute
la lumière exerguera encore la violence
identifiera les victimes à occire
et magnifiera la couleur du sang
qui gicle sous les impacts répétés dans
les corps devenus palpitants fourreaux de sabres
le sang en bain
auquel les tripes arrachées
dispersées par poignées
se rajouteront vers la fin
la violence est spectacle
multicolore vibrionnant ludique
et joyeux
une complaisance festive
la violence illégitime
est administrée impitoyablement
pour s’emparer de la violence légitime
puis l’amplifier en surenchère
avec gourmandise et frénésie
une ivresse orgiaque barbare
et totalitaire
quelques ombres s’invitent
trop discrètes
le corps nu de Makbeth
livré aux goules humides et bitumineuses
du second colloque des sorcières
la dernière image
très shakespearienne
le bouffon trônant
sur sa tour d’arbitre de tennis
avec à ses pieds
le champ si fécond du carnage
que la forêt de Birnam ne cache même plus
La morte è il nulla.
È vecchia fola il Ciel! *
* La mort mène au néant. L’antique fable du Ciel !
selon l’adaptation de Boito pour l’Otello de Verdi (ex Credo de Jago)
La maîtrise de l’outil théâtre est incontestable et impressionnante. Les effets spéciaux sont efficaces. La remarquable géométrie des lumières articule avec une grande fluidité la succession des scènes, rythme le temps et la progression dramatique. Elle sait créer des sous-espaces de complot, saisir d’un spot un aparté comme un gros plan de cinéma. L’esthétique privilégie la symétrie (les triangles sont récurrents), une organisation du plateau axée, ordonnancée (assez mussolinienne comme la pratique Hollywood dans beaucoup de ses blockbusters) avec quelques tableaux envoûtants et racés.
Ces choix favorisent la prééminence de l’action sur le dialogue d’autant que la rumeur constante de la bande-son rend le texte souvent peu compréhensible. Les enjeux, les tenants et aboutissants s’en trouvent marginalisés au profit du déchaînement halluciné et mortifère.
Les (rares) moments poétiques, de suspension, sont musicaux – un chevalier en armure chantant du Nick Cave (mais plutôt hors dramaturgie), la cornemuse de l’enterrement… –, respectant la règle hollywoodienne du mountain & valley : ne pas étouffer le spectateur, avant de relancer la mécanique de la violence volontiers distanciée par l’humour, ici en jouant la mort à pile ou face…
Les huit comédiens portent des demi-masques agrandissant le nez et les yeux d’une exophtalmie hallucinée, certains ont des prothèses de ventre, les costumes sont au croisement de chitineux insectes et d’archaïques armures.
Tous s’accordent et défendent avec engagement le projet (seules certaines voix passent plus mal au travers du brouhaha permanent). S’en détache l’adipeux roi Duncan (Delphine Cottu), le bouffon (Erwan Darlet) et la Lady queer de Lionel Lingelser, mais c’est plutôt le fruit d’une imagerie fortement caractérisée que l’approfondissement d’une option dramaturgique exigeant une incarnation puissante (le Makbeth de Louis Arene se confond facilement avec le Banquo de François Praud visuellement proche). Des figures qui semblent issues de la bande dessinée ou du jeu vidéo et ne prédisposent guère à l’empathie…
La gestique peut (vaguement) évoquer les films de Kurosawa, mais là où le Japonais ritualise les rapports hiérarchiques et les confrontations de stratégie, le Munstrum ritualise l’administration facétieuse de la violence par ces marionnettes empêtrées dans leurs armes.
Pendant la représentation, des rires fusent régulièrement, mais ils sont éparpillés et ne gagnent jamais l’ensemble unanime de la salle…
La note d’intention déplore que sous le vernis de notre civilisation éclairée, la barbarie gronde (les drapeaux palestiniens dans le dos des comédiens lors des saluts en attestent la sincérité) et invoque la catharsis, un défoulement comparable au film d’horreur ou au thriller fantastique…
Mais transformer un être en jouet ne produit-il pas aussi la nécessaire déshumanisation pour le réduire en vermine à exterminer ?
Et cette esthétisation de la violence (du Mal) ne relève-t-elle pas de l’étourdissement festif pour en infuser la banalité et la familiarité afin que le spectateur soit mieux en capacité de l’endurer le moment venu ? Ne contribue-t-elle pas à la fabrique du consentement ?
Le sang a une couleur chaude. Et séduisante !
Et la guerre est un plaisir, le plus grand des plaisirs, sinon elle s’arrêterait tout de suite. Une fois qu’on y a goûté, c’est comme l’héroïne, on veut en reprendre. (Emmanuel Carrère / Limonov, 2012)
Le Makbeth du Munstrum Théâtre : un geste spectaculairement théâtral piégé par l’éloge de la pire addiction ?
avec Louis Arene, Lionel Lingelser, Delphine Cottu, Erwan Darlet,
Sophie Botte, Olivia Dalric, Anthony Martine, François Praud
conception, mise en scène, masques Louis Arene
traduction, adaptation Lucas Samain
scénographie Mathilde Coudière Kayadjanian, Adèle Hamelin, Valentin Paul, Louis Arene
lumière Jérémie Papin, Victor Arancio
musique & création sonore Jean Thévenin, Ludovic Enderlen
costumes Colombe Lauriot Prévost
production Munstrum Théâtre
fragile avenir…

On ne choisit pas ses fantômes
de Matthias Moritz
#THÉÂTRE
représentation du jeudi 15 mai à La Filature, Mulhouse
Après Hôtel Proust et son impitoyable charge contre le cynisme de nos dirigeants, Matthias Moritz se penche sur l’intime.
Reprenant la trame des Scènes de la vie conjugale d’Ingmar Bergman (1973) et de son remake américain inversé d’Hagai Levi (2021), il décortique « jusqu’à l’os » le couple, ses dysfonctionnements, ses impasses… C’est toujours une « comédie pessimiste » avec le public comme premier interlocuteur, mais la matière est plus personnelle et elle s’installe, résonne pour le public comme pour les deux comédiens, évacuant la facilité du discursif.
Le public entre sur le Boléro de Ravel, musique répétitive emblématique – nos rêves sont trop ennuyeux dira Débora –, le motif cependant est exotique et réserve une explosion finale teintée d’érotisme…
Rien n’est jamais simple !
Le contenu d’un grenier est suspendu dans les cintres : un frigo, une plante verte, des cartons, une chaise, une télé, tout ce qu’une vie à deux accumule.
Sur l’avant du plateau, une dizaine de micros, trois caméras…
Un régisseur (Arnaud Verley) est aux petits soins pour piloter ce dispositif.
Le couple entre, séparément, au ralenti : la vie c’est du cinéma… Ils refont leur entrée : tout est mise en scène !
Ils s’asseyent, se livrent de bon gré à ce tribunal médiatique : une confession comme dans les émissions de téléréalité. Et invasive : il y a Marianne & Johan (de Bergman), Mira & Jonathan (de Levi), mais aussi Débora Cherrière & Lucas Partensky (les noms des comédiens).
Quelques formules bien senties émergent dans ce prélude. Matthias Moritz a des positions fortes (dans Hôtel Proust, il ne s’en privait pas). Débora et Lucas les profèrent en coryphées.
En quittant ce « confessionnal », elle noue et pince ses cheveux : sa façon d’endosser le rôle de Mira, mais l’écume de Débora et Lucas débordera par moments (on ne « joue » pas complètement).
Le premier mouvement est une parade : défense et illustration du couple accompli. Et stable : dix ans de vie commune ! Une victoire qui déborde d’un an et demi des statistiques. Mais… la porosité à l’externe – leurs deux boulots – conditionne l’économie domestique, fissure souterrainement le dispositif conjugal. Trois vies : un sandwich où le couple est la couche du milieu. Soumise aux frictions, aux arrangements…
Finalement l’externalité fait exploser le couple. Elle est tombée amoureuse d’un collègue, veut refaire sa vie avec lui. Son départ dévoile la profondeur des failles, pointe L’art de tout balayer sous le tapis. Et là toute la poussière leur revient à la figure ! Il y a l’effet de surprise (pour lui) et la question : les mots auraient-ils évacué les maux ?
Autour d’eux tout se décroche, se déglingue, comme leur couple qui est devenu un produit comme les autres, avec son obsolescence programmée : le couple est une industrie très lucrative.
Le partage des biens est tendu. Maintenant il y a trop de mots !
Des mots sales (Christian Bobin), les mots du dehors qui contaminent l’intime, l’explosent !
S’il offre des moments poétiques ou d’humour (les dizaines de stylos qui tombent des cintres pour qu’ils signent le partage), le spectacle interroge surtout les lignes de blocages, de fractures.
Y a-t-il trop de mots ? Ou pas assez ? Et lesquels ?
Le couple serait-il un rituel animiste travesti/perverti par le dialogue ?
La pièce ne cherche pas à donner de réponse. Et si rien n’est résolu, l’important, quand même, c’est ce qui se joue entre deux êtres.
Alors ? Esquisser un retour au tribal pour inventer une autre alchimie, un rituel vodou pour purger l’impur, les fantômes et leurs impostures ? Le tableau final avec un bout de nature (forcément climatisé) et un rayon de lumière qui irradient de la fenêtre du fond, suggère qu’un avenir semble malgré tout possible !
avec Débora Cherrière, Lucas Partensky
mise en scène & adaptation Mathias Moritz
scénographie & régie plateau Arnaud Verley
lumière Fanny Perreau
son Nicolas Lutz
ancrer et s’ancrer

@La Filature | saison 25 26
#THÉÂTRE, DANSE, MUSIQUE
La Filature (Mulhouse)
51 spectacles et 5 expositions du 1 octobre 2025 au 11 juin 2026
abonnement dès le 14.06, ouverture de la vente à l’unité le 1.07
La saison qui s’achève a été la « première année sereine » de Benoît André, directeur de la Filature (il est arrivé en janvier 2020…). Sa politique d’élargissement des publics et des offres porte doucement ses fruits.
Et de plus en plus, les spectateurs s’attardent avant et/ou après les représentations. En décembre l’ouverture du restaurant Audace saura amplifier cette dynamique. Intégré au bâtiment, il pourra fonctionner de façon autonome, disposera d’une salle de 105 couverts, d’une terrasse et proposera des prix raisonnables pour tous. Il s’adaptera bien sûr à la programmation (thèmes, horaires).
Tout cela est possible grâce au soutien de la Ville qui veut faire vivre cet équipement exceptionnel : une synergie d’utilisateurs bénéficiant du plus grand plateau de France après l’Opéra Bastille.
Nathalie Motte, Adjointe au Maire de Mulhouse déléguée à la Culture, était présente pour affirmer l’engagement de la Ville qui subventionne une partie des travaux du restaurant (à hauteur de 800 000 € comme propriétaire des lieux, le groupe BK apportant une somme légèrement supérieure). Par ailleurs après 30 ans, des travaux de rénovation et de mise aux normes du parc scénique (38 km de câbles !) sont nécessaires. Ils s’étaleront de septembre prochain à 2027 pour un montant de 1,5 million d’euros. La Ville y contribue et a en outre voté une aide supplémentaire sur 3 ans pour soutenir l’action artistique (3 x 54 000 €) : « La culture est premier budget de la Ville de Mulhouse ! »
Ces aides sont bienvenues dans un contexte tendu par ailleurs (gel des subventions voire baisse dans certaines régions). Ces restrictions touchent d’abord le dernier maillon, le plus fragile de la chaîne : les compagnies. Aussi un choix fort pour la programmation a été de soutenir les compagnies régionales souvent par des coproductions.
Ainsi le portrait de la saison est consacré à l’éclectique artiste strasbourgeoise Léopoldine HH : actrice, musicienne… Mais il faudra patienter jusqu’au printemps pour profiter de ses trois soirées : 8 soirs par semaine (15.03), Woyzeck ou la vocation de Büchner (8 & 9.04, mise en scène Tünde Deak) et La Folie Élisa (20 & 21.05, création).
Mais dès le 7 octobre, les Scènes d’Automne en Alsace mettront les troupes locales à l’honneur. Laure Werkmann bénéficie du focus 2025 avec Renaître (10 & 11.10) et sa création L’amour après (7 & 8.10). Thierry Froger et la Cie Roland furieux se sont inspirés d’un projet commandé à Godard avant le bicentenaire de 1789 (et avorté) pour Sauve qui peut (la révolution) (11 & 12.10).
Trois autres propositions sont programmées chez les partenaires.
Et six autres compagnies de la Région sont invitées lors de la saison.
Louis Arene revient avec la Comédie Française et Le Mariage forcé de Molière (6–8.11). Son Munstrum Théâtre cède la place à Romain Gneouchev issu du TNS qui entame sa complicité avec Une chose vraie (10 & 13.03) écrite pour une comédienne atteinte d’une maladie neurodégénérative précoce.
Catherine Verlaguet & Olivier Letellier proposeront Mon petit cœur imbécile (6.05) et Sylvain Groud complice depuis 2025 proposera Let’s Move ! (3.06) spectacle chorégraphique inspiré du répertoire de la comédie musicale. Conçu pour une centaine de danseurs bénévoles, c’est l’un des quatre évènements participatifs* avec Skatepark (30 & 31.05), bodies in urban spaces (30 & 31.05).
Et surtout to like or not (3–7.02) : un projet transmédia d’Émilie Anna Maillet sur l’ère numérique et l’addiction aux réseaux sociaux, le portrait d’une jeunesse immergée dans l’interactivité… et le mensonge des avatars, des fake news…
* appel à participants, respectivement : 100 danseurs, des skaters de 18 à 25 ans, des performeurs, des jeunes de 16 à 25 ans motivés par le théâtre
En mars, la Quinzaine de la Danse invitera cinq chorégraphes.
quatre saisons en mouvement (10.03) chorégraphient les musiciens des Bruges Strings (musique de Vivaldi), Thomas Lebrun nous immerge Sous les fleurs (11–13.03) dans l’univers du 3e genre chez les Zapothèques imprégné visuellement par Frida Kahlo, Catherine Gaudet nous plonge dans la transe d’ODE, Emmanuel Eggermont nous livre son subtil et émouvant hommage à Raimund Hoghe avec About Love and Death (17 & 18.03) avant les Imminentes (21.03 à Saint-Louis) de Jann Gallois.
En clôture de saison, une restitution hommage aux Ballets Russes (10 & 11.06) sera coproduite avec le Ballet du Rhin.
Le théâtre de texte n’est pas oublié avec La Maison de Bernarda Alba (4–6.03, création) de Federico García Lorca mis en scène par Thibaud Croisy et L’Hôtel du Libre-Échange (11 & 12.03) de Feydeau par Stanislas Nordey.
Christoph Marthaler revient avec Le sommet (20 & 21.03) entre alpinisme et « Davos »…
L’offre est pléthorique avec aussi sept concerts dont le coup de cœur de l’équipe : Dominique Fils-Aimé (8.04) soutenue par la Délégation générale du Québec à Paris (comme quatre autres spectacles), deux cinés concerts et un spectacle de cirque guinéen pour la fin d’année Yé ! (L’Eau !) (3–6.12) où l’énergie, l’humour, la légèreté du Circus Baobab s’emparent aussi des questions environnementales.
Sans oublier les 5es Nuits de l’étrange (30 & 31.10) et cinq expositions à la galerie dont La Régionale 26 (nov-déc) et la 7e Biennale de la Photographie de Mulhouse (juin-juil).
Pour les habitués, les Soirées Sunset (~500 personnes y participent), le club sandwich sont reconduits.
du fabuleux animal & musical

@Comédie de Colmar | saison 25 26
#THÉÂTRE, MUSIQUE & DANSE
Comédie de Colmar
26 spectacles pour 77 levers de rideau du 11 septembre 2025 au 13 juin 2026
Ouverture des abonnements le vendredi 14 juin et de la billetterie le 20 août
Nouvelle saison « idéale » selon le mot de Matthieu Cruciani, c’est-à-dire élaborée conformément aux envies de l’équipe, avec 26 spectacles (4 de plus) et les synergies habituelles : les six artistes associés, Scènes d’Automne en Alsace, la Jeune troupe avec Reims et, en novembre, la danse avec le Ballet de l’Opéra national du Rhin de Bruno Bouché.
Ouverture de saison avec Charlotte Planchou (11.09), une voix jazz formée au lyrique et fascinée par les sons anciens en amont du Festival de Jazz de Colmar (18–28.09) suivie de Zusammen (2–6.10), le cirque équestre de la Compagnie Equinote mis en scène par Émilie Capliez : une première pierre au rapport entre animal et humain, un des questionnements de la saison.
Au printemps, après Des femmes qui nagent et ses prémices vues par Jules Verne l’an passé, Émilie poursuivra Une histoire de cinéma (3–6.03) avec quelques figures des débuts, Alice Guy et Georges Méliès, très influencées par le music-hall.
En fin de saison, Raphaëlle Rousseau convoquera l’actrice Delphine Seyrig (1932–1990) pour une Discussion avec DS (28 & 29.05).
Laure Werkmann et sa tétralogie seront l’axe des Scènes d’Automne en Alsace 2025. Chacun des quatre opus trace l’itinéraire d’une femme qui se reconstruit. Dans Croire aux fauves (14 & 15.10), c’est celui de Nastassja Martin (anthropologue et militante très investie dans la défense des glaciers) laissée pour morte par un ours.
En mai, S’arracher (5–7.05, mais Par les villages dès le 31.10) croise le road trip d’un jeune qui vient de perdre son père et d’une biche traquée prolongeant cette tension entre animalité et humanité.
Et ce lien reste-t-il possible dans Le sanctuaire (4.02) préservé d’un monde post-apocalyptique ?
En contrepoint le festif sera de rigueur avec une proposition de Pierre Maillet proche du cabaret : Edith Beale au Reno Sweeney (5–8.11), le poétique Jérémy Fisher (26–28.11) mis en scène par Thomas Ress et trois spectacles s’amusant à muer le drame en humour jubilatoire : noir avec Dolorosa (4 & 5.12), onirique avec Vertiges (11 & 12.12) et dans l’autodérision avec Il tango delle capinere (18 & 19.12).
Les classiques ne sont pas oubliés avec Les femmes savantes (5–7.02), L’Hôtel du Libre-Échange (11 & 12.02) vu par Stanislas Nordey, Woyzeck (31.03, 1 & 2.04), mais aussi Les chroniques (29 & 30.01) et Hurlevent (17 & 18.03) d’après respectivement Zola et Emily Brontë.
Entre théâtre documentaire et autobiographie, Elles avant nous (12 & 13.03) portent la parole de trois femmes mahoraises et 24 place Beaumarchais (8 & 9.04) celle de Brahim Koutari qui a grandi dans un quartier et se produit aujourd’hui sur les plateaux de théâtre et de cinéma. Ensuite Marie Fortuit rendra hommage au matrimoine d’Anne Sylvestre pour La Vie en vrai (29 & 30.04).
Touche (7–12.02) sera le spectacle pour les tout-petits (18 mois–cinq ans), qu’on peut enchaîner avec les marionnettes de Retors Paniques (21–22.05) après le confinement ludique des Fusées (13–16.01) de Jeanne Candel dont l’OnR vient de présenter Brundibár.
Dès l’automne, la Comédie poursuit sa collaboration avec Bruno Bouché et le Ballet de l’Opéra national du Rhin ajoutant la danse à son offre en accueillant la proposition « chromato-chorégraphique » All Over Nymphéas d’Emmanuel Eggermont (13 & 14/11) en amont de la Quinzaine de la Danse sur le territoire mulhousien (en mars).
Les actions vers les publics sont bien sûr au rendez-vous avec le concert de Jean-Christophe Folly (21.11) lors du Festival du livre, la tournée Par les villages, L’Heure lyrique (12–13.06), l’ouverture aux amateurs avec Encrage #6 (25 & 26.06), les Courts-circuits…
regarder au lieu de voir

@Espace 110 | saison 25 26
#THÉÂTRE, DANSE, MUSIQUE
Espace 110, Centre Culturel Illzach, Scène conventionnée d’intérêt national « art et création »
abonnements & billetterie dès le 27/05
Selon un rituel bien installé, Thomas Ress a animé une présentation vitaminée de la prochaine saison avec son équipe et de nombreux artistes, notamment les membres des huit compagnies accueillies en résidence en 2025–26. Il met l’accent sur une offre transversale où les spectacles nourrissent et enrichissent la très large palette d’activités (140 offres dans tous les domaines).
Une programmation qui invite à « regarder au lieu de voir », à « savourer au lieu de consommer » et donne du sens à une communauté de vie et d’altérité sur le territoire de la commune et un peu au-delà (de Colmar à Saint-Louis avec les Scènes d’Automne en Alsace).
Deux Nuits d’été seront en entrées libres : le 14/07 avec Les Irréels entre théâtre et animation suivis de DJ Set (à partir de 20 h) puis le 30/08 avec Les Amazones d’Afrique en concert sur le parvis.
En ouverture de saison, la Compagnie Hélios dirigée par le président Jean-Pierre Verdheillan fêtera ses 30 ans avec 3 comédies à la française (Molière, Guitry, Feydeau, les 12, 13, 18, 19, 20/09).
La blessure est l’endroit où la lumière entre en nous, Saye Sirvani cite Djalâl Al-Dîn Rûmî pour évoquer La Perle (4 & 5/11) qui conclura sa résidence d’artiste dans la maison (entamée avec le beau L’ivresse des profondeurs). Certainement un des moments forts de ce premier trimestre axé sur le corps sportif avec deux spectacles chorégraphiques Goal (26/09) et Go (3/10), puis le parcours de femme de la tenniswoman Marion Bartoli : Renaître (10 & 11/10).
Les 14 & 15 novembre, Bédéciné fêtera ses quarante ans encadrés par deux propositions : Micheline (12/11) et, d’après l’œuvre de Tomi Ungerer, Le Nuage bleu (19/11).
Une soirée orientale, Ishtar Connection (29/11) avec Fawzi Al-Aiedy, chant et oud, ouvrira la période des fêtes où L’inouïe nuit de Moune (5/12, gratuit) se déroulera sous une yourte avant que Santiago Moreno l’homme-orchestre de Soledad (12/12) ne conclue l’année.
Des femmes harassées mais joyeuses s’inviteront en janvier, avec l’humour de Barmanes (16/01), Quand j’étais petite je voterais (24/01) et Silence Vacarme (30/01), ces deux derniers déjà présentés à la Comédie de Colmar.
Ensuite La ferme des animals (6/02) d’après Orwell questionnera le pouvoir et Le Sanctuaire (13/02) les marges du libre arbitre face au mensonge institutionnalisé.
La Quinzaine de la danse (6–21/03) proposera à nouveau une offre ambitieuse sur le grand plateau de La Filature avec le Ballet du Rhin comme 3e larron. En écho l’Espace 110 accueillera l’esprit argentin de Como una baguala oscura (10/03) et clubbing de Guest/Flux (20/03), ainsi que le dialogue percussif des corps avec le piano de Mikro (14/03).
L’imaginaire retrouvera Le chapelier fou (27/03) en compagnie d’Alice au pays des merveilles et le Pinocchio de Mentez-moi (11/04).
Enfin Pas touche/L’Archipel (7/05) accueillera l’été : en extérieur aux Jardins du Temps avec un repas végétarien entre les deux spectacles.
miroir sans tain

@Opéra national du Rhin, saison ’25 ’26
#OPÉRA & DANSE
Opéra national du Rhin (Strasbourg), La Filature (Mulhouse), Comédie de Colmar & Théâtre Municipal (Colmar)
ouverture des abonnements le 15/05 pour Strasbourg, le 22/05 pour Mulhouse & Colmar
billetterie à l’unité :
dès le 23/06 pour le concert Hændel et En regard (danse) à Strasbourg
le 1/07 pour Nynphéas & Ballets Russes à Mulhouse
le 2/09 pour toute la saison
En compagnie de Bruno Bouché, directeur du ballet, Alain Perroux, directeur général, a présenté sa dernière saison à l’OnR (il prendra la direction du Grand Théâtre de Genève en juillet 2026) avec un fil rouge inspiré par Shakespeare : Le monde est un théâtre.
Il en a profité pour préciser les choix et le calendrier de la rénovation du théâtre de la place Broglie fruit d’une réflexion solidement documentée avec les partenaires du projet.
la saison 25-26
Entre illusion et désillusion, Il Trionfo del Tempo e del Disinganno, premier oratorio de Hændel, peindra de couleurs mélancoliques l’ouverture de la saison (version de concert, uniquement à Strasbourg le 14/09).
Suivra une production de l’Otello de Verdi (29/10–18/11). Speranza Scappucci, une élève de Riccardo Muti, dirigera cet opéra torrentiel dans une version où le final du troisième acte est plus axé sur Jago, personnage central de la pièce, qui, pour conquérir le pouvoir, produit des fake news (comme on dirait aujourd’hui) : chez Shakespeare, on trouvait déjà tout ce qui est actuel comme l’écrivait Karl Kraus en 1933 ! Coproduit avec l’opéra de Nancy, le renfort de ses chœurs promet une impressionnante tempête initiale !
Pour les festivités de fin d’année, la reprise d’Hansel et Gretel d’Engelbert Humperdinck (7/12–11/01), présenté en streaming en 2020, ne dépaysera pas le public (à partir de 8 ans) puisque, dans sa mise en scène, Pierre-Emmanuel Rousseau remplace le pain d’épice par le spectacle forain.
Deux raretés ouvriront l’année 2026.
En création française, Le Miracle d’Héliane d’Erich Wolfgang Korngold (21/01–1/02, seulement à Strasbourg) bénéficie de l’orchestration rutilante d’un compositeur qui, ayant fait les beaux jours d’Hollywood (deux oscars), dépeint une société dystopique.
En mars, le metteur en scène Olivier Py fera renaître Le Roi d’Ys d’Édouard Lalo (11–29/03), un opéra populaire jusqu’à la fin des années cinquante, tombé en désuétude depuis…
Le second classique de la saison, Les Noces de Figaro (28/04–31/05), sera confié à une jeune distribution dont quelques anciens de l’Opéra Studio.
Ce dernier proposera une nouvelle production de chambre : Les Mamelles de Tirésias de Francis Poulenc (8–27/03) sur un livret loufoque et surréaliste d’Apollinaire. Proposée dans l’adaptation pour deux pianos de Britten, elle voyagera avec l’Opéra Volant en 2026.
Les jeunes chanteurs reprendront dès novembre dans la production créée en 2024 Les Fantasticks (4/11–5/12), grand classique de la comédie musicale.
Et c’est avec ce goût assumé pour Broadway (avec encore en ce mois de juin 2025 Sweeney Todd de Sondheim), qu’Alain Perroux conclura son mandat : Follies de Stephen Sondheim (7–23/06) coproduit avec le Châtelet et le Grand Théâtre de Genève, mis en scène par Laurent Pelly. Un feu d’artifice qui associe toutes les forces vives de la maison et dont l’action est une célébration en forme d’adieu à un théâtre voué à la démolition. Tout un symbole.
Côté danse, Bruno Bouché bénéficie d’une ample programmation et y affirme son attachement à la peinture.
La proposition « chromato-chorégraphique » All Over Nymphéas d’Emmanuel Eggermon (13/11–12/05) permet une première collaboration avec Pôle Sud et sera présentée lors de la Quinzaine de la Danse (Mulhouse).
Caravage (25/03–1/04), la 6e création de Bruno Bouché à l’OnR, sera dansé par le Ballet du Théâtre de Chemnitz (ville jumelée avec Mulhouse) avec l’envie de transcrire par le geste et le corps la puissance et la sensualité qui émanent des toiles tourmentées de l’Italien. Les musiques seront, pour la plupart, d’époque (Monterverdi…).
Et dès septembre…
En regard (18–29/09) mettra la tradition créole de Léo Lérus avec une sensibilité plutôt intimiste en écho avec l’impressionnante énergie collective de Sharon Eyal (cf. Love Cycle à La Filature en 2021).
Bryan Arias créera Hamlet (30/01–13/02) en insistant sur le rôle des femmes dans cette tragédie tendue par des musiques de Sibelius.
Pénalisée par les restrictions lors de sa création, Danser Mozart au XXIe siècle (Rubén Julliard / Marwik Schmitt) sera repris en mai (21–20/05).
Enfin une coréalisation avec La Filature promet un final de saison spectaculaire (11–27/06) : Tero Saarinen, Dominique Brun et François Chaignaud poseront un nouveau regard sur les chorégraphies de la compagnie des Ballets russes de Diaghilev qui a bouleversé la danse au début du XXe siècle.
Sans oublier les récitals : Christian Immler & Julie Depardieu, Marina Viotti, Sabine Devieilhe, Pene Pati, Huw Montague Rendall.
Ainsi que la participation aux Festival Musica (19/09–5/10) et Arsmondo consacré aux Îles (12–22/03) ainsi qu’à la Quinzaine de la Danse (6–22/03) sur le territoire mulhousien.
Souscription des abonnements et billetterie en ligne sur le site de l’OnR.
le projet de rénovation, horizon 2033…
Le bâtiment de la place Broglie est en délicatesse avec les normes depuis 1997, aussi cette rénovation figurait en bonne place dans le programme de l’équipe municipale actuelle.
Des expertises patrimoniales, techniques, financières approfondies avec des préfigurations ont permis d’éclairer la prise de décisions.
Un premier arbitrage a écarté la solution la plus onéreuse : une nouvelle construction sur un autre site. Par contre, plutôt qu’une mise aux normes plus ou moins ambitieuse, les partenaires institutionnels et en concertation avec l’opposition municipale ont choisi un remaniement en profondeur pour un confort optimal du public : visibilité, acoustique & accueil. Alain Perroux insiste sur ces aspects assez déficients actuellement légitimant le passage d’une jauge de 1 100 places à 940.
Pour le public, les saisons se dérouleront sans changement notable jusqu’à celle de 2027–28 incluse, ces trois années permettront à la fois d’adapter le Palais des fêtes pour l’accueil d’une grande partie des spectacles et de mener, jusqu’en février 2027, un « dialogue compétitif » qui préserve une maîtrise plus fine qu’un simple concours d’architecture. Suivront le chantier (avec notamment un rehaussement de cinq mètres du toit actuel) et cinq saisons hors-les-murs avec une réouverture programmée à l’automne 2033.
Et pour mémoire :
Chrysoline Dupont succèdera le 1er juillet 2026 à Alain Perroux, comme directrice générale de l’Opéra national du Rhin (communiqué de presse du 5.07.2024).
de l’autre côté du miroir

Mémoires Croisées
Raymond E. Waydelich
#EXPOSITION
Drusenheim, Espace d’Art PASO du 30 avril au 22 mai 2025
commissaire Germain Roesz, catalogue 44 p.
L’exposition, tout comme le catalogue, a été élaborée en étroite collaboration avec l’artiste puis repoussé en raison de ses problèmes de santé : Raymond tenait à être présent à l’accrochage, au vernissage… Suite à sa disparition en août 2024, elle s’est transformée en hommage au « marchand de bonheur ».
La Fondation Fernet-Branca consacre également une importante exposition à Raymond E. Waydelich (avec Christophe Hohler) jusqu’au 31 août 2025 : anonymous-famous. Une grande salle à l’étage est consacrée à ses boîtes reliquaires dont certaines n’ont jamais été exposées.
Un texte sensible et juste de Jean Christian ouvre l’exposition vers quatre lithographies rares prêtées par Pierre Gangloff (des Pattern Painting de 1973) et une boîte reliquaire datée de 1977 : une merlette (sans doute) « crucifiée » de dos et coiffée d’un haut bonnet conique fabriqué à partir d’une page imprimée, le bec dépasse sur la gauche.
Cette tête becquée coiffée d’un capirote semble une préfiguration miniature de celle de L’homme de Frédehof (Venise, 1978) dont le corps par contre est humain.
Ici comme dans l’installation vénitienne, le capirote rappelle ceux portés par les pénitents en Espagne (cf. Goya) et plus tard les membres du Ku Klux Klan – l’indice d’une meute incontrôlable susceptible de coups de folie collective. Le long bec de Frédehof évoque ceux utilisés par les médecins, remplis d’aromates, notamment lors des épidémies de peste du XIVe au XVIIe siècle (Doctor Schnabel). L’environnement de l’installation vénitienne où trône le personnage est celui d’après une catastrophe. Les choix de Raymond pour le traitement du protagoniste semblent suggérer qu’il est à la fois le (co)responsable et la victime de ce désastre.
Pour mémoire, en ces années-là, un conflit nucléaire restait une éventualité tangible (crise des euromissiles en 1977) et des alertes aussi claires qu’énergiques pointaient les risques liés tant à la pollution qu’aux ressources limitées de la planète (Le Printemps silencieux de Rachel Carson date de 1962, le rapport Meadows de 1972, etc.). Et la catastrophe hante en prérequis son projet Mutarotnegra (1995)…
Le dispositif a été démantelé après la Biennale, mais l’inspiration mémorielle et les questions restent palpables dans les boîtes reliquaire qui sont des installations domestiques, miniatures, « portables » aussi comme La Boîte-en-valise (1949) de Marcel Duchamp que Raymond admirait : Il cassait la baraque (interview de mai 2021). Sauf que lui en profite pour déployer l’univers de Lydia Jacob : celui de la génération de ses grands-parents, celui de gens modestes qui vivaient chichement et dont l’esprit de vie survivrait jusqu’aux années cinquante avant d’être balayé par l’essor de la société de consommation. Les rares objets que possédait cette génération (et qui duraient une vie entière voire plusieurs) seront peu à peu mis au rebut, jetés.
Un univers disparaît et Raymond, archéologue sensible et averti, en récupère des fragments devenus obsolètes ou désactivés par le progrès. Il les mue en œuvre, il les relie, les réordonne par la poésie et l’imagination en un monde fictif plus convaincant que le (dit) réel : une nouvelle vie, un nouveau sens (quelquefois du non-sens) esquissent des histoires souvent touchantes, quelquefois drôles. Le bonheur qu’il offrait naissait là, au-delà du parfum et de la densité du souvenir.
Pages illustrées, carte de géographie (ou à jouer) dressent un itinéraire à d’anciennes photos noir et blanc très posées, à des camées, des cadrans de montre derrière un bout de grillage de cage à poule rappelant l’ancrage dans la ruralité. Il y a des pinceaux, des couverts, des microsillons, des flotteurs de canne à pêche ou cette lame de scie à bûches ringardisée par l’abattage des tronçonneuses, mais anoblie par le geste du peintre.
Et s’il était très attaché au terroir, cette coloration reste discrète, beaucoup de pièces pourraient figurer à l’autre bout de la planète dans Le Musée du silence (2000) ou à côté des spécimens du laboratoire de L’Annuaire (1994), romans de la Japonaise Yoko Ogawa.
Ce goût du ludique n’évacue pas la dimension critique.
L’omniprésence de la numérotation, de ficelles et de sceaux, de tampons, de grillages donne classe et distinction à la logique d’inventaire et à l’obsessionnel administratif de tout contrôler (et ne rien maîtriser : les flèches pour orienter dans le désordre ambiant remplacent peu à peu les chiffres…).
Un merle brandissant du bec un transistor dans un environnement de pièces électroniques dénonce sans avoir l’air d’y toucher l’obsolescence extraordinairement rapide et la toxicité des déchets technologiques.
Ou cet acharnement de hache, scie, tarière à martyriser les livres (il y en a plusieurs sur un parterre voisinant avec des masques Thonet Afrika).
La récurrence des oiseaux naturalisés, de leurs ailes et plumes (et ces jeux de mots : se faire couper les ailes, y laisser des plumes ?) n’est guère étonnante : contrairement aux humains, ces animaux savent prendre de la hauteur, voir les choses que nous, le nez dans le guidon, ne voyons plus. Et que l’artiste sait aviver sous nos yeux !
La découverte en 1984 des silhouettes noires en Crète puis à Chypre (un petit truc qui déclenche…) lui ouvre d’autres perspectives : le trait vif et énergique du dessin propice au gisement imaginatif d’un humour cinglant. Naîtront les séries Kreta, Namibia et ce bestiaire qu’il décline en dessin et jusqu’aux dernières eaux-fortes, mais aussi avec les sculptures en tôle découpée.
Au centre de l’exposition, ce chat au regard avide vers la souris à ses pieds et souligné par un sourire carnassier tout en dents nous raconte – avec un clin d’œil à Tex Avery – l’humaine condition aussi bien que ces vers de Friedrich Schiller (Das Lied von der Glocke / Le chant de la cloche, 1800) :
| Gefährlich ist’s den Leu zu wecken, Und grimmig ist des Tigers Zahn, Jedoch der schrecklichste der Schrecken Das ist der Mensch in seinem Wahn. | Réveiller le lion est périlleux, Et redoutable est la dent du tigre. Mais la plus terrible des terreurs, C’est l’homme dans sa folie. |
En août 2024, un article rendait hommage à Raymond E. Waydelich et détaillait son itinéraire et la singularité de son travail.
Plus récemment, en avril 2025, est parue dans L’imaginaire artistique d’un Musée Zoologique, Une vie rêvée qui évoque ses installations en dialogue avec la faune naturalisée du Musée Zoologique de Strasbourg (1981).
images de l’hédonisme

Garden–Party
fleurs et jardins dans la Collection Würth
#EXPOSITION
Erstein, Musée Würth du 27 avril 2025 au 4 janvier 2026
catalogue en allemand (avec livret en français) 208 p., 30 €
entrée libre du mardi au samedi, de 10h à 17h, de 10h à 18h le dimanche
En puisant dans son fond de quelque 20 000 pièces, la Fondation Würth élabore des expositions thématiques ou monographiques qui voyagent ensuite dans ses douze autres musées en Europe.
Si Art Brut (2023) était une initiative du musée d’Erstein, Garden-Party est la déclinaison de : Rosen rot Gras grün Quitten gelb, Les secrets des plantes dans la Collection Würth présentée à la Kunsthalle Würth, Schwäbish Hall en 2023. Entre fascination et exploration, une quarantaine d’artistes tentent de nous dévoiler leur perception des mystères du végétal…
La délectation analytique ouvre l’exposition avec les radioscopies d’Azuma Makoto (X-ray Flowers, 2021) qui voisinent avec l’accumulation taxinomique d’herman van vries (les 123 cadres de From the laguna of Venice, a journal, 2014) et la subtile précision digne de planches botaniques des Tulipes (1983 & 2001) de Jan Peter Tripp et des Orchidées (1985) de Paul Wunderlich. Pour Pflanzturmkonstrukt (2010), Gunther Damisch réélabore habilement le réel avec un assemblage architecturé d’éléments végétaux… coulé en bronze.
L’hédonisme capiteux de Marc Quinn prend ensuite largement ses aises et face à la luxuriance de ses grands formats, personne ne pourra ignorer que la fleur est un organe sexuel ! Ses roses sont l’alibi ludique pour érotiser la pinup dont l’oreiller est un quartier de viande… (The Living and the Dead, 2012) De même ses trois sculptures, des têtes mangées par le végétal, évoquent plus un accouplement que la dissolution du corps qui retourne à la poussière.
Dans l’hommage à Monet qui conclue le rez-de-chaussée, Alex Katz préserve surtout le motif des nymphéas avec une grâce aérienne quand il privilégie les tons lumineux (Boutons d’or, 2009, sur la mezzanine), mais avec une netteté stricte quand il impose le fond noir (Hommage to Monet 6, 2009). Sonia Streng accède à la complexité de l’impressionniste en ouvrant de chatoyantes épaisseurs de sous-bois entre ses hautes herbes (Wiesen und Feldbilder Nr.1, 2004).
À l’étage un premier cabinet accueille des pièces plus anciennes issues de la sphère germanique qui travaillait à un « après impressionnisme » tout en se méfiant de l’influence parisienne… Ils traitent pourtant les mêmes sujets – des jardins quelquefois très fréquentés, des parterres de fleurs ou de simples bouquets –, mais d’un geste qui donne envie de s’attarder : la subtilité de la touche, la juxtaposition fine et vive des coups du pinceau, du couteau – Max Liebermann, Ernst Ludwig Kirchner, Oskar Kokoschka – ou d’aplats plus francs et nets pour trouver la résonance juste – Gabrielle Münter qu’on retrouvera dans le second cabinet (Stillleben mit Holzente, vers 1930) à côté de l’exubérant Lovis Corinth. Dommage que les Erick Nolde, Franz Marc qui figuraient dans la première édition en Allemagne (cf. catalogue) soient absents (de même que les Hockney).
Le parcours suit la chronologie et le figuratif laisse la place à un jeu s’appropriant cet inépuisable gisement de formes et de couleurs. La ludique géométrie de Johannes Itten décline les quatre saisons (1963), l’ocre lumineux du Mittelstrom (2004) de Gunther Damisch est particulièrement mis en valeur dans la perspective sur une paroi noire…
Les acquisitions plus récentes reviennent vers des éléments plus familiers : Nicole Bianchet travaille le support au cutter produisant scarification et échardes avec des saillies de tiges et de fanes apaisées de peinture aux tons sourds suggérant un univers plus rugueux que bucolique (Tell tale & Blaue Blume riecht man nicht, 2009). Presque l’inverse du jaillissement de Saeko Takagi (Twilight Picnic – Purple, 2017) où l’exubérance multicolore emplit la toile du joyeux débordement d’une nature inventive et proliférante.
Le second cabinet accueille des « classiques » plus tardifs : Jean Fautrier, Richard Mortensen, Günter Grass, Victor Bauer, Bernard Buffet…
La matière champêtre très figurative de L’herbier démesuré créé par Garance Coppens (étudiante en didactique visuelle à la HEAR) raccompagne le visiteur qui peut prolonger la Garden-Party en musardant au gré des quatre saisons (l’exposition dure jusqu’en janvier) dans l’écrin de verdure de cinq hectares au sud du musée.
éruptive liberté

Medardo Rosso
L’invention de la sculpture moderne
#EXPOSITION
Kunstmuseum Basel | Neubau du 29 mars au 10 août 2025
commissaires Heike Eipeldauer (mumok, Wien) & Elena Filipovic (Kunstmuseum Basel)
catalogue très exhaustif sur le peintre en allemand ou en anglais, 500 p., 59 CHF
du mardi au dimanche de 10h à 18h (20h le mercredi)
Cette monographie, déjà présentée à Vienne (18.10.2024–23.02.2025), bénéficie des cinq années de recherche et de préparation d’Heike Eipeldauer, directrice générale adjointe du mumok. C’est aussi la première comme commissaire d’Elena Filipovic au Kunstmuseum Basel dont elle a pris la direction en 2024.
D’origine italienne, Medardo Rosso (1858–1928) a vécu une trentaine d’années à Paris et a notamment influencé Rodin (pourtant son aîné de 18 ans). Il utilisait les innovations techniques de l’époque (en particulier la photo), représentait volontiers les petites gens et organisait même des performances privées dans son atelier. Un défricheur important mais rarement montré et peu documenté. L’exposition du Neubau répare cette injustice et permet de découvrir en majesté ce passeur entre l’impressionnisme et la modernité.
la terre palpite
enfante un visage
un éveil
en surprise en immédiateté
en sourire souvent
quelquefois ils éclosent par paire
mère et enfant
en émouvante promiscuité
le regard mémoire capte
la main trace et pétrit
geste éruptif
capturant l’apparition
en fougueuse invention d’un gisement de matière
en sensible empathie d’un être miroir
frémissant et offert
la cire sur le plâtre
si souvent
avec le soyeux de la peau
et une chaleur sensible
que n’a pas le marbre
beaucoup d’enfants
Ecce Puer
joyeux pied de nez de l’anarchiste
à l’Ecce Homo
des mères
et des prostituées
des malades aussi
et des petites mains
concierge bookmaker sacristain
des épiphanies
en lave ascensionnelle
défiant le temps
et l’équilibre
un organique jaillissement
sédimenté en corps
entier ou pas
en oblique ou soutenu
toujours en fragilité
car le monde est fragile
s’y tenir droit relève de l’exploit
que le rire sanctifie d’un éclat
Medardo Rosso n’apprécie guère le marbre : une sculpture ne doit pas glorifier le marbre de Carrare. Et la logique de soustraction de la pierre réduit les possibles. Lui privilégie la cire (sur une âme en plâtre si la pièce est grande), la facilité mais surtout la fragilité, la sensualité de l’efflorescence, la magie du dévoilement afin de faire oublier la matière. Et puis ce déséquilibre inspirant (et qui a inspiré Rodin…).
Dans la première salle (RdC), le visiteur ne se pose pas la question du matériau, il est saisi par la fougue, l’expressivité, le frémissement des pièces et cette texture dorée de la cire qui capte la lumière : beaucoup de têtes et de bustes, en naissance et en sourires ! L’audace se mêle à un sentiment d’ancrage : comment ne pas penser à des fragments de statues antiques exhumées ? Et il est possible de tourner autour des œuvres qui s’affichent sur leurs socles avec les renforts, les cales. Une petite trahison (voulue) de la part des commissaires : l’artiste était très attentif à la mise en scène.
Lors des expositions, il installe ses œuvres de façon à dissimuler ces constructions de maintien. Souvent il les cadre avec des cages vitrées sur chevalets pour orienter le regard, déligner l’environnement. Il les met aussi en dialogue (les siennes – en réel ou en photos – avec celles d’autrui) comme ici son Portrait d’Henri Rouart (1890) exposé aux côtés du Torse (1878–1879) de Rodin et des Cinq baigneuses (1885 ou 1887) de Cézanne.
À l’étage, les commissaires préservent cet esprit de « conversation » et prolongent les pistes ouvertes vers la modernité par des jeux d’influences et de filiations en puisant dans les collections des deux musées (mais pas que). L’importance de l’environnement, cet art de l’air avec Giacometti, les inclinations et la recherche de l’épure avec Brancusi, la fragilité issue autant de la matière que du sujet avec Alina Szapocznikow et son visage christique (Glowa Piotra, 1972, résine polyester) ou la vitalité du mouvement avec la Danse serpentine de Loïe Fuller (1897-99, vidéo), etc. Plus de soixante artistes d’Edgar Degas à Olga Balema (née en 1984), de La Petite Danseuse de quatorze ans (1881) à Sin Pool (Plasmin, 2025, cour du Hauptbau) de Pamela Rosenkranz.
Cette sélection dresse un écrin délicat où s’épanouit la volubilité des 50 sculptures mais aussi des 250 clichés réalisés par l’artiste. Car à partir de 1900, le sculpteur utilise abondamment la photographie aussi bien pour retravailler ses œuvres que pour exposer les épreuves. Il varie les angles de prises de vues, modifie l’éclairage, recherche les changements d’expressions, d’autres dramaturgies. Ces créations à part entière sèment quelquefois le doute sur la taille réelle de la sculpture qui s’en trouve monumentalisée. Ses tirages (beaucoup d’origine) sont mis en écho des œuvres photographiées, mais aussi dans deux longues vitrines au rez-de-chaussée.
L’usage de la photo n’est qu’un aspect de son goût pour le multiple et la série. Au fil de sa carrière, Medardo Rosso n’a décliné qu’une quarantaine de thèmes auxquels il revient régulièrement : l’Enfant juif, Aetas aurea, La Rieuse, Ecce Puer… D’un exemplaire à l’autre, le matériau, des détails changent (quelquefois importants : la tête de la mère d’Enfant au sein (salle 9) disparaît). Souvent il réalise une version en bronze, s’occupant lui-même de la fonte selon la technique de la cire perdue.
Ses dessins (beaucoup non datés, salle 9) semblent tardifs et en balance avec la photographie : essentiellement des vues paysagères avec d’envoûtants jeux de masses – encres ou crayon griffonné pour sommairement remplir – qui délivrent des profondeurs, des amplitudes, suggèrent des saignées de lumière.
Cependant aucun opus emblématique ne s’est spontanément imposé au public lui permettant d’accéder à la notoriété. S’y ajoute sa brouille avec Rodin après le Balzac (il l’estime inspiré de ses travaux), ses idées plutôt anarchistes, son origine étrangère…
Mise en spectacle (il semble être l’inventeur de l’installation mélangeant ses créations avec des objets réels à la première Biennale de Venise en mai 1887), recherche, photographie et bien sûr sculpture, cette activité foisonnante et inventive se traduit surtout par des « petits » formats* souvent dans des matériaux dits pauvres qui assument les traces de fabrication, revendiquent l’inachevé, l’ébauche, très loin de la monumentalité, de la perfection factice et compassée de l’art officiel qui est susceptible de tuer ce qui respire l’énergie humaine, d’éteindre à la fois l’espérance et la peur sous l’empire de l’encre et du papier. (Joseph Conrad / La ligne d’ombre, 1916)
Medardo Rosso, était-il un artiste trop en avance sur son temps ?
Peut-être aussi… qu’il a sculpté trop de sourires !
* ses sujets sont grandeur nature en général, mais fragmentaires (têtes, bustes…) : de belles pièces « domestiques » alors qu’à l’époque les sculptures ont surtout vocation à garnir l’espace public (cf. celles de Bartholdi ou Les Bourgeois de Calais (cour du Hauptbau), le Balzac de Rodin…)
L’article est paru en juillet dans le trimestriel Novo n° 77 (p. 72 & 73).
#Autre contribution à cette postérité aussi méritée que nécessaire, l’important catalogue (500 p., 450 ill., 59 CHF) édité pour l’occasion sous la direction d’Heike Eipeldauer : la publication la plus complète à ce jour consacrée à Medardo Rosso.
#L’ART-Kuratorenpreis 2024 a été attribué le 10.04.2025 par le jury du magazine « art DAS KUNSTMAGAZIN » à Heike Eipeldauer pour cette exposition (récompense la plus prestigieuse pour un commissariat d’exposition de l’espace germanophone).
Depuis 1928, le Museo Medardo Rosso ouvert par son fils Francesco à Barzio (Italie) est dédié à l’artiste.
Ayant prêté beaucoup de ses pièces pour cette exposition, il est fermé jusqu’en septembre 2025.
la vie en [très] grand

anonymous-famous
Christophe Hohler & Raymond Émile Waydelich
#EXPOSITION
Saint-Louis, Fondation Fernet-Branca du 5 avril au 31 août 2025
commissariat Ute Dahmen
• catalogue trilingue (français, allemand & anglais) consacré aux travaux exposés par Christophe Hohler, 184 p., 25 €
• catalogue bilingue (français & allemand) édité pour la rétrospective des 80 ans de Raymond E. Waydelich à Offenbourg (D) en 2017, 192 p., 35 €
du mercredi au dimanche de 13h à 18h
2, rue du Ballon • 03 89 69 10 77 / info@fondationfernet-branca.org
Après une longue fermeture pour travaux, la Fondation Fernet-Branca avait retrouvé son niveau d’excellence avec l’exposition monographique L’ŒUVRE MESSAGIER (2024). Ce printemps elle confronte la vision de deux artistes importants ancrés dans le territoire rhénan et qui ont toujours été attentifs aux petites gens, aux anonymes : de leur réinterprétation de L’Angélus (J-F Millet, 1857–59) à Lydia Jacob, alter ego de Raymond E. Waydelich, ou à cette foule d’Hommes qui avancent (ou pas) de Christophe Hohler.
En écho à la société dans laquelle il vit, un artiste peut faire comme Shakespeare (ou Goya), montrer les violences, les meurtres, toute la barbarie qu’elle est capable de mettre en œuvre ou alors, comme le théâtre classique, évacuer chastement toutes les horreurs en coulisses et n’afficher qu’un présomptueux vernis de civilisation.
Christophe Hohler serait plutôt du côté de Shakespeare, sauf qu’en face, la société se revendique policée et suture consciencieusement par les discours le vernis qui craque de partout : si la violence n’est plus administrée aussi ostensiblement qu’il y a deux ou quatre siècles, elle a été externalisée, a élargi son périmètre et déployé des routines plus souterraines (tout aussi destructrices si ce n’est plus).
la vie est tellement violente, tellement plus violente que tout ce que je peux faire ! On est tout le temps assailli par la violence, et aujourd’hui, avec ces millions d’images qui viennent de partout, la violence est partout et permanente. Vraiment, je ne parviens pas à penser que mes toiles sont violentes.
Une réflexion que Francis Bacon livrait en 1992 à Michel Archimbaud… il y a plus de trente ans et aujourd’hui les millions d’images sont devenues des milliards !
transhumance
Et Christophe Hohler peint…
des hommes, quelques femmes quand même.
Seuls, à deux, en troupe. De face, de profil, souvent en marche, sinon debout ou assis, rarement en activité (il y a bien quelques musiciens, quelques pêcheurs…). Beaucoup sont peints en pied.
Par dizaines, ils hantent les cimaises : tout un peuple.
Et l’artiste creuse les expressions d’un geste nerveux et intense, il jette une ligne rapide, aérienne et torturée ou surligne, fourgonne une tête, une bouche autour d’un cri muet, charge jusqu’au presque noir hors duquel éclate quelquefois le blanc d’un œil qui interpelle le regardeur.
Les postures sont fatiguées accablées, les bras tentent de s’en extraire, d’aller au-delà de la carcasse, de trouver une amplitude qui en impose et par là révèle l’aura, la projette en reconquête de l’espace vital et mental qu’a confisqué cette violence travestie.
Une aura individuelle ou collective.
Elle se matérialise par ces éclaboussures – ce dripping –, cette matière vibrante grandissant les silhouettes : une révolte contenue qui déborde et s’insurge contre la violence subie, tente de s’en débarrasser comme un chien trempé qui s’ébroue ou un Prométhée qui secouerait des chaînes invisibles. Et sur les grands formats, coincés entre le ciel et la terre, réduits à cette ligne en stabulation masquant l’horizon, celle de détenus qui se débattent contre le fatum. (Affluence, 2019)
La vigueur du trait est expressive et… anonyme. Ses êtres sont présents avec densité mais peu identifiables (certains ont une barbe, un cigare…), on distingue un col un sac à dos, mais on ne pense pas aux vêtements – on dirait : ils ne sont pas nus ou alors habillés de peinture – et les quelques indices vestimentaires n’indiquent aucune époque, aucune géographie.
Par contre l’âme de chaque individualité est là : à nue, cinglée sur la toile, débordant de son aura !
Une aura en bataille où les éclats polychromes sont l’indice du combat contre l’adversaire invisible, où l’immobilité tendue du noir et blanc est bafouée par la couleur en taches mordantes comme une malédiction.
La plupart sont en déplacement, de nombreux titres l’indiquent : marcheurs voyageurs pèlerins ou traversée en fuite en marche… Une humanité de corps outragés égarés dans un espace linceul, mais toujours en quête avec quelquefois ces regards levés (Il se passe quelque chose dans le ciel, 2 toiles 2024 & 2025).
L’envie de ménager un modeste espoir ?
La présence oppressante d’un fond rouge, vert malachite ou nuit le ravale crûment.
Et quand un accessoire s’affiche, c’est une kalachnikov aux mains d’un gamin en miroir de son ballon de foot (Jeux d’enfants, 2007)…
Même les poissons ont leur pendant sans chair et tout en arêtes… (Poisson, 2 toiles de 2019)
Et le miroir s’invite en arbitre de ses Danses macabres (2018–2019). Loin des hétéroclites farandoles médiévales, c’est le face-à-face d’Hamlet avec le crâne de Yorick – celui de la tirade To be or not to be* – qui orchestre l’affrontement du rouge et du noir. De la nuit et du sang. Le rouge translucide du sang mêlé de sueur.
Mais tout n’est pas noir chez Christophe Hohler : profitant de l’ampleur du lieu, il voulait montrer une autre palette. Dès la deuxième salle, des vues de forêts, des sous-bois sombres certes mais enluminés de discrètes flaques dorées ; dans l’aile ouest, des fleurs et des violettes en petits formats très pop art dans la vivacité colorée et l’agencement en séries ; des musiciens dans l’espace au sud ; Les oliviers près de Cargèse, la cathédrale de Strasbourg à l’étage…
Et il y a des gestes d’affection : Assistance (2 toiles de 2022), 2 hommes en conversation (2022), L’étreinte (2023) et dans L’Angélus (triptyque, 2024), le couple de paysans ne prie pas comme chez Millet, mais s’étreint intensément : ils ont compris que le partenaire en chair et en os, hic et nunc, était le seul soutien possible et qu’il ne fallait rien attendre d’une entité qu’elle soit déique, étatique…
Si ses sculptures (terre cuite – vernissée en général – ou fonte) reprennent les mêmes thèmes, elles sont plus torturées que sa peinture. L’énergie du geste tourmente la matière au lieu de se prolonger en fusées et en tourbillons comme sur la toile. L’engobe est blanc, céladon, vert-de-gris… mais rouge pour la peau ! à moins que l’or (ou le rouille du métal brut pour les grands formats) ne prenne la main.
Dans Das Narrenschiff (2019), les fous ne sont pas typés et individualisés comme chez Bosch, mais, tout en cris et en agressive gesticulation avec des attributs de fétiches vodous, ils semblent emportés dans une folie collective dont l’issue est certaine : ils mènent l’embarcation vers le naufrage (sujet de 3 autres pièces… 2018 & 2023).
anonymous…
et ces anonymes marchent
car le monde est f(l)ou
et ils luttent pour ne pas devenir fous !
mais s’ils accèdent à la célébrité
ils le deviennent
famous…
* Être ou ne pas être : forme active (masculine ?) de la Melancholia ?
En peinture, la question mérite d’être réfléchie…
archéo-fiction
L’approche de Raymond E. Waydelich (qui se revendiquait « marchand de bonheur ») semble plus joyeuse et offrir un contrepoint facétieux au tragique du Sundgauvien, mais le caractère carnassier de ses créatures est bien présent et s’il s’en moque, c’est pour ne surtout pas le dénier.
Dans ses Angélus (deux canevas dénichés dans un grenier et amendés), la sérénité champêtre est compromise par les artefacts technologiques : avion dans le ciel, moto.
L’association des deux artistes est harmonieuse et quelquefois piquante. L’invitation leur avait été lancée pour 2023, mais, voisin et familier du lieu (de l’étendue de ses cimaises notamment), Christophe Hohler avait demandé du temps et ce report au printemps 2025. Entretemps Raymond est parti… et l’accrochage se transforme en hommage. La commissaire Ute Dahmen (qui connaît bien son travail) a sélectionné les pièces avec les proches de l’artiste.
La grande salle de l’étage (côté nord) présente beaucoup de boîtes reliquaires pour lesquelles Raymond avait une tendresse particulière – certaines n’ont jamais été exposées. Elles sont liées à Lydia Jacob (son arbre généalogique est présent à l’entrée), préservent en miniature l’esprit de L’homme de Frédehof (Venise, 1978) et déroulent cette fabrique d’archives fictives, mais touchantes et justes : elles sont nourries d’objets quotidiens liés à des souvenirs d’enfance, de voyage, à des habitudes, un savoir-faire, des objets familiers et poétiques mais souvent disparus ou voués à l’oubli.
Ses autres travaux sont accrochés en dialogue avec ceux de son collègue et ami : quelques Memories painting (en bas), des collages, des dessins, des gravures… mais peu de sculptures.
Une exposition dense, riche, avec des grands formats, aussi impressionnante par la quantité des pièces que par la qualité des deux artistes.
L’Espace d’Art PASO à Drusenheim (67) consacre également une exposition à Raymond E. Waydelich jusqu’au 22 mai 2025 : Mémoires Croisées, (l’analyse sur les boîtes reliquaire y est plus approfondie).
En août 2024, un article rendait hommage à Raymond E. Waydelich et détaillait son itinéraire et la singularité de son travail.
Tout récemment, en avril 2025, est parue dans L’imaginaire artistique d’un Musée Zoologique, Une vie rêvée qui évoque ses installations en dialogue avec la faune naturalisée du Musée Zoologique de Strasbourg (1981).
L’imaginaire artistique d’un Musée Zoologique
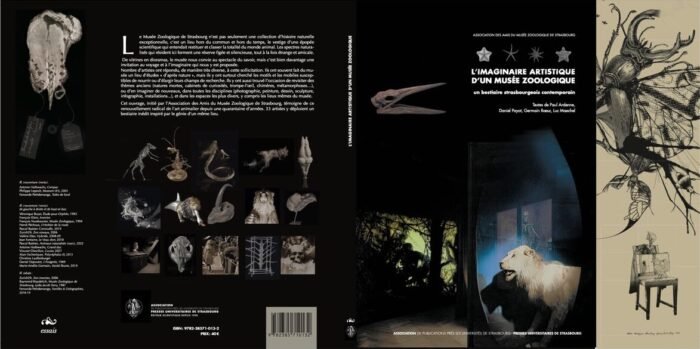
Un bestiaire strasbourgeois contemporain
textes de Paul Ardenne, Daniel Payot, Germain Rœsz, Luc Maechel
#LIVRE
chez Association des Presses Universitaires de Strasbourg, avril 2025 (Collection Essais : 144 p., 186 ill., 40 €)
#EXPOSITION
Strasbourg, galerie Chantal Bamberger du 17 au 31 mai 2025
Après une très importante compagne de travaux, le Musée Zoologique de Strasbourg rouvrira ses portes à l’automne 2025. L’Association des Amis du Musée a profité de cette longue pause pour revisiter l’histoire du lieu en élaborant cet ouvrage. Il met l’accent sur l’une des singularités de ses expositions temporaires : proposer à des artistes contemporains de mettre en écho leur travail avec les collections. Les textes et les images font revire ces belles rencontres entre art et science.
texte du 4e de couverture
Le Musée Zoologique de Strasbourg n’est pas seulement une collection d’histoire naturelle exceptionnelle, c’est un lieu hors du commun et hors du temps, le vestige d’une épopée scientiste visant à restituer et classer la totalité du monde animal. Leurs spectres naturalisés y forment une réserve figée et silencieuse, tout à la fois étrange et familière.
De vitrines en dioramas, le public y est convié au spectacle du savoir, mais c’est bien davantage une invitation au voyage et à l’imaginaire qui nous est faite ici.
Nombre d’artistes ont répondu, de manière très diverse, à cette sollicitation implicite. Ils ont souvent fait du musée un lieu d’études « d’après nature » mais ils y ont surtout cherché les motifs et les mobiles susceptibles de nourrir ou d’élargir leurs champs de recherche. Ils y ont aussi trouvé l’occasion de revisiter des thèmes anciens (natures mortes, cabinets de curiosités, trompe-l’œil, chimères, métamorphoses…), ou d’en imaginer de nouveaux dans toutes les disciplines (photographie, peinture, dessin, sculpture, infographie, installations…), et dans les espaces les plus divers, y compris les lieux mêmes du musée.
Cet ouvrage, initié par l’Association des Amis du Musée Zoologique de Strasbourg, témoigne de ce renouvellement radical de l’art animalier depuis une quarantaine d’années. 32 artistes y déploient un bestiaire inédit inspiré par le génie d’un même lieu.
Les artistes ayant exposé au Musée Zoologique et dont le travail est présenté dans le livre ont exposé certaines de leurs pièces à la Galerie Chantal Bamberger du 17 au 31 mai 2025.
l’appel du large

Jérémy Fisher
de Mohamed Rouabhi
#THÉÂTRE
représentation du jeudi 3 avril à l’Espace 110 (Illzach)
en tournée à partir de septembre 2025
Pour leur création 2025, Thomas Ress, directeur de la maison, et sa Compagnie des Rives de l’Ill s’offrent un dispositif bi frontal immersif construit expressément pour l’occasion.
La pièce est un conte, recommandé à partir de 12 ans pour 1h15, mais adapté à un public un peu plus jeune s’il n’est pas trop impressionnable (par le masque du médecin et les effets lumineux du cauchemar).
Le public est invité à prendre place sous une grande tente évoquant un bateau renversé avec une ouverture sommitale en forme de poisson : un orifice permettant à l’âme de s’échapper chez les animistes. Discrètement le sacral s’invite…
Des « projections » activent la toile écrue de cette nef – la noyade de Foster (récit de Tom), l’échographie de Jodie, l’irruption du cauchemar, le final… Un dispositif scénique acteur à part entière du spectacle.
Cette mise en vibration immersive de l’espace entre ténèbres et lumière avec ombres chinoises, effets kaléidoscopiques, faisceaux traqueurs… est le fruit d’un subtil jeu de manipulations assurées à vue par les comédiens et la régie.
Ludmila Gander l’amplifie d’une bande-son délicatement élaborée : bruissements, bourdonnements, bouillonnements, battements de cœur, glougloutements, etc.
La pièce se veut une ode au droit à la différence et met en scène une parentalité attentive et intelligente en cohérence avec la profondeur des sentiments et acceptant, accompagnant l’émancipation de leur fils qui veut/doit quitter le nid pour un autre destin : aquatique.
Jérémy (Nicolas Phongpheth) porte le récit en étant à la fois le narrateur et en jeu. Son autre destin s’invite par le biais d’une alter ego danseuse (Virginia Danh) – travail au sol à fleur du praticable jusqu’à leur conjonction finale.
Laure Werckmann et Fred Cacheux donnent une certaine épaisseur humaine à Jodie et Tom, les parents de Jérémy, des personnages peu complexes et sans beaucoup d’interactions. La confrontation au monde est croquée par deux figures de grotesques : le médecin avec son masque bec d’oiseau médiéval et sa perche échographique (Philippe Cousin), puis le commis voyageur en aquarium (Jean-Pierre Verdeilhan), farfadet particulièrement envahissant (Comment s’en débarrasser ?). Accessoirement Jérémy évoque la proposition du directeur de la piscine qui veut le transformer en attraction de cirque.
Ces scènes plutôt humoristiques suggèrent (discrètement) la tentative de la science de régenter les vies et celle du marché de tout transformer en espèces sonnantes et trébuchantes.
Pas sûr par contre que Mulder et Scully parleront aux plus jeunes… (scène du cauchemar)
Le texte de Mohamed Rouabhi est linéaire et lisse. Sa langue est simple mais sans la subtilité allusive d’un Mæterlinck qui savait ouvrir de déchirants abîmes sur le sens de la Vie et les impasses de la destinée (Pelléas et Mélisande est aussi une histoire d’altérité…).
En embarquant le spectateur dans cette nef chaleureuse rendue envoûtante par des techniques traditionnelles au théâtre et qui savent vivifier un autre monde, Thomas Ress et son équipe donnent un charme inventif et poétique, drôle par moments, à cette fable et à son message de bienveillance.
Mais comme l’écrivait Adam Smith : Ce n’est pas de la bienveillance du boucher, du marchand de bière et du boulanger que nous attendons notre dîner, mais bien du soin qu’ils apportent à leurs intérêts. Nous ne nous adressons jamais à leur humanité, mais à leur égoïsme.
avec Nicolas Phongpheth, Laure Werckmann, Fred Cacheux,
Jean-Pierre Verdeilhan, Philippe Cousin, Virginia Danh
mise en scène Thomas Ress
scénographie Antonin Bouvret
création musicale Ludmila Gander
dunkle Sehnsucht*
* sombre nostalgie/désir (terme très utilisé par les Romantiques allemands)

Le Misanthrope
de Molière
#THÉÂTRE
représentation du vendredi 28 mars à la Comédie de Colmar
Simon Delétang a une histoire complexe avec Le Misanthrope. La première scène avec Célimène (AII, s1) lui a ouvert les portes de l’ENSATT, mais ensuite des rendez-vous manqués ont contrarié son envie de le jouer, de le monter jusqu’à cette production. Un temps long pour mûrir la pièce et son personnage emblématique : un « Héros romantique absolutiste », « le plus beau personnage du théâtre français » « en avance sur son temps ».
Des convictions qui innervent fortement son spectacle créé au Théâtre de Lorient – CDN en octobre 2024.
un parfum d’écurie
deux arrière-train de chevaux
et de la paille sous un portique à jardin
une porte basse dans le mur du fond
avec un escalier
une montée vers le SILENCE
c’est écrit en grande lettres capitales au-dessus
et deux bancs
un lieu où on passe où on vaque
avec énergie et vitalité
une chorégraphie enlevée
comme souvent chez Delétang
et on y parle
beaucoup
presque une arène de disputatio
où l’alexandrin semble une évidence
pour déployer les dogmes
et il en faut plusieurs pour qu’ils s’affrontent
que le « en société » vaille la peine
l’inverse du SILENCE placardé
un lieu d’intrigue et d’influence
de trahison aussi
bien plus dangereux qu’un café du commerce
avec l’hypocrisie en règle d’or
la polémique sur le sonnet d’Oronte (Gaël Baron) le confirme d’emblée
sauf que l’exigeante posture qu’Alceste défend est intenable
face à Célimène notamment
surtout
l’intimité s’accommode mal des dogmes
qui évacuent les sentiments voire l’humain
au fond tout cela n’est qu’un jeu
de vanités
et Célimène le sait et s’en amuse
ces WC qu’elle offre en sièges à ses invités
les piques qu’elle distille avec délectation
et tous savourent la grâce de sa férocité
sauf Alceste
Si l’argumentation patiente et raisonnable de Philinte (Julien Chavrial) qui prône le sincèrement hypocrite (ou l’hypocritement sincère) ne convainc guère Alceste, Célimène, plus pratique, jongle avec une habile mise à distance. Le « Demeurez » (AII, s3) qu’elle lance à son amant, Thibault Vinçon à la fois charmant et ébouriffant, vise à lui dévoiler le spectacle du jeu de dupes que sont les mœurs (et sa manière à elle d’en jouer) : un édifiant teaser plutôt qu’un discours abscons.
Sur ces bases, Leïla Muse compose une Célimène d’une nature saine et lucide (une forme de sincérité qui touche Alceste – malgré les compromis) et elle lui fait voir (comme avec des lunettes déformantes) tous ces gens tels qu’ils sont fondamentalement : des bouffons bouffis d’eux-mêmes. Ainsi des WC à la perruque de Clitandre (Yanis Skouta) en passant par les tics de petits marquis et le spectaculaire numéro de venimosité de l’Arsinoé de Déborah Marique. Une radioscopie qui suggère par l’exemple qu’il n’y pourra rien changer !
Dire du mal des autres est encore la plus grande récréation que l’homme social ait trouvée. (Edmond de Goncourt)
La musique appuie les traits grinçants de cette cour ou amplifie les moments de poésie, il y en a (ce rebec rudimentaire jouée par Fabrice Lebert en écho à Célimène).
Tous en rient y compris le public. Mais pas Alceste qui reste hermétique à la démonstration.
Or Célimène est encore jeune, elle veut prendre le risque de vivre pour quelques moments miraculeux (et garder espoir ?), aussi elle rejette la lente extinction sous l’ascèse rigide (et exclusive) que veut lui imposer l’intransigeant Alceste.
Absolutiste jusqu’au bout, il s’en va, monte vers le SILENCE.
La cloison tombe et ouvre l’espace : le Misanthrope est devenu Le Voyageur contemplant une mer de nuages de Caspar David Friedrich (1818). Une icône du romantisme.
Pendant quelques secondes, Alceste regarde le monde de haut, s’imagine le dominer peut-être… Mais la vraie vie n’est pas une toile de maître, la brume enfle et l’avale.
Le verbe… pour en faire quoi ?
Une tragédie de la conversation suggérait Vitez.
avec Thibault Vinçon, Leïla Muse, Julien Chavrial, Gaël Baron, Déborah Marique, Yanis Skouta, Romain Gillot, Pauline Moulène, Fabrice Lebert
mise en scène et scénographie Simon Delétang
lumière Mathilde Chamoux
costumes Charlotte Gillard
son Nicolas Lespagnol-Rizzi
lumière noire

Phèdre
de Jean Racine
#THÉÂTRE
représentation du mercredi 26 mars à La Filature, Mulhouse
en tournée jusqu’au 26 novembre 2025
Pour sa production de 2024, Matthieu Cruciani avait privilégié un décor très construit et baigné de soleil : une salle d’apparat s’ouvrant sur une terrasse avec vue sur la mer. Pour sa création 2025 (début février Le Cratère–Alès), Anne-Laure Liégeois fait à l’inverse le choix d’une version dépouillée : un plateau quasi nu dévoré par la pénombre. Les costumes contemporains, noirs et anthracites, amplifient cette froide austérité.
Deux manières de décortiquer les jeux de pouvoir et comment l’humain s’y fracasse !
trois canapés affrontés
un vaste tatami les sépare
trois clans enfermés
dans un des carceri de Piranesi dont on aurait évacué les structures labyrinthiques pour ne conserver que la lumière noire
des corps affalés livrés
à peine des corps
la viande disparaîtra très vite
les jambes de Phèdre sous le pantalon
le corps dans les jeux de pouvoir ne peut être qu’une loque
ou une arme (comme cette lame qui passe de main en main)
l’affirmation du pouvoir surgit de l’ombre
et y retourne
le temps de méditer le (sale) coup d’après
Thésée lui arrive de la salle
(il vient d’échapper aux ombres de la mort)
comme l’annonce de Panope juste avant
D’entrée Anne-Laure Liégeois déporte le dialogue d’exposition en salle (un peu moins audible du coup), un tunnel qu’assure Ulysse Dutilloy-Liégeois sans vraiment en résoudre le statut. Sur le plateau par contre, il sait donner consistance à son Hyppolite dépassé et trop tendre pour ces venimeux jeux stratégiques où il joue plutôt perdant. Théramène (David Migeot) saura l’anoblir avec un récit de sa mort enlevé mais plus hagiographique qu’ému – un joli rôle… épique par procuration.
Aricie est la plus lucide et parvient à esquisser un (minuscule) chemin. La blondeur de Liora Jaccottet détonne dans cet aréopage de sombres silhouettes et elle porte avec netteté cette détermination laissant peu d’espace aux conseils d’Ismène (Ema Haznadar).
Personnage calculateur, l’Œnone de Laure Wolf se démène, déverse son argumentaire nourri de logique dynastique, de tactiques manœuvrières… mais ne parvient qu’à lever les inhibitions de Phèdre catalysant la tragédie. Sa scansion des alexandrins (indice mécanique d’une rationalité désemparée ?) se heurte à l’engagement ordalique de la fille de Minos.
La lumière noire crucifie et la Phèdre d’Anna Mouglalis le sait, le vit.
Elle croule sous le poids de son corps, avance chancelante, désarticulée. Sa sombre voix d’alto fourrage sa blessure, musique rauque et ardente, fêlée sur la fin : un lamento avec des feulements et des insurrections où l’incarnation transcende la métrique des vers. Sa viande mourra au milieu de l’autel plateau. La veste tombe découvrant bras et épaules nus, livrant une carcasse démissionnée, un chiffon de chair : le seul corps en jeu, la seule qui avait osé toucher les autres. Et la terre…
Le Thésée d’Olivier Dutilloy est blanchi sous le harnais, un sexagénaire pétri d’une colère autoritaire, active ou rentrée, dont il cisèle les pulsations dictées par une intransigeance qui finit par le terrasser.
Le pouvoir décidément est bien ingrat.
La lecture d’Anne-Laure Liégeois est sobre, concentrée sur le texte, avec des manteaux qu’on enlève pour avoir l’impression d’alléger sa charge et des face-à-face comme deux aimants qui se repoussent au lieu de s’attirer.
Sur la grande (et haute) scène de La Filature, la folie du pouvoir déploie ses effluves délétères, mais cet écrin vaste et dru la confronte aussi au vertige de sa vacuité.
mise en scène, scénographie Anne-Laure Liégeois
avec Anna Mouglalis, Ulysse Dutilloy-Liégeois, Olivier Dutilloy, Liora Jaccottet, Laure Wolf, David Migeot, Anne-Laure Liégeois, Ema Haznadar
création lumière Guillaume Tesson
costumes Séverine Thiebault
transcender la transe

Naharin’s Virus
d’Ohad Naharin · The Batsheva Ensemble
#DANSE
représentation du jeudi 20 mars à La Filature, Mulhouse
en tournée jusqu’au 11.06.2025
+ Kamuyot (chorégraphie d’Ohad Naharin) en gymnase à Mulhouse, Colmar et Strasbourg par le Ballet de l’OnR du 23 avril au 18 juin
Le spectacle a été créé en mars 2001. Ohad Naharin et The Batsheva Ensemble l’ont recréé en 2014 et il est au répertoire de la compagnie depuis. Sa proposition est atypique : Cette pièce est un prologue. […] Ce que vous allez voir n’est pas une pièce. Ce soir on ne joue pas. […] on joue avec vous.
Le chorégraphe et les interprètes endossent avec force (et à leur manière) le projet de Peter Handke (Outrage au public) en installant une tension entre le plateau et ses danseurs, les mots dits ou écrits et le public en interface interpellée sur ses préjugés, ses habitudes, son statut…
lumière sur le plateau
s’y tortille une croix
mannequin simili-danseur
des boudins torturés par le vent sur une plage
déserte
le public s’installe en face
un confortable balcon
pour assister à la tempête ?
musique arabe clinquante et enlevée
la nuit tombe
souffle et sifflement du vent
torture du vide, de l’absence
du fond noir et mat
un corps phagocyté affleure
il s’y débat s’y frotte s’y contorsionne
accrochée à une craie
la danseuse trace une ligne blanche
un fil de lien
elle suit le contour de son bras
de sa souffrance
se hisse de cour vers jardin
lentement
elle réussit le mot VOUS
elle ne lâche pas la ligne blanche sur le tableau noir
dressé sur son extrémité à jardin
un coryphée
immobile en costume cravate
en mirador d’une cour de prison
il dit les mots de Peter Handke
ceci n’est pas un spectacle…
au compte-goutte les danseurs entrent
forment des couples des trios
le coryphée aussi les rejoint
il quitte son costume de mannequin acéphale
ils sont six quatorze dix-sept
ils écrivent
geste au sol et sur le mur
au fond tambourinement perlé des craies contre
ils écrivent le mot NOUS blanc sur noir
bientôt en anagramme PALESTINIA
de grandes lettrines sur toute la largeur du plateau
ils écrivent et affrontent le public
des détenus qui se débattent
en contention entre les mots et les spectateurs
intense présence des corps tout en largeur
alignés à face avec énergie et puissance
un second rang en quinconce
déplacements latéraux et gestes mimétiques
en raccourci d’un meneur
des cris des interjections des coups sur le sol
de pieds de mains
certains sautent se suspendent au fond
tournent le dos au public
Et toujours le texte de Handke…
Le plateau avec ses danseurs est un espace en énergique dialogue frontal avec les mots (écrits ou parlés) et le public interpellé en permanence et très directement par le coryphée (mais sans interactivité concrète). D’une scène à l’autre, d’une musique à l’autre, des mouvements, des attitudes, des gestes reviennent, prennent une autre couleur, portent une autre émotion (ainsi avec l’adagio de Barber). Et le dispositif est d’une belle et simple unité : un sol blanc cassé, des parois noires dont se détachent en contraste, comme des troncs de statues antiques, les danseurs avec leurs justaucorps chair (jusqu’au bout des ongles) dressés sur des collants noirs.
Vers la fin, obsessionnelle, maniaque, une danseuse trace un cercle autour du A – un Peace & Love runique –, celui d’anarchie, d’amour ?
À l’autre bout, une autre perchée et penchée frotte une tache rouge qui grandit, grandit.
Le noir et blanc des mots avec le rouge du sang.
Dans son texte, Handke questionne les mots.
Mais de quel côté sont les mots ?
La pièce est dense, forte, intrigante aussi : un morceau d’enfer qui brûle dans l’absence de tout parce que seules les frustrations du corps et les images obsédantes du rêve l’alimentent. (Pascal Quignard / L’amour la mer, 2022)
avec le Batsheva Ensemble, division junior de la Batsheva Dance Company
chorégraphie & scénographie Ohad Naharin
création musicale Karni Postel avec des musiques additionnelles
costumes Rakefet Levi
lumière Avi Yona Bueno « Bambi »
paix profonde

Planètes
de Jérôme Brabant
#DANSE
représentation du samedi 15 mars 2025 à l’Espace 110 (Illzach)
Créée en mai 2024 au Manège, scène nationale-Reims, Planètes est la première pièce de groupe de cette envergure dans le parcours de Jérôme Brabant. C’est aussi l’une des premières fois où il ne danse pas dans sa création. La chorégraphie est conçue pour être en totale symbiose avec la musique originale du duo Philip | Schneider, compositrices et chanteuses danoises.
premiers gestes dans le silence
intrusion timide
une femme seule
Ève cosmique en contre-jour
ses paumes tranchantes aux reflets argentés
forent l’espace
tracent le chemin
tirent le corps
en sourdine la combustion
grandit
mûrit une voix céleste
une syllabe unique et scandée
tendue et têtue
les mains impulsent la giration
emballent la gravitation
qui décroche les autres danseurs des flancs à cour à jardin
ils créent rejoignent le manège orbital
leurs mains leurs bras se tendent
cherchent l’espace
et le colonisent
bâtissent le non-vide
désamorcent le néant
les corps activent le spectre
de l’infrarouge à l’ultraviolet
avec leur académique moiré
corps et matière saisis dans des faisceaux rouge jaune vert
le vertige pendulaire des rondes ordonne l’espace
balise le temps
avec les ombres mouvantes en cadran stellaire
la modulation extatique s’amplifie en duo
le mezzo s’entrelace au soprano
les danseurs s’invitent en ison
en écho des bourdons vibratoires
trépidations ferroviaires
tourmente venteuse
grondement intergalactique
combustion (à nouveau)
les révolutions successives
disparition réapparition
se résolvent quelquefois en figure collective
ascensionnelle
comme émergeant de la magie des voix
témoins et satellites du sidéral brassage
des montées en éruption hypnotique
où le geste n’est pas en rythme avec la musique
mais semble naître de la transe sonore
s’épanouir en géante rouge
avant sa dissolution en naine blanche en trou noir
La chorégraphie de Planètes est (forcément) répétitive, obsessionnelle. La geste galactique portée par les danseurs se distribue d’un corps à l’autre, les coalise ou pas. L’entrecroisement centrifuge mené par les mains, des mains toujours actives et quêteuses, crée et cherche du sens…
Jérôme Brabant trouve des poses d’arabesques, de statuaire antique (discobole, guerrier couché…), de divinités égyptiennes, leur impulse une dynamique qui ici peut prendre son essor, aller au bout de l’élan… avant de se dissoudre.
La ductilité liquide de son travail inscrit dans notre mémoire le corps astral de ses danseuses et danseurs tels d’universels hiéroglyphes issus du temps, de l’espace : indices fragiles et mouvants de notre atavique tentative d’appréhender l’orientation de l’homme en lui-même et dans le cosmos, à partir du mythe et de la peur (Aby Warburg).
avec Alexandra Damasse, Valentin Mériot, Yves Mwamba, Emma Noël, Manuele Robert, Nina Vallon, Lucie Vaugeois
musique & chant Joséphine Philip, Hannah Schneider
conception & chorégraphie Jérôme Brabant
scénographie Jérôme Brabant, Françoise Michel
lumière Françoise Michel
un mantra du Care

Robot, l’amour éternel
de & avec Kaori Ito
#DANSE
représentation du 11 mars 2025 à l’Espace 110 (Illzach)
en tournée au Manège, Scène nationale de Reims le 28 mai 2025
Kaori Ito a été nommée à la direction du TJP, Centre Dramatique National de Strasbourg Grand-Est au 1er janvier 2023. Danseuse depuis plus de vingt ans (pour Decouflé, Preljocaj, Platel, Cherkaoui & Thierrée entre autres), elle a fondé Himé sa propre compagnie en 2015 et entamé une trilogie autobiographique dont Robot est le dernier volet. Depuis sa création en 2018, la chorégraphe reprend régulièrement le spectacle en tournée.
le piano saupoudre un ostinato teinté de romantisme
paix irénique de la nuit
avec le tourbillon cristallin des notes
la lumière éclôt délicatement
caresse une membrane
dorée comme le sable, elle pulse
l’ombre se joue du chatoiement
sculpte cette étendue palpitante
tandis que le tissu glisse vers le fond
dans le gouffre
la lumière sédimente une vaste surface minérale
percée d’orifices carrés anguleux
comme les tombes ouvertes par la parousie de Fra Angelico*
de l’une émerge un pied
prudent expressif
il se retire
plus loin pointe une tête un tronc
la moitié du visage est masqué
demi-masque couleur chair et plastique
le corps s’extirpe
essaye sa mécanique
ses mouvements sont un peu heurtés
il arpente l’estrade
quelques prothèses en plastique traînent
il en ramasse une
teste ce fragment d’exosquelette
un expédient pour prévenir la désarticulation
et assurer le fonctionnement au long cours
puis
impératif de robot au réveil
il attrape son smartphone
l’éclat de l’écran tétanise le visage
glaçante impérieuse
une voix synthétique égrène les injonctions
voix d’aéroport
voix lisant les items d’un agenda
dense débridé harassant
a rat race
une vie mécanique
le corps s’y conforme
joue cette vie-là
voix attendue aussi
le corps la bouche miment l’énonciation de consignes
jeu de rivalité avec la machine
rébellion minuscule
par l’humour souvent
en dépit de la contrainte
la personne la femme Kaori existe
Robot, l’amour éternel ne met pas en chorégraphie une danse de robot. La danse est le moyen de paramétrer le corps en mécanique destinée à abattre un emploi du temps. Une vie normale. Ou presque.
Le métro boulot dodo devient pour la danseuse en tournée à l’international avion boulot et pas dodo.
Et le Campo Santo de Fra Angelico se mue en radeau de la méduse où la naufragée trace un itinéraire où ni le corps, ni l’esprit ne trouvent le repos.
Abattage…
Alors la pulsion de mort pour rompre l’abrutissement ?
Les mots le disent, évoquent aussi ces petites morts : les pointillés lumineux d’une vie normale. Mais qui peinent à devenir une ligne de Vie…
Thanatos
Éros
La maternité précipite la rupture de cette logique, la commotion très concrète de l’accouchement surtout. Quoique : Je t’ai donné la vie. Je t’ai donné la mort.
Mais un fil de vie se dessine.
La voix synthétique et anonyme devient celle de Kaori enregistrée, puis sa voix devient réelle. Et elle interpelle le public.
Le doute demeure, sous l’ombre de la mort ?
Nouée en linceul, la membrane textile du début affleure à nouveau, traverse le plateau d’une tombe à l’autre. Kaori en galérienne l’active doucement, très doucement. En mode mineur au rythme lancinant du O Solitude de Purcell.
Éloge de la lenteur. Éloge de la paresse ?
Le repos enfin ? La mort joyeuse avec les derniers selfies couchée dans la tombe (pas de jugement dernier pour les robots !)
Noir morendo.
Et en conjuration : La danse est un mantra pour réparer les vivants (Kaori Ito).
Il convient de saluer le travail de Yann Ledebt qui, de sous le plateau, assure beaucoup de manipulations et la régie du spectacle.
* Le Jugement dernier conservé au musée national du couvent San Marco de Florence (tempera et or sur bois, 105 × 210 cm, 1431 – 1435)
avec Kaori Ito
manipulations et régie Yann Ledebt
texte, mise en scène & chorégraphie Kaori Ito
décor Pierre Dequivre, Delphine Houdas & Cyril Turpin
direction technique & création lumière Arno Veyrat
Angelus novus, speriamo

EXIT ABOVE d’après la tempête
d’Anne Teresa De Keersmaeker, Meskerem Mees, Jean-Marie Aerts, Carlos Garbin · Rosas
#DANSE
représentation du mercredi 5 mars à La Filature, Mulhouse
en tournée jusqu’au 7.06.2025
Avec son hypnotique immersion dans le blues, le spectacle d’Anne Teresa De Keersmaeker, Meskerem Mees, Jean-Marie Aerts, Carlos Garbin · Rosas créé à Bruxelles en 2023 inaugure la Quinzaine de la Danse à La Filature. C’est la première proposition d’une programmation particulièrement relevée cette année avec, entre autres, une soirée William Forsythe et The Batsheva Ensemble pour ne citer que les plus connus…
un danseur vient jusqu’en bord de scène
battements de mains
adressés
à la technique
au public
léger flou
voulu
avant le chaos
celui d’Angelus novus
Walter Benjamin pour les mots*
Meskerem Mees pour les dire
… du paradis souffle une tempête qui s’est prise dans ses ailes, si violemment que l’ange ne peut plus les refermer. Cette tempête le pousse irrésistiblement vers l’avenir auquel il tourne le dos, tandis que devant lui les ruines s’accumulent dressées jusqu’au ciel. Cette tempête est ce que nous appelons le progrès.
en sourdine un bruissement d’eau
contaminé par la mécanique
le danseur est toujours seul
les mouvements de ses bras travaillent le doute
au fond un voile écru monte vers les cintres
masque l’écran noir où s’écrivaient les mots de Benjamin
la machine à vent enfle le voile
houle textile
ample soyeuse avec des reflets argentés
scintillant vertige du déchaînement
ivresse dionysiaque
le son de la tempête enfle
souffle liquide et fabriqué
la mécanique de la machine à tempêtes
engloutit le danseur
vacarme du progrès ?
silence brutal
la fine toile tombe
black cube
la foule après la houle
avec le blues
le chant de Meskerem Mees
la guitare de Carlos Garbin
en sourdine souvent
le chaos se berce de sonorités mélancoliques
l’ardent désir du chaos est devenu nostalgie. Et il en sera ainsi jusqu’à ce qu’un vent terrible précipite dans l’oubli la majorité de l’humanité. Les survivants frissonneront au milieu du chaos. (D. H. Lawrence / Le Chaos en poésie, 1928)
un chaos insensible
et nomade
de la tempête de Benjamin
remontée vers celle de Shakespeare
à l’errance sur l’île du naufrage
la marche
et la quête
Dans le blues, les gens frappent des mains, tapent sur leurs cuisses, sur leurs jeans : c’est une participation à la fois individuelle et collective. (Anne Teresa De Keersmaeker)
Créer du collectif. Grâce au blues !
La chorégraphe dirige et fixe les élans, les précipite, les détourne aussi.
Irrépressibles pulsions vers l’après : trouver son lieu, trouver son âme.
Les bras prolongent les corps qui cherchent d’autres corps.
Et se trouvent quelquefois. Lien fugace, ineffable.
Des gestes de construction, en équilibre pour lutter contre le déséquilibre. Ensemble.
Ils sont jeunes, aiment la fête, en abusent quelquefois…
Les treize interprètes de Rosas – des grands, des petits, des peaux blanches ou noires, des hommes en jupes… – occupent tout le plateau : par ronde, par vague – fond/face, cour/jardin. Ils marchent, elles marchent.
Parfois Anne Teresa De Keersmaeker fige les postures : images gelées en photos souvenirs. Elle juxtapose les rythmes : des déplacements, des mouvements calés sur la musique et, en diffraction, certains courent, d’autres traînent, s’immobilisent.
Rien de classique, à peine trois porters, mais des jeux à terre, quelques acrobaties hip hop : trouver l’ancrage.
Une virtuosité contrapuntique. La houle humaine en intelligibilité. Il faudrait un troisième œil pour tout saisir, tout enregistrer…
Le tango est une pensée triste qui se danse disait Enrique Santos Discèpolo. Le blues de Meskerem Mees n’en est pas loin avec sa mélancolie, mais Anne Teresa De Keersmaeker sait briser cet envoûtement, planter des silences tendus, faire éclater des moments jubilatoires et enlevés, rendre complices ses anges.
Pour nous en sortir par le haut !
avec Abigail Aleksander, Jean Pierre Buré, Niklas Capel, Lav Crnčević, José Paulo dos Santos, Nathan Felix-Rivot, Carlos Garbin, Nina Godderis, Robson Ledesma, Meskerem Mees, Mariana Miranda, Ariadna Navarrete Valverde, Margarida Ramalhete
composition musicale Meskerem Mees, Jean-Marie Aerts, Carlos Garbin
paroles Meskerem Mees, Wannes Gyselinck
scénographie Michel François, lumière Max Adams, costumes Aouatif Boulaich
parfums d’enfance

Le Château des Carpathes
d’Émilie Capliez d’après Jules Verne
#THÉÂTRE
représentation du vendredi 28 février à la Comédie de Colmar
en tournée jusqu’au 26 janvier 2026
Dans la continuité de Little Nemo (2022), Émilie Capliez adapte Jules Verne avec l’envie de partager cet âge d’or du livre de jeunesse illustré (elle se réfère explicitement à l’édition Hetzel de 1892), d’autant plus qu’en s’appropriant les découvertes scientifiques, l’écrivain défriche le terrain au roman d’aventures, mais aussi policier, gothique, fantastique…
Respectant l’exigence pédagogique revendiquée par le Magasin d’éducation et de récréation où le roman a été publié en feuilleton, l’auteur contextualise précisément les lieux de l’action et, à la fin, fournit d’amples explications sur les inventions d’Orfanik l’âme damnée (et technique) du baron de Gortz.
La structure narrative du conte adoptée pour transposer le récit à la scène, s’en accommode et Fatou Malsert en narratrice s’en empare avec malice et énergie (elle incarne aussi une aubergiste pleine de bon sens).
Malgré tout le texte de la pièce aurait pu s’alléger encore plus : un siècle de cinéma s’est chargé d’établir la (mauvaise) réputation des Carpathes – et la première scène avec un plateau inondé de fumerolles l’expose très bien visuellement –, quant aux détails des technologies employées (nouvelles à l’époque), si le lecteur du livre peut s’en délecter, sur scène ils se dissolvent…
L’autre gageure de la transposition était d’offrir un espace aux nombreux lieux du roman : ceux du village, du château sans compter les maisons d’opéra des flash-back. La scénographie d’Alban Ho Van s’en acquitte avec fluidité : la plupart des éléments descendent des cintres et deux grands écrans verticaux mobiles racontent les montées au château. La Stilla se permet même un jeu sur l’avant/arrière du rideau d’avant-scène jouant la plasticité de l’espace.
Le nœud de l‘intrigue est la volonté concurrente du jeune comte de Télek et du baron de Gortz de s’approprier la Stilla une talentueuse cantatrice napolitaine, le premier par le mariage, le second par tous les moyens possibles… aussi ce dernier la traque de représentations en représentations – limite harcèlement –, à tel point que la jeune femme meurt en scène…
C’est là, avec la mise en musique par la compositrice de jazz Airelle Besson, que le spectacle est le plus réussi. Un trio – trompette (Oscar Viret), violoncelle (Adèle Viret) et piano (Julien Lallier) – accompagne les changements du décor, le passage du temps avec parfois des parfums de blues, de tango… À l’occasion, le trompettiste s’invite en confident, distillant sa plainte en écho aux tourments de l’un ou l’autre personnage. Emma Liégeois en Stilla s’affirme aussi chanteuse : en contraste à la rigoureuse netteté du piano, ses modulations expriment l’extatique déchirure de son être et fascinent autant les deux soupirants que le public du San Carlo.
Dans un autre registre, elle incarne une villageoise pleine d’allant.
D’une scène, d’un lieu à l’autre, les trois comédiens et les deux comédiennes endossent les nombreux rôles, rejoints au besoin par les trois musiciens.
Acteur expérimenté, Jean-Baptiste Verquin sait moduler son boitement selon qu’il joue le maire, le baron ou le colporteur. François Charron et Rayan Ouertani, membres de la jeune troupe, alternent vanité et couardise – propices à quelques traits d’humour – au gré des changements de costumes et de postiches.
Si la technologie qui s’amorce en 1892, est devenue invasive un siècle plus tard au point de remplacer progressivement l’humain, le conte tel que le monte Émilie Capliez ne s’ouvre pas vers ces abîmes… Mais toute la troupe prend visiblement plaisir à cette histoire qui se déplie comme un livre d’images.
lumière Kelig Le Bars
vidéo Pierre Martin Oriol
costumes Pauline Kieffer
extravagance & distinction

La Clef des songes
Chefs-d’œuvre surréalistes de la Collection Hersaint
#EXPOSITION
Riehen (Bâle), Fondation Beyeler du 6 février au 4 mai 2025
commissariat Raphaël Bouvier
catalogue bilingue allemand & français, 144 p., 58 CHF, 44 €
Parallèlement à l’exposition « Lumières du Nord », la Fondation ouvre ses cimaises à la Collection Hersaint avec une cinquantaine de tableaux.
Initiée dès 1921 avec Cage et oiseau (1920) de Max Ernst, Claude Hersaint (1904–1993) l’enrichit principalement d’œuvres liées au surréalisme. Proche d’Ernst et Hildy Beyeler, les choix du couple Hersaint divergent de ceux des galeristes bâlois, mais finalement le fond constitué par ces derniers les complète harmonieusement par amplification – Picasso, Miro – ou confrontation – Louise Bourgeois, Giacometti.
Après la sérénité fauve des forêts boréales canadiennes (Lumières du Nord, salle 9), il est possible d’accéder directement à la troisième salle de l’exposition. Le passage vers la sauvagerie du Picasso qui triture les physionomies (c’est après Les Demoiselles d’Avignon) paraîtra un peu rude. Mais seule La femme au chat (1937) est issue de la Collection, la Fondation complétant avec ses propres acquisitions. Ce portrait est celui de Paul Éluard déguisé en femme, une forme d’outrance ludique revendiquée par le Catalan.
Sinon les autres toiles accrochées – de Magritte à Dubuffet selon le parcours proposé – sont d’une grande délicatesse et s’accordent à l’exigence mentionnée par sa fille Évangéline : élégance et discrétion. Il est vrai que les œuvres s’invitaient en proximité quotidienne comme l’attestent les photos de leurs intérieurs, ce qui conditionnait forcément les choix.
Max Ernst est le plus représenté avec un panorama sur presque quarante ans de sa carrière (1920 à 1957) : L’Ange du foyer (Le Triomphe du surréalisme, 1937), d’une énergie sauvage mais finement élaboré – cf. les plumes comme les drapés – rejoignant l’exigeante précision du seul Dali présent (Le Jeu lugubre, 1929), les Noces chimiques (1948) plus mécaniques et articulées, ses jeux de formes et de couleurs (Une nuit d’amour, Loplop, Évangéline…) et surtout ses luxuriants et intrigants paysages dont les organiques et ascensionnelles proliférations rhizomateuses abritent dans leur ombre des yeux, des griffes, des créatures fantastiques [salle 4].
La ville entière (1936/37), pièce préférée du collectionneur est là. D’un avant-plan végétal touffu surgit une ville repliée derrière ses remparts : un îlot défiant et menacé…
Non loin, Le lion, ayant faim, se jette sur l’antilope (1898/1905, Fondation Beyeler) d’Henri Rousseau suggère le passage à l’acte…
Cet entre-aperçu latent et mystérieux – une vie sous la vie – est peut-être le fil conducteur des acquisitions.
D’ailleurs le collectionneur n’émerge que partiellement de l’ombre dans le portrait qu’en peint Balthus autre artiste très présent. La lascivité de ses trois nymphettes est interpellée par le trait nerveux, jaillissant d’Alberto Giacometti et l’aérienne chorégraphie de ses sculptures menant vers le prêt permanent des Hersaint à la Fondation : le monumental Passage du Commerce-Saint-André (1952–1954) dressé en majesté face aux baies nord et qui figurait dans l’exposition monographique de 2018.
La salle 8 rend hommage aux femmes très actives dans le mouvement surréaliste : trois Dorothea Tanning et son univers kafkaïen dont la Valse bleue (1954) et le Prométhée enchaîné (1953) par des barbelés de Toyen mis en regard avec deux pièces de Louise Bourgeois.
En tout 23 peintres sont exposés, notamment trois René Magritte dont La Clef des songes (1930) et autant de facétieuses compositions anthropomorphes de Victor Brauner.
Le fond Beyeler complète abondamment l’unique Joan Miró (Femme, 1934) ou Jean Dubuffet présent avec son délicat Personnage en ailes de papillons (1953) et L’homme de marbre (1955) dont le sourire enjoué clôture la présentation.
Banquier de profession, Claude Hersaint fréquentait volontiers les artistes, les galeries et les salons (celui de Marie-Laure et Charles de Noailles entre autres), mais restait à distance des coteries. Sa fille cite volontiers sa sentence : Quand les peintres se rencontrent, ils parlent d’Argent. Quand les banquiers se rencontrent, ils parlent de peinture.
Une lucidité qui serait le secret de sa distinction ?
Le catalogue est alphabétique (par peintres) et ne restitue que les pièces issues de la Collection Hersaint. Il inclut une interview par le commissaire d‘Évangéline Hersaint, fille des collectionneurs.
L’exposition est montée en étroite collaboration avec elle.
l’envers du décor

en retrait à droite l’Ange de l’Annonciation (école Hans Baldung Grien)
Verso Histoires d’envers
#EXPOSITION
Kunstmuseum Basel | Neubau du 1 février 2025 au 4 janvier 2026,
commissaire : Bodo Brinkmann
du mardi au dimanche de 10h à 18h (20h le mercredi)
entrée libre dans les collections en semaine à partir de 17h et le 1er dimanche du mois (sauf jours fériés)
La directrice du Kunstmuseum Basel, Elena Filipovic a permis à Bodo Brinkmann, conservateur Maîtres anciens, XVe–XVIIIe siècle, de mener à bien un projet qui lui tenait à cœur depuis longtemps : faire découvrir la face cachée d’œuvres appartenant aux collections du musée. Dans trois salles du Neubau, il a chorégraphié un dispositif permettant d’admirer 36 pièces datées du XIVe au XVIIIe siècle sous toutes les coutures : recto et Verso.
Après cette dernière exposition, il élaborera encore avec Anita Haldemann la nouvelle présentation des collections d’art ancien du Hauptbau où certains agencements réalisés pour Verso pourront trouver leur place.
Un musée décontextualise les pièces qu’il présente et d’autant plus quand elles sont anciennes induisant quelquefois une vue parcellaire. La partie occultée peut cependant avoir un rôle significatif dans l’usage de l’objet, éclairer son histoire ou celle du sujet portraituré…
Dans ce jeu d’avers et de revers, les retables dont les séquences de voilement dévoilement rythmaient le calendrier liturgique sont les plus spectaculaires. Peindre les deux faces des panneaux latéraux était nécessaire pour préserver la qualité de la dévotion et la faire vivre en fonction des circonstances : valoriser des saints particuliers, mettre en scène des sculptures dans un ensemble signifiant et aussi permettre aux donateurs de figurer par leur image dans l’espace sacré.
Quand un panneau est périphérique, la vénération veille à l’anoblir : un fond souvent incarnat avec des initiales (IM pour Iesus Maria, MRA pour Maria) ou un motif imitant la pierre, matériau noble utilisé pour les autels, ou le brocart.
La présence d’armoiries ou d’un monogramme permet d’identifier le propriétaire du tableau ou le sujet du recto dans le cas d’un portrait.
Des appropriations plus tardives s’opèrent aussi. Suite à un changement d’usage, l’autre face est peinte (volets d’un orgue) ou alors quelques décennies plus tard un artiste réutilise comme support une ancienne plaque de cuivre gravée tel Pieter Snyers pour sa délicate Nature morte avec des tiges de primevères et des légumes (1752) : l’ancien verso devient le recto…
Des inscriptions sont quelquefois ajoutées postérieurement, en général pour préserver un historique… ou ce cas interpellant : le revers du portrait en gentilhomme de Johann von Brügge (vers 1544). Trois ans après sa mort en 1556, les autorités bâloises découvrent que sous ce faux nom prospérait David Joris recherché comme hérétique et chef de secte anabaptiste. Condamné à titre posthume comme « archi-hérétique », sa dépouille est exhumée, brûlée avec ses écrits et un placard est apposé au dos de son effigie avec la sentence en latin et en allemand.
Parfois le revers s’efforce d’imposer une image édifiante : une prostituée aguichée par un squelette (une métaphore des maladies vénériennes) traitée presque en miroir au verso de l’effusion érotique de Bethsabée au bain (Niklaus Manuel dit Deutsch, 1517)……
Enfin, de par son statut, l’enseigne est traitée sur les deux faces, mais celle des frères Holbein relève sans doute d’un hommage à leur professeur, Oswald Geisshüsler, dit Myconius, lorsqu’il quitte Bâle en 1516.
Cet accrochage bâlois montre de la très belle peinture et permet de découvrir autrement Baldung Grien, Cranach, Holbein, Snyers, Stimmer, Witz… pour ne citer que les plus connus.
Le dispositif est un doux labyrinthe où le regard croise celui des visages peints et participe à ces échanges d’une toile à l’autre où les personnages observent la scène voisine, où les animaux sont souriants, les tissus voluptueux, les chevelures ciselées de reflets dorés, où les expressions sont chargées d’empathie et portées par cette ineffable chorégraphie des mains vecteurs d’une sérénité qui plonge le visiteur dans une paix presque surnaturelle (Siri Hustvedt).
Et puis ces versos rendent perceptible l’émouvant passage du temps – un sourire surgissant d’un vêtement écaillé, un corps tronqué par une reprise, l’évanescente empreinte d’une scène presque fondue dans le support –, d’autant plus que cette fragilité de la trace est affrontée à l’éclat triomphant du recto avec le bleu, le vermillon des costumes et le rose onctueux des chairs !
rendre dicible

1972
de Fred Cacheux, Nils Öhlund
#THÉÂTRE
représentation du vendredi 31 janvier à l’Espace 110 (Illzach)
Dans le programme, la présentation de la pièce évoque le rapport Meadows, l’âge des comédiens, les problèmes liés au climat (Un écran soutient les démonstrations…) laissant imaginer une production sérieuse voire aride.
Le spectacle est tout l’inverse (le rapport ne sera évoqué qu’au bout d’une heure) et s’il part dans tous les sens, c’est pour nous interpeller certes, mais aussi rire, rire de nous-mêmes (et plutôt beaucoup) et toujours revenir à Nous, Nous tous acteurs de 1972 et de notre destin commun.
un grand écran vertical à jardin
un compte à rebours
une chaise bistrot déplacée
abandonnée déplacée à nouveau
Francis (tout le monde s’appelle Francis)
Francis monte descend du plateau
remonte rejoint la coulisse
revient dubitatif
du temps de flottement
une mise en place brouillonne
volontairement
la salle reste allumée
dans le silence
hésitations encore
Francis se dédouble
même sweat outremer
même jeans rouille
même moustache
Ils se parlent
en anglais
se négocient la chaise
symbole de notre terre limitée ?
glissent vers le franglais
le chaos linguistique de Babel ?
la langue de bois s’intensifie
avec la bascule vers le français
et puis la conscience
peut-on profiter du fruit de son crime ?
Francis rameute Caïn
et surtout Claudius (Hamlet)
il lance sa tirade du IIe acte (scène 5)
leurs propres souvenirs remontent
et les Francis s’emballent
s’envolent sur l’ivresse des possibles
consuméristes !
Très vite les Francis (Fred Cacheux, Nils Öhlund) impliquent le public, l’embarquent sur le plateau, se jouent des codes de la re/présentation, installent une tension entre la salle vidée et la scène où stabule maintenant le public : ils instaurent un débat mouvant.
Ils l’interpellent depuis la salle
avec d’autres questionnements
aiguisés de quelques sentences
nous ne savons pas maîtriser le présent
nous manque le sens de l’orientation
la croyance passe pour de la connaissance …
Le rapport Meadows s’invite tard.
C’est une douche froide en pleine euphorie consumériste adossée à une frénétique exploitation des ressources.
Les jeunes ingénieurs du MIT ont brassé beaucoup de papier (il n’y avait pas encore d’informatique). Ils étaient prêts à s’engager comme beaucoup de jeunes aujourd’hui.
Mais ailleurs…
chacun veut la plus grosse part du gâteau (ce qu’il en reste) !
D’autres statistiques, d’autres discours le balayent sous le tapis :
le vent des mots, des mots sales le plus souvent
et de modestes sparadraps sur l’hémorragie …
Jusqu’à présent, rien n’indique qu’ils se soient trompés.
Et s’il n’était pas trop tard ?
Les Francis font le rapprochement avec la fresque d’Ambrogio Lorenzetti au Palazzo Pubblico de Sienne : Allégorie et effets du Bon et du Mauvais Gouvernement.
Ils suggèrent l’atavisme du comportement collectivement mortifère (cf. les cinq besoins fondamentaux) …
Les deux Francis nous offrent pendant 90 min, un bouillonnement partagé avec feu et conviction, un pas de deux original qui réussit l’implication du public (si souvent ratée), une stimulante prise en main de l’objet théâtre qu’ils « révolutionnent » (au sens littéral : mettre à l’envers) avec l’envie et l’espoir de pareillement et joyeusement « révolutionner » le système par le bas (du coup le remettre à l’endroit !). Ils expérimentent ce tissage du lien personnel et individuel à l’Autre générant du Nous ensemble sans lequel rien n’est possible.
Et ils le prolongent en dehors de la salle avant, après par des rencontres, des animations…
En 2025, on sait encore plus qu’en 1972…
pourtant plane la résurgence phénoménalement délirante d’un monde où le « tout est monnayable » se réarme en dogme absolu !
Une mise en spectacle médiatique des prolégomènes de l’apocalypse ?
Les deux Francis et Nous, autres Francis, voulons croire que non…
mise en scène & jeu Fred Cacheux, Nils Öhlund
création et régie technique Pierre Mallaisé
production Facteurs Communs
commentaire Fred C du 9 février 2025 à 18:41
Un très grand merci pour ce texte à propos de 1972. Notre objet est de rendre dicible. L’expression dont vous faites le titre d’un article démultiplie le geste. Rendre dicible au carré. Et vous donnez sens et juste mesure à notre proposition. De Francis à Francis, salut !
l’art et la matière
Ressources humaines
Michel Cornu & Robert Schad
#EXPOSITION
Strasbourg, Galerie Radial Art Contemporain du 7 février au 22 mars 2025
Avec comme titre un joli pied de nez au langage technocratique, deux artistes dont l’engagement physique pour créer leurs œuvres est impressionnant, partagent une exposition à la Galerie Radial à Strasbourg du 7 février au 22 mars.
Michel Cornu comme Robert Schad ont préparé des pièces expressément pour l’occasion et art karlsruhe qui se tiendra fin février. Le galeriste qui leur a fait confiance, Frédéric Croizer découvrira leurs créations lors de l’accrochage 🙂
Le travail de Michel Cornu ressemblera certainement à ce qu’il pratique depuis quelques temps déjà : des abstractions vibrantes, souvent des grands formats, sur papier.
Gravures sur cuivre et sur bois, encres sur papier Japon et grands dessins
travaillés dans la profondeur de la matière
posée imposée déposée surexposée…
comme un sous-bois saisi lors d’une fulgurante éclaircie
où seul un intense travail d’approche permet d’en exprimer le mystère
ou d’accéder à d’astronomiques confins ?
J’avais évoqué son travail lors d’une précédente exposition à la galerie Murmure (automne 2023) et j’ai eu la chance de le filmer en énergie durant l’été 2021 dans son atelier et celui de l’ami taille-doucier Rémy Bucciali.
Robert Schad débite et soude l’acier : des modules industriels standards (tubes et poutrelles de différentes sections).
Il avait exposé son travail dans une dizaine de sites patrimoniaux en Bourgogne, le parcours de sculptures Dix par Dix d’octobre 2021 à septembre 2023 : des envolements dont l’aérienne chorégraphie défie la pesanteur du matériau et fait oublier la lourde logistique industrielle nécessaire à leur fabrication.
D’altières horographies semblant effilées par le souffle du vent
dressant fièrement leur arachnéenne fragilité face aux tourmentes !
Je l’ai filmé fin 2022 lors d’une résidence de gravure chez Rémy Bucciali : un exercice plus léger, fruit également de l’agencement ludique de modules identiques. L’atelier s’est ensuite chargé de préparer, mordre puis imprimer les plaques.
quand le paysage sculpte la peinture

Nordlicher
von Edvard Munch bis Hilma af Klint
#EXPOSITION
Riehen (Bâle), Fondation Beyeler du 26 janvier au 25 mai 2025
commissariat : Ulf Küster, assisté d’Helga Christoffersen
beau catalogue en anglais ou en allemand, 240 p., 62,50 CHF, 58 €
tous les jours de 10h à 18h, jusqu’à 20h le mercredi & 21h le vendredi
« Lumières du Nord » est le 6e opus d’une programmation consacrée au paysage initiée avec Monet en 2002. L’exposition en présente 74 peints au-delà du 60e parallèle nord par treize artistes de 1888 à 1937. Huit Scandinaves, quatre Canadiens et un Russe (le contexte géopolitique actuel justifie en partie ce dernier choix).
L’exposition est coréalisée avec le Buffalo AKG Art Museum (Buffalo, New York) qui l’accueillera du 1er août 2025 au 12 janvier 2026.
Le catalogue inclut un cahier de photos : un réel mythifié par le noir et blanc, émouvant écho aux vues des peintres alternant un fantomatique cérusé et l’exaltation fauviste. Anna Boberg y figure en pied avec son équipement pour peindre sur le motif dans ces conditions polaires !
Regroupée par peintres, la présentation dresse une arche chronologiquement cohérente qui va des Scandinaves avec en point d’orgue le plus connu Edvard Munch [salle 6] pour s’achever par les Canadiens. Les premiers (six sur les huit) ont séjourné à Paris, Berlin, Munich… et côtoyé les œuvres et les acteurs de leurs foisonnants courants artistiques. De retour au pays, ils ambitionnent de développer un art singulier, quelquefois préoccupés par l’identité nationale fortement présente à l’époque (séparation des royaumes de Suède et de Norvège en 1905, indépendance de la Finlande en 1917…).
Un âge d’or s’ouvre, il aboutira à la grande exposition « Contemporary Scandinavian Art » à Buffalo (USA) en 1913. Leurs toiles inspireront leurs collègues canadiens qui la visitent et dont l’environnement (principalement l’Ontario) a des caractéristiques voisines conduisant à la création en 1920 du Groupe des Sept (The Group of Seven).
Constituée majoritairement de conifères, la forêt boréale (aussi connu sous le nom de toundra ou taïga) est parcourue par un vaste réseau lacustre.
Le grand fusain d’Ivan Chichkine (Wind Fallen Trees, 1888) dévoile le chaos de cette forêt primaire, la plus grande de la planète, et s’immisce dans sa mystérieuse profondeur.
Ses collègues privilégient des futaies moins denses et leurs arbres cisaillent la toile d’une cinglante présence suscitant la vibration de l’air pur mais glacial. Les troncs souvent à contre-jour comme les barreaux d’une cage – avec parfois l’inquiétante gesticulation des branches évoquant Caspar David Friedrich – aiguisent l’irruption saisissante ou discrètement mordorée de la lumière anoblissant le territoire en épiphanie. Les habitants sont rares sinon à l’état de trace : une échelle, la lumière à une fenêtre, des pas dans la neige…
Akseli Gallen-Kallela s’attarde sur la profondeur du temps : ces couches de neige accumulées (The Lair of the Lynx (Lokulan), 1908). Par le blanc, il suggère la fusion entre l’air et l’eau – neige ou glace –, la verticalité terre ciel avec des arbres qui sortent du cadre en haut comme en bas. Il métamorphose sa cascade en matière symphonique dont le motif, l’explosion liquide, affronte la luxuriante polyphonie des roches ; le cadre Jugendstil et les quatre cordes dorées attendrissent la rudesse du paysage et le froid que projettent les éclaboussures (Mäntykoski Waterfall, 1892-94). Ses vues aériennes sont plus apaisées et souvent ivres de soleil (Lanscape by Ruovesi, 1898).
Comme la Vue depuis Pyynikki Ridge (1900) d’Helmi Biese dont le geste sait transmettre les fougueuses tourmentes à la pâte picturale quand le blizzard se lève : une violence aussi intense qu’obstinée qui accable branches et roches (Coastal Landscape, 1904).
Les influences sont sensibles.
Le pointillisme donne une densité obsédante aux tempêtes de neige d’Anna Boberg qui étouffent l’horizon en contraste avec l’avant-plan liquide traité en larges lignes horizontales (Mountains. Study from North Norway). Quand l’été met à nu le territoire, elle burine en une composition quasi abstraite la gigantesque broyeuse de roches et de glace où l’homme n’a pas sa place (Glacial Lake). Elle s’autorise aussi le spectaculaire des aurores boréales (deux toiles avec une troisième du Canadien Tom Thomson).
Harald Sohlberg accroche la lumière avec un élément toujours mis à distance : maison, horizon au crépuscule, cimes enneigées… Elle apparaît comme une conquête sur la nuit boréale et quelquefois s’immisce rasante jusqu’à l’avant-plan.
Alors qu’Hilma af Klint dont Sunrise (1907) évoque Turner, en saisit la lointaine et ténébreuse incandescence (Serenity of the Evening, 1907).
Chez Gustaf Fjæstad, le pointillisme sculpte la luminosité des amas de neige, il sacrifie les cimes au détriment des étendues gelées : le peintre comme le promeneur regarde où il met les pieds ! Sans négliger la poésie des rides liquides suscitées par la caresse du vent (Winter Evening by a River, 1907).
Prince Eugen (qui appartient à la famille régnante suédoise) montre un pays plus luxuriant, presque hédoniste. Il en capte cependant la dimension transcendantale avec ses arbres qui sortent du cadre, ses vues d’oiseaux plantant l’ampleur du territoire (Orlängen Lake, Balingsta, 1891).
L’humanité industrieuse, condamnée au ralenti en hiver, brutale en été, hante les toiles d’Edvard Munch : ces saignées de bûcherons avec les arbres abattus rendues par de larges aplats rageux aux couleurs sourdes (The Yellow Log, 1912). Ailleurs ses enfants semblent en admiration touristique… (Children in the Forest, 1901-02)
En Colombie-Britannique, Emily Carr privilégie la perception glacée d’un environnement rude, sombre, peu accueillant (In the Forest, 1935). Elle le malmène de frissons, de distorsions ou amplifie la tension abstraite : le jeu ambigu entre le couvert et le découvert installe un espace en occlusion malgré la vivacité du chromatisme et l’énergie du mouvement (Abstract Tree Forms, 1931-32).
Lawren S. Harris est plus enjoué et délivre la quintessence du paysage mis en spectacle, surrection contre nuées, affrontement terre lumière : les images du « chaosmos* » mis en compréhension par l’articulation des volumes (Lac Superior, 1923). Certains rapprochent son travail du Danois Munch, mais il est plus acéré dans le jeu des ombres et du soleil sur les matières (Beaver Pond, 1921). Dans ses petits formats, il infuse une patte et une chaleur fauviste à ces confins arctiques (Montreal River, 1920 ou Mitchell Lake, 1918-21).
Il partage cette flamboyante netteté avec J. E. H. MacDonald – plus nerveux et plus attentif à l’échelonnement des plans (A Lakeshore, Algoma, 1921) – et Tom Thomson dont la flamboyante ivresse est réprimée par les silhouettes spectrales des arbres (Fire-Swept Hills, 1915).
Les tons sont séduisants, certains proches de la marqueterie (Tom Thomson : Tamaracks, 1915) et, en dépit de leur petite taille (21,5 x 26,5 cm en général), leurs toiles déploient une exubérance non dénuée de mysticisme. Elles sont présentées à fleur du bois dans les colonnes en planches cérusées dressées dans la dernière salle [9] : une scénographie épurant cet univers arctique, métaphore fantomatique des vers de Baudelaire (Correspondances).
La Nature est un temple où de vivants piliers
Laissent parfois sortir de confuses paroles ;
[…]
Vaste comme la nuit et comme la clarté,
Les parfums, les couleurs et les sons se répondent.
* selon le mot d’Asger Jorn (1953)
Boreal Dreams
Quelques peintures le montrent (Munch) et déjà en 1930, Emily Carr se plaint du déboisement radical pratiqué par l’industrie forestière. Mais toutes ces œuvres préservent le souvenir de sites iridescents et envoûtants dont la magnificence est perceptible même quand le froid les sédimente. Peut-être est-ce un des destins du musée : préserver les images (les traces, les artefacts ?) d’une nature épargnée par les activités humaines, celle d’avant les catastrophes…
Boreal Dreams de Jakob Kudsk Steensen commandé par la Fondation pour cette exposition s’empare de cette problématique et tente de visualiser l’impact du réchauffement climatique sur les forêts boréales : une vidéo visible depuis les baies sud sur un grand écran LED (avec le son en libre accès wifi par QRC).
La bonne volonté est indiscutable et les images séduisantes (assez répétitives cependant), mais l’ambition n’est compréhensible qu’à la lecture du livret de visite (gratuit). Et pour prendre pleinement la mesure du projet, il est nécessaire de se plonger dans le catalogue ou d’aller sur le site web…
Installée dans le parc (côté entrée du musée), la projection est librement accessible aux heures d’ouverture de la Fondation.
regard sur le regard

Robert Cahen De la trame au drame
de Jean-Paul Fargier
#LIVRE
chez Médiapop Éditions, janvier 2025, (175 p., 17 €)
Critique depuis 1968 aussi bien aux Cahiers du cinéma ou Art Press qu’au Monde ou à Libération, l’auteur Jean-Paul Fargier, particulièrement attentif au cinéma militant et expérimental, a souvent écrit sur le travail de Robert Cahen.
S’il avait déjà réuni ses chroniques et ses réflexions sur d’autres pionniers de la vidéo notamment Nam June Paik (1989), Bill Viola (2014), il ne l’avait pas fait pour le vidéaste mulhousien et il tenait à compléter son travail d’historien. C’est chose faite avec ce « journal de voyage » allant de 1973 (L’invitation au voyage) à 2023 (Arabia Felix).
L’auteur fait le choix de conserver ses textes tels quels – et quelques coups de griffe égratignent ici ou là –, cependant il a revisionné tous les films et rédigé à chaque fois une introduction qui contextualise la chronique (ou l’interview) et quelquefois la nuance. Cette démarche d’une grande sincérité préserve la fraîcheur et la saveur d’une autre époque : une ère bien plus liée au matériel (hardware) avec souvent la description des drôles de machines (les « joujous ») et aussi le plaisir de la découverte ou l’étonnement devant certaines réalisations.
Le récit de ces (presque) origines est émouvant – on parlait de bandes – et fait vivre ce milieu dont les membres finalement peu nombreux se croisent, collaborent, se perdent de vue puis se retrouvent notamment lors de festivals où d’autres perspectives s’inventent quelquefois. Comme Robert, une partie vient de la musique, entre autres Nam June Paik (1932–2006) considéré comme l’inventeur de l’art vidéo (à Wuppertal en 1963 « au sein du mouvement Fluxus »).
Les œuvres (mais toutes n’y figurent pas) servent un fil conducteur chronologique où par petites touches d’hier ou d’aujourd’hui, il révèle un artiste appartenant à une génération qui savait prendre le temps et pour laquelle l’exigence avait un sens. À plusieurs reprises, il le qualifie de Maître ès ralentis (ils ne sont jamais gratuits, il insiste à chaque fois) qui recourt aux effets pour trouver « la forme fine qui sied à son sujet ». Le parfum de nouveauté est d’autant plus éloquent qu’il remet l’histoire dans l’ordre : ces dernières années, les logiciels (software) ont pris la main et assurent facilement et spectaculairement des effets comparables voire plus complexes qu’à cette époque de défricheurs.
Visiblement il a une tendresse particulière pour les pièces où le cinéaste s’assure au son de la complicité de grands anciens (Bach pour Sanaa) ou contemporains : Messiaen (Dernier Adieu), Boulez (Répons & Le Maître du Temps) ou Michel Chion, son ami depuis le GRM*.
En cinquante ans de carrière, Robert Cahen a beaucoup voyagé avec sa caméra, sur les cinq continents, mais aussi dans les genres, souvent en proximité d’autres artistes (danseurs, musiciens…) et il serait dommage de le réduire à ses ralentis. Certes ils permettent de diffracter le temps, de faire palpiter les « Flux et reflux du monde », mais, tentant de « découvrir du sens derrière du caché », il cultive ce goût pour le regard caméra, qui se métamorphose en beau regard public (normalement proscrit par le cinéma officiel), celui des rencontres furtives avec les « Fantômes d’une existence entr’aperçue. Embryons de fiction restée en devenir. » Il imprime dans nos regards ce « figuratif défiguré », ce temps qui dure longtemps – une aspiration à (re)trouver l’éternité ? –, mais aussi s’effiloche en destin furtif, non résolu (encore une transgression des règles de la fiction dominante) comme finalement la vie… avant sa chute imperceptible dans l’absence.
En cours d’ouvrage, Jean-Paul Fargier s’interroge : Où va la vidéo ? Dans tous les sens. Mais lequel est le bon ? Avec ce livre d’amitié, il montre que Robert Cahen ouvre un chemin : exigeant et attentif au souffle du monde !
Si la lecture du livre donne envie de (re)voir les films de l’artiste, Entrevoir, un DVD édité chez RE-VOIR regroupe 14 vidéos de 1973 à 2021.
* Groupe de Recherches Musicales au sein de l’ORTF, puis de l’INA
être improbable

Polywere
de Catherine Monin
#THÉÂTRE
représentation du samedi 18 janvier à l’Espace 110 (Illzach)
L’Espace 110 entame l’année 2025 avec une réflexion sur « Nos empreintes terrestres », proposition ô combien nécessaire (et prémonitoire ?).
En début de cycle, le spectacle Polywere met à jour un premier artefact. Suivront deux week-ends d’ateliers ponctués par Des larmes d’eau douces et 1972 (respectivement les 24 et 31 janvier).
Issu de la nuit à laquelle il retournera, Hugues De La Salle incarne un Emmanuel, grand échalas adolescent, fort convaincant. Il nous raconte d’abord ce souvenir d’enfance, ce traumatisme de chasse qui fait basculer son destin. Si au début, le gamin est plutôt enthousiaste par cette complicité sauvage avec les adultes (mâles !), le sang, la mort, l’objet cadavre amènent la prise en conscience de ces êtres qui sont tués, se mangent entre eux et surtout la nature du plus vorace de tous : l’homme. Ce bouleversement suscite une empathie si fascinée et intense avec les victimes qu’il se glisse dans leur peau – de la thérianthropie comme l’explique la psychiatre (Cécile Arthus) à ses parents (Stéphanie Schwartzbrod & Philippe Lardaud). Ceux-ci complètent le fil narratif de cette métamorphose qui contrarie leur envie de normalité, livrant finalement leur fils à la psychiatrie seule habilitée à circonscrire le périmètre de l’irrationnel.
S’évadant de l’hôpital pour échapper autant à l’enfermement matériel qu’à la camisole chimique destinée à l’intégrer, Emmanuel se réfugie en forêt et rencontre ses « congénères ».
Le dispositif scénique, épuré et envoûtant, accompagne cette quête initiatique : un cylindre piédestal (au début) dont la géométrie se fragmente en éléments praticables, des fumées rasantes évoquant l’humus palpitant des sous-bois, des halos suggérant ces saignées de soleil entre les frondaisons, de sveltes fûts en contrejour zébrant le fond…
Le texte de Catherine Monin sait trouver le rythme haletant (toujours bien tenu par le comédien), la matière vocale de cette créature transmuée, mais aussi glisser quelques formules pertinentes et inventer de belles métaphores poétiques.
Sans naïveté, Polywere institue une parenthèse à notre condition aliénée avec l’hédonisme d’un Waldweben (mais sans le triomphalisme wagnérien) grâce à ses mots, ses images et nous permet d’accéder au bruissement de cette autre nuit… une ouverture plus qu’un destin : J’arrive pas à suivre les flèches alors qu’il n’y a pas de sens…
avec Hugues De La Salle, Stéphanie Schwartzbrod, Philippe Lardaud, Cécile Arthus
texte Catherine Monin
mise en scène Cécile Arthus
scénographie Laurence Villerot
lumières Maëlle Payonne
sons Antoine Reibre
production et contact compagnie Oblique
en quête du paradis perdu

Goliath, Germaine et moi
de Gwladys Morinière (2024)
#CINÉMA
documentaire tourné entre 2005 & 2023, sorti en salle en octobre 2024 (France, 90 min)
=> dates des projections en présence de la réalisatrice
Après une vie de commerçante prospère et le décès de son mari, Germaine entame une retraite engagée et militante. La réalisatrice la rencontre lors d’une « Caravane pour la Palestine » en 2005 et la filme pour la première fois : elle a 76 ans.
Elle la retrouve quelques années plus tard dans les manifestations contre le Grand Contournement Ouest de Strasbourg et décide de nouer leur amitié en lui consacrant un documentaire. Hasard de l’Histoire, les Gilets Jaunes, une pandémie et le confinement s’invitent comme nouveaux terreaux de luttes. De répression et de doutes aussi…
Des images édéniques ouvrent le film : un faon s’invite au pique-nique de la famille. Germaine le biberonne, ses enfants le caressent. La patine du Super 8 renforce l’aspect bucolique de Kœnigshoffen, ce quartier de Strasbourg verdoyant dans les années-cinquante aujourd’hui bétonné.
Entretemps elle s’est retirée plus loin, à Kolbsheim. Là aussi la forêt voisine doit être rasée au profit du GCO : un serpent de mer vieux de plus de trente ans qui se concrétise en pleine crise climatique. Les opposants regroupés en collectif organisent la résistance et multiplient les recours. Germaine participe aux manifestations sur place, à Strasbourg, aux célébrations festives et cultuelles (enterrement symbolique d’un arbre), aux réunions, aux rassemblements devant le tribunal… et à la dénonciation des services de l’État en délicatesse avec le droit et l’exemplarité.
Le 10 septembre 2018, pour ouvrir la voie aux tronçonneuses et aux bulldozers de Vinci, la police intervient. La nonagénaire est gazée sans ménagement tout comme les élus (les députés José Bové & Martine Wonner, le maire de Kolbsheim Dany Karcher). Des photos en stock-shot montrent l’intervention et en atténuent la brutalité…
Avec le mouvement des Gilets Jaunes, puis l’opposition aux contraintes liées à la pandémie, une agrégation des manifestations s’opère à défaut d’une convergence des luttes.
Germaine est omniprésente, s’incarne en passionaria entourée avec respect et enthousiasme. Son verbe est haut, sa cour est pressante et admirative. Elle est une figure fédératrice, un personnage inspirant plutôt qu’un tribun. Cependant face à la maréchaussée surarmée, elle dénonce « les requins de la finance » comme la « destruction de notre belle nature ». En face les expressions sont gênées : l’âge de l’égérie sans doute, peut-être aussi de sentir qu’ils sont le bras armé d’une société fatiguée et fracturée qui tente de préserver ses lambeaux en imposant un « Absurdistan autoritaire » (Die Zeit, 12.11.2020).
Assise dans son séjour, l’œil malicieux, elle montre et lit les slogans griffonnés sur les enveloppes de ses courriers, commente la politique, le népotisme, le « théâtre » du pouvoir, invoque la profondeur dans le temps des luttes : les petits commerces de sa jeunesse sinistrés par une administration tatillonne et favorable aux supermarchés. Elle accueille aussi des réunions et plaisante sur les risques judiciaires !
En écho, des animations – blanc sur fond noir – rythment le film et la voix de la réalisatrice suggère les enjeux, articule le passage du temps et des luttes. Le personnage métaphorique de Goliath lui permet d’installer une entité qui incarne aussi bien Vinci qu’un système protéiforme qui profite des working poor, des mesures sanitaires et parvient à prolonger ce temps de tous les possibles (à son bénéfice) grâce à la puissance publique.
Le glissement de la septuagénaire rayonnante de vitalité dansant avec les Gazaouies en 2005 vers la vieille dame recroquevillée dans un fauteuil roulant poussé par son amie Malika illustre la marche du destin et esquisse une métaphore.
Le corps comme le militantisme atteignent leurs limites…
Vers la fin, la réalisatrice se filme jardinant dans sa ferme vosgienne acquise depuis peu : sans doute qu’elle aussi pourra recueillir un faon égaré, mais Le cri de détresse d’un seul gouverné ne vient pas à bout du tambour (Ahmadou Kourouma / En attendant le vote des bêtes sauvages, 1998).
images, son Gwladys Morinière, Laurent Marboeuf, Hervé Roesch
montage Gwladys Morinière, Agata Bielecka, Andrea Pica
production & diffusion (avec les dates de projection) L’Humaine prod
contact lhumaineprod@yahoo.com