Illustration : L’homme le plus perspicace, père de l’artiste, 1996 (détail)
huile sur toile, 200 x 235 cm (collection particulière)
Yan Pei-Ming – Au nom du père
Colmar, Musée Unterlinden du 19 mai au 11 octobre 2021
catalogue bilingue franco-anglais sous la direction de Frédérique Goerig-Hergott, conservatrice en chef (192 p.)
L’artiste était présent avec Frédérique Goerig-Hergott, commissaire de l’exposition, pendant l’inauguration (en réel pour la presse) le 1er avril ; le musée a accueilli le public à partir du 19 mai…
Après Corpus Baselitz en 2018, c’est la deuxième grande monographie d’un artiste contemporain que les Unterlinden accueillent dans la nouvelle nef de l’Ackerhof à l’initiative de la commissaire Frédérique Goerig-Hergott, conservatrice en chef au Musée. Lors de l’inauguration, l’artiste a rencontré la presse, mais regrettait que, jusqu’à nouvel ordre, le public reste confiné à l’extérieur ou derrière ses écrans. Pouvoir approcher intimement ses toiles, puis reprendre du recul est indispensable pour appréhender son travail (et les si vastes espaces du musée s’y prêtent aisément).
Mensonge… « La peinture a toujours été un mensonge parfait » comme l’affirmait Yan Pei-Ming en 1994.
À déambuler sous le regard de ces têtes monumentales, d’être si intensément toisé, n’est-ce pas plutôt le mensonge, celui qui s’installe entre nous et qui fabrique notre monde contemporain, qu’interrogent ces yeux immenses interpellant notre conscience d’humain ? Un mensonge qui s’incarne avec le temps, en silence. Celui des images souvent, celles de propagande qu’il peignait dans l’atelier de son lycée. Des Mao – qu’il réinterprète et qui l’ont lancé en 1987 (série close en 2007) – aux autoportraits – miroirs déformants quelquefois morbides –, en passant par Bouddha, des anonymes ou ses parents, ses œuvres imposent un silence pénétrant. Qui se résigne au mensonge, le prolonge ?

huile sur toile 150 x 300 cm (collection particulière)
Le plus souvent, les denses regards caméra ne nous lâchent pas et le Louvre a eu ce flair de l’inviter en 2008 à travailler autour de la Joconde au regard si célèbre (Les Funérailles de Mona Lisa*). Quand ces figures ne nous regardent pas, une minuscule réserve explose de lumière sur la débauche cinabre (ou la grisaille) de la toile (L’homme le plus perspicace/père de l’artiste, 1996 – affiche de l’évènement).
De cet échange entre le regard du sujet amplifié par la présence massive en taille comme en puissance expressive de son visage et celui du visiteur naît un monde partagé, mais filtré par ce voile immatériel que suggèrent les discrètes larmes de peinture (noires sur fond blanc, blanches sur fond noir, notamment : Pour l’amour du père de l’artiste, 2007). Comme si le monde pleurait un jour d’orage, qu’une bourrasque jetait en pluie ces gouttes de peinture contre une vitre invisible, des larmes dressées entre ses modèles et l’observateur : que fais-tu contre toute cette tristesse, cette mort qui nous hante ?

Ces éclaboussures – « La peinture, ce n’est pas une caresse » – s’opposent à l’apparent stoïcisme des personnages, distillent la spiritualité d’un Tarkovski. Et les paysages, les lointains de Yan Pei-Ming rappellent autant ceux du cinéaste russe que L’île des morts de Böcklin avec ces avant-plans liquides (les gratte-ciel de Pudong remplaçant les cyprès). Cette volonté de cultiver le mystérieux, de suggérer au lieu de montrer, légitime son choix de la monochromie car « l’œil habite la sobriété ».
Quand il tente l’aquarelle ces taches s’arrondissent, jouent l’osmose du jus et du papier avec un impact encore plus troublant peut-être : ce magnifique grand format où il affronte son père décédé quatre ans auparavant (L’artiste avec son père, 2007). Le peintre interroge ce destin qui se dresse entre eux, deux êtres si proches, si lointains…

aquarelle sur papier 154 x 248 cm (collection particulière)
Les portraits pourraient être qualifiés de photo-réalistes, mais, à y regarder de près, c’est un fouillis intense et proliférant de matières et la technique du peintre – l’utilisation presque exclusive de brosses de 20 cm – cultive un geste vaste qui brasse la pâte picturale. En gros plan, tout semble brouillé, abstrait. Le visage, l’expression serait aussi mensonge ?
Si ses premiers travaux (déjà des portraits) restent classiques, la manière ample de s’emparer du support (le fusain plutôt que la mine), ces traces assumées comme traces avec le figuratif qui s’en induit est déjà présent.
Le travail de Yan Pei-Ming rappelle celui du modeleur qui pétrit la glaise, ajoute, enlève… Le catalogue documente ces modifications, ces bouleversements, ces repentirs pour Pandémie qu’il photographiait tous les jours. Une quête pour faire jaillir le tableau : « Le début d’un tableau, c’est surtout le temps du remplissage et de la réflexion. Puis arrive la couche finale, pour moi le moment le plus important. Il faut que le geste soit fluide, que la peinture jaillisse seule comme une évidence » (2020).
Si certains suggèrent que son goût des grands formats dérive de la peinture de propagande de ses tout débuts, il proclame surtout cette « évidence ». « La peinture doit être pensée en grand. Nous avons besoin d’être capables d’entrer physiquement en elle » (2009).

huile sur toile (triptyque) 400 x 280 cm (chacune, collection particulière)
C’est le choc du triptyque Nom d’un chien ! Un jour parfait (2012) qui est à l’origine de l’invitation lancée par la commissaire. Une révélation compréhensible : c’est le corps de l’artiste en pied presque nu, surgissant, toujours silencieux, le regard baissé sur un des panneaux, les yeux fermés sur les deux autres. En voilant le regard, le corps en surrection s’impose du geste entre invocation christique et mudra. Le corps devient nécessaire pour agir, désormais le peintre sera présent et actif : à l’enterrement de sa mère (Un enterrement à Shanghai *, 2018), appuyé sur sa pelle dans Pandémie peint exprès pour cette exposition. L’artiste, à droite, est l’axe qui focalise la toile, l’irradie d’une lumière qui circule en triangulation avec la lune et, à l’opposé au fond, le rayonnement de la coupole de Saint-Pierre à Rome (englobant ainsi l’espace européen), tandis que les soignants s’activent entourés de sacs funéraires dans l’ombre intermédiaire. « Quand on peint la lumière on peint aussi l’âme. Et même dans le noir il y a de la lumière. » (2016)
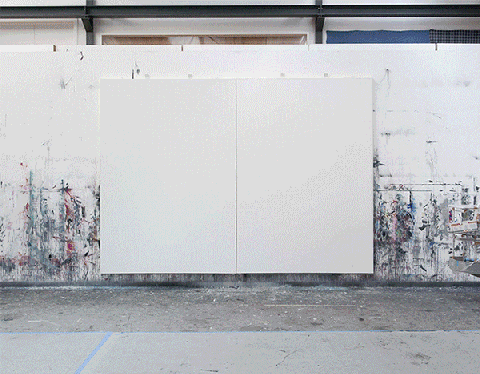
huile sur toile (diptyque), 400 x 560 cm
Au-delà de la paternité qu’invoque le titre de l’exposition, n’est-ce pas notre propension individuelle, mais aussi collective à produire « une façade un peu plus bruyante, un peu plus construite et plus moderne ** » au détriment du sens et de notre potentiel de compassion qu’interroge l’artiste ?
Et avec quelle phénoménale puissance !

* pièces ne figurant pas dans l’exposition
** à propos de Shanghai

Parution papier :
Hebdoscope, n° 1072, mai-juin 2021
